
ALAIN RENE LE SAGE
- LA BIOGRAPHIE D’ALAIN RENE LE SAGE
LA BIOGRAPHIE D’ALAIN RENE LE SAGE
«Les faits sont têtus» faussement attribué à Lénine
"Alain René Le Sage (1668-1747) s'est inspiré de la culture espagnole
pour ridiculiser les travers de la noblesse et de la haute bourgeoisie" Cliquez sur le bouton pour accéder aux livres en ligne gratuits de Le Sage
1677: Mort de sa mère.
1682: Mort de son père, il est alors sous la tutelle d'un oncle qui laissa dépérir la fortune de son pupille.
1682 à 1686: Placé au collège des jésuites de Vannes, il y est considéré comme un bon élève. 1686 à 1690: A la fin de ses études il est employé dans des
petits boulots et devient gestionnaire d'un domaine de Bretagne. Il perd son poste par injustice et la haine qu'il en conçut contre les financiers,
laissa dans son cœur de profondes racines. 1690: Le Sage vient à Paris dans le triple but d'y faire sa philosophie, son droit et d'y postuler à un nouvel emploi. 1692: Il obtient sa licence de droit et s'inscrit au barreau de Paris. Avec une figure agréable, une taille avantageuse,
beaucoup d'esprit naturel et un goût exquis pour la belle littérature, il est bientôt recherché dans les salons. Il a une
aventure amoureuse avec une femme de qualité demeurée inconnue mais qui lui aurait offert sa main et sa fortune. En revanche, Le Sage devient amoureux de la
jolie Marie-Elisabeth Huyard, fille d'un bourgeois de Paris qui demeure sur la paroisse de Saint-Barthélemy en la Cité. 1694: Le 17 août, il obtint de l'archevêque de Paris une dispense de publication de bans. Le 28 septembre, son mariage est célébré dans l'église de Saint-Sulpice à Paris.
Il aura de Marie-Elisabeth Huyard trois fils et une fille. Le Sage quitte Paris pour entrer au service d’un fermier général à Vitré. 1695:
Publication des «Lettres galantes d'Aristenète» qu'il fait imprimer à Chartres où il était alors professeur de rhétorique. Cet ouvrage
fait d'après une version latine parait en 1 volume in-12, sous l'indication de Rotterdam. Ce livre est froidement accueilli. 1696: De retour dans la capitale, Le Sage se fait recevoir avocat au parlement de Paris. Naissance de son premier fils. 1698: Naissance de son second fils le futur chanoine de Boulogne sur mer. Il n'est plus avocat et
se contente du titre de bourgeois de Paris. 1699: Quoiqu'il ait beaucoup d'amis, comme il n'est ni
intriguant et ni pressant dans ses sollicitations, il vit quelque temps dans un état en dessous du seuil de pauvreté avant d'obtenir un emploi peu lucratif auquel il
renonce bientôt pour se consacrer entièrement à la littérature. Le maréchal de Villars voulut inutilement se l'attacher. Le Sage résista et préféra toujours son
indépendance. Mais il garda la constante amitié d'un homme puissant : L'abbé de Lyonne qui le combla de présents et lui assura une rentre de six cents livres.
Passionné pour la langue espagnole, il l'apprit à son ami, et lui fit goûter la littérature castillane. 1700: Publications de deux comédies en cinq actes, "traduites"
en réalité imitées, de la littérature espagnole : «Le Traître puni» de don Francesco de Roxas, «Don Félix de Mendoce» de Lopez de Vega. 1702: Une comédie en cinq actes, "traduite" en réalité imitées
de la littérature espagnole, «Le Point d'honneur» de don Francesco de Roxas obtient le succès au Théâtre-Français dès le 3 février. De 1704 à 1706: Publication de la traduction de Le Sage des «Nouvelles
aventures de don Quichotte» d'Avellaneda, en 2 vol. in-12. C'est un échec. Seules les "aventures de Don quichotte" de Cervantès sont appréciées du public. 1707: Sa comédie de «Don César Ursin» imitée
de Calderon est applaudie à la Cour et au Théâtre-Français. Une autre pièce «Crispin rival de son maître» qui n'avait paru aux courtisans qu'une misérable
farce, est jouée à Paris avec le plus brillant succès. Cette comédie conte une fourberie de valets. La vérité du dialogue, la qualité des plaisanteries toujours
amenées par le sujet, l'heureux enchaînement et la rapidité des scènes, provoquent le rire et entraînent le spectateur. Publication du «Diable boiteux» dont Le Sage a pris le nom et l'idée dans «El Diablo cojuelo»
de Louis Velez de Guevara. Un diable ouvre les toitures comme des couvercles de boites pour espionner les familles durant la nuit. Cet ouvrage est la satire de toutes les
couches sociales. Le merveilleux qui en fait le fond ne donne lieu qu'à des récits épisodiques mais la diversité des aventures, une critique vive et ingénieuse, la vérité des
portraits, un style nerveux, des anecdotes piquantes relatives à quelques contemporains notamment celles qui ont trait à Ninon, à Baron, au mariage de Dufresny, ont fait le
succès de ce roman. Il eut une vogue prodigieuse et occasionna même un duel entre deux jeunes seigneurs qui se disputaient le dernier exemplaire de la seconde édition. 1708: Il devint tellement sourd qu'il fait usage d'un cornet acoustique. Il présente aux comédiens une pièce en un acte,
intitulée «Les Etrennes» pour être jouée le 1er janvier 1708. Sur leur refus, il la refit en cinq actes, sous le titre de «Turcaret». Il eut moins de peine à la faire
recevoir qu'à la faire représenter. Cette comédie parait à une époque où les malheurs et les besoins de la France avaient multiplié les usuriers. Voulant signaler sa
haine contre ces vampires, Le Sage avait lu sa pièce dans plusieurs sociétés. Le bruit des applaudissements qu'elle y avait obtenus alarma les financiers.
Ils cabalèrent parmi les actrices pour empêcher la représentation de la satire la plus amère et la plus gaie qui ait été dirigée contre eux. La duchesse de Bouillon qui
tenait chez elle un salon, promit sa protection à l'auteur et lui fit demander une lecture de sa pièce. Au jour convenu, Le Sage, retenu au palais par le jugement d'un procès
important qu'il eut le malheur de perdre, ne put être exact au rendez-vous. En entrant chez la princesse, il raconte sa disgrâce et se confond en excuses.
Il est reçu avec hauteur, la duchesse lui reproche aigrement d'avoir fait perdre deux heures à la compagnie.
«Madame, dit Le Sage avec dignité, je vous ai fait perdre deux heures, il est juste de vous les faire regagner: je n'aurai point l'honneur de vous lire ma pièce».
La duchesse s'efforça de le retenir. Elle courut après lui mais il ne voulut ni rentrer ni remettre les pieds dans son hôtel. Les financiers lui offrirent cent mille francs
pour l'engager à retirer du théâtre une comédie qui devait mettre au grand jour les secrets et les turpitudes de leur métier. Malgré sa pauvreté, il rejeta leurs offres
et sacrifia sa fortune au plaisir de la vengeance nourrie depuis sa jeunesse bretonne. Furieux de son refus, ils redoublèrent leurs intrigues et il ne fallut rien moins
qu'un ordre de Monseigneur daté du 13 octobre 1708 et consigné sur le registre de la Comédie française, pour forcer les comédiens à jouer «Turcaret». 1709: Cette pièce est représentée le 14 janvier et malgré
les efforts de la cabale, malgré les murmures des gens qui avaient cru s'y reconnaître, malgré le froid excessif qui obligea de fermer les spectacles, elle obtient le succès.
L'auteur y avait joint une sorte de critique en forme de prologue et d'épilogue dialogués entre dom Cléophas et Asmodée, les deux principaux personnages du «Diable boiteux».
Mais ils furent supprimés dès la première reprise. Malgré les apparences, cette pièce n'a pas de caractère libertin. Écrivain très moral, Le Sage a su décrire le caractère
séduisant du vice tout en le rendant ridicule. Tous les personnages de «Turcaret», excepté le marquis, sont plus ou moins fripons mais aussi plus ou moins méprisables. Si
l'action est faible, les peintures vraies, un dialogue vif et naturel, une gaieté piquante et satirique, la finesse des détails, la verve comique étincellent.
Tous les incidents et tous les accessoires sont heureux. Chaque mot de Turcaret est un trait de caractère. Chaque mot du marquis est une saillie.
Même si le thème du laquais devenu financier en une génération est un mythe littéraire, la pièce fait clairement écho aux mœurs du temps. Toutefois, les
milieux financiers réussissent après la septième représentation, alors même que les recettes sont tout à fait correctes, de la faire disparaître de l’affiche.
La pièce fit à sa septième représentation une recette de 653 livres 4 sols. Or pour tomber dans les règles et disparaître de la scène, une pièce devait baisser
à 500 livres en hiver et 300 livres en été. Par conséquent, Lesage se brouille avec les comédiens français. Les railleries qu'il s'est permises contre eux dans
tous ses écrits démontrent sa rancune. Il disait à cette occasion : «Je cherche à satisfaire le public; qu'il permettre aussi que je me satisfasse». 1710:
François Pétis de la Croix interprète des langues orientales, se méfiant de son talent pour écrire
en français, emprunte la plume de Le Sage pour corriger le style de sa traduction des «Mille et un jours». Le Sage profite des richesses qui lui furent
confiées et trouve bientôt l'occasion de mettre sur la scène plusieurs contes persans. 1712: Il écrit pour les spectacles des foires de
Saint-Germain et de Saint-Laurent "Arlequin roi de Serendib", "Arlequin baron allemand"suivi d'une quinzaine d'autres pièces sur Arlequin. 1713: La «Petite Bibliothèque des théâtres» lui attribue à partir de cette année 1713, cent un opéras comiques, prologues et
divertissements dont vingt quatre composés par lui seul et les autres en collaboration avec Fuzelier, d'Orneval, Autreau, Lafont, Piron et Fromaget.
La plupart eurent une vogue étonnante et quelques-uns obtinrent l'honneur d'être joués au Palais-Royal devant le régent. 1714: Représentation de "La Foire de Guibray". 1715: Parution de
«Gil Blas de Santillane» en 2 vol. in-12. Sa notoriété est alors assurée et définitive
pourtant Bruxen de la Martinière et Voltaire ont avancé que «Gil Blas»
était entièrement tiré de l'espagnol.
de 1717 à 1721: Publication de
«Roland l'amoureux» par livraisons pour former 2 volumes in- 12. Ce n'est pas une "traduction" mais une imitation de l'Arioste. 1718: Représentation de "Le Monde renversé" 1721: Publication avec
d'Orneval des trois premiers volumes de la collection intitulée : «Théâtre de la foire», le quatrième et le cinquième parurent en 1724, le sixième en 1731 et
les trois derniers en 1737 pour former 9 volumes in-12. Un autre volume imprimé en 1734 et qui forme le dixième de cette édition, a été publié par Carolet et
ne contient que des pièces de sa composition. 1724: Parution
d'une nouvelle édition augmentée d'un troisième volume de "Gil blas de Santillane" 1725:
«L'Arbitre des différends » une reprise réduite en trois actes du "Point d'Honneur" obtient deux représentations au Théâtre-Italien. 1726: Représentation de "Les Pèlerins de la Mecque". Publication de les
«Aventures de Guzman d'Alfarache», 2 vol. in-12, imitation fort abrégée et très amusante de l'ouvrage de Matthieu
Aleman. Il corrige, réécrit et fait imprimer les mémoires fournies par une veuve, «les Aventures de Ribert, dit le chevalier de Beauchesne»,
2 vol. in-12. Ce n'est point une fiction, mais l'histoire singulière d'un capitaine de flibustiers qui fut tué à Tours par des Anglais en 1731. 1734: Publication de
«l'Histoire d'Estevanille Gonzales, surnommé le Garçon de bonne humeur», 2 vol. in- 12. C'est encore,
de l'aveu de Le Sage, une imitation de l'espagnol, d'après la « Vie de l'écuyer Obregon» par Vincent Espinel mais il n'en a pris que quelques traits tels
que l'aventure du nécromancien démasqué. Ce roman, modelé sur «Gil Blas» en rappelle parfois la gaieté,
l'esprit et les situations. Cependant il est moins varié, moins fortement dessiné et les deux dernières parties sont fort inférieures aux précédentes. Quand il fallut songer à établir ses enfants, l'aîné qu'il destinait au barreau et qui avait même plaidé quelques causes avec succès,
se fit comédien, et se rendit célèbre sous le nom de «Montménil». Le troisième choisit la même profession. C'était celle pour laquelle Le Sage avait le plus d'aversion
depuis sa mésaventure des représentations de "Turcaret". Il garda toutefois la tendresse constante de sa fille et du second de ses fils qui, ayant embrassé l'état
ecclésiastique, avait obtenu un canonicat à Boulogne-sur-Mer. Le Sage avait cessé de voir Montménil mais lorsqu'il eut acquis de la réputation dans ses rôles de valet et de paysan,
il le reçut en grâce, soit que leur réconciliation se fût opérée à Boulogne par l'effet d'une ingénieuse médiation du chanoine Le Sage, soit que des amis communs
ayant entraîné le vieillard au Théâtre-Français, il y vit son fils dans «Turcaret», l'applaudit en pleurant de joie, l'embrassa et lui rendit toute son affection.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que Montménil devint le plus intime ami de son père. Lorsque cet acteur était au théâtre, Le Sage passait la soirée dans un café de la
rue Saint-Jacques, voisin de sa demeure et l'attendait pour souper. Quand Montménil rejoignait son père, les convives faisaient cercle autour d'eux, montaient sur
les chaises, sur les tables pour écouter et pour applaudir la justesse, la clarté, la variété de l'élocution du comédien. 1735: Publication d'une
nouvelle édition augmentée d'un quatrième volume de "Gil blas de Santillane". Publication d'«Une journée des Parques», in-12, dialogue
plein de philosophie, de pensées fortes et hardies, rendues avec une vigueur étonnante. Il fait aussi représenter au Théâtre-Italien, le 21 novembre, et devant la cour le 26 du même mois, «Les Amants jaloux»,
comédie en trois actes et en prose imprimée en 1736 in-12. Cette pièce eut peu de succès. Il ne la fera pas figurer dans son théâtre en huit volumes publié en 1737. 1737: Quatrième édition
du "Diable Boiteux" à laquelle il ajouta «l'Entretien des cheminées de Madrid» et «les Béquilles du Diable Boiteux», opuscules dont l'un est une suite du roman
et l'autre l'éloge rédigé par l'abbé Borderon. Publication d'une nouvelle édition de son "Théâtre de Foire" en 8 volumes in-12, dans laquelle il n'a pas compris
les pièces de Carolet. 1738: Publication de
«Le Bachelier de Salamanque», 2 vol. in-12. Il fait jouer ses quatre derniers opéras-comiques. 1739: Publications
de «Don César Ursin» et sous le titre de "Point d'honneur" de "L'Arbitre des différends" complété avec un prologue. Publication du «Théâtre français», 2 vol. in-12 qui sera réimprimé en 1774. Des sept comédies, deux seulement, «Turcaret»
et «Crispin rival de son maître» ont été insérées dans la «Petite bibliothèque des théâtres» et dans le «Répertoire du Théâtre-Français». 1740: Publication anonyme
de «La Valise trouée», 1 volume in-12, où, dans un cadre assez simple, il a renfermé une trentaine de lettres qu'il suppose écrites par divers personnages sur différents
sujets satiriques. 1743: Publication de
«Mélange amusant de saillies d'esprit et de traits historiques des plus frappants», 1 vol. in-12. La plupart de ses anecdotes n'ont plus rien d'amusant aujourd'hui. Façade de la maison dans laquelle Le Sage est mort. Elle est située rue du Château à l'intérieur
des remparts de Boulogne sur mer. La mort de Montménil fut pour Lesage un coup de foudre. Malade, il se retire à Boulogne sur mer avec sa femme et sa fille,
auprès de son fils le chanoine. Il y passa ses dernières années dans un état d'affaissement assez triste. le 17 novembre 1747: Il meurt à Boulogne sur mer. Le comte de Tressan qui commandait alors dans le Boulonnais,
se fit un devoir d'assister avec tout son état-major aux obsèques de Le Sage. Par l'éclat de cette pompe funèbre, il rendit un hommage
public à la mémoire de son génie. le 7 avril 1752: Sa veuve meurt. 1794:
Nouvelle publication de
"Gil Blas" chez Didot jeune, Paris, 4 vol. in-8°, fig 1801: Nouvelle publication de
"Gil Blas" 8 vol. in-18 chez Didot jeune. 1819: Nouvelle publication
à Paris de "Gil Blas" 3 vol. in-8°, chez Didot l'aîné faisant partie de sa Collection des auteurs classiques
français. Cette édition, conforme à celle de 1747, qui avait été corrigée par l'auteur, est précédée du Mémoire de François de Neufchâteau intitulé : «Examen
de la question de savoir si Le Sage est auteur de Gil Blas ou s'il l'a pris de l'espagnol.» Il a de plus, noté en
marge et au bas des pages d'un exemplaire de "Gil Blas" aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale,
plusieurs allusions qu'il avait recueillies dans ses entretiens avec le conte de Tressan. Celui ci les tenait de la bouche même de Le Sage. Ces notes peuvent servir
de commentaire et de clef pour expliquer diverses anecdotes du roman et pour faire connaître les personnages sous leurs véritables noms. Ses notes sont reproduites
dans une nouvelle édition du même éditeur in-18, 1844, Paris. 1821-1822: Les œuvres complètes de Le Sage
sont publiées à Paris par A.-A Renouard en 12 vol. in-8°. Avec son ton radouci, sa face minaudière, je le crois un grand comédien La justice est une chose si précieuse qu’on ne saurait trop l’acheter Il a de l'argent, il est prodigue et crédule, c'est un homme fait pour les coquettes. Une fille prévenue est à moitié séduite. Il ne faut pas mettre dans une cave un ivrogne qui a renoncé au vin. Je sens naître malgré moi des scrupules. - Il faut les étouffer Quand on connaît le défaut d'un homme à qui l'on veut plaire il faut être maladroit pour n'y pas réussir. La crainte me prêta des ailes pour fuir. il aime le jeu, le vin, les femmes ; c'est un homme universel Ah ! qu'il est doux de voir sauver son honneur par l'objet même de son amour! On nous réconcilia. Nous nous embrassâmes et depuis ce temps-là nous sommes ennemis mortels. Tous les hommes aiment à s'approprier le bien d'autrui. C'est un sentiment général. La manière seule de le faire en est différente. La ville natale de SARZEAU:
http://www.infobretagne.com/sarzeau.htm L'office de tourisme de SARZEAU: http://www.tourisme-sarzeau.com/ Le lycée Lesage de Vannes porte son nom pour lui rendre hommage:
http://www.lycee-lesage.net/ Site créé et édité par Frederic Fabre
frederic@fredlit.com
Frédéric Fabre
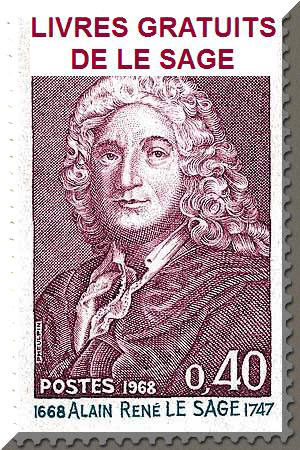 Le 8 mai 1668, Alain René Le Sage naît
à Sarzeau, petite ville de la presqu'île de Rhuys, à quelques kilomètres de Vannes. Il est le fils unique du mariage de Claude Le Sage et de la demoiselle Jeanne Brenugate.
Son père, avocat, notaire et greffier de la cour royale de Rhuys, était réputé riche dans une région pauvre.
Le 8 mai 1668, Alain René Le Sage naît
à Sarzeau, petite ville de la presqu'île de Rhuys, à quelques kilomètres de Vannes. Il est le fils unique du mariage de Claude Le Sage et de la demoiselle Jeanne Brenugate.
Son père, avocat, notaire et greffier de la cour royale de Rhuys, était réputé riche dans une région pauvre.

 Voltaire
assure que ce n'est qu'une traduction de la «Vie de l'écuyer Obregon» par Vincent Espinel. Le Sage s'est tellement identifié avec ses
personnages, il a si bien pris la couleur locale que l'Espagne s'y est reconnue et que diverses opinions lui ont disputé la paternité de ce chef-d'œuvre. La diversité de
ces opinions qui se contredisent tous, qui ne s'accordent en rien et qui par conséquent, se détruisent les uns par les autres, en démontre le faible échafaudage et la
fausseté. François de Neufchâteau a lu à l'Académie française deux dissertations ayant pour but de défendre la nationalité française de
«Gil Blas»
et la paternité de Le Sage. La première, lue le 7 juillet 1818 et mise en tête de deux éditions de ce roman de 1819 et 1820 est intitulée «Examen
de la question de savoir si Le Sage est l'auteur de Gil Blas
ou s'il l'a pris de l'espagnol». L'auteur y réfute d'abord les assertions injustes et erronées de Voltaire et de Brusen de La Martinière qui ont
avancé que Le Sage avait pris en entier son chef-d'oeuvre dans la «Relation de la vie de l'écuyer don Marc de Obregon», roman espagnol de Vincent Espinel publié à Madrid
en 1618, in-4° et dont la 4° édition a paru aussi à Madrid en 1801, 2 vol. in-12, sans table de chapitres. Le Sage a emprunté quelques traits de ce roman pour son
«Gil Blas» , son «Estevanille» et son «Bachelier de Salamanque», mais il n'a en rien
plagié. L'assertion de Voltaire se trouve d'ailleurs anéantie par une autre démonstration réalisée par François de Neufchâteau dans la même dissertation. Le
Père Isla, jésuite espagnol, mort à Bologne entre 1781 et 1783, a laissé une traduction espagnole du
«Gil Blas» de Le Sage et d'une continuation donnée à ce roman par le chanoine
Monti, à la suite d'une traduction italienne. Cette traduction du Père Isla ne parut qu'en 1787, soit plusieurs années après la mort de Le Sage et par conséquent
sans sa participation. Ce n'est donc pas lui, mais un éditeur qui, pour donner plus de vogue et de débit à la version espagnole, l'annonça sur le titre et dans la préface,
comme un ouvrage «volé à l'Espagne par Le Sage et restitué à sa patrie et à sa langue naturelle par un espagnol zélé». Dans ses «Observations critiques sur le roman de
«Gil Blas» , l'éditeur cherche à prouver que
«Gil Blas» n'est pas un ouvrage original, mais un démembrement des aventures du
«Bachelier de Salamanque», manuscrit espagnol alors inédit que Le Sage dépouilla de ses parties les plus précieuses pour son
«Gil Blas»
Voltaire
assure que ce n'est qu'une traduction de la «Vie de l'écuyer Obregon» par Vincent Espinel. Le Sage s'est tellement identifié avec ses
personnages, il a si bien pris la couleur locale que l'Espagne s'y est reconnue et que diverses opinions lui ont disputé la paternité de ce chef-d'œuvre. La diversité de
ces opinions qui se contredisent tous, qui ne s'accordent en rien et qui par conséquent, se détruisent les uns par les autres, en démontre le faible échafaudage et la
fausseté. François de Neufchâteau a lu à l'Académie française deux dissertations ayant pour but de défendre la nationalité française de
«Gil Blas»
et la paternité de Le Sage. La première, lue le 7 juillet 1818 et mise en tête de deux éditions de ce roman de 1819 et 1820 est intitulée «Examen
de la question de savoir si Le Sage est l'auteur de Gil Blas
ou s'il l'a pris de l'espagnol». L'auteur y réfute d'abord les assertions injustes et erronées de Voltaire et de Brusen de La Martinière qui ont
avancé que Le Sage avait pris en entier son chef-d'oeuvre dans la «Relation de la vie de l'écuyer don Marc de Obregon», roman espagnol de Vincent Espinel publié à Madrid
en 1618, in-4° et dont la 4° édition a paru aussi à Madrid en 1801, 2 vol. in-12, sans table de chapitres. Le Sage a emprunté quelques traits de ce roman pour son
«Gil Blas» , son «Estevanille» et son «Bachelier de Salamanque», mais il n'a en rien
plagié. L'assertion de Voltaire se trouve d'ailleurs anéantie par une autre démonstration réalisée par François de Neufchâteau dans la même dissertation. Le
Père Isla, jésuite espagnol, mort à Bologne entre 1781 et 1783, a laissé une traduction espagnole du
«Gil Blas» de Le Sage et d'une continuation donnée à ce roman par le chanoine
Monti, à la suite d'une traduction italienne. Cette traduction du Père Isla ne parut qu'en 1787, soit plusieurs années après la mort de Le Sage et par conséquent
sans sa participation. Ce n'est donc pas lui, mais un éditeur qui, pour donner plus de vogue et de débit à la version espagnole, l'annonça sur le titre et dans la préface,
comme un ouvrage «volé à l'Espagne par Le Sage et restitué à sa patrie et à sa langue naturelle par un espagnol zélé». Dans ses «Observations critiques sur le roman de
«Gil Blas» , l'éditeur cherche à prouver que
«Gil Blas» n'est pas un ouvrage original, mais un démembrement des aventures du
«Bachelier de Salamanque», manuscrit espagnol alors inédit que Le Sage dépouilla de ses parties les plus précieuses pour son
«Gil Blas»1732: "La tontine"
reçue en 1708 est enfin jouée.
 1736:
Troisième édition augmentée d'un volume du "Diable Boiteux" pour
lequel il dit avoir emprunté des vers et quelques images à Francesco Santos, auteur de «Dia y noche de Madrid».
1736:
Troisième édition augmentée d'un volume du "Diable Boiteux" pour
lequel il dit avoir emprunté des vers et quelques images à Francesco Santos, auteur de «Dia y noche de Madrid».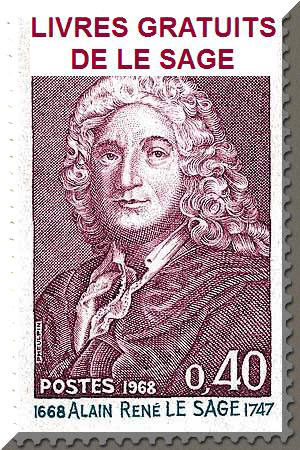 Ils
brûlaient la chandelle par les deux bouts
Ils
brûlaient la chandelle par les deux bouts



