
VOLTAIRE
- ZADIG
- CANDIDE
- MEMNON
- LE FANATISME, OU MAHOMET LE PROPHETE
- FEMME, SOYER SOUMISES A VOS MARIS
"Le génie de François Marie Arouet dit Voltaire
(1694-1778) est la fierté de l'esprit français" Le 21 novembre 1694: François Marie Arouet
naît à Paris. Il est le troisième enfant d'une famille et le troisième
fils d’un notaire au Châtelet, puis payeur des épices de la Chambre des Comptes.
Frédéric Fabre
1704-1711: Il suit de brillantes études de rhétorique et de philosophie chez les jésuites du collège Louis Le Grand. Cette éducation l'initie aux plaisirs de la conversation et du théâtre. Il aurait subi la pédophilie de certains de ses maîtres.
1712: Son parrain, l’abbé de
Châteauneuf le présente à Ninon de Lenclos, alors âgée de plus de quatre-vingt
ans.
La vieille courtisane, charmée par le jeune homme, l'aurait couché dans son lit
puis sur son testament.
1713: Le jeune François Marie Arouet néglige ses études de droit. Il part comme secrétaire d'ambassade à la Haye. Il tombe amoureux d'une jolie huguenote. L'ambassadeur est alors contraint de le renvoyer à Paris.
1714: Son parrain, l’abbé de Châteauneuf, l'introduit dans les milieux mondains et libertins parisiens. Il vole de château en château et anime les dîners galants de ses vers hardis.
1716: Ses écrits satiriques sur les relations incestueuses du Régent font scandale.
1717: De mai 1717 à Avril 1718, il est emprisonné à la Bastille durant onze mois pour le punir de ses écrits satiriques sur les moeurs dissolues du régent. Il y écrit une tragédie, Oedipe.
1718: Dès sa sortie de prison, le jeune Arouet prend le pseudonyme de Voltaire, l'anagramme probable de A.R.O.V.E.T L.e I.eune. Le U et V, J et I se confondent à cette époque. Sa première tragédie, Œdipe rencontre le succès.
1720: Voltaire rend visite à Lord Bolingbroke au château de la Source près d'Orléans. Il y rencontre Robert Walpole. Il fait jouer avec un succès médiocre Artémise.
1721: Robert Walpole est nommé "premier ministre" en Angleterre. Il le restera jusque 1742.
1722: Le Régent pardonne à Voltaire et lui
accorde une pension de 1200 livres. Le père de Voltaire meurt en lui laissant
une belle fortune. Voltaire voyage en Hollande. Il y apprécie la tolérance et la
prospérité commerciale du Pays.
1723: Il publie La Ligue première version de la Henriade, une épopée consacrée aux guerres de religion et à Henri IV.
1725: Il est chargé des représentations théâtrales pour les fêtes du mariage de louis XV.
1726: Le cardinal de Fleury devient "premier ministre" Il le restera jusqu'à sa mort en 1743.
Le 4 février, il est bastonné sur ordre du chevalier de Rohan qui, manifestant du mépris pour ce bourgeois sans nom, s’est vu répondre : "Mon nom, je le commence, et vous finissez le vôtre".
Le 17 avril, il est embastillé sur la demande du chevalier de Rohan, pour deux semaines.
Le 5 mai, il est à Calais en partance pour l'Angleterre. Il y passera deux ans et demi.
En juillet: Il revient secrètement en France pour provoquer et battre en duel le chevalier de Rohan.
1727: Voltaire est séduit par la monarchie parlementaire et libérale anglaise.
En janvier, il est présenté à George 1er, roi d'Angleterre. Il apprécie sa tolérance religieuse et son respect de la liberté. ll rencontre Pope et Swift. Il découvre la philosophie de John Locke. Il est frappé du contraste économique, social, politique et scientifique que l’Angleterre présente avec la France.
Le 8 avril: Il assiste aux funérailles grandioses de Newton à Westminster.
En décembre, il publie deux opuscules en anglais: Essay on civil wars et Essay on epick poetry.
1728: Il dédie La Henriade publiée à Londres par souscription, à la reine d'Angleterre. Cette œuvre sera très appréciée des anglais.
En novembre, il rentre en France alors que L'abbé Prévost se convertit au protestantisme et se réfugie à Londres.
1729: Voltaire est en France. Montesquieu est en Angleterre.
 1730: Le 15 mars, la grande comédienne
Adrienne Lecouveur meurt. Comme elle est comédienne elle est automatiquement
excommuniée. L'Eglise lui refuse une sépulture. Son corps est jeté à la voierie.
Voltaire s'en émeut et écrit un poème appelé La Mort de Mademoiselle Lecouvreur.
1730: Le 15 mars, la grande comédienne
Adrienne Lecouveur meurt. Comme elle est comédienne elle est automatiquement
excommuniée. L'Eglise lui refuse une sépulture. Son corps est jeté à la voierie.
Voltaire s'en émeut et écrit un poème appelé La Mort de Mademoiselle Lecouvreur.
En décembre, il fait jouer Brutus une tragédie imitée de Shakespeare.
1731: Voltaire publie Histoire de Charles XII commencé à Londres. Le gouvernement ordonne la saisie de l'œuvre mais celle-ci circule clandestinement.
1732: Il fait jouer Zaïre, une tragédie écrite en trois semaines, dédiée au marchand anglais Falkener. Son immense succès fait apparaître Voltaire comme le digne successeur de Corneille et Racine.
1733: En janvier, Voltaire publie le Temple du Goût.
En juin, il a une liaison avec Madame Emilie du Châtelet.
En juillet, suite aux agitations jansénistes, il écrit ses remarques sur Pascal dans ses lettres philosophiques.
 1734: Les Lettres sur les Anglais dites
les Lettres Philosophiques sont
publiées.
Voltaire y fait l’éloge des mœurs politiques anglaises et
dénonce à contrario, les travers de la monarchie française. Ces lettres déclenchent un
immense scandale. Le Parlement condamne l’ouvrage comme «propre à inspirer le
libertinage le plus dangereux pour la religion et l’ordre de la société civile».
Le livre est brûlé au pied du grand escalier du palais. Le libraire Jore est
jeté à la Bastille. Voltaire, pour éviter le même sort, doit quitter Paris et
s’enfuir précipitamment en Lorraine. Au bout d’un mois, Voltaire revient en
France avec une permission tacite. Il s’installe, non pas à Paris qui lui est
interdit, mais au château
d'Emilie du Châtelet, à Cirey en Champagne. Il y restera dix ans et s’adonne à
l’étude, à l’écriture et à des expériences scientifiques. Un théâtre est
installé au grenier. Voltaire écrit alors toute une série de tragédies et de
comédies à un rythme soutenu. Voltaire installe un laboratoire, fait venir des
instruments, concourt pour un prix de l’Académie des sciences, en même temps que
son amie. Ni elle, leibnizienne, ni lui, newtonien n’ont le prix. Il s’occupe de
physique, de chimie, d’astronomie,
écrit un Essai sur la nature du feu, une Épître sur Newton et vulgarise un
Élément de la philosophie de Newton.
1734: Les Lettres sur les Anglais dites
les Lettres Philosophiques sont
publiées.
Voltaire y fait l’éloge des mœurs politiques anglaises et
dénonce à contrario, les travers de la monarchie française. Ces lettres déclenchent un
immense scandale. Le Parlement condamne l’ouvrage comme «propre à inspirer le
libertinage le plus dangereux pour la religion et l’ordre de la société civile».
Le livre est brûlé au pied du grand escalier du palais. Le libraire Jore est
jeté à la Bastille. Voltaire, pour éviter le même sort, doit quitter Paris et
s’enfuir précipitamment en Lorraine. Au bout d’un mois, Voltaire revient en
France avec une permission tacite. Il s’installe, non pas à Paris qui lui est
interdit, mais au château
d'Emilie du Châtelet, à Cirey en Champagne. Il y restera dix ans et s’adonne à
l’étude, à l’écriture et à des expériences scientifiques. Un théâtre est
installé au grenier. Voltaire écrit alors toute une série de tragédies et de
comédies à un rythme soutenu. Voltaire installe un laboratoire, fait venir des
instruments, concourt pour un prix de l’Académie des sciences, en même temps que
son amie. Ni elle, leibnizienne, ni lui, newtonien n’ont le prix. Il s’occupe de
physique, de chimie, d’astronomie,
écrit un Essai sur la nature du feu, une Épître sur Newton et vulgarise un
Élément de la philosophie de Newton.
1735: Voltaire revient à Paris et publie un Traité de métaphysique et la Mort de Jules César.
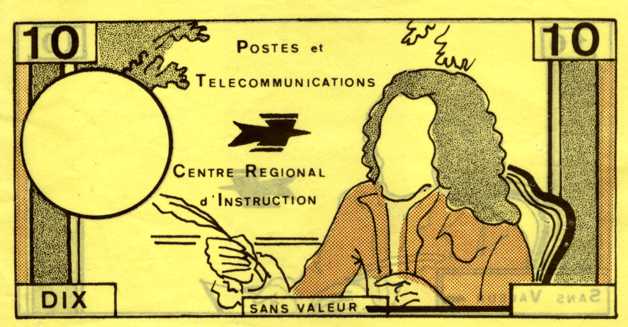 1736: Emilie du Châtelet apprend l'anglais
et traduit La Fable des Abeilles de Mandeville.
1736: Emilie du Châtelet apprend l'anglais
et traduit La Fable des Abeilles de Mandeville.
Après la publication du Mondain, poème à la fois épicurien et ironique sur le bonheur d'être sur terre, Voltaire se réfugie pendant quelques semaines en Hollande. Il écrit Alzire ou les Américains et L'Enfant Prodigue.
En Août, Voltaire entame des relations épistolaires avec Fréderic II, alors prince royal de Prusse.
1737: Il publie Éléments de la philosophie de Newton, ouvrage de vulgarisation qui contribue largement à la diffusion des idées nouvelles.
1738: Voltaire est de retour à Cirey et retrouve Emilie du Châtelet.
1739: Il écrit Une Vie de Molière.
 1740: Dès son avènement, Frédéric II roi
de Prusse envahit la Silésie. Il rencontre Voltaire pour la première fois à
Clèves.
1740: Dès son avènement, Frédéric II roi
de Prusse envahit la Silésie. Il rencontre Voltaire pour la première fois à
Clèves.
1741: La guerre de Succession d'Autriche est ouverte après l'avènement de Marie Thérèse d'Autriche durant l'année précédente. Voltaire fait un premier séjour à Berlin, chez le roi de Prusse.
1742: "Mahomet ou le fanatisme", une tragédie sur le drame du pouvoir est interdite à Paris.
1743: A la mort de Fleury, les frères d'Argenson entrent au ministère. Voltaire accomplit une mission secrète auprès du roi de Prusse. Il fait jouer une tragédie, Mérope.
1744: Le comte Marc Pierre D’Argenson, son ancien condisciple chez les jésuites de Louis-le-Grand, devenu ministre des Affaires Etrangères, fait revenir officiellement Voltaire à Paris.
1745: Après la Bataille de Fontenoy, Madame de Pompadour, la nouvelle favorite du roi, soutient Voltaire qui devient historiographe du roi Louis XV.
 1746: Le 2 mai, Voltaire est élu à
l’unanimité, à l'académie française, en remplacement de Jean Bouhier. Reçu par
son ancien maître, l’abbé d’Olivet le 9 mai suivant, son discours est uniquement
littéraire. Il n’y fait aucune allusion aux questions qui auraient pu soulever
des protestations. Il a pour sujet "Des effets de la Poésie sur le génie des
langues".
1746: Le 2 mai, Voltaire est élu à
l’unanimité, à l'académie française, en remplacement de Jean Bouhier. Reçu par
son ancien maître, l’abbé d’Olivet le 9 mai suivant, son discours est uniquement
littéraire. Il n’y fait aucune allusion aux questions qui auraient pu soulever
des protestations. Il a pour sujet "Des effets de la Poésie sur le génie des
langues".
1747: A la Cour, Voltaire se fait des ennemis, dont Madame de Pompadour. Il fréquente alors à Sceaux la Cour plus riante de la duchesse du Maine. En une journée il écrit première version de Zadig soit Memnon, histoire orientale et le fait jouer le soir même. Il y décrit toutes ses mésaventures de courtisan. Il y traite de la destinée humaine, du bonheur et du destin. Son premier conte philosophique important lui attire les foudres de Versailles.
1748: Il fait jouer une tragédie Sémiramis. Peu apprécié du couple royal, Voltaire déçu et désabusé, se retire un an, avec Emilie du Châtelet, à Nancy et Lunéville, à la cour du beau père de Louis XV, le roi de Pologne Stanislas.
1749: Madame du Châtelet, qui a une liaison avec le jeune poète Saint-Lambert, meurt en couches. Cette mort affecte profondément Voltaire qui décide alors de répondre à l’invitation de Frédéric II, et part pour la Prusse qui lui verse une pension de 20 000 livres. Les soupers du roi et du philosophe sont célèbres. Voltaire reste quatre ans au château de Sans-Souci. Les relations entre le roi philosophe et le philosophe roi sont d’abord idylliques mais deviennent vite orageuses.
1750: Il publie Oreste. Contre les usages, Voltaire perd sa fonction d’historiographe de Louis XV.
1751: Alors que le tome I de l'Encyclopédie sort, Voltaire publie Le Siècle de Louis XIV.
1752: Voltaire publie Micromégas, un conte philosophique qui traite de la relativité des connaissances.
1753: Voltaire conteste Maupertuis, président de l’Académie de Berlin et se brouille avec Frédéric II.
Du 1er mai au 6 juillet, il est retenu prisonnier et doit rendre les papiers du roi qu’il a emportés. Il peut ensuite quitter l’Allemagne. La France lui refuse l’asile, en raison du scandale causé par l'édition pirate de son Abrégé de l'Histoire Universelle. Louis XV lui interdit d'approcher Paris. Il séjourne en Alsace.
1755: En mars, il s'installe avec Madame Denis sa nièce devenue sa maîtresse dix ans auparavant, dans les environs de Genève. Il achète une propriété qu'il appelle Les Délices. Il découvre la nature, la vie rustique et reçoit ses amis. Il va aménager la région, bâtir, planter, semer et développer l’élevage. Il y fait vivre un millier de personnes, se fait agriculteur, architecte, fabricant de montres et de bas de soie. Avec son sens de la formule, il résume l’entreprise: «Un repaire de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente habitée par 1200 personnes utiles».
1756: Voltaire publie un Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Il joue alors un rôle essentiel dans le renouveau des études historiques. Il écrit un poème sur le désastre de Lisbonne. Voltaire a un premier désaccord avec Rousseau sur la question de la Providence.
1757: Il collabore au septième tome de l’Encyclopédie. Les autorités genevoises n’apprécient pas l’article Genève qu’il rédige, en raison des critiques sévères contre la République et la religion calviniste qu’il contient. Rousseau soutient les autorités de Genève et leur interdiction du théâtre. C'est le deuxième désaccord qui durera jusqu'à leur mort. La publication de l'Encyclopédie est interrompue et les philosophes sont persécutés.
 1758: Le Duc de Choiseul entre au
ministère. Voltaire qui doit s'éloigner quelque peu de Genève du fait de son
article, achète Ferney et Tourney, en territoire français près de Genève et la
Suisse pour pouvoir s’y réfugier à la moindre alerte.
1758: Le Duc de Choiseul entre au
ministère. Voltaire qui doit s'éloigner quelque peu de Genève du fait de son
article, achète Ferney et Tourney, en territoire français près de Genève et la
Suisse pour pouvoir s’y réfugier à la moindre alerte.
1759: Il publie Candide, un conte philosophique considéré comme l’un de ses chefs d’oeuvre. Le héros, Candide, est un jeune homme crédule à qui son précepteur, Pangloss, inculque une théorie très simpliste sur l’optimisme. Les mésaventures du jeune héros mettent à mal cette doctrine. Cela permet à Voltaire de se moquer de Rousseau et de toutes les théories métaphysiques qui ne résistent pas à l’épreuve des faits. Au-delà du procès de l’intolérance, du fanatisme, de la mauvaise foi ou de la superstition, Candide est aussi une défense du pragmatisme, présentée comme une forme de lucidité et de sagesse.
1760: Voltaire s’établit définitivement à Ferney. Il va faire de cette petite ville du pays de Gex, un haut lieu de l’Europe intellectuelle. Il engage une correspondance de 6000 lettres, avec plusieurs souverains : l’impératrice Catherine II de Russie, Frédéric II, les rois de Pologne, du Danemark et de Suède. De Paris, Choiseul alors Ministre des Affaires étrangères, d’Alembert, Richelieu, Helvétius, Turgot et Condorcet, lui témoignent également leur soutien.
1762: Voltaire défend Calas, un huguenot condamné sans preuve. Calas se voit reprocher d'avoir tué son fils, qu’il aurait soupçonné de vouloir se convertir au catholicisme.
 1763: Voltaire publie un Traité sur la
Tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas. Ce Traité sur la Tolérance est
une protestation
contre l’injustice faite à l’accusé et contre le fanatisme d’une accusation née
de la rumeur et de la haine.
1763: Voltaire publie un Traité sur la
Tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas. Ce Traité sur la Tolérance est
une protestation
contre l’injustice faite à l’accusé et contre le fanatisme d’une accusation née
de la rumeur et de la haine.
1764: Voltaire publie Le Dictionnaire Philosophique Portatif. Il y raille la métaphysique, le fanatisme, la théologie et y expose ses grands principes politiques, soit les lois, l'Etat et le Gouvernement. Il écrit aussi des Commentaires sur Corneille.
1765: Voltaire publie La Philosophie de l'Histoire et obtient la réhabilitation de Calas.
1767: Voltaire publie l'Ingénu.
1772: Il publie une Epître à Horace
1775: Il écrit des Lettres de Monsieur de Voltaire à l'Académie française
1778: le 5 février, Voltaire quitte Ferney et fait un retour triomphal à Paris. Il déclare dans une ultime profession de foi: "Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition".
Le 30 mars, il reçoit l’hommage de l’Académie française. Il est porté en triomphe par la foule pour aller assister à la sixième représentation d’Irène, sa dernière tragédie.
Le 30 mai, Voltaire meurt à l’angle de la rue de Beaune et du quai Voltaire dans l’hôtel du Marquis de Villette. Le curé de saint Sulpice refuse de l’inhumer mais garde le silence. Pour lui éviter d’échouer dans un quelconque terrain vague, son neveu Mignot, abbé de l’abbaye de Sellières, garde sa mort secrète et le transporte dans un fiacre, en catastrophe. La dépouille est assise, poudrée, perruquée et ligotée à sa banquette, jusqu’à l’abbaye près de Romilly sur Seine.
 Le
2 juin, l’inhumation a lieu dans l’abbatiale, après une nuit veillée par les
moines. Pari gagné puisque l’interdiction d’obsèques religieuses émanant de l’évêque arrive juste un peu plus tard !
Le
2 juin, l’inhumation a lieu dans l’abbatiale, après une nuit veillée par les
moines. Pari gagné puisque l’interdiction d’obsèques religieuses émanant de l’évêque arrive juste un peu plus tard !
1791: Le 8 mai, les officiers municipaux de Paris, sur la requête du marquis de Villette, neveu par alliance de Voltaire, demandent à l’Assemblée le transfert des cendres de l’abbaye de Sellières. L’abbaye vient d’être vendue, il y a urgence car le département de l’Aube, le club des Jacobins de Troyes et la municipalité de Romilly songent à se partager les ossements. Le décret rendu et l’exhumation faite, le directoire du département de Paris est chargé du transfert et de l’ordonnance du cortège.
Le 5 juillet, après un séjour dans l’église de Romilly dont le curé constitutionnel le régale d’une oraison funèbre et des vêpres des morts, le corps de Voltaire se mit en branle sur un char attelé de quatre chevaux blancs caparaçonnés de violet.
Le 6 juillet, la dépouilles est à Nogent puis Provins.
Le 7 juillet, elle est à Nangis.
Le 8 juillet, elle arrive à Guignes.
Le 9 juillet, Brie-Comte-Robert la reçoit.
Le 10 juillet, après un arrêt à midi à Créteil, la dépouille entre dans Paris à la nuit close.
Le 11 juillet, la cérémonie révolutionnaire a lieu sans la participation du clergé, avec le transfert de ses cendres au Panthéon. Mirabeau, est le premier à y être entré avant d'être expulsé en 1794. Voltaire est par conséquent, le premier occupant dans la durée du temple républicain.
APPROBATION
Je soussigné, qui me suis fait passer pour savant, et même pour homme d’esprit, ai lu ce manuscrit, que j’ai trouvé, malgré moi, curieux, amusant, moral, philosophique, digne de plaire à ceux mêmes qui haïssent les romans. Ainsi je l’ai décrié, et j’ai assuré monsieur le cadi-lesquier que c’est un ouvrage détestable.
ÉPITRE DÉDICATOIRE DE ZADIG A LA SULTANE SHERAA, PAR SADI. Le 10 du mois de schewal, l’an 837 de l’hégire.
Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l’esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d’Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d’un livre d’un ancien sage qui, ayant le bonheur de n’avoir rien à faire, eut celui de s’amuser à écrire l’histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu’il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d’en juger ; car, quoique vous soyez dans le printemps de votre vie, quoique tous les plaisirs vous cherchent, quoique vous soyez belle, et que vos talents ajoutent à votre beauté; quoiqu’on vous loue du soir au matin, et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n’avoir pas le sens commun, cependant vous avez l’esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendue raisonner mieux que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet pointu. Vous êtes discrète et vous n’êtes point défiante ; vous êtes douce sans être faible ; vous êtes bienfaisante avec discernement; vous aimez vos amis, et vous ne vous faites point d’ennemis. Votre esprit n’emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance ; vous ne dites de mal ni n’en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y auriez. Enfin votre âme m’a toujours paru pure comme votre beauté. Vous avez même un petit fond de philosophie qui m’a fait croire que vous prendriez plus de goût qu’une autre à cet ouvrage d’un sage.
Il fut écrit d’abord en ancien chaldéen, que ni vous ni moi n’entendons. On le traduisit en arabe, pour amuser le célèbre sultan Ouloug-beb. C’était du temps où les Arabes et les Persans commençaient à écrire des Mille et une nuits, des Mille et un jours, etc. Ouloug aimait mieux la lecture de Zadig ; mais les sultanes aimaient mieux les Mille et un. Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Ouloug, des contes qui sont sans raison, et qui ne signifient rien? C’est précisément pour cela que nous les aimons, répondaient les sultanes.
Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas, et que vous serez un vrai Ouloug. J’espère même que, quand vous serez lasse des conversations générales, qui ressemblent assez aux Mille et un, à cela près qu’elles sont moins amusantes, je pourrai trouver une minute pour avoir l’honneur de vous parler raison. Si vous aviez été Thalestris du temps de Scander, fils de Philippe ; si vous aviez été la reine de Sabée du temps de Soleiman, c’eussent été ces rois qui auraient fait le voyage.
Je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable, et votre bonheur sans fin.
SADI.
Du temps du roi Moabdar il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l’éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions; il n’affectait rien; il ne voulait point toujours avoir raison, et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu’avec beaucoup d’esprit il n’insultât jamais par des railleries à ces propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ces médisances téméraires, à ces décisions ignorantes, à ces turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles, qu’on appelait conversation dans Babylone. Il avait appris, dans le premier livre de Zoroastre, que l’amour-propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux; il ne craignait point d’obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre, Quand tu manges, donne à manger aux chiens, dussent-ils te mordre. Il était aussi sage qu’on peut l’être; car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens Chaldéens, il n’ignorait pas les principes physiques de la nature, tels qu’on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu’on en a su dans tous les âges, c’est-à-dire fort peu de chose. Il était fermement persuadé que l’année était de trois cent soixante et cinq jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde; et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu’il avait de mauvais sentiments, et que c’était être ennemi de l’état que de croire que le soleil tournait sur lui-même, et que l’année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain.
Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu’il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémire, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémire l’aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l’Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C’étaient les satellites du jeune Orcan, neveu d’un ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroire que tout lui était permis. Il n’avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig; mais, croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n’être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu’il aimait éperdument Sémire. Il voulait l’enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence ils la blessèrent, et firent couler le sang d’une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s’écriait, Mon cher époux! on m’arrache à ce que j’adore. Elle n’était point occupée de son danger; elle ne pensait qu’à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l’amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite, et ramena chez elle Sémire évanouie et sanglante, qui en ouvrant les yeux vit son libérateur. Elle lui dit: O Zadig! je vous aimais comme mon époux, je vous aime comme celui à qui je dois l’honneur et la vie. Jamais il n’y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémire; jamais bouche plus ravissante n’exprima des sentiments plus touchants par ces paroles de feu qu’inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l’amour le plus légitime. Sa blessure était légère; elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement; un coup de flèche reçu près de l’oeil lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait aux dieux que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes: elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards; mais un abcès survenu à l’oeil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu’à Memphis chercher le grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux cortège. Il visita le malade, et déclara qu’il perdrait l’oeil; il prédit même le jour et l’heure où ce funeste accident devait arriver. Si c’eût été l’oeil droit, dit-il, je l’aurais guéri; mais les plaies de l’oeil gauche sont incurables. Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d’Hermès. Deux jours après l’abcès perça de lui-même; Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu’il n’avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point; mais, dès qu’il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l’espérance du bonheur de sa vie, et pour qui seule il voulait avoir des yeux. Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu’elle avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orcan la nuit même. A cette nouvelle il tomba sans connaissance; sa douleur le mit au bord du tombeau; il fut longtemps malade, mais enfin la raison l’emporta sur son affliction; et l’atrocité de ce qu’il éprouvait servit même à le consoler. Puisque j’ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d’une fille élevée à la cour, il faut que j’épouse une citoyenne. Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville; il l’épousa, et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l’union la plus tendre. Seulement il remarquait en elle un peu de légèreté, et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d’esprit et de vertu.
Un jour Azora revint d’une promenade, tout en colère, et faisant de grandes exclamations.
Qu’avez-vous, lui dit-il, ma chère épouse? qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même?
Hélas! dit-elle, vous seriez indigné comme moi, si vous aviez vu le spectacle dont je viens d’être témoin. J’ai été consoler la jeune veuve Cosrou, qui vient d’élever, depuis deux jours, un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l’eau de ce ruisseau coulerait auprès.
Eh bien! dit Zadig, voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari!
Ah! reprit Azora, si vous saviez à quoi elle s’occupait quand je lui ai rendu visite!
A quoi donc, belle Azora?
Elle fesait détourner le ruisseau. Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproches si violents contre la jeune veuve, que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig.
Il avait un ami, nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu’aux autres: il le mit dans sa confidence, et s’assura, autant qu’il le pouvait, de sa fidélité par un présent considérable. Azora ayant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement, la nuit même, qu’on n’avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle, et qu’on venait d’ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères, au bout du jardin. Elle pleura, s’arracha les cheveux, et jura de mourir.
Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler, et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleurèrent moins, et dinèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé la plus grande partie de son bien, et lui fit entendre qu’il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s’adoucit; le souper fut plus long que le dîner; on se parla avec plus de confiance. Azora fit l’éloge du défunt; mais elle avoua qu’il avait des défauts dont Cador était exempt.
Au milieu du souper, Cador se plaignit d’un mal de rate violent; la dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait, pour essayer s’il n’y en avait pas quelqu’une qui fût bonne pour le mal de rate; elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone; elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. Etes-vous sujet à cette cruelle maladie? lui dit-elle avec compassion. Elle me met quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador, et il n’y a qu’un seul remède qui puisse me soulager: c’est de m’appliquer sur le côté le nez d’un homme qui soit mort la veille. Voilà un étrange remède, dit Azora. Pas plus étrange, répondit-il, que les sachets du sieur Arnoult contre l’apoplexie. Cette raison, jointe à l’extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. Après tout, dit-elle, quand mon mari passera du monde d’hier dans le monde du lendemain sur le pont Tchinavar, l’ange Asrael lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première? Elle prit donc un rasoir; elle alla au tombeau de son époux, l’arrosa de ses larmes, et s’approcha pour couper le nez à Zadig, qu’elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d’une main, et arrêtant le rasoir de l’autre. Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Cosrou; le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau.
Zadig éprouva que le premier mois du mariage, comme il est écrit dans le livre du Zend, est la lune du miel, et que le second est la lune de l’absinthe. Il fut quelque temps après obligé de répudier Azora, qui était devenue trop difficile à vivre, et il chercha son bonheur dans l’étude de la nature. Rien n’est plus heureux, disait-il, qu’un philosophe qui lit dans ce grand livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités qu’il découvre sont à lui: il nourrit et il élève son âme, il vit tranquille; il ne craint rien des hommes, et sa tendre épouse ne vient point lui couper le nez.
Plein de ces idées, il se retira dans une maison de campagne sur les bords de l’Euphrate. Là il ne s’occupait pas à calculer combien de pouces d’eau coulaient en une seconde sous les arches d’un pont, ou s’il tombait une ligne cube de pluie dans le mois de la souris plus que dans le mois du mouton. Il n’imaginait point de faire de la soie avec des toiles d’araignée, ni de la porcelaine avec des bouteilles cassées; mais il étudia surtout les propriétés des animaux et des plantes, et il acquit bientôt une sagacité qui lui découvrait mille différences où les autres hommes ne voient rien que d’uniforme.
Un jour, se promenant auprès d’un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient çà et là comme des hommes égarés qui cherchent ce qu’ils ont perdu de plus précieux. Jeune homme, lui dit le premier eunuque, n’avez-vous point vu le chien de la reine? Zadig répondit modestement, C’est une chienne, et non pas un chien. Vous avez raison, reprit le premier eunuque. C’est une épagneule très petite, ajouta Zadig; elle a fait depuis peu des chiens; elle boite du pied gauche de devant, et elle a les oreilles très longues. Vous l’avez donc vue? dit le premier eunuque tout essoufflé. Non, répondit Zadig, je ne l’ai jamais vue, et je n’ai jamais su si la reine avait une chienne.
Précisément dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau cheval de l’écurie du roi s’était échappé des mains d’un palefrenier dans les plaines de Babylone. Le grand-veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d’inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand-veneur s’adressa à Zadig, et lui demanda s’il n’avait point vu passer le cheval du roi. C’est, répondit Zadig, le cheval qui galope le mieux; il a cinq pieds de haut, le sabot fort petit; il porte une queue de trois pieds et demi de long; les bossettes de son mors sont d’or à vingt-trois carats; ses fers sont d’argent à onze deniers. Quel chemin a-t-il pris? où est-il? demanda le grand-veneur. Je ne l’ai point vu, répondit Zadig, et je n’en ai jamais entendu parler. Le grand-veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n’eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine; ils le firent conduire devant l’assemblée du grand Desterham, qui le condamna au knout, et à passer le reste de ses jours en Sibérie. A peine le jugement fut-il rendu qu’on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt; mais ils condamnèrent Zadig à payer quatre cents onces d’or, pour avoir dit qu’il n’avait point vu ce qu’il avait vu. Il fallut d’abord payer cette amende; après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand Desterham; il parla en ces termes: «Étoiles de justice, abîmes de science, miroirs de vérité, qui avez la pesanteur du plomb, la dureté du fer, l’éclat du diamant, et beaucoup d’affinité avec l’or, puisqu’il m’est permis de parler devant cette auguste assemblée, je vous jure par Orosmade, que je n’ai jamais vu la chienne respectable de la reine, ni le cheval sacré du roi des rois. Voici ce qui m’est arrivé: Je me promenais vers le petit bois où j’ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très illustre grand-veneur. J’ai vu sur le sable les traces d’un animal, et j’ai jugé aisément que c’étaient celles d’un petit chien. Des sillons légers et longs, imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces des pattes, m’ont fait connaître que c’était une chienne dont les mamelles étaient pendantes, et qu’ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D’autres traces en un sens différent, qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m’ont appris qu’elle avait les oreilles très longues; et comme j’ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j’ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l’ose dire. «A l’égard du cheval du roi des rois, vous saurez que, me promenant dans les routes de ce bois, j’ai aperçu les marques des fers d’un cheval; elles étaient toutes à égales distances. Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop parfait. La poussière des arbres, dans une route étroite qui n’a que sept pieds de large, était un peu enlevée à droite et à gauche, à trois pieds et demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je dit, a une queue de trois pieds et demi, qui, par ses mouvements de droite et de gauche, a balayé cette poussière. J’ai vu sous les arbres qui formaient un berceau de cinq pieds de haut, les feuilles des branches nouvellement tombées; et j’ai connu que ce cheval y avait touché, et qu’ainsi il avait cinq pieds de haut. Quant à son mors, il doit être d’or à vingt-trois carats; car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j’ai reconnue être une pierre de touche, et dont j’ai fait l’essai. J’ai jugé enfin par les marques que ses fers ont laissées sur des cailloux, d’une autre espèce, qu’il était ferré d’argent à onze deniers de fin.» Tous les juges admirèrent le profond et subtil discernement de Zadig; la nouvelle en vint jusqu’au roi et à la reine. On ne parlait que de Zadig dans les antichambres, dans la chambre, et dans le cabinet; et quoique plusieurs mages opinassent qu’on devait le brûler comme sorcier, le roi ordonna qu’on lui rendît l’amende des quatre cents onces d’or à laquelle il avait été condamné. Le greffier, les huissiers, les procureurs, vinrent chez lui en grand appareil lui rapporter ses quatre cents onces; ils en retinrent seulement trois cent quatre-vingt-dix-huit pour les frais de justice, et leurs valets demandèrent des honoraires. Zadig vit combien il était dangereux quelquefois d’être trop savant, et se promit bien, à la première occasion, de ne point dire ce qu’il avait vu. Cette occasion se trouva bientôt. Un prisonnier d’état s’échappa; il passa sous les fenêtres de sa maison. On interrogea Zadig, il ne répondit rien; mais on lui prouva qu’il avait regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour ce crime à cinq cents onces d’or, et il remercia ses juges de leur indulgence, selon la coutume de Babylone. Grand Dieu! dit-il en lui-même, qu’on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé! qu’il est dangereux de se mettre à la fenêtre! et qu’il est difficile d’être heureux dans cette vie!
Zadig voulut se consoler, par la philosophie et par l’amitié, des maux que lui avait faits la fortune. Il avait, dans un faubourg de Babylone, une maison ornée avec goût, où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d’un honnête homme. Le matin sa bibliothèque était ouverte à tous les savants; le soir, sa table l’était à la bonne compagnie; mais il connut bientôt combien les savants sont dangereux; il s’éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre, qui défendait de manger du griffon. Comment défendre le griffon, disaient les uns, si cet animal n’existe pas? Il faut bien qu’il existe, disaient les autres, puisque Zoroastre ne veut pas qu’on en mange. Zadig voulut les accorder, en leur disant, S’il y a des griffons, n’en mangeons point; s’il n’y en a point, nous en mangerons encore moins; et par là nous obéirons tous à Zoroastre. Un savant qui avait composé treize volumes sur les propriétés du griffon, et qui de plus était grand théurgite, se hâta d’aller accuser Zadig devant un archimage nommé Yébor, le plus sot des Chaldéens, et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait empaler Zadig pour la plus grande gloire du soleil, et en aurait récité le bréviaire de Zoroastre d’un ton plus satisfait. L’ami Cador (un ami vaut mieux que cent prêtres) alla trouver le vieux Yébor, et lui dit: Vivent le soleil et les griffons! gardez-vous bien de punir Zadig: c’est un saint; il a des griffons dans sa basse-cour, et il n’en mange point; et son accusateur est un hérétique qui ose soutenir que les lapins ont le pied fendu, et ne sont point immondes. Eh bien! dit Yébor en branlant sa tête chauve, il faut empaler Zadig pour avoir mal pensé des griffons, et l’autre pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaisa l’affaire par le moyen d’une fille d’honneur à laquelle il avait fait un enfant, et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages. Personne ne fut empalé; de quoi plusieurs docteurs murmurèrent, et en présagèrent la décadence de Babylone. Zadig s’écria: A quoi tient le bonheur! tout me persécute dans ce monde, jusqu’aux êtres qui n’existent pas. Il maudit les savants, et ne voulut plus vivre qu’en bonne compagnie.
Il rassemblait chez lui les plus honnêtes gens de Babylone, et les dames les plus aimables; il donnait des soupers délicats, souvent précédés de concerts, et animés par des conversations charmantes dont il avait su bannir l’empressement de montrer de l’esprit, qui est la plus sûre manière de n’en point avoir, et de gâter la société la plus brillante. Ni le choix de ses amis, ni celui des mets, n’étaient faits par la vanité; car en tout il préférait l’être au paraître, et par là il s’attirait la considération véritable, à laquelle il ne prétendait pas. Vis-à-vis sa maison demeurait Arimaze, personnage dont la méchante âme était peinte sur sa grossière physionomie. Il était rongé de fiel et bouffi d’orgueil, et pour comble, c’était un bel esprit ennuyeux. N’ayant jamais pu réussir dans le monde, il se vengeait par en médire. Tout riche qu’il était, il avait de la peine à rassembler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars qui entraient le soir chez Zadig l’importunait, le bruit de ses louanges l’irritait davantage. Il allait quelquefois chez Zadig, et se mettait à table sans être prié: il y corrompait toute la joie de la société, comme on dit que les harpies infectent les viandes qu’elles touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner une fête à une dame qui, au lieu de la recevoir, alla souper chez Zadig. Un autre jour, causant avec lui dans le palais, ils abordèrent un ministre qui pria Zadig à souper, et ne pria point Arimaze. Les plus implacables haines n’ont pas souvent des fondements plus importants. Cet homme, qu’on appelait l’Envieux dans Babylone, voulut perdre Zadig, parcequ’on l’appelait l’Heureux. L’occasion de faire du mal se trouve cent fois par jour, et celle de faire du bien, une fois dans l’année, comme dit Zoroastre.
L’Envieux alla chez Zadig, qui se promenait dans ses jardins avec deux amis et une dame à laquelle il disait souvent des choses galantes, sans autre intention que celle de les dire. La conversation roulait sur une guerre que le roi venait de terminer heureusement contre le prince d’Hyrcanie, son vassal. Zadig, qui avait signalé son courage dans cette courte guerre, louait beaucoup le roi, et encore plus la dame. Il prit ses tablettes, et écrivit quatre vers qu’il fit sur-le-champ, et qu’il donna à lire à cette belle personne. Ses amis le prièrent de leur en faire part: la modestie, ou plutôt un amour-propre bien entendu, l’en empêcha. Il savait que des vers impromptus ne sont jamais bons que pour celle en l’honneur de qui ils sont faits: il brisa en deux la feuille des tablettes sur laquelle il venait d’écrire, et jeta les deux moitiés dans un buisson de roses, où on les chercha inutilement. Une petite pluie survint; on regagna la maison. L’Envieux, qui resta dans le jardin, chercha tant, qu’il trouva un morceau de la feuille. Elle avait été tellement rompue, que chaque moitié de vers qui remplissait la ligne fesait un sens, et même un vers d’une plus petite mesure; mais, par un hasard encore plus étrange, ces petits vers se trouvaient former un sens qui contenait les injures les plus horribles contre le roi; on y lisait: Par les plus grands forfaits Sur le trône affermi, Dans la publique paix C’est le seul ennemi. L’Envieux fut heureux pour la première fois de sa vie. Il avait entre les mains de quoi perdre un homme vertueux et aimable. Plein de cette cruelle joie, il fit parvenir jusqu’au roi cette satire écrite de la main de Zadig: on le fit mettre en prison, lui, ses deux amis, et la dame. Son procès lui fut bientôt fait, sans qu’on daignât l’entendre. Lorsqu’il vint recevoir sa sentence, l’Envieux se trouva sur son passage, et lui dit tout haut que ses vers ne valaient rien. Zadig ne se piquait pas d’être bon poëte; mais il était au désespoir d’être condamné comme criminel de lèse-majesté, et de voir qu’on retînt en prison une belle dame et deux amis pour un crime qu’il n’avait pas fait. On ne lui permit pas de parler, parceque ses tablettes parlaient. Telle était la loi de Babylone. On le fit donc aller au supplice à travers une foule de curieux dont aucun n’osait le plaindre, et qui se précipitaient pour examiner son visage, et pour voir s’il mourrait avec bonne grâce. Ses parents seulement étaient affligés, car ils n’héritaient pas. Les trois quarts de son bien étaient confisqués au profit du roi, et l’autre quart au profit de l’Envieux. Dans le temps qu’il se préparait à la mort, le perroquet du roi s’envola de son balcon, et s’abattit dans le jardin de Zadig sur un buisson de roses. Une pêche y avait été portée d’un arbre voisin par le vent; elle était tombée sur un morceau de tablettes à écrire auquel elle s’était collée. L’oiseau enleva la pêche et la tablette, et les porta sur les genoux du monarque. Le prince curieux y lut des mots qui ne formaient aucun sens, et qui paraissaient des fins de vers. Il aimait la poésie, et il y a toujours de la ressource avec les princes qui aiment les vers: l’aventure de son perroquet le fit rêver. La reine, qui se souvenait de ce qui avait été écrit sur une pièce de la tablette de Zadig, se la fit apporter. On confronta les deux morceaux, qui s’ajustaient ensemble parfaitement; on lut alors les vers tels que Zadig les avait faits: Par les plus grands forfaits j’ai vu troubler la terre. Sur le trône affermi le roi sait tout dompter. Dans la publique paix l’amour seul fait la guerre: C’est le seul ennemi qui soit à redouter. Le roi ordonna aussitôt qu’on fît venir Zadig devant lui, et qu’on fît sortir de prison ses deux amis et la belle dame. Zadig se jeta le visage contre terre aux pieds du roi et de la reine: il leur demanda très humblement pardon d’avoir fait de mauvais vers: il parla avec tant de grâce, d’esprit, et de raison, que le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint, et plut encore davantage. On lui donna tous les biens de l’Envieux, qui l’avait injustement accusé: mais Zadig les rendit tous; et l’Envieux ne fut touché que du plaisir de ne pas perdre son bien. L’estime du roi s’accrut de jour en jour pour Zadig. Il le mettait de tous ses plaisirs, et le consultait dans toutes ses affaires. La reine le regarda dès-lors avec une complaisance qui pouvait devenir dangereuse pour elle, pour le roi son auguste époux, pour Zadig, et pour le royaume. Zadig commençait à croire qu’il n’est pas si difficile d’être heureux.
Le temps arriva où l’on célébrait une grande fête qui revenait tous les cinq ans. C’était la coutume à Babylone de déclarer solennellement, au bout de cinq années, celui des citoyens qui avait fait l’action la plus généreuse. Les grands et les mages étaient les juges. Le premier satrape, chargé du soin de la ville, exposait les plus belles actions qui s’étaient passées sous son gouvernement. On allait aux voix: le roi prononçait le jugement. On venait à cette solennité des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des mains du monarque une coupe d’or garnie de pierreries, et le roi lui disait ces paroles: «Recevez ce prix de la générosité, et puissent les dieux me donner beaucoup de sujets qui vous ressemblent!» Ce jour mémorable venu, le roi parut sur son trône, environné des grands, des mages, et des députés de toutes les nations, qui venaient à ces jeux où la gloire s’acquérait, non par la légèreté des chevaux, non par la force du corps, mais par la vertu. Le premier satrape rapporta à haute voix les actions qui pouvaient mériter à leurs auteurs ce prix inestimable. Il ne parla point de la grandeur d’âme avec laquelle Zadig avait rendu à l’Envieux toute sa fortune: ce n’était pas une action qui méritât de disputer le prix. Il présenta d’abord un juge qui, ayant fait perdre un procès considérable à un citoyen, par une méprise dont il n’était pas même responsable, lui avait donné tout son bien, qui était la valeur de ce que l’autre avait perdu. C’est à peu près le trait de Des Barreaux. Voyez, tome XIX, le Catalogue des écrivains, en tête du Siècle de Louis XIV; et dans les Mélanges, année 1767, la septième des Lettres à S. A. monseigneur le prince de***. B. Il produisit ensuite un jeune homme qui, étant éperdument épris d’une fille qu’il allait épouser, l’avait cédée à un ami près d’expirer d’amour pour elle, et qui avait encore payé la dot en cédant la fille. Ensuite il fit paraître un soldat qui, dans la guerre d’Hyrcanie, avait donné encore un plus grand exemple de générosité. Des soldats ennemis lui enlevaient sa maîtresse, et il la défendait contre eux: on vint lui dire que d’autres Hyrcaniens enlevaient sa mère à quelques pas de là: il quitta en pleurant sa maîtresse, et courut délivrer sa mère: il retourna ensuite vers celle qu’il aimait, et la trouva expirante. Il voulut se tuer; sa mère lui remontra qu’elle n’avait que lui pour tout secours, et il eut le courage de souffrir la vie. Les juges penchaient pour ce soldat. Le roi prit la parole, et dit: Son action et celles des autres sont belles, mais elles ne m’étonnent point; hier Zadig en a fait une qui m’a étonné. J’avais disgracié depuis quelques jours mon ministre et mon favori Coreb. Je plaignais de lui avec violence, et tous mes courtisans m’assuraient que j’étais trop doux; c’était à qui me dirait le plus de mal de Coreb. Je demandai à Zadig ce qu’il en pensait, et il osa en dire du bien. J’avoue que j’ai vu, dans nos histoires, des exemples qu’on a payé de son bien une erreur, qu’on a cédé sa maîtresse qu’on a préféré une mère à l’objet de son amour; mais je n’ai jamais lu qu’un courtisan ait parlé avantageusement d’un ministre disgracié contre qui son souverain était en colère. Je donne vingt mille pièces d’or à chacun de ceux dont on vient de réciter les actions généreuses; mais je donne la coupe à Zadig. Sire, lui dit-il, c’est votre majesté seule qui mérite la coupe, c’est elle qui a fait l’action la plus inouïe, puisque étant roi vous ne vous êtes point fâché contre votre esclave, lorsqu’il contredisait votre passion. On admira le roi et Zadig. Le juge qui avait donné son bien, l’amant qui avait marié sa maîtresse à son ami, le soldat qui avait préféré le salut de sa mère à celui de sa maîtresse, reçurent les présents du monarque: ils virent leurs noms écrits dans le livre des généreux. Zadig eut la coupe. Le roi acquit la réputation d’un bon prince, qu’il ne garda pas long-temps. Ce jour fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait. La mémoire s’en conserve encore dans l’Asie. Zadig disait: Je suis donc enfin heureux! Mais il se trompait.
Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. Toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix, car depuis la fondation de l’empire il n’y avait jamais eu de ministre si jeune. Tous les courtisans furent fâchés; l’Envieux en eut un crachement de sang, et le nez lui enfla prodigieusement. Zadig ayant remercié le roi et la reine, alla remercier aussi le perroquet: Bel oiseau, lui dit-il, c’est vous qui m’avez sauvé la vie, et qui m’avez fait premier ministre: la chienne et le cheval de leurs majestés m’avaient fait beaucoup de mal, mais vous m’avez fait du bien. Voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes! Mais, ajouta-t-il, un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui. Le perroquet répondit, Oui. Ce mot frappa Zadig. Cependant, comme il était bon physicien, et qu’il ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes, il se rassura bientôt; il se mit à exercer son ministère de son mieux. Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois, et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Il ne gêna point les voix du divan, et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n’était pas lui qui jugeait, c’était la loi; mais quand elle était trop sévère, il la tempérait; et quand on manquait de lois, son équité en faisait qu’on aurait prises pour celles de Zoroastre. C’est de lui que les nations tiennent ce grand principe, Qu’il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration il mit ce grand talent en usage. Un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes; il avait fait ses héritiers ses deux fils par portions égales, après avoir marié leur sœur, et il laissait un présent de trente mille pièces d’or à celui de ses deux fils qui serait jugé l’aimer davantage. L’aîné lui bâtit un tombeau, le second augmenta d’une partie de son héritage la dot de sa sœur; chacun disait: C’est l’aîné qui aime le mieux son père, le cadet aime mieux sa sœur; c’est à l’aîné qu’appartiennent les trente mille pièces. Zadig les fit venir tous deux l’un après l’autre. Il dit à l’aîné: Votre père n’est point mort, il est guéri de sa dernière maladie, il revient à Babylone. Dieu soit loué, répondit le jeune homme; mais voilà un tombeau qui m’a coûté bien cher! Zadig dit ensuite la même chose au cadet. Dieu soit loué! répondit-il, je vais rendre à mon père tout ce que j’ai; mais je voudrais qu’il laissât à ma sœur ce que je lui ai donné. Vous ne rendrez rien, dit Zadig, et vous aurez les trente mille pièces; c’est vous qui aimez le mieux votre père. Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages, et, après avoir reçu quelques mois des instructions de l’un et de l’autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l’épouser. Je prendrai pour mon mari, dit-elle, celui des deux qui m’a mise en état de donner un citoyen à l’empire. C’est moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l’un. C’est moi qui ai eu cet avantage, dit l’autre. Eh bien! répondit-elle, je reconnais pour père de l’enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation. Elle accoucha d’un fils. Chacun des mages veut l’élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les deux mages. Qu’enseigneras-tu à ton pupille? dit-il au premier. Je lui apprendrai, dit le docteur, les huit parties d’oraison, la dialectique, l’astrologie, la démonomanie; ce que c’est que la substance et l’accident, l’abstrait et le concret, les monades et l’harmonie préétablie. Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d’avoir des amis. Zadig prononça: Que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. [1]Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre l’itimadoulet de Médie, nommé Irax. C’était un grand seigneur dont le fonds n’était pas mauvais, mais qui était corrompu par la vanité et par la volupté. Il souffrait rarement qu’on lui parlât, et jamais qu’on l’osât contredire. Les paons ne sont pas plus vains, les colombes ne sont pas plus voluptueuses, les tortues ont moins de paresse; il ne respirait que la fausse gloire et les faux plaisirs: Zadig entreprit de le corriger. Toute la fin de ce chapitre a paru, pour la première fois dans les éditions de Kehl. B. Il lui envoya de la part du roi un maître de musique avec douze voix et vingt-quatre violons, un maître-d’hôtel avec six cuisiniers et quatre chambellans, qui ne devaient pas le quitter. L’ordre du roi portait que l’étiquette suivante serait inviolablement observée; et voici comme les choses se passèrent. Le premier jour, dès que le voluptueux Irax fut éveillé, le maître de musique entra, suivi des voix et des violons: on chanta une cantate qui dura deux heures, et, de trois minutes en trois minutes, le refrain était: Que son mérite est extrême! Que de grâces! que de grandeur! Ah! combien monseigneur Doit être content de lui-même! Après l’exécution de la cantate un chambellan lui fit une harangue de trois quarts d’heure, dans laquelle on le louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au son des instruments. Le dîner dura trois heures; dès qu’il ouvrit la bouche pour parler, le premier chambellan dit: II aura raison. A peine eut-il prononcé quatre paroles que le second chambellan s’écria: II a raison! Les deux autres chambellans firent de grands éclats de rire des bons mots qu’Irax avait dits ou qu’il avait dû dire. Après dîner on lui répéta la cantate. Cette première journée lui parut délicieuse, il crut que le roi des rois l’honorait selon ses mérites; la seconde lui parut moins agréable; la troisième fut gênante; la quatrième-fût insupportable; la cinquième fut un supplice: enfin, outré d’entendre toujours cbanter, Ah! combien monseigneur Doit être content de lui-même! d’entendre toujours dire qu’il avait raison, et d’être harangué chaque jour à la même heure, il écrivit en cour pour supplier le roi qu’il daignât rappeler ses chambellans, ses musiciens, son maître-d’hôtel; il promit d’être désormais moins vain et plus appliqué; il se fit moins encenser, eut moins de fêtes, et fut plus heureux; car, comme dit le Sadder, toujours du plaisir n’est pas du plaisir.
C’est ainsi que Zadig montrait tous les jours la subtilité de son génie et la bonté de son âme; on l’admirait, et cependant on l’aimait. Il passait pour le plus fortuné de tous les hommes, tout l’empire était rempli de son nom; toutes les femmes le lorgnaient; tous les citoyens célébraient sa justice; les savants le regardaient comme leur oracle; les prêtres même avouaient qu’il en savait plus que le vieux archimage Yébor. On était bien loin alors de lui faire des procès sur les griffons; on ne croyait que ce qui lui semblait croyable. Il y avait une grande querelle dans Babylone qui durait depuis quinze cents années, et qui partageait l’empire en deux sectes opiniâtres: l’une prétendait qu’il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mithra que du pied gauche; l’autre avait cette coutume en abomination, et n’entrait jamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig. L’univers avait les yeux sur ses deux pieds, et toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds joints, et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre, qui n’a acception de personne, ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite. L’Envieux et sa femme prétendirent que dans son discours il n’y avait pas assez de figures, qu’il n’avait pas fait assez danser les montagnes et les collines. Il est sec et sans génie, disaient-ils; on ne voit chez lui ni la mer s’enfuir, ni les étoiles tomber, ni le soleil se fondre comme de la cire; il n’a point le bon style oriental. Zadig se contentait d’avoir le style de la raison. Tout le monde fut pour lui, non pas parce qu’il était dans le bon chemin, non pas parcequ’il était raisonnable, non pas parcequ’il était aimable, mais parce qu’il était premier vizir.
Il termina aussi heureusement le grand procès entre les mages blancs et les mages noirs. Les blancs soutenaient que c’était une impiété de se tourner, en priant Dieu, vers l’orient d’hiver; les noirs assuraient que Dieu avait en horreur les prières des hommes qui se tournaient vers le couchant d’été. Zadig ordonna qu’on se tournât comme on voudrait. Il trouva ainsi le secret d’expédier le matin les affaires particulières et les générales: le reste du jour il s’occupait des embellissements de Babylone: il faisait représenter des tragédies où l’on pleurait, et des comédies où l’on riait; ce qui était passé de mode depuis longtemps, et ce qu’il fit renaître parce qu’il avait du goût. Il ne prétendait pas en savoir plus que les artistes; il les récompensait par des bienfaits et des distinctions, et n’était point jaloux en secret de leurs talents. Le soir il amusait beaucoup le roi, et surtout la reine. Le roi disait: Le grand ministre! la reine disait: L’aimable ministre! et tous deux ajoutaient: C’eût été grand dommage qu’il eût été pendu. Jamais homme en place ne fut obligé de donner tant d’audiences aux dames. La plupart venaient lui parler des affaires qu’elles n’avaient point, pour en avoir une avec lui. La femme de l’Envieux s’y présenta des premières; elle lui jura par Mithra, par le Zenda-Vesta, et par le feu sacré, qu’elle avait détesté la conduite de son mari; elle lui confia ensuite que ce mari était un jaloux, un brutal; elle lui fit entendre que les dieux le punissaient, en lui refusant les précieux effets de ce feu sacré par lequel seul l’homme est semblable aux immortels: elle finit par laisser tomber sa jarretière; Zadig la ramassa avec sa politesse ordinaire; mais il ne la rattacha point au genou de la dame; et cette petite faute, si c’en est une, fut la cause des plus horribles infortunes. Zadig n’y pensa pas, et la femme de l’Envieux y pensa beaucoup. D’autres dames se présentaient tous les jours. Les annales secrètes de Babylone prétendent qu’il succomba une fois, mais qu’il fut tout étonné de jouir sans volupté, et d’embrasser son amante avec distraction. Celle à qui il donna, sans presque s’en apercevoir, des marques de sa protection, était une femme de chambre de la reine Astarté. Cette tendre Babylonienne se disait à elle-même pour se consoler: Il faut que cet homme-là ait prodigieusement d’affaires dans la tête, puisqu’il y songe encore même en faisant l’amour. Il échappa à Zadig, dans les instants où plusieurs personnes ne disent mot, et où d’autres ne prononcent que des paroles sacrées, de s’écrier tout d’un coup. La reine! La Babylonienne crut qu’enfin il était revenu à lui dans un bon moment, et qu’il lui disait: Ma reine. Mais Zadig, toujours très distrait, prononça le nom d’Astarté. La dame, qui dans ces heureuses circonstances interprétait tout à son avantage, s’imagina que cela voulait dire: Vous êtes plus belle que la reine Astarté. Elle sortit du sérail de Zadig avec de très beaux présents. Elle alla conter son aventure à l’Envieuse, qui était son amie intime; celle-ci fut cruellement piquée de la préférence. Il n’a pas daigné seulement, dit-elle, me rattacher cette jarretière que voici, et dont je ne veux plus me servir. Oh! oh! dit la fortunée à l’Envieuse, vous portez les mêmes jarretières que la reine! Vous les prenez donc chez la même faiseuse? L’Envieuse rêva profondément, ne répondit rien, et alla consulter son mari l’Envieux. Cependant Zadig s’apercevait qu’il avait toujours des distractions quand il donnait des audiences, et quand il jugeait: il ne savait à quoi les attribuer; c’était là sa seule peine. Il eut un songe: il lui semblait qu’il était couché d’abord sur des herbes sèches, parmi lesquelles il y en avait quelques unes de piquantes qui l’incommodaient; et qu’ensuite il reposait mollement sur un lit de roses, dont il sortait un serpent qui le blessait au cœur de sa langue acérée et envenimée. Hélas! disait-il, j’ai été longtemps couché sur ces herbes sèches et piquantes, je suis maintenant sur le lit de roses; mais quel sera le serpent?
Le malheur de Zadig vint de son bonheur même, et surtout de son mérite. Il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté son auguste épouse. Les charmes de sa conversation redoublaient encore par cette envie de plaire qui est à l’esprit ce que la parure est à la beauté; sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s’aperçut pas d’abord. Sa passion croissait dans le sein de l’innocence. Astarté se livrait sans scrupule et sans crainte au plaisir de voir et d’entendre un homme cher à son époux et à l’état; elle ne cessait de le vanter au roi; elle en parlait à ses femmes, qui enchérissaient encore sur ses louanges; tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu’elle ne sentait pas. Elle faisait des présents à Zadig, dans lesquels il entrait plus de galanterie qu’elle ne pensait; elle croyait ne lui parler qu’en reine contente de ses services, et quelquefois ses expressions étaient d’une femme sensible. Astarté était beaucoup plus belle que cette Sémire qui haïssait tant les borgnes, et que cette autre femme qui avait voulu couper le nez à son époux. La familiarité d’Astarté, ses discours tendres, dont elle commençait à rougir, ses regards, qu’elle voulait détourner, et qui se fixaient sur les siens, allumèrent dans le cœur de Zadig un feu dont il s’étonna. Il combattit; il appela à son secours la philosophie, qui l’avait toujours secouru; il n’en tira que des lumières, et n’en reçut aucun soulagement. Le devoir, la reconnaissance, la majesté souveraine violée, se présentaient à ses yeux comme des dieux vengeurs; il combattait, il triomphait; mais cette victoire, qu’il fallait remporter à tout moment, lui coûtait des gémissements et des larmes. Il n’osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charmes pour tous deux: ses yeux se couvraient d’un nuage; ses discours étaient contraints et sans suite: il baissait la vue; et quand, malgré lui, ses regards se tournaient vers Astarté, ils rencontraient ceux de la reine mouillés de pleurs, dont il partait des traits de flamme; ils semblaient se dire l’un à l’autre: Nous nous adorons, et nous craignons de nous aimer; nous brûlons tous deux d’un feu que nous condamnons. Zadig sortait d’auprès d’elle égaré, éperdu, le cœur surchargé d’un fardeau qu’il ne pouvait plus porter: dans la violence de ses agitations, il laissa pénétrer son secret à son ami Cador, comme un homme qui, ayant soutenu longtemps les atteintes d’une vive douleur, fait enfin connaître son mal par un cri qu’un redoublement aigu lui arrache, et par la sueur froide qui coule sur son front. Cador lui dit: J’ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même; les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre. Jugez, mon cher Zadig, puisque j’ai lu dans votre cœur, si le roi n’y découvrira pas un sentiment qui l’offense. Il n’a d’autre défaut que celui d’être le plus jaloux des hommes. Vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne, parce que vous êtes philosophe, et parce que vous êtes Zadig. Astarté est femme; elle laisse parler ses regards avec d’autant plus d’imprudence qu’elle ne se croit pas encore coupable. Malheureusement rassurée sur son innocence, elle néglige des dehors nécessaires. Je tremblerai pour elle, tant qu’elle n’aura rien à se reprocher. Si vous étiez d’accord l’un et l’autre, vous sauriez tromper tous les yeux: une passion naissante et combattue éclate; un amour satisfait sait se cacher. Zadig frémit à la proposition de trahir le roi, son bienfaiteur; et jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d’un crime involontaire. Cependant la reine prononçait si souvent le nom de Zadig, son front se couvrait de tant de rougeur en le prononçant, elle était tantôt si animée; tantôt si interdite, quand elle lui parlait en présence du roi; une rêverie si profonde s’emparait d’elle quand il était sorti, que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu’il voyait, et imagina tout ce qu’il ne voyait point. Il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues, et que les babouches de Zadig étaient bleues, que les rubans de sa femme étaient jaunes, et que le bonnet de Zadig était jaune; c’étaient là de terribles indices pour un prince délicat. Les soupçons se tournèrent en certitude dans son esprit aigri. Tous les esclaves des rois et des reines sont autant d’espions de leurs cœurs. On pénétra bientôt qu’Astarté était tendre, et que Moabdar était jaloux. L’Envieux engagea l’Envieuse à envoyer au roi sa jarretière, qui ressemblait à celle de la reine. Pour surcroît de malheur, cette jarretière était bleue. Le monarque ne songea plus qu’à la manière de se venger. Il résolut une nuit d’empoisonner la reine, et de faire mourir Zadig par le cordeau au point du jour. L’ordre en fut donné à un impitoyable eunuque, exécuteur de ses vengeances. Il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était muet, mais qui n’était pas sourd. On le souffrait toujours: il était témoin de ce qui se passait de plus secret, comme un animal domestique. Ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig. Il entendit, avec autant de surprise que d’horreur, donner l’ordre de leur mort. Mais comment faire pour prévenir cet ordre effroyable, qui allait s’exécuter dans peu d’heures? Il ne savait pas écrire; mais il avait appris à peindre, et savait surtout faire ressembler. Il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu’il voulait faire entendre à la reine. Son dessin représentait le roi agité de fureur, dans un coin du tableau, donnant des ordres à son eunuque; un cordeau bleu et un vase sur une table, avec des jarretières bleues et des rubans jaunes; la reine, dans le milieu du tableau, expirante entre les bras de ses femmes; et Zadig étranglé à ses pieds. L’horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire aux premiers rayons de l’aurore. Dès qu’il eut fini cet ouvrage, il courut chez une femme d’Astarté, la réveilla, et lui fit entendre qu’il fallait dans l’instant même porter ce tableau à la reine. Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper à la porte de Zadig; on le réveille; on lui donne un billet de la reine; il doute si c’est un songe; il ouvre la lettre d’une main tremblante. Quelle fut sa surprise, et qui pourrait exprimer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il lut ces paroles: «Fuyez dans l’instant même, ou l’on va vous arracher la vie! Fuyez, Zadig; je vous l’ordonne au nom de notre amour et de mes rubans jaunes. Je n’étais point coupable; mais je sens que je vais mourir criminelle.» Zadig eut à peine la force de parler. Il ordonna qu’on fît venir Cador; et, sans lui rien dire, il lui donna ce billet. Cador le força d’obéir, et de prendre sur-le-champ la route de Memphis. Si vous osez aller trouver la reine, lui dit-il, vous hâtez sa mort; si vous parlez au roi, vous la perdez encore. Je me charge de sa destinée; suivez la vôtre. Je répandrai le bruit que vous avez pris la route des Indes. Je viendrai bientôt vous trouver, et je vous apprendrai ce qui se sera passé à Babylone. Cador, dans le moment même, fit placer deux dromadaires des plus légers à la course vers une porte secrète du palais: il y fit monter Zadig, qu’il fallut porter, et qui était près de rendre l’âme. Un seul domestique l’accompagna; et bientôt Cador, plongé dans l’étonnement et dans la douleur, perdit son ami de vue. Cet illustre fugitif, arrivé sur le bord d’une colline dont on voyait Babylone, tourna la vue sur le palais de la reine, et s’évanouit; il ne reprit ses sens que pour verser des larmes, et pour souhaiter la mort. Enfin, après s’être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde, il fit un moment de retour sur lui-même, et s’écria: Qu’est-ce donc que la vie humaine? O vertu! à quoi m’avez-vous servi? Deux femmes m’ont indignement trompé; la troisième, qui n’est point coupable, et qui est plus belle que les autres, va mourir! Tout ce que j’ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédictions, et je n’ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l’infortune. Si j’eusse été méchant comme tant d’autres, je serais heureux comme eux. Accablé de ces réflexions funestes, les yeux chargés du voile de la douleur, la pâleur de la mort sur le visage, et l’âme abîmée dans l’excès d’un sombre désespoir, il continuait son voyage vers l’Egypte.
Zadig dirigeait sa route sur les étoiles. La constellation d’Orion et le brillant astre de Sirius le guidaient vers le port[1] de Canope. Il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux, tandis que la terre, qui n’est en effet qu’un point imperceptible dans la nature, paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble. Il se figurait alors les hommes tels qu’ils sont en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Cette image vraie semblait anéantir ses malheurs, en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone. Son âme s’élançait jusque dans l’infini, et contemplait, détachée de ses sens, l’ordre immuable de l’univers. Mais lorsque ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans son cœur, il pensait qu’Astarté était peut-être morte pour lui, l’univers disparaissait à ses yeux, et il ne voyait dans la nature entière qu’Astarté mourante et Zadig infortuné. Comme il se livrait à ce flux et à ce reflux de philosophie sublime et de douleur accablante, il avançait vers les frontières de l’Egypte; et déjà son domestique fidèle était dans la première bourgade, où il lui cherchait un logement. Zadig cependant se promenait vers les jardins qui bordaient ce village. Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours, et un homme furieux qui la suivait. Elle était déjà atteinte par lui, elle embrassait ses genoux. Cet homme l’accablait de coups et de reproches. Il jugea, à la violence de l’Egyptien et aux pardons réitérés que lui demandait la dame, que l’un était un jaloux, et l’autre une infidèle; mais quand il eut considéré cette femme, qui était d’une beauté touchante, et qui même ressemblait un peu à la malheureuse Astarté, il se sentit pénétré de compassion pour elle, et d’horreur pour l’Égyptien. Secourez-moi, s’écria-t-elle à Zadig avec des sanglots; tirez-moi des mains du plus barbare des hommes, sauvez-moi la vie! A ces cris, Zadig courut se jeter entre elle et ce barbare. Il avait quelque connaissance de la langue égyptienne. Il lui dit en cette langue: Si vous avez quelque humanité, je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse. Pouvez-vous outrager ainsi un chef-d’œuvre de la nature, qui est à vos pieds, et qui n’a pour sa défense que des larmes? Ah! ah! lui dit cet emporté, tu l’aimes donc aussi! et c’est de toi qu’il faut que je me venge. En disant ces paroles, il laisse la dame, qu’il tenait d’une main par les cheveux, et, prenant sa lance, il veut en percer l’étranger. Celui-ci, qui était de sang-froid, évita aisément le coup d’un furieux. Il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée. L’un veut la retirer, l’autre l’arracher. Elle se brise entre leurs mains. L’Égyptien tire son épée; Zadig s’arme de la sienne. Ils s’attaquent l’un l’autre. Celui-là porte cent coups précipités; celui-ci les pare avec adresse. La dame, assise sur un gazon, rajuste sa coiffure, et les regarde. L’Égyptien était plus robuste que son adversaire, Zadig était plus adroit. Celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras, et celui-là comme un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard. Zadig passe à lui, et le désarme; et tandis que l’Égyptien, devenu plus furieux, veut se jeter sur lui, il le saisit, le presse, le fait tomber en lui tenant l’épée sur la poitrine; il lui offre de lui donner la vie. L’Égyptien hors de lui tire son poignard; il en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait. Zadig indigné lui plonge son épée dans le sein. L’Égyptien jette un cri horrible, et meurt en se débattant. Zadig alors s’avança vers la dame, et lui dit d’une voix soumise: Il m’a forcé de le tuer: je vous ai vengée; vous êtes délivrée de l’homme le plus violent que j’aie jamais vu. Que voulez-vous maintenant de moi, madame? Que tu meures, scélérat, lui répondit-elle; que tu meures! tu as tué mon amant; je voudrais pouvoir déchirer ton cœur. En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit Zadig; il vous battait de toutes ses forces, et il voulait m’arracher la vie parce que vous m’avez conjuré de vous secourir. Je voudrais qu’il me battît encore, reprit la dame en poussant des cris. Je le méritais bien, je lui avais donné de la jalousie. Plût au ciel qu’il me battît, et que tu fusses à sa place! Zadig, plus surpris et plus en colère qu’il ne l’avait été de sa vie, lui dit: Madame, toute belle que vous êtes, vous mériteriez que je vous battisse à mon tour, tant vous êtes extravagante; mais je n’en prendrai pas la peine. Là-dessus il remonta sur son chameau, et avança vers le bourg. A peine avait-il fait quelques pas qu’il se retourne au bruit que faisaient quatre courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride. L’un d’eux, en voyant cette femme, s’écria: C’est elle-même! elle ressemble au portrait qu’on nous en a fait. Ils ne s’embarrassèrent pas du mort, et se saisirent incontinent de la dame. Elle ne cessait de crier à Zadig: Secourez-moi encore une fois, étranger généreux! je vous demande pardon de m’être plainte de vous: secourez-moi, et je suis à vous jusqu’au tombeau! L’envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle. A d’autres, répond-il; vous ne m’y attraperez plus. D’ailleurs il était blessé, son sang coulait, il avait besoin de secours; et la vue des quatre Babyloniens, probablement envoyés par le roi Moabdar, le remplissait d’inquiétude. Il s’avance en hâte vers le village, n’imaginant pas pourquoi quatre courriers de Babylone venaient prendre cette Egyptienne, mais encore plus étonné du caractère de cette dame.
Comme il entrait dans la bourgade égyptienne, il se vit entouré par le peuple. Chacun criait: Voilà celui qui a enlevé la belle Missouf, et qui vient d’assassiner Clétofis! Messieurs, dit-il, Dieu me préserve d’enlever jamais votre belle Missouf! elle est trop capricieuse; et, à l’égard de Clétofis, je ne l’ai point assassiné; je me suis défendu seulement contre lui. Il voulait me tuer, parce que je lui avais demandé très humblement grâce pour la belle Missouf, qu’il battait impitoyablement. Je suis un étranger qui vient chercher un asile dans l’Egypte; et il n’y a pas d’apparence qu’en venant demander votre protection, j’aie commencé par enlever une femme, et par assassiner un homme. Les Egyptiens étaient alors justes et humains. Le peuple conduisit Zadig à la maison de ville. On commença par le faire panser de sa blessure, et ensuite on l’interrogea, lui et son domestique séparément, pour savoir la vérité. On reconnut que Zadig n’était point un assassin; mais il était coupable du sang d’un homme: la loi le condamnait à être esclave. On vendit au profit de la bourgade ses deux chameaux; on distribua aux habitants tout l’or qu’il avait apporté; sa personne fut exposée en vente dans la place publique, ainsi que celle de son compagnon de voyage. Un marchand arabe, nommé Sétoc, y mit l’enchère; mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu bien plus chèrement que le maître. On ne faisait pas de comparaison entre ces deux hommes. Zadig fut donc esclave subordonné à son valet: on les attacha ensemble avec une chaîne qu’on leur passa aux pieds, et en cet état ils suivirent le marchand arabe dans sa maison. Zadig, en chemin, consolait son domestique, et l’exhortait à la patience; mais, selon sa coutume, il faisait des réflexions sur la vie humaine. Je vois, lui disait-il, que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne. Tout m’a tourné jusqu’ici d’une façon bien étrange. J’ai été condamné à l’amende pour avoir vu passer une chienne; j’ai pensé être empalé pour un griffon; j’ai été envoyé au supplice parce que j’avais fait des vers à la louange du roi; j’ai été sur le point d’être étranglé parce que la reine avait des rubans jaunes, et me voici esclave avec toi parce qu’un brutal a battu sa maîtresse. Allons, ne perdons point courage; tout ceci finira peut-être; il faut bien que les marchands arabes aient des esclaves; et pourquoi ne le serais-je pas comme un autre, puisque je suis homme comme un autre? Ce marchand ne sera pas impitoyable; il faut qu’il traite bien ses esclaves, s’il en veut tirer des services. Il parlait ainsi, et dans le fond de son cœur il était occupé du sort de la reine de Babylone. Sétoc, le marchand, partit deux jours après pour l’Arabie déserte avec ses esclaves et ses chameaux. Sa tribu habitait vers le désert d’Horeb. Le chemin fut long et pénible. Sétoc, dans la route, faisait bien plus de cas du valet que du maître, parce que le premier chargeait bien mieux les chameaux; et toutes les petites distinctions furent pour lui. Un chameau mourut à deux journées d’Horeb: on répartit sa charge sur le dos de chacun des serviteurs; Zadig en eut sa part. Sétoc se mit à rire en voyant tous ses esclaves marcher courbés. Zadig prit la liberté de lui en expliquer la raison, et lui apprit les lois de l’équilibre. Le marchand étonné commença à le regarder d’un autre oeil. Zadig, voyant qu’il avait excité sa curiosité, la redoubla en lui apprenant beaucoup de choses qui n’étaient point étrangères à son commerce; les pesanteurs spécifiques des métaux et des denrées sous un volume égal; les propriétés de plusieurs animaux utiles; le moyen de rendre tels ceux qui ne l’étaient pas; enfin il lui parut un sage. Sétoc lui donna la préférence sur son camarade, qu’il avait tant estimé. Il le traita bien, et n’eut pas sujet de s’en repentir. Arrivé dans sa tribu, Sétoc commença par redemander cinq cents onces d’argent à un Hébreu auquel il les avait prêtées en présence de deux témoins; mais ces deux témoins étaient morts, et l’Hébreu, ne pouvant être convaincu, s’appropriait l’argent du marchand, en remerciant Dieu de ce qu’il lui avait donné le moyen de tromper un Arabe. Sétoc confia sa peine à Zadig, qui était devenu son conseil. En quel endroit, demanda Zadig, prêtâtes-vous vos cinq cents onces à cet infidèle? Sur une large pierre, répondit le marchand, qui est auprès du mont Horeb. Quel est le caractère de votre débiteur? dit Zadig. Celui d’un fripon, reprit Sétoc. Mais je vous demande si c’est un homme vif ou flegmatique, avisé ou imprudent. C’est de tous les mauvais payeurs, dit Sétoc, le plus vif que je connaisse. Eh bien! insista Zadig, permettez que je plaide votre cause devant le juge. En effet il cita l’Hébreu au tribunal, et il parla ainsi au juge: Oreiller du trône d’équité, je viens redemander à cet homme, au nom de mon maître, cinq cents onces d’argent qu’il ne veut pas rendre. Avez-vous des témoins? dit le juge. Non, ils sont morts; mais il reste une large pierre sur laquelle l’argent fut compté; et s’il plaît à votre grandeur d’ordonner qu’on aille chercher la pierre, j’espère qu’elle portera témoignage; nous resterons ici l’Hébreu et moi, en attendant que la pierre vienne; je l’enverrai chercher aux dépens de Sétoc, mon maître. Très volontiers, répondit le juge; et il se mit à expédier d’autres affaires. A la fin de l’audience: Eh bien! dit-il à Zadig, votre pierre n’est pas encore venue? L’Hébreu, en riant, répondit: Votre grandeur resterait ici jusqu’à demain que la pierre ne serait pas encore arrivée; elle est à plus de six milles d’ici, et il faudrait quinze hommes pour la remuer. Eh bien! s’écria Zadig, je vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage; puisque cet homme sait où elle est, il avoue donc que c’est sur elle que l’argent fut compté. L’Hébreu déconcerté fut bientôt contraint de tout avouer. Le juge ordonna qu’il serait lié à la pierre, sans boire ni manger, jusqu’à ce qu’il eût rendu les cinq cents onces, qui furent bientôt payées. L’esclave Zadig et la pierre furent en grande recommandation dans l’Arabie.
Sétoc enchanté fit de son esclave son ami intime. Il ne pouvait pas plus se passer de lui qu’avait fait le roi de Babylone; et Zadig fut heureux que Sétoc n’eût point de femme. Il découvrait dans son maître un naturel porté au bien, beaucoup de droiture et de bon sens. Il fut fâché de voir qu’il adorait l’armée céleste, c’est-à-dire le soleil, la lune, et les étoiles, selon l’ancien usage d’Arabie. Il lui en parlait quelquefois avec beaucoup de discrétion. Enfin il lui dit que c’étaient des corps comme les autres, qui ne méritaient pas plus son hommage qu’un arbre ou un rocher. Mais, disait Sétoc, ce sont des êtres éternels dont nous tirons tous nos avantages; ils animent la nature; ils règlent les saisons; ils sont d’ailleurs si loin de nous qu’on ne peut pas s’empêcher de les révérer. Vous recevez plus d’avantages, répondit Zadig, des eaux de la mer Rouge, qui porte vos marchandises aux Indes. Pourquoi ne serait-elle pas aussi ancienne que les étoiles? Et si vous adorez ce qui est éloigné de vous, vous devez adorer la terre des Gangarides, qui est aux extrémités du monde. Non, disait Sétoc, les étoiles sont trop brillantes pour que je ne les adore pas. Le soir venu, Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait souper avec Sétoc; et dès que son patron parut, il se jeta à genoux devant ces cires allumées, et leur dit: Éternelles et brillantes clartés, soyez-moi toujours propices! Ayant proféré ces paroles, il se mit à table sans regarder Sétoc. Que faites-vous donc? lui dit Sétoc étonné. Je fais comme vous, répondit Zadig; j’adore ces chandelles, et je néglige leur maître et le mien. Sétoc comprit le sens profond de cet apologue. La sagesse de son esclave entra dans son âme; il ne prodigua plus son encens aux créatures, et adora l’Etre éternel qui les a faites. Il y avait alors dans l’Arabie une coutume affreuse, venue originairement de Scythie, et qui, s’étant établie dans les Indes par le crédit des brachmanes, menaçait d’envahir tout l’orient. Lorsqu’un homme marié était mort, et que sa femme bien-aimée voulait être sainte, elle se brûlait en public sur le corps de son mari. C’était une fête solennelle qui s’appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans laquelle il y avait eu le plus de femmes brûlées était la plus considérée. Un Arabe de la tribu de Sétoc étant mort, sa veuve, nommée Almona, qui était fort dévote, fit savoir le jour et l’heure où elle se jetterait dans le feu au son des tambours et des trompettes. Zadig remontra à Sétoc combien cette horrible coutume était contraire au bien du genre humain; qu’on laissait brûler tous les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des enfants à l’état, ou du moins élever les leurs; et il le fit convenir qu’il fallait, si on pouvait, abolir un usage si barbare. Sétoc répondit: Il y a plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler. Qui de nous osera changer une loi que le temps a consacrée? Y a-t-il rien de plus respectable qu’un ancien abus? La raison est plus ancienne, reprit Zadig. Parlez aux chefs des tribus, et je vais trouver la jeune veuve. Il se fit présenter à elle; et après s’être insinué dans son esprit par des louanges sur sa beauté, après lui avoir dit combien c’était dommage de mettre au feu tant de charmes, il la loua encore sur sa constance et sur son courage. Vous aimiez donc prodigieusement votre mari? lui dit-il. Moi? point du tout, répondit la dame arabe. C’était un brutal, un jaloux, un homme insupportable; mais je suis fermement résolue de me jeter sur son bûcher. Il faut, dit Zadig, qu’il y ait apparemment un plaisir bien délicieux à être brûlée vive. Ah! cela fait frémir la nature, dit la dame; mais il faut en passer par là. Je suis dévote; je serais perdue de réputation, et tout le monde se moquerait de moi si je ne me brûlais pas. Zadig, l’ayant fait convenir qu’elle se brûlait pour les autres et par vanité, lui parla longtemps d’une manière à lui faire aimer un peu la vie, et parvint même à lui inspirer quelque bienveillance pour celui qui lui parlait. Que feriez-vous enfin, lui dit-il, si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas? Hélas! dit la dame, je crois que je vous prierais de m’épouser. Zadig était trop rempli de l’idée d’Astarté pour ne pas éluder cette déclaration; mais il alla dans l’instant trouver les chefs des tribus, leur dit ce qui s’était passé, et leur conseilla de faire une loi par laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu’après avoir entretenu un jeune homme tête à tête pendant une heure entière. Depuis ce temps, aucune dame ne se brûla en Arabie. On eut au seul Zadig l’obligation d’avoir détruit en un jour une coutume si cruelle, qui durait depuis tant de siècles. Il était donc le bienfaiteur de l’Arabie.
Sétoc, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Bassora, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d’hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l’univers était une grande famille qui se rassemblait à Bassora. Il se trouva à table dès le second jour avec un Egyptien, un Indien gangaride, un habitant du Cathay, un Grec, un Celte, et plusieurs autres étrangers qui, dans leurs fréquents voyages vers le golfe Arabique, avaient appris assez d’arabe pour se faire entendre. L’Egyptien paraissait fort en colère. Quel abominable pays que Bassora! disait-il; on m’y refuse mille onces d’or sur le meilleur effet du monde. Comment donc, dit Sétoc, sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme? Sur le corps de ma tante, répondit l’Égyptien; c’était la plus brave femme d’Egypte. Elle m’accompagnait toujours; elle est morte en chemin; j’en ai fait une des plus belles momies que nous ayons; et je trouverais dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage. Il est bien étrange qu’on ne veuille pas seulement me donner ici mille onces d’or sur un effet si solide. Tout en se courrouçant, il était prêt de manger d’une excellente poule bouillie, quand l’Indien, le prenant par la main, s’écria avec douleur: Ah! qu’allez-vous faire? Manger de cette poule, dit l’homme à la momie. Gardez-vous-en bien, dit le Gangaride; il se pourrait faire que l’âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante. Faire cuire des poules, c’est outrager manifestement la nature. Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules? reprit le colérique Egyptien; nous adorons un bœuf, et nous en mangeons bien. Vous adorez un bœuf! est-il possible? dit l’homme du Gange. Il n’y a rien de si possible, repartit l’autre; il y a cent trente-cinq mille ans que nous en usons ainsi, et personne parmi nous n’y trouve à redire. Ah! cent trente-cinq mille ans! dit l’Indien, ce compte est un peu exagéré; il n’y en a que quatre-vingt mille que l’Inde est peuplée, et assurément nous sommes vos anciens; et Brama nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les autels et à la broche. Voilà un plaisant animal que votre Brama, pour le comparer à Apis! dit l’Egyptien; qu’a donc fait votre Brama de si beau? Le bramin répondit: C’est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui toute la terre doit le jeu des échecs. Vous vous trompez, dit un Chaldéen qui était auprès de lui; c’est le poisson Oannès à qui on doit de si grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu’à lui ses hommages. Tout le monde vous dira que c’était un être divin, qu’il avait la queue dorée, avec une belle tête d’homme, et qu’il sortait de l’eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour. Il eut plusieurs enfants qui furent tous rois, comme chacun sait. J’ai son portrait chez moi, que je révère comme je le dois. On peut manger du bœuf tant qu’on veut; mais c’est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson; d’ailleurs vous êtes tous deux d’une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer. La nation égyptienne ne compte que cent trente-cinq mille ans, et les Indiens ne se vantent que de quatre-vingt mille, tandis que nous avons des almanachs de quatre mille siècles. Croyez-moi, renoncez à vos folies, et je vous donnerai à chacun un beau portrait d’Oannès. L’homme de Cambalu, prenant la parole, dit: Je respecte fort les Egyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Celtes, Brama, le bœuf Apis, le beau poisson Oannès; mais peut-être que le Li ou le Tien[a], comme on voudra l’appeler, vaut bien les bœufs et les poissons. Je ne dirai rien de mon pays; il est aussi grand que la terre d’Egypte, la Chaldée, et les Indes ensemble. Je ne dispute pas d’antiquité, parce qu’il suffit d’être heureux, et que c’est fort peu de chose d’être ancien; mais, s’il fallait parler d’almanachs, je dirais que toute l’Asie prend les nôtres, et que nous en avions de fort bons avant qu’on sut l’arithmétique en Chaldée. Mots chinois qui signifient proprement: li, la lumière naturelle, la raison; et tien, le ciel; et qui signifient aussi Dieu. Vous êtes de grands ignorants tous tant que vous êtes! s’écria le Grec: est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout, et que la forme et la matière ont mis le monde dans l’état où il est? Ce Grec parla longtemps; mais il fut enfin interrompu par le Celte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu’on disputait, se crut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu’il n’y avait que Teutath et le gui de chêne qui valussent la peine qu’on en parlât; que, pour lui, il avait toujours du gui dans sa poche; que les Scythes, ses ancêtres, étaient les seules gens de bien qui eussent jamais été au monde; qu’ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes, mais que cela n’empêchait pas qu’on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation; et qu’enfin, si quelqu’un parlait mal de Teutath, il lui apprendrait à vivre. La querelle s’échauffa pour lors, et Sétoc vit le moment où la table allait être ensanglantée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin: il s’adressa d’abord au Celte, comme au plus furieux; il lui dit qu’il avait raison, et lui demanda du gui; il loua le Grec sur son éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de chose à l’homme du Cathay, parce qu’il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite il leur dit: Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien, car vous êtes tous du même avis. A ce mot, ils se récrièrent tous. N’est-il pas vrai, dit-il au Celte, que vous n’adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gui et le chêne? Assurément, répondit le Celte. Et vous, monsieur l’Egyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs? Oui, dit l’Egyptien. Le poisson Oannès, continua-t-il, doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. D’accord, dit le Chaldéen. L’Indien, ajouta-t-il, et le Cathayen, reconnaissent comme vous un premier principe; je n’ai pas trop bien compris les choses admirables que le Grec a dites, mais je suis sûr qu’il admet aussi un Etre supérieur, de qui la forme et la matière dépendent. Le Grec qu’on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. Vous êtes donc tous de même avis, répliqua Zadig, et il n’y a pas là de quoi se quereller. Tout le monde l’embrassa. Sétoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig apprit en arrivant qu’on lui avait fait son procès en son absence, et qu’il allait être brûlé à petit feu.
Pendant son voyage à Bassora, les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir. Les pierreries et les ornements des jeunes veuves qu’ils envoyaient au bûcher leur appartenaient de droit; c’était bien le moins qu’ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu’il leur avait joué. Ils accusèrent donc Zadig d’avoir des sentiments erronés sur l’armée céleste; ils déposèrent contre lui, et jurèrent qu’ils lui avaient entendu dire que les étoiles ne se couchaient pas dans la mer. Ce blasphème effroyable fit frémir les juges; ils furent prêts de déchirer leurs vêtements, quand ils ouïrent ces paroles impies, et ils l’auraient fait, sans doute, si Zadig avait eu de quoi les payer; mais, dans l’excès de leur douleur, ils se contentèrent de le condamner à être brûlé à petit feu. Sétoc, désespéré, employa en vain son crédit pour sauver son ami; il fut bientôt obligé de se taire. La jeune veuve Almona, qui avait pris beaucoup de goût à la vie, et qui en avait obligation à Zadig, résolut de le tirer du bûcher, dont il lui avait fait connaître l’abus. Elle roula son dessein dans sa tête, sans en parler à personne. Zadig devait être exécuté le lendemain; elle n’avait que la nuit pour le sauver: voici comme elle s’y prit en femme charitable et prudente. Elle se parfuma; elle releva sa beauté par l’ajustement le plus riche et le plus galant, et alla demander une audience secrète au chef des prêtres des étoiles. Quand elle fut devant ce vieillard vénérable, elle lui parla en ces termes: Fils aîné de la grande Ourse, frère du Taureau, cousin du grand Chien (c’étaient les titres de ce pontife), je viens vous confier mes scrupules. J’ai bien peur d’avoir commis un péché énorme, en ne me brûlant pas dans le bûcher de mon cher mari. En effet qu’avais-je à conserver? une chair périssable, et qui est déjà toute flétrie. En disant ces paroles elle tira de ses longues manches de soie, ses bras nus d’une forme admirable et d’une blancheur éblouissante. Vous voyez, dit-elle, le peu que cela vaut. Le pontife trouva dans son cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent, et sa bouche le confirma; il jura qu’il n’avait vu de sa vie de si beaux bras. Hélas! lui dit la veuve, les bras peuvent être un peu moins mal que le reste; mais vous m’avouerez que la gorge n’était pas digne de mes attentions. Alors elle laissa voir le sein le plus charmant que la nature eût jamais formé. Un bouton de rose sur une pomme d’ivoire n’eût paru auprès que de la garance sur du buis, et les agneaux sortant du lavoir auraient semblé d’un jaune brun. Cette gorge, ses grands yeux noirs qui languissaient en brillant doucement d’un feu tendre, ses joues animées de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le plus pur; son nez, qui n’était pas comme la tour du mont Liban; ses lèvres, qui étaient comme deux bordures de corail renfermant les plus belles perles de la mer d’Arabie, tout cela ensemble fit croire au vieillard qu’il avait vingt ans. Il fit en bégayant une déclaration tendre. Almona le voyant enflammé lui demanda la grâce de Zadig. Hélas! dit-il, ma belle dame, quand je vous accorderais sa grâce, mon indulgence ne servirait de rien; il faut qu’elle soit signée de trois autres de mes confrères. Signez toujours, dit Almona. Volontiers, dit le prêtre, à condition que vos faveurs seront le prix de ma facilité. Vous me faites trop d’honneur, dit Almona; ayez seulement pour agréable de venir dans ma chambre après que le soleil sera couché, et dès que la brillante étoile Sheat sera sur l’horizon, vous me trouverez sur un sofa couleur de rose, et vous en userez comme vous pourrez avec votre servante. Elle sortit alors, emportant avec elle la signature, et laissa le vieillard plein d’amour et de défiance de ses forces. Il employa le reste du jour à se baigner; il but une liqueur composée de la cannelle de Ceylan, et des précieuses épices de Tidor et de Ternate, et attendit avec impatience que l’étoile Sheat vînt à paraître. Cependant la belle Almona alla trouver le second pontife. Celui-ci l’assura que le soleil, la lune, et tous les feux du firmament, n’étaient que des feux follets en comparaison de ses charmes. Elle lui demanda la même grâce, et on lui proposa d’en donner le prix. Elle se laissa vaincre, et donna rendez-vous au second pontife au lever de l’étoile Algénib. De là elle passa chez le troisième et chez le quatrième prêtre, prenant toujours une signature, et donnant un rendez-vous d’étoile en étoile. Alors elle fit avertir les juges de venir chez elle pour une affaire importante. Ils s’y rendirent: elle leur montra les quatre noms, et leur dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de Zadig. Chacun d’eux arriva à l’heure prescrite; chacun fut bien étonné d’y trouver ses confrères, et plus encore d’y trouver les juges devant qui leur honte fut manifestée. Zadig fut sauvé. Sétoc fut si charmé de l’habileté d’Almona, qu’il en fit sa femme.
Dans l’édition de 1748 et dans toutes celles qui l’ont suivie, jusques à l’édition de Kehl exclusivement, ce chapitre se terminait ainsi: «Zadig partit après s’être jeté aux pieds de sa belle libératrice. Sétoc et lui se quittèrent en pleurant, en se jurant une amitié éternelle, et en se promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune en ferait part à l’autre. «Zadig marcha du côté de la Syrie, toujours pensant à la malheureuse Astarté,et toujours réfléchissant sur le sort qui s’obstinait à se jouer de lui et à le persécuter. Quoi! disait-il, quatre cents onces d’or pour avoir vu passer une chienne! condamné à être décapité pour quatre mauvais vers à la louange du roi! prêt à être étranglé parceque la reine avait des babouches de la couleur de mon bonnet! réduit en esclavage pour avoir secouru une femme qu’on battait; et sur le point d’être brûlé pour avoir sauvé la vie à toutes les jeunes veuves arabes!» Venait ensuite ce qui forme aujourd’hui le chapitre XVI.
Sétoc devait aller, pour les affaires de son commerce, dans l’île de Serendib; mais le premier mois de son mariage, qui est, comme on sait, la lune du Miel, ne lui permettait ni de quitter sa femme, ni de croire qu’il pût jamais la quitter: il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage. Hélas! disait Zadig, faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi? mais il faut servir mes bienfaiteurs: il dit, il pleura; et il partit. Il ne fut pas longtemps dans l’île de Serendib, sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l’arbitre de tous les différents entre les négociants, l’ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Le roi voulut le voir et l’entendre. Il connut bientôt tout ce que valait Zadig; il eut confiance en sa sagesse, et en fit son ami. La familiarité et l’estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar. Je plais au roi, disait-il, ne serai-je pas perdu? Cependant il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté; car il faut avouer que Nabussan, roi de Serendib, fils de Nussanab, fils de Nabassun, fils de Sanbusna, était un des meilleurs princes de l’Asie; et quand on lui parlait il était difficile de ne le pas aimer. Ce bon prince était toujours loué, trompé, et volé: c’était à qui pillerait ses trésors. Le receveur général de l’île de Serendib donnait toujours cet exemple fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait; il avait changé de trésorier plusieurs fois; mais il n’avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté, et la plus grosse aux administrateurs. Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig. Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous pas le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. Le roi charmé lui demanda, en l’embrassant, comment il fallait s’y prendre. Il n’y a, dit Zadig, qu’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. Vous vous moquez, dit le roi; voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances! Quoi! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile! Je ne vous réponds pas qu’il sera le plus habile, repartit Zadig; mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. Zadig parlait avec tant de confiance, que le roi crut qu’il avait quelque secret surnaturel pour connaître les financiers. Je n’aime pas le surnaturel, dit Zadig; les gens et les livres à prodiges m’ont toujours déplu: si votre majesté veut me laisser faire l’épreuve que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. Nabussan, roi de Serendib, fut bien plus étonné d’entendre que ce secret était simple, que si on le lui avait donné pour un miracle: Or bien, dit-il, faites comme vous l’entendrez. Laissez-moi faire, dit Zadig, vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. Le jour même il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l’emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan, fils de Nussanab, eussent à se rendre, en habits de soie légère, le premier de la lune du Crocodile, dans l’antichambre du roi. Ils s’y rendirent au nombre de soixante et quatre. On avait fait venir des violons dans un salon voisin; tout était préparé pour le bal; mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l’un après l’autre, par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, sa majesté ordonna qu’on les fît danser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce; ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leurs côtés? Quels fripons! disait tout bas Zadig. Un seul d’entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. Ah! l’honnête homme! le brave homme! disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde; car chacun, dans le temps qu’il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches, et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante et quatre danseurs il y eût soixante et trois filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la Tentation. On aurait en Perse empalé ces soixante et trois seigneurs; en d’autres pays on eût fait une chambre de justice qui eût consommé en frais le triple de l’argent volé, et qui n’eût rien remis dans les coffres du souverain; dans un autre royaume, ils se seraient pleinement justifiés, et auraient fait disgracier ce danseur si léger: à Serendib, ils ne furent condamnés qu’à augmenter le trésor public, car Nabussan était fort indulgent. Il était aussi fort reconnaissant; il donna à Zadig une somme d’argent plus considérable qu’aucun trésorier n’en avait jamais volé au roi son maître. Zadig s’en servit pour envoyer des exprès à Babylone, qui devaient l’informer de la destinée d’Astarté. Sa voix trembla en donnant cet ordre, son sang reflua vers son cœur, ses yeux se couvrirent de ténèbres, son âme fut prête à l’abandonner. Le courrier partit, Zadig le vit embarquer; il rentra chez le roi, ne voyant personne, croyant être dans sa chambre, et prononçant le nom d’amour. Ah! l’amour, dit le roi; c’est précisément ce dont il s’agit; vous avez deviné ce qui fait ma peine. Que vous êtes un grand homme! j’espère que vous m’apprendrez à connaître une femme à toute épreuve, comme vous m’avez fait trouver un trésorier désintéressé. Zadig, ayant repris ses sens, lui promit de le servir en amour comme en finance, quoique la chose parût plus difficile encore.
Le corps et le cœur, dit le roi à Zadig.... A ces mots le Babylonien ne put s’empêcher d’interrompre sa majesté. Que je vous sais bon gré, dit-il, de n’avoir point dit l’esprit et le cœur! car on n’entend que ces mots dans les conversations de Babylone: on ne voit que des livres où il est question du cœur et de l’esprit, composés par des gens qui n’ont ni de l’un ni de l’autre; mais, de grâce, sire, poursuivez. Nabussan continua ainsi: Le corps et le cœur sont chez moi destinés à aimer; la première de ces deux puissances a tout lieu d’être satisfaite. J’ai ici cent femmes à mon service, toutes belles, complaisantes, prévenantes, voluptueuses même, ou feignant de l’être avec moi. Mon cœur n’est pas à beaucoup près si heureux. Je n’ai que trop éprouvé qu’on caresse beaucoup le roi de Serendib, et qu’on se soucie fort peu de Nabussan. Ce n’est pas que je croie mes femmes infidèles; mais je voudrais trouver une âme qui fût à moi; je donnerais pour un pareil trésor les cent beautés dont je possède les charmes: voyez si, sur ces cent sultanes, vous pouvez m’en trouver une dont je sois sûr d’être aimé. [1] Ce trait porte surtout contre Rollin, qui emploie souvent ces expressions dans son Traité des études. Voltaire y revient souvent: voyez, dans le présent volume, le chapitre I de Micromégas, et dans le tome XXXIV, le chapitre XI de l’Homme aux quarante écus, le chapitre IX du Taureau blanc; et tome XI, le second vers du chant VIII de la Pucelle. B. Zadig lui répondit comme il avait fait sur l’article des financiers: Sire, laissez-moi faire; mais permettez d’abord que je dispose de ce que vous aviez étalé dans la galerie de la Tentation; je vous en rendrai bon compte, et vous n’y perdrez rien. Le roi le laissa le maître absolu. Il choisit dans Serendib trente-trois petits bossus des plus vilains qu’il put trouver, trente-trois pages des plus beaux, et trente-trois bonzes des plus éloquents et des plus robustes. Il leur laissa à tous la liberté d’entrer dans les cellules des sultanes; chaque petit bossu eut quatre mille pièces d’or à donner; et dès le premier jour tous les bossus furent heureux. Les pages, qui n’avaient rien à donner qu’eux-mêmes, ne triomphèrent qu’au bout de deux ou trois jours. Les bonzes eurent un peu plus de peine; mais enfin trente-trois dévotes se rendirent à eux. Le roi, par des jalousies qui avaient vue sur toutes les cellules, vit toutes ces épreuves, et fut émerveillé. De ses cent femmes, quatre-vingt-dix-neuf succombèrent à ses yeux. Il en restait une toute jeune, toute neuve, de qui sa majesté n’avait jamais approché. On lui détacha un, deux, trois bossus, qui lui offrirent jusqu’à vingt mille pièces; elle fut incorruptible, et ne put s’empêcher de rire de l’idée qu’avaient ces bossus de croire que de l’argent les rendrait mieux faits. On lui présenta les deux plus beaux pages; elle dit qu’elle trouvait le roi encore plus beau. On lui lâcha le plus éloquent des bonzes, et ensuite le plus intrépide; elle trouva le premier un bavard, et ne daigna pas même soupçonner le mérite du second. Le cœur fait tout, disait-elle; je ne céderai jamais ni à l’or d’un bossu, ni aux grâces d’un jeune homme, ni aux séductions d’un bonze: j’aimerai uniquement Nabussan, fils de Nussanab, et j’attendrai qu’il daigne m’aimer. Le roi fut transporté de joie, d’étonnement, et de tendresse. Il reprit tout l’argent qui avait fait réussir les bossus, et en fit présent à la belle Falide; c’était le nom de cette jeune personne. Il lui donna son cœur: elle le méritait bien. Jamais la fleur de la jeunesse ne fut si brillante; jamais les charmes de la beauté ne furent si enchanteurs. La vérité de l’histoire ne permet pas de taire qu’elle fesait mal la révérence, mais elle dansait comme les fées, chantait comme les sirènes, et parlait comme les Grâces: elle était pleine de talents et de vertus. Nabussan aimé l’adora: mais elle avait les yeux bleus, et ce fut la source des plus grands malheurs. Il y avait une ancienne loi qui défendait aux rois d’aimer une de ces femmes que les Grecs ont appelées depuis.
Le chef des bonzes avait établi cette loi il y avait plus de cinq mille ans; c’était pour s’approprier la maîtresse du premier roi de l’île de Serendib que ce premier bonze avait fait passer l’anathème des yeux bleus en constitution fondamentale d’état. Tous les ordres de l’empire vinrent faire à Nabussan des remontrances. On disait publiquement que les derniers jours du royaume étaient arrivés, que l’abomination était à son comble, que toute la nature était menacée d’un événement sinistre; qu’en un mot Nabussan, fils de Nussanab, aimait deux grands yeux bleus. Les bossus, les financiers, les bonzes, et les brunes, remplirent le royaume de leurs plaintes. Les peuples sauvages qui habitent le nord de Serendib profitèrent de ce mécontentement général. Ils firent une irruption dans les états du bon Nabussan. Il demanda des subsides à ses sujets; les bonzes, qui possédaient la moitié des revenus de l’état, se contentèrent de lever les mains au ciel, et refusèrent de les mettre dans leurs coffres pour aider le roi. Ils firent de belles prières en musique, et laissèrent l’état en proie aux barbares. O mon cher Zadig, me tireras-tu encore de cet horrible embarras? s’écria douloureusement Nabussan. Très volontiers, répondit Zadig; vous aurez de l’argent des bonzes tant que vous en voudrez. Laissez à l’abandon les terres où sont situés leurs châteaux, et défendez seulement les vôtres. Nabussan n’y manqua pas: les bonzes vinrent se jeter aux pieds du roi, et implorer son assistance. Le roi leur répondit par une belle musique dont les paroles étaient des prières au ciel pour la conservation de leurs terres. Les bonzes enfin donnèrent de l’argent, et le roi finit heureusement la guerre. Ainsi Zadig, par ses conseils sages et heureux, et par les plus grands services, s’était attiré l’irréconciliable inimitié des hommes les plus puissants de l’état; les bonzes et les brunes jurèrent sa perte; les financiers et les bossus ne l’épargnèrent pas; on le rendit suspect au bon Nabussan. Les services rendus restent souvent dans l’antichambre, et les soupçons entrent dans le cabinet, selon la sentence de Zoroastre: c’était tous les jours de nouvelles accusations; la première est repoussée, la seconde effleure, la troisième blesse, la quatrième tue. Zadig intimidé, qui avait bien fait les affaires de son ami Sétoc, et qui lui avait fait tenir son argent, ne songea plus qu’à partir de l’île, et résolut d’aller lui-même chercher des nouvelles d’Astarté; car, disait-il, si je reste dans Serendib, les bonzes me feront empaler; mais où aller? je serai esclave en Egypte, brûlé selon toutes les apparences en Arabie, étranglé à Babylone. Cependant il faut savoir ce qu’Astarté est devenue: partons, et voyons à quoi me réserve ma triste destinée.
En arrivant aux frontières qui séparent l’Arabie pétrée de la Syrie, comme il passait près d’un château assez fort, des Arabes armés en sortirent. Il se vit entouré; on lui criait: Tout ce que vous avez nous appartient, et votre personne appartient à notre maître. Zadig, pour réponse, tira son épée; son valet, qui avait du courage, en fit autant. Ils renversèrent morts les premiers Arabes qui mirent la main sur eux; le nombre redoubla; ils ne s’étonnèrent point, et résolurent de périr en combattant. On voyait deux hommes se défendre contre une multitude; un tel combat ne pouvait durer longtemps. Le maître du château, nommé Arbogad, ayant vu d’une fenêtre les prodiges de valeur que faisait Zadig, conçut de l’estime pour lui. Il descendit en hâte, et vint lui-même écarter ses gens, et délivrer les deux voyageurs. Tout ce qui passe sur mes terres est à moi, dit-il, aussi bien que ce que je trouve sur les terres des autres; mais vous me paraissez un si brave homme, que je vous exempte de la loi commune. Il le fit entrer dans son château, ordonnant à ses gens de le bien traiter; et le soir Arbogad voulut souper avec Zadig. Le seigneur du château était un de ces Arabes qu’on appelle voleurs; mais il faisait quelquefois de bonnes actions parmi une foule de mauvaises; il volait avec une rapacité furieuse, et donnait libéralement: intrépide dans l’action, assez doux dans le commerce, débauché à table, gai dans la débauche, et surtout plein de franchise. Zadig lui plut beaucoup; sa conversation, qui s’anima, fit durer le repas: enfin Arbogad lui dit: Je vous conseille de vous enrôler sous moi, vous ne sauriez mieux faire; ce métier-ci n’est pas mauvais; vous pourrez un jour devenir ce que je suis. Puis-je vous demander, dit Zadig, depuis quel temps vous exercez cette noble profession? Dès ma plus tendre jeunesse, reprit le seigneur. J’étais valet d’un Arabe assez habile; ma situation m’était insupportable. J’étais au désespoir de voir que, dans toute la terre qui appartient également aux hommes, la destinée ne m’eût pas réservé ma portion. Je confiai mes peines à un vieil Arabe qui me dit: Mon fils, ne désespérez pas; il y avait autrefois un grain de sable qui se lamentait d’être un atome ignoré dans les déserts; au bout de quelques années il devint diamant, et il est à présent le plus bel ornement de la couronne du roi des Indes. Ce discours me fit impression; j’étais le grain de sable, je résolus de devenir diamant. Je commençai par voler deux chevaux; je m’associai des camarades; je me mis en état de voler de petites caravanes: ainsi je fis cesser peu-à-peu la disproportion qui était d’abord entre les hommes et moi. J’eus ma part aux biens de ce monde, et je fus même dédommagé avec usure: on me considéra beaucoup; je devins seigneur brigand; j’acquis ce château par voie de fait. Le satrape de Syrie voulut m’en déposséder; mais j’étais déjà trop riche pour avoir rien à craindre; je donnai de l’argent au satrape, moyennant quoi je conservai ce château, et j’agrandis mes domaines; il me nomma même trésorier des tributs que l’Arabie pétrée payait au roi des rois. Je fis ma charge de receveur, et point du tout celle de payeur. Le grand desterham de Babylone envoya ici, au nom du roi Moabdar, un petit satrape, pour me faire étrangler. Cet homme arriva avec son ordre: j’étais instruit de tout; je fis étrangler en sa présence les quatre personnes qu’il avait amenées avec lui pour serrer le lacet; après quoi je lui demandai ce que pouvait lui valoir la commission de m’étrangler. Il me répondit que ses honoraires pouvaient aller à trois cents pièces d’or. Je lui fis voir clair qu’il y aurait plus à gagner avec moi. Je le fis sous-brigand; il est aujourd’hui un de mes meilleurs officiers, et des plus riches. Si vous m’en croyez, vous réussirez comme lui. Jamais la saison de voler n’a été meilleure, depuis que Moabdar est tué, et que tout est en confusion dans Babylone. Moabdar est tué! dit Zadig; et qu’est devenue la reine Astarté? Je n’en sais rien, reprit Arbogad; tout ce que je sais, c’est que Moabdar est devenu fou, qu’il a été tué, que Babylone est un grand coupe-gorge, que tout l’empire est désolé, qu’il y a de beaux coups à faire encore, et que pour ma part j’en ai fait d’admirables. Mais la reine, dit Zadig; de grâce, ne savez-vous rien de la destinée de la reine? On m’a parlé d’un prince d’Hyrcanie, reprit-il; elle est probablement parmi ses concubines, si elle n’a pas été tuée dans le tumulte; mais je suis plus curieux de butin que de nouvelles. J’ai pris plusieurs femmes dans mes courses, je n’en garde aucune; je les vends cher quand elles sont belles, sans m’informer de ce qu’elles sont. On n’achète point le rang; une reine qui serait laide ne trouverait pas marchand; peut-être ai-je vendu la reine Astarté, peut-être est-elle morte; mais peu m’importe, et je pense que vous ne devez pas vous en soucier plus que moi. En parlant ainsi il buvait avec tant de courage, il confondait tellement toutes les idées, que Zadig n’en put tirer aucun éclaircissement. Il restait interdit, accablé, immobile. Arbogad buvait toujours, faisait des contes, répétait sans cesse qu’il était le plus heureux de tous les hommes, exhortant Zadig à se rendre aussi heureux que lui. Enfin doucement assoupi par les fumées du vin, il alla dormir d’un sommeil tranquille. Zadig passa la nuit dans l’agitation la plus violente. Quoi, disait-il, le roi est devenu fou! il est tué! Je ne puis m’empêcher de le plaindre. L’empire est déchiré, et ce brigand est heureux: ô fortune! ô destinée! un voleur est heureux, et ce que la nature a fait de plus aimable a péri peut-être d’une manière affreuse, ou vit dans un état pire que la mort. O Astarté! qu’êtes-vous devenue? Dès le point du jour il interrogea tous ceux qu’il rencontrait dans le château; mais tout le monde était occupé, personne ne lui répondit: on avait fait pendant la nuit de nouvelles conquêtes, on partageait les dépouilles. Tout ce qu’il put obtenir dans cette confusion tumultueuse, ce fut la permission de partir. Il en profita sans tarder, plus abîmé que jamais dans ses réflexions douloureuses. Zadig marchait inquiet, agité, l’esprit tout occupé de la malheureuse Astarté, du roi de Babylone, de son fidèle Cador, de l’heureux brigand Arbogad, de cette femme si capricieuse que des Babyloniens avaient enlevée sur les confins de l’Egypte, enfin de tous les contre-temps et de toutes les infortunes qu’il avait éprouvées.
A quelques lieues du château d’Arbogad, il se trouva sur le bord d’une petite rivière, toujours déplorant sa destinée, et se regardant comme le modèle du malheur. Il vit un pêcheur couché sur la rive, tenant à peine d’une main languissante son filet, qu’il semblait abandonner, et levant les yeux vers le ciel. Je suis certainement le plus malheureux de tous les hommes, disait le pêcheur. J’ai été, de l’aveu de tout le monde, le plus célèbre marchand de fromages à la crème dans Babylone, et j’ai été ruiné. J’avais la plus jolie femme qu’homme pût posséder, et j’en ai été trahi. Il me restait une chétive maison, je l’ai vue pillée et détruite. Réfugié dans une cabane, je n’ai de ressource que ma pêche, et je ne prends pas un poisson. O mon filet! je ne te jetterai plus dans l’eau, c’est à moi de m’y jeter. En disant ces mots il se lève, et s’avance dans l’attitude d’un homme qui allait se précipiter et finir sa vie. Eh quoi! se dit Zadig à lui-même, il y a donc des hommes aussi malheureux que moi! L’ardeur de sauver la vie au pêcheur fut aussi prompte que cette réflexion. Il court à lui, il l’arrête, il l’interroge d’un air attendri et consolant. On prétend qu’on en est moins malheureux quand on ne l’est pas seul: mais, selon Zoroastre, ce n’est pas par malignité, c’est par besoin. On se sent alors entraîné vers un infortuné comme vers son semblable. La joie d’un homme heureux serait une insulte; mais deux malheureux sont comme deux arbrisseaux faibles qui, s’appuyant l’un sur l’autre, se fortifient contre l’orage. Pourquoi succombez-vous à vos malheurs? dit Zadig au pêcheur. C’est, répondit-il, parce que je n’y vois pas de ressource. J’ai été le plus considéré du village de Derlback auprès de Babylone, et je faisais, avec l’aide de ma femme, les meilleurs fromages à la crème de l’empire. La reine Astarté et le fameux ministre Zadig les aimaient passionnément. J’avais fourni à leurs maisons six cents fromages. J’allai un jour à la ville pour être payé; j’appris en arrivant dans Babylone que la reine et Zadig avaient disparu. Je courus chez le seigneur Zadig, que je n’avais jamais vu; je trouvai les archers du grand desterham, qui, munis d’un papier royal, pillaient sa maison loyalement et avec ordre. Je volai aux cuisines de la reine; quelques uns des seigneurs de la bouche me dirent qu’elle était morte; d’autres dirent qu’elle était en prison; d’autres prétendirent qu’elle avait pris la fuite; mais tous m’assurèrent qu’on ne me paierait point mes fromages. J’allai avec ma femme chez le seigneur Orcan, qui était une de mes pratiques: nous lui demandâmes sa protection dans notre disgrâce. Il l’accorda à ma femme, et me la refusa. Elle était plus blanche que ces fromages à la crème qui commencèrent mon malheur; et l’éclat de la pourpre de Tyr n’était pas plus brillant que l’incarnat qui animait cette blancheur. C’est ce qui fit qu’Orcan la retint, et me chassa de sa maison. J’écrivis à ma chère femme la lettre d’un désespéré. Elle dit au porteur: Ah, ah! oui! je sais quel est l’homme qui m’écrit, j’en ai entendu parler: on dit qu’il fait des fromages à la crème excellents; qu’on m’en apporte, et qu’on les lui paie. Dans mon malheur, je voulus m’adresser à la justice. Il me restait six onces d’or: il fallut en donner deux onces à l’homme de loi que je consultai, deux au procureur qui entreprit mon affaire, deux au secrétaire du premier juge. Quand tout cela fut fait, mon procès n’était pas encore commencé, et j’avais déjà dépensé plus d’argent que mes fromages et ma femme ne valaient. Je retournai à mon village dans l’intention de vendre ma maison pour avoir ma femme. Ma maison valait bien soixante onces d’or; mais on me voyait pauvre et pressé de vendre. Le premier à qui je m’adressai m’en offrit trente onces; le second, vingt; et le troisième, dix. J’étais prêt enfin de conclure, tant j’étais aveuglé, lorsqu’un prince d’Hyrcanie vint à Babylone, et ravagea tout sur son passage. Ma maison fut d’abord saccagée, et ensuite brûlée. Ayant ainsi perdu mon argent, ma femme, et ma maison, je me suis retiré dans ce pays où vous me voyez; j’ai tâché de subsister du métier de pêcheur. Les poissons se moquent de moi comme les hommes; je ne prends rien, je meurs de faim; et sans vous, auguste consolateur, j’allais mourir dans la rivière. Le pêcheur ne fit point ce récit tout de suite; car à tout moment Zadig ému et transporté lui disait: Quoi! vous ne savez rien de la destinée de la reine? Non, seigneur, répondait le pêcheur; mais je sais que la reine et Zadig ne m’ont point payé mes fromages à la crème, qu’on a pris ma femme, et que je suis au désespoir. Je me flatte, dit Zadig, que vous ne perdrez pas tout votre argent. J’ai entendu parler de ce Zadig; il est honnête homme; et s’il retourne à Babylone, comme il l’espère, il vous donnera plus qu’il ne vous doit; mais pour votre femme, qui n’est pas si honnête, je vous conseille de ne pas chercher à la reprendre. Croyez-moi, allez à Babylone; j’y serai avant vous, parce que je suis à cheval, et que vous êtes à pied. Adressez-vous à l’illustre Cador; dites-lui que vous avez rencontré son ami; attendez-moi chez lui; allez; peut-être ne serez-vous pas toujours malheureux. O puissant Orosmade! continua-t-il, vous vous servez de moi pour consoler cet homme; de qui vous servirez-vous pour me consoler? En parlant ainsi il donnait au pêcheur la moitié de tout l’argent qu’il avait apporté d’Arabie, et le pêcheur, confondu et ravi, baisait les pieds de l’ami de Cador, et disait: Vous êtes un ange sauveur. Cependant Zadig demandait toujours des nouvelles, et versait des larmes. Quoi! seigneur, s’écria le pêcheur, vous seriez donc aussi malheureux, vous qui faites du bien? Plus malheureux que toi cent fois, répondait Zadig. Mais comment se peut-il faire, disait le bonhomme, que celui qui donne soit plus à plaindre que celui qui reçoit? C’est que ton plus grand malheur, reprit Zadig, était le besoin, et que je suis infortuné par le cœur. Orcan vous aurait-il pris votre femme? dit le pêcheur. Ce mot rappela dans l’esprit de Zadig toutes ses aventures; il répétait la liste de ses infortunes, à commencer depuis la chienne de la reine jusqu’à son arrivée chez le brigand Arbogad. Ah! dit-il au pêcheur, Orcan mérite d’être puni. Mais d’ordinaire ce sont ces gens-là qui sont les favoris de la destinée. Quoi qu’il en soit, va chez le seigneur Cador, et attends-moi. Ils se séparèrent: le pêcheur marcha en remerciant son destin, et Zadig courut en accusant toujours le sien.
Arrivé dans une belle prairie, il y vit plusieurs femmes qui cherchaient quelque chose avec beaucoup d’application. Il prit la liberté de s’approcher de l’une d’elles, et de lui demander s’il pouvait avoir l’honneur de les aider dans leurs recherches. Gardez-vous-en bien, répondit la Syrienne; ce que nous cherchons ne peut être touché que par des femmes. Voilà qui est bien étrange, dit Zadig; oserai-je vous prier de m’apprendre ce que c’est qu’il n’est permis qu’aux femmes de toucher? C’est un basilic, dit-elle. Un basilic, madame! et pour quelle raison, s’il vous plaît, cherchez-vous un basilic? C’est pour notre seigneur et maître Ogul, dont vous voyez le château sur le bord de cette rivière, au bout de la prairie. Nous sommes ses très humbles esclaves; le seigneur Ogul est malade; son médecin lui a ordonné de manger un basilic cuit dans l’eau rose; et comme c’est un animal fort rare, et qui ne se laisse jamais prendre que par des femmes, le seigneur Ogul a promis de choisir pour sa femme bien-aimée celle de nous qui lui apporterait un basilic: laissez-moi chercher, s’il vous plaît: car vous voyez ce qu’il m’en coûterait si j’étais prévenue par mes compagnes. Zadig laissa cette Syrienne et les autres chercher leur basilic, et continua de marcher dans la prairie. Quand il fut au bord d’un petit ruisseau, il y trouva une autre dame couchée sur le gazon, et qui ne cherchait rien. Sa taille paraissait majestueuse, mais son visage était couvert d’un voile. Elle était penchée vers le ruisseau; de profonds soupirs sortaient de sa bouche. Elle tenait en main une petite baguette, avec laquelle elle traçait des caractères sur un sable fin qui se trouvait entre le gazon et le ruisseau. Zadig eut la curiosité de voir ce que cette femme écrivait; il s’approcha, il vit la lettre Z, puis un A; il fut étonné; puis parut un D; il tressaillit. Jamais surprise ne fut égale à la sienne, quand il vit les deux dernières lettres de son nom. Il demeura quelque temps immobile: enfin rompant le silence d’une voix entrecoupée: O généreuse dame! pardonnez à un étranger, à un infortuné, d’oser vous demander par quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de ZADIG tracé de votre main divine? A cette voix, à ces paroles, la dame releva son voile d’une main tremblante, regarda Zadig, jeta un cri d’attendrissement, de surprise, et de joie, et succombant sous tous les mouvements divers qui assaillaient à la fois son âme, elle tomba évanouie entre ses bras. C’était Astarté elle-même, c’était la reine de Babylone, c’était celle que Zadig adorait, et qu’il se reprochait d’adorer; c’était celle dont il avait tant pleuré et tant craint la destinée. Il fut un moment privé de l’usage de ses sens; et quand il eut attaché ses regards sur les yeux d’Astarté, qui se rouvraient avec une langueur mêlée de confusion et de tendresse: O puissances immortelles! s’écria-t-il, qui présidez aux destins des faibles humains, me rendez-vous Astarté? En quel temps, en quels lieux, en quel état la revois-je? Il se jeta à genoux devant Astarté, et il attacha son front à la poussière de ses pieds. La reine de Babylone le relève, et le fait asseoir auprès d’elle sur le bord de ce ruisseau; elle essuyait à plusieurs reprises ses yeux dont les larmes recommençaient toujours à couler. Elle reprenait vingt fois des discours que ses gémissements interrompaient; elle l’interrogeait sur le hasard qui les rassemblait, et prévenait soudain ses réponses par d’autres questions. Elle entamait le récit de ses malheurs, et voulait savoir ceux de Zadig. Enfin tous deux ayant un peu apaisé le tumulte de leurs âmes, Zadig lui conta en peu de mots par quelle aventure il se trouvait dans cette prairie. Mais, ô malheureuse et respectable reine! comment vous retrouvé-je en ce lieu écarté, vêtue en esclave, et accompagnée d’autres femmes esclaves qui cherchent un basilic pour le faire cuire dans de l’eau rose par ordonnance du médecin? Pendant qu’elles cherchent leur basilic, dit la belle Astarté, je vais vous apprendre tout ce que j’ai souffert, et tout ce que je pardonne au ciel depuis que je vous revois. Vous savez que le roi mon mari trouva mauvais que vous fussiez le plus aimable de tous les hommes; et ce fut pour cette raison qu’il prit une nuit la résolution de vous faire étrangler et de m’empoisonner. Vous savez comme le ciel permit que mon petit muet m’avertît de l’ordre de sa sublime majesté. A peine le fidèle Cador vous eut-il forcé de m’obéir et de partir, qu’il osa entrer chez moi au milieu de la nuit par une issue secrète. Il m’enleva, et me conduisit dans le temple d’Orosmade, où le mage, son frère, m’enferma dans une statue colossale dont la base touche aux fondements du temple, et dont la tête atteint la voûte. Je fus là comme ensevelie, mais servie par le mage, et ne manquant d’aucune chose nécessaire. Cependant au point du jour l’apothicaire de sa majesté entra dans ma chambre avec une potion mêlée de jusquiame, d’opium, de ciguë, d’ellébore noir, et d’aconit; et un autre officier alla chez vous avec un lacet de soie bleue. On ne trouva personne. Cador, pour mieux tromper le roi, feignit de venir nous accuser tous deux. Il dit que vous aviez pris la route des Indes, et moi celle de Memphis: on envoya des satellites après vous et après moi. Les courriers qui me cherchaient ne me connaissaient pas. Je n’avais presque jamais montré mon visage qu’à vous seul, en présence et par ordre de mon époux. Ils coururent à ma poursuite, sur le portrait qu’on leur faisait de ma personne: une femme de la même taille que moi, et qui peut-être avait plus de charmes, s’offrit à leurs regards sur les frontières de l’Egypte. Elle était éplorée, errante; ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine de Babylone; ils la menèrent à Moabdar. Leur méprise fit entrer d’abord le roi dans une violente colère; mais bientôt ayant considéré de plus près cette femme, il la trouva très belle, et fut consolé. On l’appelait Missouf. On m’a dit depuis que ce nom signifie en langue égyptienne la belle capricieuse. Elle l’était en effet; mais elle avait autant d’art que de caprice. Elle plut à Moabdar. Elle le subjugua au point de se faire déclarer sa femme. Alors son caractère se développa tout entier: elle se livra sans crainte à toutes les folies de son imagination. Elle voulut obliger le chef des mages, qui était vieux et goutteux, de danser devant elle; et sur le refus du mage, elle le persécuta violemment. Elle ordonna à son grand écuyer de lui faire une tourte de confitures. Le grand écuyer eut beau lui représenter qu’il n’était point pâtissier, il fallut qu’il fît la tourte; et on le chassa, parce qu’elle était trop brûlée. Elle donna la charge de grand écuyer à son nain, et la place de chancelier à un page. C’est ainsi qu’elle gouverna Babylone. Tout le monde me regrettait. Le roi, qui avait été assez honnête homme jusqu’au moment où il avait voulu m’empoisonner et vous faire étrangler, semblait avoir noyé ses vertus dans l’amour prodigieux qu’il avait pour la belle capricieuse. Il vint au temple le grand jour du feu sacré. Je le vis implorer les dieux pour Missouf aux pieds de la statue où j’étais renfermée. J’élevai la voix; je lui criai: «Les dieux refusent les vœux d’un roi devenu tyran, qui a voulu faire mourir une femme raisonnable pour épouser une extravagante.» Moabdar fut confondu de ces paroles au point que sa tête se troubla. L’oracle que j’avais rendu, et la tyrannie de Missouf, suffisaient pour lui faire perdre le jugement. Il devint fou en peu de jours. Sa folie, qui parut un châtiment du ciel, fut le signal de la révolte. On se souleva, on courut aux armes. Babylone, si longtemps plongée dans une mollesse oisive, devint le théâtre d’une guerre civile affreuse. On me tira du creux de ma statue, et on me mit à la tête d’un parti. Cador courut à Memphis, pour vous ramener à Babylone. Le prince d’Hyrcanie, apprenant ces funestes nouvelles, revint avec son armée faire un troisième parti dans la Chaldée. Il attaqua le roi, qui courut au-devant de lui avec son extravagante Egyptienne. Moabdar mourut percé de coups. Missouf tomba aux mains du vainqueur. Mon malheur voulut que je fusse prise moi-même par un parti hyrcanien, et qu’on me menât devant le prince précisément dans le temps qu’on lui amenait Missouf. Vous serez flatté, sans doute, en apprenant que le prince me trouva plus belle que l’Égyptienne; mais vous serez fâché d’apprendre qu’il me destina à son sérail. Il me dit fort résolument que, dès qu’il aurait fini une expédition militaire qu’il allait exécuter, il viendrait à moi. Jugez de ma douleur. Mes liens avec Moabdar étaient rompus, je pouvais être à Zadig; et je tombais dans les chaînes de ce barbare! Je lui répondis avec toute la fierté que me donnaient mon rang et mes sentiments. J’avais toujours entendu dire que le ciel attachait aux personnes de ma sorte un caractère de grandeur qui d’un mot et d’un coup d’oeil faisait rentrer dans l’abaissement du plus profond respect les téméraires qui osaient s’en écarter. Je parlai en reine, mais je fus traitée en demoiselle suivante. L’Hyrcanien, sans daigner seulement m’adresser la parole, dit à son eunuque noir que j’étais une impertinente, mais qu’il me trouvait jolie. Il lui ordonna d’avoir soin de moi et de me mettre au régime des favorites, afin de me rafraîchir le teint, et de me rendre plus digne de ses faveurs, pour le jour où il aurait la commodité de m’en honorer. Je lui dis que je me tuerais: il répliqua, en riant, qu’on ne se tuait point, qu’il était fait à ces façons-là, et me quitta comme un homme qui vient de mettre un perroquet dans sa ménagerie. Quel état pour la première reine de l’univers, et, je dirai plus, pour un cœur qui était à Zadig! A ces paroles il se jeta à ses genoux, et les baigna de larmes. Astarté le releva tendrement, et elle continua ainsi: Je me voyais au pouvoir d’un barbare, et rivale d’une folle avec qui j’étais renfermée. Elle me raconta son aventure d’Egypte. Je jugeai par les traits dont elle vous peignait, par le temps, par le dromadaire sur lequel vous étiez monté, par toutes les circonstances, que c’était Zadig qui avait combattu pour elle. Je ne doutai pas que vous ne fussiez à Memphis; je pris la résolution de m’y retirer. Belle Missouf, lui dis-je, vous êtes beaucoup plus plaisante que moi, vous divertirez bien mieux que moi le prince d’Hyrcanie. Facilitez-moi les moyens de me sauver; vous régnerez seule; vous me rendrez heureuse, en vous débarrassant d’une rivale. Missouf concerta avec moi les moyens de ma fuite. Je partis donc secrètement avec une esclave égyptienne. J’étais déjà près de l’Arabie, lorsqu’un fameux voleur, nommé Arbogad, m’enleva, et me vendit à des marchands qui m’ont amenée dans ce château, où demeure le seigneur Ogul. Il m’a achetée sans savoir qui j’étais. C’est un homme voluptueux qui ne cherche qu’à faire grande chère, et qui croit que Dieu l’a mis au monde pour tenir table. Il est d’un embonpoint excessif, qui est toujours prêt à le suffoquer. Son médecin, qui n’a que peu de crédit auprès de lui quand il digère bien, le gouverne despotiquement quand il a trop mangé. Il lui a persuadé qu’il le guérirait avec un basilic cuit dans de l’eau rose. Le seigneur Ogul a promis sa main à celle de ses esclaves qui lui apporterait un basilic. Vous voyez que je les laisse s’empresser à mériter cet honneur, et je n’ai jamais eu moins d’envie de trouver ce basilic que depuis que le ciel a permis que je vous revisse. Alors Astarté et Zadig se dirent tout ce que des sentiments longtemps retenus, tout ce que leurs malheurs et leurs amours pouvaient inspirer aux cœurs les plus nobles et les plus passionnés; et les génies qui président à l’amour portèrent leurs paroles jusqu’à la sphère de Vénus. Les femmes rentrèrent chez Ogul sans avoir rien trouvé. Zadig se fit présenter à lui, et lui parla en ces termes: Que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de tous vos jours! Je suis médecin, j’ai accouru vers vous sur le bruit de votre maladie, et je vous ai apporté un basilic cuit dans de l’eau rose. Ce n’est pas que je prétende vous épouser: je ne vous demande que la liberté d’une jeune esclave de Babylone que vous avez depuis quelques jours; et je consens de rester en esclavage à sa place, si je n’ai pas le bonheur de guérir le magnifique seigneur Ogul. La proposition fut acceptée. Astarté partit pour Babylone avec le domestique de Zadig, en lui promettant de lui envoyer incessamment un courrier, pour l’instruire de tout ce qui se serait passé. Leurs adieux furent aussi tendres que l’avait été leur reconnaissance. Le moment où l’on se retrouve, et celui où l’on se sépare, sont les deux plus grandes époques de la vie, comme dit le grand livre du Zend. Zadig aimait la reine autant qu’il le jurait, et la reine aimait Zadig plus qu’elle ne le lui disait. Cependant Zadig parla ainsi à Ogul: Seigneur, on ne mange point mon basilic, toute sa vertu doit entrer chez vous par les pores. Je l’ai mis dans une petite outre bien enflée et couverte d’une peau fine: il faut que vous poussiez cette outre de toute votre force, et que je vous la renvoie à plusieurs reprises; et en peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon art. Ogul dès le premier jour fut tout essoufflé, et crut qu’il mourrait de fatigue. Le second il fut moins fatigué, et dormit mieux. En huit jours il recouvra toute la force, la santé, la légèreté, et la gaieté de ses plus brillantes années. Vous avez joué au ballon, et vous avez été sobre, lui dit Zadig: apprenez qu’il n’y a point de basilic dans la nature, qu’on se porte toujours bien avec de la sobriété et de l’exercice, et que l’art de faire subsister ensemble l’intempérance et la santé est un art aussi chimérique que la pierre philosophale, l’astrologie judiciaire, et la théologie des mages. Le premier médecin d’Ogul, sentant combien cet homme était dangereux pour la médecine, s’unit avec l’apothicaire du corps pour envoyer Zadig chercher des basilics dans l’autre monde. Ainsi, après avoir été toujours puni pour avoir bien fait, il était près de périr pour avoir guéri un seigneur gourmand. On l’invita à un excellent dîner. Il devait être empoisonné au second service; mais il reçut un courrier de la belle Astarté au premier. Il quitta la table, et partit. Quand on est aimé d’une belle femme, dit le grand Zoroastre, on se tire toujours d’affaire dans ce monde.
La reine avait été reçue à Babylone avec les transports qu’on a toujours pour une belle princesse qui a été malheureuse. Babylone alors paraissait être plus tranquille. Le prince d’Hyrcanie avait été tué dans un combat. Les Babyloniens vainqueurs déclarèrent qu’Astarté épouserait celui qu’on choisirait pour souverain. On ne voulut point que la première place du monde, qui serait celle de mari d’Astarté et de roi de Babylone, dépendît des intrigues et des cabales. On jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le plus sage. Une grande lice, bordée d’amphithéâtres magnifiquement ornés, fut formée à quelques lieues de la ville. Les combattants devaient s’y rendre armés de toutes pièces. Chacun d’eux avait derrière les amphithéâtres un appartement séparé, où il ne devait être vu ni connu de personne. Il fallait courir quatre lances. Ceux qui seraient assez heureux pour vaincre quatre chevaliers devaient combattre ensuite les uns contre les autres; de façon que celui qui resterait le dernier maître du camp serait proclamé le vainqueur des jeux. Il devait revenir quatre jours après avec les mêmes armes, et expliquer les énigmes proposées par les mages. S’il n’expliquait point les énigmes, il n’était point roi, et il fallait recommencer à courir des lances, jusqu’à ce qu’on trouvât un homme qui fût vainqueur dans ces deux combats; car on voulait absolument pour roi le plus vaillant et le plus sage. La reine, pendant tout ce temps, devait être étroitement gardée: on lui permettait seulement d’assister aux jeux, couverte d’un voile; mais on ne souffrait pas qu’elle parlât à aucun des prétendants, afin qu’il n’y eût ni faveur ni injustice. Voilà ce qu’Astarté faisait savoir à son amant, espérant qu’il montrerait pour elle plus de valeur et d’esprit que personne. Il partit, et pria Vénus de fortifier son courage et d’éclairer son esprit. Il arriva sur le rivage de l’Euphrate, la veille de ce grand jour. Il fit inscrire sa devise parmi celles des combattants, en cachant son visage et son nom, comme la loi l’ordonnait, et alla se reposer dans l’appartement qui lui échut par le sort. Son ami Cador, qui était revenu à Babylone, après l’avoir inutilement cherché en Egypte, fit porter dans sa loge une armure complète que la reine lui envoyait. Il lui fit amener aussi de sa part le plus beau cheval de Perse. Zadig reconnut Astarté à ces présents: son courage et son amour en prirent de nouvelles forces et de nouvelles espérances. Le lendemain la reine étant venue se placer sous un dais de pierreries, et les amphithéâtres étant remplis de toutes les dames et de tous les ordres de Babylone, les combattants parurent dans le cirque. Chacun d’eux vint mettre sa devise aux pieds du grand mage. On tira au sort les devises; celle de Zadig fut la dernière. Le premier qui s’avança était un seigneur très riche, nommé Itobad, fort vain, peu courageux, très maladroit, et sans esprit. Ses domestiques l’avaient persuadé qu’un homme comme lui devait être roi; il leur avait répondu: Un homme comme moi doit régner; ainsi on l’avait armé de pied en cap. Il portait une armure d’or émaillée de vert, un panache vert, une lance ornée de rubans verts. On s’aperçut d’abord, à la manière dont Itobad gouvernait son cheval, que ce n’était pas un homme comme lui à qui le ciel réservait le sceptre de Babylone. Le premier chevalier qui courut contre lui le désarçonna; le second le renversa sur la croupe de son cheval, les deux jambes en l’air et les bras étendus. Itobad se remit, mais de si mauvaise grâce que tout l’amphithéâtre se mit à rire. Un troisième ne daigna pas se servir de sa lance; mais en lui faisant une passe, il le prit par la jambe droite, et lui faisant faire un demi tour, il le fit tomber sur le sable: les écuyers des jeux accoururent à lui en riant, et le remirent en selle. Le quatrième combattant le prend par la jambe gauche, et le fait tomber de l’autre côté. On le conduisit avec des huées à sa loge, où il devait passer la nuit selon la loi; et il disait en marchant à peine: Quelle aventure pour un homme comme moi! Les autres chevaliers s’acquittèrent mieux de leur devoir. Il y en eut qui vainquirent deux combattants de suite; quelques uns allèrent jusqu’à trois. Il n’y eut que le prince Otame qui en vainquit quatre. Enfin Zadig combattit à son tour: il désarçonna quatre cavaliers de suite avec toute la grâce possible. Il fallut donc voir qui serait vainqueur d’Otame ou de Zadig. Le premier portait des armes bleues et or, avec un panache de même; celles de Zadig étaient blanches. Tous les vœux se partageaient entre le chevalier bleu et le chevalier blanc. La reine, à qui le cœur palpitait, faisait des prières au ciel pour la couleur blanche. Les deux champions firent des passes et des voltes avec tant d’agilité, ils se donnèrent de si beaux coups de lance, ils étaient si fermes sur leurs arçons, que tout le monde, hors la reine, souhaitait qu’il y eût deux rois dans Babylone. Enfin, leurs chevaux étant lassés et leurs lances rompues, Zadig usa de cette adresse: il passe derrière le prince bleu, s’élance sur la croupe de son cheval, le prend par le milieu du corps, le jette à terre, se met en selle à sa place, et caracole autour d’Otame étendu sur la place. Tout l’amphithéâtre crie: Victoire au chevalier blanc! Otame indigné se relève, tire son épée; Zadig saute de cheval, le sabre à la main. Les voilà tous deux sur l’arène, livrant un nouveau combat, où la force et l’agilité triomphent tour à tour. Les plumes de leur casque, les clous de leurs brassards, les mailles de leur armure sautent au loin sous mille coups précipités. Ils frappent de pointe et de taille, à droite, à gauche, sur la tête, sur la poitrine; ils reculent, ils avancent, ils se mesurent, ils se rejoignent, ils se saisissent, ils se replient comme des serpents, ils s’attaquent comme des lions; le feu jaillit à tout moment des coups qu’ils se portent. Enfin Zadig ayant un moment repris ses esprits s’arrête, fait une feinte, passe sur Otame, le fait tomber, le désarme, et Otame s’écrie: O chevalier blanc! c’est vous qui devez régner sur Babylone. La reine était au comble de la joie. On reconduisit le chevalier bleu et le chevalier blanc chacun à leur loge, ainsi que tous les autres, selon ce qui était porté par la loi. Des muets vinrent les servir et leur apporter à manger. On peut juger si le petit muet de la reine ne fut pas celui qui servit Zadig. Ensuite on les laissa dormir seuls jusqu’au lendemain matin, temps où le vainqueur devait apporter sa devise au grand mage, pour la confronter et se faire reconnaître. Zadig dormit, quoique amoureux, tant il était fatigué. Itobad, qui était couché auprès de lui, ne dormit point. Il se leva pendant la nuit, entra dans sa loge, prit les armes blanches de Zadig avec sa devise, et mit son armure verte à la place. Le point du jour étant venu, il alla fièrement au grand mage, déclarer qu’un homme comme lui était vainqueur. On ne s’y attendait pas; mais il fut proclamé pendant que Zadig dormait encore. Astarté surprise, et le désespoir dans le cœur, s’en retourna dans Babylone. Tout l’amphithéâtre était déjà presque vide, lorsque Zadig s’éveilla; il chercha ses armes, et ne trouva que cette armure verte. Il était obligé de s’en couvrir, n’ayant rien autre chose auprès de lui. Etonné et indigné, il les endosse avec fureur, il avance dans cet équipage. Tout ce qui était encore sur l’amphithéâtre et dans le cirque le reçut avec des huées. On l’entourait; on lui insultait en face. Jamais homme n’essuya des mortifications si humiliantes. La patience lui échappa; il écarta à coups de sabre la populace qui osait l’outrager; mais il ne savait quel parti prendre. Il ne pouvait voir la reine; il ne pouvait réclamer l’armure blanche qu’elle lui avait envoyée; c’eût été la compromettre: ainsi, tandis qu’elle était plongée dans la douleur, il était pénétré de fureur et d’inquiétude. Il se promenait sur les bords de l’Euphrate, persuadé que son étoile le destinait à être malheureux sans ressource, repassant dans son esprit toutes ses disgrâces depuis l’aventure de la femme qui haïssait les borgnes, jusqu’à celle de son armure. Voilà ce que c’est, disait-il, de m’être éveillé trop tard; si j’avais moins dormi, je serais roi de Babylone, je posséderais Astarté. Les sciences, les mœurs, le courage, n’ont donc jamais servi qu’à mon infortune. Il lui échappa enfin de murmurer contre la Providence, et il fut tenté de croire que tout était gouverné par une destinée cruelle qui opprimait les bons et qui faisait prospérer les chevaliers verts. Un de ses chagrins était de porter cette armure verte qui lui avait attiré tant de huées. Un marchand passa, il la lui vendit à vil prix, et prit du marchand une robe et un bonnet long. Dans cet équipage, il côtoyait l’Euphrate, rempli de désespoir, et accusant en secret la Providence qui le persécutait toujours.
Il rencontra en marchant un ermite, dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu’à la ceinture. Il tenait en main un livre qu’il lisait attentivement. Zadig s’arrêta, et lui fit une profonde inclination. L’ermite le salua d’un air si noble et si doux, que Zadig eut la curiosité de l’entretenir. Il lui demanda quel livre il lisait. C’est le livre des destinées, dit l’ermite; voulez-vous en lire quelque chose? Il mit le livre dans les mains de Zadig, qui, tout instruit qu’il était dans plusieurs langues, ne put déchiffrer un seul caractère du livre. Cela redoubla encore sa curiosité. Vous me paraissez bien chagrin, lui dit ce bon père. Hélas! que j’en ai sujet! dit Zadig. Si vous permettez que je vous accompagne, repartit le vieillard, peut-être vous serai-je utile: j’ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l’âme des malheureux. Zadig se sentit du respect pour l’air, pour la barbe, et pour le livre de l’ermite. Il lui trouva dans la conversation des lumières supérieures. L’ermite parlait de la destinée, de la justice, de la morale, du souverain bien, de la faiblesse humaine, des vertus, et des vices, avec une éloquence si vive et si touchante, que Zadig se sentit entraîné vers lui par un charme invincible. Il le pria avec instance de ne le point quitter, jusqu’à ce qu’ils fussent de retour à Babylone. Je vous demande moi-même cette grâce, lui dit le vieillard; jurez-moi par Orosmade que vous ne vous séparerez point de moi d’ici à quelques jours, quelque chose que je fasse. Zadig jura, et ils partirent ensemble. Les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe. L’ermite demanda l’hospitalité pour lui et pour le jeune homme qui l’accompagnait. Le portier, qu’on aurait pris pour un grand seigneur, les introduisit avec une espèce de bonté dédaigneuse. On les présenta à un principal domestique, qui leur fit voir les appartements magnifiques du maître. Ils furent admis à sa table au bas bout, sans que le seigneur du château les honorât d’un regard; mais ils furent servis comme les autres avec délicatesse et profusion. On leur donna ensuite à laver dans un bassin d’or garni d’émeraudes et de rubis. On les mena coucher dans un bel appartement, et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce d’or, après quoi on les congédia. Le maître de la maison, dit Zadig en chemin, me paraît être un homme généreux, quoique un peu fier; il exerce noblement l’hospitalité. En disant ces paroles, il aperçut qu’une espèce de poche très large que portait l’ermite paraissait tendue et enflée: il y vit le bassin d’or garni de pierreries, que celui-ci avait volé. Il n’osa d’abord en rien témoigner; mais il était dans une étrange surprise. Vers le midi, l’ermite se présenta à la porte d’une maison très petite, où logeait un riche avare; il y demanda l’hospitalité pour quelques heures. Un vieux valet mal habillé le reçut d’un ton rude, et fit entrer l’ermite et Zadig dans l’écurie, où on leur donna quelques olives pourries, de mauvais pain, et de la bière gâtée. L’ermite but et mangea d’un air aussi content que la veille; puis s’adressant à ce vieux valet qui les observait tous deux pour voir s’ils ne volaient rien, et qui les pressait de partir, il lui donna les deux pièces d’or qu’il avait reçues le matin, et le remercia de toutes ses attentions. Je vous prie, ajouta-t-il, faites-moi parler à votre maître. Le valet étonné introduisit les deux voyageurs: Magnifique seigneur, dit l’ermite, je ne puis que vous rendre de très humbles grâces de la manière noble dont vous nous avez reçus: daignez accepter ce bassin d’or comme un faible gage de ma reconnaissance. L’avare fut près de tomber à la renverse. L’ermite ne lui donna pas le temps de revenir de son saisissement, il partit au plus vite avec son jeune voyageur. Mon père, lui dit Zadig, qu’est-ce que tout ce que je vois? Vous ne me paraissez ressembler en rien aux autres hommes: vous volez un bassin d’or garni de pierreries à un seigneur qui vous reçoit magnifiquement, et vous le donnez à un avare, qui vous traite avec indignité. Mon fils, répondit le vieillard, cet homme magnifique, qui ne reçoit les étrangers que par vanité, et pour faire admirer ses richesses, deviendra plus sage; l’avare apprendra à exercer l’hospitalité: ne vous étonnez de rien, et suivez-moi. Zadig ne savait encore s’il avait affaire au plus fou ou au plus sage de tous les hommes; mais l’ermite parlait avec tant d’ascendant, que Zadig, lié d’ailleurs par son serment, ne put s’empêcher de le suivre. Ils arrivèrent le soir à une maison agréablement bâtie, mais simple, où rien ne sentait ni la prodigalité ni l’avarice. Le maître était un philosophe retiré du monde, qui cultivait en paix la sagesse et la vertu, et qui cependant ne s’ennuyait pas. Il s’était plu à bâtir cette retraite dans laquelle il recevait les étrangers avec une noblesse qui n’avait rien de l’ostentation. Il alla lui-même au-devant des deux voyageurs, qu’il fit reposer d’abord dans un appartement commode. Quelque temps après, il les vint prendre lui-même pour les inviter à un repas propre et bien entendu, pendant lequel il parla avec discrétion des dernières révolutions de Babylone. Il parut sincèrement attaché à la reine, et souhaita que Zadig eût paru dans la lice pour disputer la couronne; mais les hommes, ajouta-t-il, ne méritent pas d’avoir un roi comme Zadig. Celui-ci rougissait, et sentait redoubler ses douleurs. On convint dans la conversation que les choses de ce monde n’allaient pas toujours au gré des plus sages. L’ermite soutint toujours qu’on ne connaissait pas les voies de la Providence, et que les hommes avaient tort de juger d’un tout dont ils n’apercevaient que la plus petite partie. On parla des passions. Ah! qu’elles sont funestes! disait Zadig. Ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau, repartit l’ermite: elles le submergent quelquefois; mais sans elles il ne pourrait voguer. La bile rend colère et malade; mais sans la bile l’homme ne saurait vivre. Tout est dangereux ici-bas, et tout est nécessaire. On parla de plaisir, et l’ermite prouva que c’est un présent de la Divinité; car, dit-il, l’homme ne peut se donner ni sensation ni idées, il reçoit tout; la peine et le plaisir lui viennent d’ailleurs comme son être. Zadig admirait comment un homme qui avait fait des choses si extravagantes pouvait raisonner si bien. Enfin, après un entretien aussi instructif qu’agréable, l’hôte reconduisit ses deux voyageurs dans leur appartement, en bénissant le ciel qui lui avait envoyé deux hommes si sages et si vertueux. Il leur offrit de l’argent d’une manière aisée et noble qui ne pouvait déplaire. L’ermite le refusa, et lui dit qu’il prenait congé de lui, comptant partir pour Babylone avant le jour. Leur séparation fut tendre, Zadig surtout se sentait plein d’estime et d’inclination pour un homme si aimable. Quand l’ermite et lui furent dans leur appartement, ils firent longtemps l’éloge de leur hôte. Le vieillard au point du jour éveilla son camarade. Il faut partir, dit-il; mais tandis que tout le monde dort encore, je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection. En disant ces mots, il prit un flambeau, et mit le feu à la maison. Zadig épouvanté jeta des cris, et voulut l’empêcher de commettre une action si affreuse. L’ermite l’entraînait par une force supérieure; la maison était enflammée. L’ermite, qui était déjà assez loin avec son compagnon, la regardait brûler tranquillement. Dieu merci! dit-il, voilà la maison de mon cher hôte détruite de fond en comble! L’heureux homme! A ces mots Zadig fut tenté à la fois d’éclater de rire, de dire des injures au révérend père, de le battre, et de s’enfuir; mais il ne fit rien de tout cela, et toujours subjugué par l’ascendant de l’ermite, il le suivit malgré lui à la dernière couchée. Ce fut chez une veuve charitable et vertueuse qui avait un neveu de quatorze ans, plein d’agréments et son unique espérance. Elle fit du mieux qu’elle put les honneurs de sa maison. Le lendemain, elle ordonna à son neveu d’accompagner les voyageurs jusqu’à un pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage dangereux. Le jeune homme empressé marche au-devant d’eux. Quand ils furent sur le pont: Venez, dit l’ermite au jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante. Il le prend alors par les cheveux, et le jette dans la rivière. L’enfant tombe, reparaît un moment sur l’eau, et est engouffré dans le torrent. O monstre! ô le plus scélérat de tous les hommes! s’écria Zadig. Vous m’aviez promis plus de patience, lui dit l’ermite en l’interrompant: apprenez que sous les ruines de cette maison où la Providence a mis le feu, le maître a trouvé un trésor immense: apprenez que ce jeune homme dont la Providence a tordu le cou aurait assassiné sa tante dans un an, et vous dans deux. Qui te l’a dit, barbare? cria Zadig; et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées, t’est-il permis de noyer un enfant qui ne t’a point fait de mal? Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n’avait plus de barbe, que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d’ermite disparut; quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière. O envoyé du ciel! ô ange divin! s’écria Zadig en se prosternant, tu es donc descendu de l’empyrée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels? Les hommes, dit l’ange Jesrad, jugent de tout sans rien connaître: tu étais celui de tous les hommes qui méritait le plus d’être éclairé. Zadig lui demanda la permission de parler. Je me défie de moi-même, dit-il; mais oserai-je te prier de m’éclaircir un doute: ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, et l’avoir rendu vertueux, que de le noyer? Jesrad reprit: S’il avait été vertueux, et s’il eût vécu, son destin était d’être assassiné lui-même avec la femme qu’il devait épouser, et le fils qui en devait naître. Mais quoi! dit Zadig, il est donc nécessaire qu’il y ait des crimes et des malheurs? et les malheurs tombent sur les gens de bien! Les méchants, répondit Jesrad, sont toujours malheureux: ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre, et il n’y a point de mal dont il ne naisse un bien. Mais, dit Zadig, s’il n’y avait que du bien, et point de mal? Alors, reprit Jesrad, cette terre serait une autre terre, l’enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse; et cet ordre, qui serait parfait, ne peut être que dans la demeure éternelle de l’Être suprême, de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes, dont aucun ne peut ressembler à l’autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n’y a ni deux feuilles d’arbre sur la terre, ni deux globes dans les champs infinis du ciel, qui soient semblables, et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l’eau par hasard, que c’est par un même hasard que cette maison est brûlée: mais il n’y a point de hasard; tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Souviens-toi de ce pêcheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Orosmade t’a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel! cesse de disputer contre ce qu’il faut adorer. Mais, dit Zadig.... Comme il disait mais, l’ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig à genoux adora la Providence, et se soumit. L’ange lui cria du haut des airs: Prends ton chemin vers Babylone.
Zadig hors de lui-même, et comme un homme auprès de qui est tombé le tonnerre, marchait au hasard. Il entra dans Babylone le jour où ceux qui avaient combattu dans la lice étaient déjà assemblés dans le grand vestibule du palais pour expliquer les énigmes, et pour répondre aux questions du grand mage. Tous les chevaliers étaient arrivés, excepté l’armure verte. Dès que Zadig parut dans la ville, le peuple s’assembla autour de lui ; les yeux ne se rassasiaient point de le voir, les bouches de le bénir, les cœurs de lui souhaiter l’empire. L’Envieux le vit passer, frémit, et se détourna ; le peuple le porta jusqu’au lieu de l’assemblée. La reine, à qui on apprit son arrivée, fut en proie à l’agitation de la crainte et de l’espérance ; l’inquiétude la dévorait : elle ne pouvait comprendre, ni pourquoi Zadig était sans armes, ni comment Itobad portait l’armure blanche. Un murmure confus s’éleva à la vue de Zadig. On était surpris et charmé de le revoir ; mais il n’était permis qu’aux chevaliers qui avaient combattu de paraître dans l’assemblée. J’ai combattu comme un autre, dit-il ; mais un autre porte ici mes armes ; et en attendant que j’aie l’honneur de le prouver, je demande la permission de me présenter pour expliquer les énigmes. On alla aux voix : sa réputation de probité était encore si fortement imprimée dans les esprits, qu’on ne balança pas à l’admettre. Le grand mage proposa d’abord cette question : Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et la plus courte, la plus prompte et la plus lente, la plus divisible et la plus étendue, la plus négligée et la plus regrettée, sans qui rien ne se peut faire, qui dévore tout ce qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand ? C’était à Itobad à parler. Il répondit qu’un homme comme lui n’entendait rien aux énigmes, et qu’il lui suffisait d’avoir vaincu à grands coups de lance. Les uns dirent que le mot de l’énigme était la fortune, d’autres la terre, d’autres la lumière. Zadig dit que c’était le temps : Rien n’est plus long, ajouta-t-il, puisqu’il est la mesure de l’éternité ; rien n’est plus court, puisqu’il manque à tous nos projets ; rien n’est plus lent pour qui attend ; rien de plus rapide pour qui jouit ; il s’étend jusqu’à l’infini en grand ; il se divise jusque dans l’infini en petit ; tous les hommes le négligent, tous en regrettent la perte ; rien ne se fait sans lui ; il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité et il immortalise les grandes choses. L’assemblée convint que Zadig avait raison. On demanda ensuite : Quelle est la chose qu’on reçoit sans remercier, dont on jouit sans savoir comment, qu’on donne aux autres quand on ne sait où l’on en est et qu’on perd sans s’en apercevoir ? Chacun dit son mot : Zadig devina seul que c’était la vie. Il expliqua toutes les autres énigmes avec la même facilité. Itobad disait toujours que rien n’était plus aisé, et qu’il en serait venu à bout tout aussi facilement, s’il avait voulu s’en donner la peine. On proposa des questions sur la justice, sur le souverain bien, sur l’art de régner. Les réponses de Zadig furent jugées les plus solides. C’est bien dommage, disait-on, qu’un si bon esprit soit un si mauvais cavalier. Illustres seigneurs, dit Zadig, j’ai eu l’honneur de vaincre dans la lice. C’est à moi qu’appartient l’armure blanche. Le seigneur Itobad s’en empara pendant mon sommeil : il jugea apparemment qu’elle lui siérait mieux que la verte. Je suis prêt à lui prouver d’abord devant vous, avec ma robe et mon épée, contre toute cette belle armure blanche qu’il m’a prise, que c’est moi qui ai eu l’honneur de vaincre le brave Otame. Itobad accepta le défi avec la plus grande confiance. Il ne doutait pas qu’étant casqué, cuirassé, brassardé, il ne vînt aisément à bout d’un champion en bonnet de nuit et en robe de chambre. Zadig tira son épée, en saluant la reine qui le regardait, pénétrée de joie et de crainte. Itobad tira la sienne, en ne saluant personne. Il s’avança sur Zadig comme un homme qui n’avait rien à craindre. Il était prêt à lui fendre la tête : Zadig sut parer le coup, en opposant ce qu’on appelle le fort de l’épée au faible de son adversaire, de façon que l’épée d’Itobad se rompit. Alors Zadig saisissant son ennemi au corps le renversa par terre ; et lui portant la pointe de son épée au défaut de la cuirasse : Laissez-vous désarmer, dit-il, ou je vous tue. Itobad, toujours surpris des disgrâces qui arrivaient à un homme comme lui, laissa faire Zadig, qui lui ôta paisiblement son magnifique casque, sa superbe cuirasse, ses beaux brassards, ses brillants cuissards ; s’en revêtit, et courut dans cet équipage se jeter aux genoux d’Astarté. Cador prouva aisément que l’armure appartenait à Zadig. Il fut reconnu roi d’un consentement unanime, et surtout de celui d’Astarté, qui goûtait, après tant d’adversités, la douceur de voir son amant digne aux yeux de l’univers d’être son époux. Itobad alla se faire appeler monseigneur dans sa maison. Zadig fut roi, et fut heureux. Il avait présent à l’esprit ce que lui avait dit l’ange Jesrad. Il se souvenait même du grain de sable devenu diamant. La reine et lui adorèrent la Providence. Zadig laissa la belle capricieuse Missouf courir le monde. Il envoya chercher le brigand Arbogad, auquel il donna un grade honorable dans son armée, avec promesse de l’avancer aux premières dignités s’il se comportait en vrai guerrier, et de le faire pendre s’il faisait le métier de brigand. Sétoc fut appelé du fond de l’Arabie, avec la belle Almona, pour être à la tête du commerce de Babylone. Cador fut placé et chéri selon ses services ; il fut l’ami du roi, et le roi fut alors le seul monarque de la terre qui eût un ami. Le petit muet ne fut pas oublié. On donna une belle maison au pêcheur. Orcan fut condamné à lui payer une grosse somme et à lui rendre sa femme ; mais le pêcheur, devenu sage, ne prit que l’argent. Ni la belle Sémire ne se consolait d’avoir cru que Zadig serait borgne, ni Azora ne cessait de pleurer d’avoir voulu lui couper le nez. Il adoucit leurs douleurs par des présents. L’Envieux mourut de rage et de honte. L’empire jouit de la paix, de la gloire, et de l’abondance : ce fut le plus beau siècle de la terre ; elle était gouvernée par la justice et par l’amour. On bénissait Zadig, et Zadig bénissait le ciel.
C’est ici que finit le manuscrit qu’on a retrouvé de l’histoire de Zadig. On sait qu’il a essuyé bien d’autres aventures qui ont été fidèlement écrites. On prie messieurs les interprètes des langues orientales de les communiquer, si elles parviennent jusqu’à eux.
CHAPITRE I.
Comment Candide fut élevé dans un beau château, et comment il fut chassé d’icelui.
Il y avait en Vestphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les moeurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple; c’est, je crois, pour cette raison qu’on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils de la soeur de monsieur le baron et d’un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu’il n’avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l’injure du temps.
Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Vestphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d’une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin; ses palefreniers étaient ses piqueurs; le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l’appelaient tous monseigneur, et ils riaient quand il faisait des contes.
Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s’attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l’oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère.
Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles.
« Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement: car, tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux, aussi monseigneur a un très beau château; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé; et, les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l’année: par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise; il fallait dire que tout est au mieux. »
Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment; car il trouvait Mlle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu’il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu’après le bonheur d’être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur était d’être Mlle Cunégonde; le troisième, de la voir tous les jours; et le quatrième, d’entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre.
Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu’on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme Mlle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin; elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s’en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d’être savante, songeant qu’elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne.
Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit; Candide rougit aussi; elle lui dit bonjour d’une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu’il disait. Le lendemain après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent; Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment la main, le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière; leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s’enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s’égarèrent. M. le baron de Thunder-ten-tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière; Cunégonde s’évanouit; elle fut souffletée par madame la baronne dès qu’elle fut revenue à elle-même; et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.
CHAPITRE II.
Ce que devint Candide parmi les Bulgares.
Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes; il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons; la neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s’appelle Valdberghoff-trarbk-dikdorff, n’ayant point d’argent, mourant de faim et de lassitude. Il s’arrêta tristement à la porte d’un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent: « Camarade, dit l’un, voilà un jeune homme très bien fait, et qui a la taille requise. » Ils s’avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d’honneur, mais je n’ai pas de quoi payer mon écot. — Ah! monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien: n’avez-vous pas cinq pieds cinq pouces de haut? — Oui, messieurs, c’est ma taille, dit-il en faisant la révérence. — Ah! monsieur, mettez-vous à table; non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu’un homme comme vous manque d’argent; les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. — Vous avez raison, dit Candide: c’est ce que M. Pangloss m’a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. » On le prie d’accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet; on n’en veut point, on se met à table: « N’aimez-vous pas tendrement?... — Oh! oui, répondit-il, j’aime tendrement Mlle Cunégonde. — Non, dit l’un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n’aimez pas tendrement le roi des Bulgares. — Point du tout, dit-il, car je ne l’ai jamais vu. — Comment! c’est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. — Oh! très volontiers, messieurs »; et il boit. « C’en est assez, lui dit-on, vous voilà l’appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares; votre fortune est faite, et votre gloire est assurée. » On lui met sur-le-champ les fers aux pieds, et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne trente coups de bâton; le lendemain il fait l’exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que vingt coups; le surlendemain on ne lui en donne que dix, et il est regardé par ses camarades comme un prodige.
Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s’avisa un beau jour de printemps de s’aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c’était un privilège de l’espèce humaine, comme de l’espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n’eut pas fait deux lieues que voilà quatre autres héros de six pieds qui l’atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu’il aimait le mieux d’être fustigé trente-six fois par tout le régiment, ou de recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres; et qu’il ne voulait ni l’un ni l’autre, il fallut faire un choix; il se détermina, en vertu du don de Dieu qu’on nomme liberté, à passer trente-six fois par les baguettes; il essuya deux promenades. Le régiment était composé de deux mille hommes; cela lui composa quatre mille coups de baguette, qui, depuis la nuque du cou jusqu’au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n’en pouvant plus, demanda en grâce qu’on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête; il obtint cette faveur; on lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s’informe du crime du patient; et comme ce roi avait un grand génie, il comprit, par tout ce qu’il apprit de Candide, que c’était un jeune métaphysicien, fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en trois semaines avec les émollients enseignés par Dioscoride, Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.
CHAPITRE III.
Comment Candide se sauva d’entre les Bulgares, et ce qu’il devint.
Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de chaque côté; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le parti d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d’abord un village voisin; il était en cendres: c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes; là des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs; d’autres, à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés.
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village: il appartenait à des Bulgares, et des héros abares l’avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac, et n’oubliant jamais Mlle Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande; mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là, et qu’on y était chrétien, il ne douta pas qu’on ne le traitât aussi bien qu’il l’avait été dans le château de monsieur le baron avant qu’il en eût été chassé pour les beaux yeux de Mlle Cunégonde.
Il demanda l’aumône à plusieurs graves personnages, qui lui répondirent tous que, s’il continuait à faire ce métier, on l’enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre.
Il s’adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul une heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit: « Que venez-vous faire ici? y êtes-vous pour la bonne cause? — Il n’y a point d’effet sans cause, répondit modestement Candide, tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d’auprès de Mlle Cunégonde, que j’aie passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu’à ce que je puisse en gagner; tout cela ne pouvait être autrement. — Mon ami, lui dit l’orateur, croyez-vous que le pape soit l’Antéchrist? — Je ne l’avais pas encore entendu dire, répondit Candide; mais qu’il le soit ou qu’il ne le soit pas, je manque de pain. — Tu ne mérites pas d’en manger, dit l’autre; va, coquin, va, misérable, ne m’approche de ta vie. » La femme de l’orateur, ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fût antéchrist, lui répandit sur le chef un plein... O ciel! à quel excès se porte le zèle de la religion dans les dames!
Un homme qui n’avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à deux pieds sans plumes, qui avait une âme; il l’amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de deux florins, et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu’on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s’écriait: « Maître Pangloss me l’avait bien dit que tout est au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de la dureté de ce monsieur à manteau noir et de madame son épouse. »
Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la gorge, tourmenté d’une toux violente et crachant une dent à chaque effort.
CHAPITRE. IV.
Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint.
Candide, plus ému encore de compassion que d’horreur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu’il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes, et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. « Hélas! dit le misérable à l’autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? — Qu’entends-je? Vous, mon cher maître! vous, dans cet état horrible! Quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n’êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? Qu’est devenue Mlle Cunégonde, la perle des filles, le chef d’oeuvre de la nature? — Je n’en peux plus », dit Pangloss. Aussitôt Candide le mena dans l’étable de l’anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain; et quand Pangloss fut refait: « Eh bien! lui dit-il, Cunégonde? — Elle est morte », reprit l’autre. Candide s’évanouit à ce mot; son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l’étable. Candide rouvre les yeux. « Cunégonde est morte! Ah! meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? ne serait-ce point de m’avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied? — Non, dit Pangloss; elle a été éventrée par des soldats bulgares, après avoir été violée autant qu’on peut l’être; ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre; madame la baronne a été coupée en morceaux; mon pauvre pupille, traité précisément comme sa soeur; et quant au château, il n’est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre; mais nous avons été bien vengés, car les Abares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. »
A ce discours, Candide s’évanouit encore; mais revenu à soi, et ayant dit tout ce qu’il devait dire, il s’enquit de la cause et de l’effet, et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. « Hélas! dit l’autre, c’est l’amour; l’amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l’univers, l’âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. — Hélas! dit Candide, je l’ai connu, cet amour, ce souverain des coeurs, cette âme de notre âme; il ne m’a jamais valu qu’un baiser et vingt coups de pied au cul. — Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable? »
Pangloss répondit en ces termes: « O mon cher Candide! vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne; j’ai goûté dans ses bras les délices du paradis, qui ont produit ces tourments d’enfer dont vous me voyez dévoré; elle en était infectée, elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d’un cordelier très savant, qui avait remonté à la source; car il l’avait eue d’une vieille comtesse, qui l’avait reçue d’un capitaine de cavalerie, qui la devait à une marquise, qui la tenait d’un page, qui l’avait reçue d’un jésuite, qui, étant novice, l’avait eue en droite ligne d’un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me meurs.
— Ô Pangloss! s’écria Candide, voilà une étrange généalogie! n’est-ce pas le diable qui en fut la souche? — Point du tout, répliqua ce grand homme; c’était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire; car si Colomb n’avait pas attrapé, dans une île de l’Amérique, cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l’opposé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le chocolat ni la cochenille; il faut encore observer que jusqu’aujourd’hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais, ne la connaissent pas encore; mais il y a une raison suffisante pour qu’ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées composées d’honnêtes stipendiaires, bien élevés, qui décident du destin des États; on peut assurer que, quand trente mille hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ vingt mille vérolés de chaque côté.
— Voilà qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir. — Et comment le puis-je? dit Pangloss; je n’ai pas le sou, mon ami; et dans toute l’étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu’il y ait quelqu’un qui paye pour nous. »
Ce dernier discours détermina Candide; il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques, et lui fit une peinture si touchante de l’état où son ami était réduit que le bonhomme n’hésita pas à recueillir le docteur Pangloss; il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu’un oeil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l’arithmétique. L’anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de deux mois, étant obligé d’aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ses deux philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n’était pas de cet avis. « Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de vingt-quatre ni baïonnettes, et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes, et la justice qui s’empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. — Tout cela était indispensable, répliquait le docteur borgne, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. » Tandis qu’il raisonnait, l’air s’obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne.
CHAPITRE V.
Tempête, naufrage, tremblement de terre, et ce qui advint du Docteur Pangloss, de Candide et de l’Anabaptiste Jacques.
La moitié des passagers, affaiblis, expirants de ces angoisses inconcevables que le roulis d’un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agitées en sens contraire, n’avait pas même la force de s’inquiéter du danger. L’autre moitié jetait des cris et faisait des prières; les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entrouvert. Travaillait qui pouvait, personne ne s’entendait, personne ne commandait. L’anabaptiste aidait un peu à la manoeuvre; il était sur le tillac; un matelot furieux le frappe rudement et l’étend sur les planches; mais du coup qu’il lui donna il eut lui-même une si violente secousse qu’il tomba hors du vaisseau la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompue. Le bon Jacques court à son secours, l’aide à remonter, et de l’effort qu’il fit il est précipité dans la mer à la vue du matelot, qui le laissa périr, sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer; le philosophe Pangloss l’en empêche, en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s’y noyât. Tandis qu’il le prouvait a priori, le vaisseau s’entrouvre, tout périt à la réserve de Pangloss, de Candide, et de ce brutal de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste; le coquin nagea heureusement jusqu’au rivage où Pangloss et Candide furent portés sur une planche.
Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne; il leur restait quelque argent, avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête.
A peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu’ils sentent la terre trembler sous leurs pas(1); la mer s’élève en bouillonnant dans le port, et brise les vaisseaux qui sont à l’ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques; les maisons s’écroulent, les toits sont renversés sur les fondements, et les fondements se dispersent; trente mille habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines, Le matelot disait en sifflant et en jurant: « Il y aura quelque chose à gagner ici. — Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène? disait Pangloss. — Voici le dernier jour du monde! » s’écriait Candide. Le matelot court incontinent au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l’argent, en trouve, s’en empare, s’enivre, et, ayant cuvé son vin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu’il rencontre sur les ruines des maisons détruites et au milieu des mourants et des morts. Pangloss le tirait cependant par la manche. « Mon ami, lui disait-il, cela n’est pas bien, vous manquez à la raison universelle, vous prenez mal votre temps. — Tête et sang! répondit l’autre, je suis matelot et né à Batavia; j’ai marché quatre fois sur le crucifix dans quatre voyages au Japon; tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle! »
Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide; il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il disait à Pangloss: « Hélas! procure-moi un peu de vin et d’huile; je me meurs. — Ce tremblement de terre n’est pas une chose nouvelle, répondit Pangloss; la ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l’année passée; même causes, même effets: il y a certainement une traînée de soufre sous terre depuis Lima jusqu’à Lisbonne. — Rien n’est plus probable, dit Candide; mais, pour Dieu, un peu d’huile et de vin. — Comment, probable? répliqua le philosophe; je soutiens que la chose est démontrée. » Candide perdit connaissance, et Pangloss lui apporta un peu d’eau d’une fontaine voisine.
Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche en se glissant à travers des décombres, ils réparèrent un peu leurs forces. Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens secourus par eux leur donnèrent un aussi bon dîner qu’on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste; les convives arrosaient leur pain de leurs larmes; mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement: « Car, dit-il, tout ceci est ce qu’il y a de mieux. Car, s’il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs. Car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont. Car tout est bien. »
Un petit homme noir, familier de l’Inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et dit: « Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel; car, si tout est au mieux, il n’y a donc eu ni chute ni punition.
— Je demande très humblement pardon à Votre Excellence, répondit Pangloss encore plus poliment, car la chute de l’homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. — Monsieur ne croit donc pas à la liberté? dit le familier. — Votre Excellence m’excusera, dit Pangloss; la liberté peut subsister avec la nécessité absolue; car il était nécessaire que nous fussions libres; car enfin la volonté déterminée... » Pangloss était au milieu de sa phrase, quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui servait à boire du vin de Porto, ou d’Oporto.
CHAPITRE. VI.
Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre, et comment Candide fut fessé.
Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n’avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé; il était décidé par l’université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler.
On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d’avoir épousé sa commère, et deux Portugais qui en mangeant un poulet en avaient arraché le lard: on vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l’un pour avoir parlé, et l’autre pour avoir écouté avec un air d’approbation: tous deux furent menés séparément dans des appartements d’une extrême fraîcheur, dans lesquels on n’était jamais incommodé du soleil; huit jours après ils furent tous deux revêtus d’un san-benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier: la mitre et le san-benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n’avaient ni queues ni griffes; mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d’une belle musique en faux-bourdon. Candide fut fessé en cadence, pendant qu’on chantait; le Biscayen et les deux hommes qui n’avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable.
Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même: « Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Passe encore si je n’étais que fessé, je l’ai été chez les Bulgares. Mais, ô mon cher Pangloss! le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi! Ô mon cher anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port! Ô Mlle Cunégonde! la perle des filles, faut-il qu’on vous ait fendu le ventre! »
Il s’en retournait, se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni, lorsqu’une vieille l’aborda et lui dit: « Mon fils, prenez courage, suivez-moi. »
CHAPITRE. VII.
Comment une vieille prit soin de Candide, et comment il retrouva celle qu’il aimait.
Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure; elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire; elle lui montra un petit lit assez propre; il y avait auprès du lit un habit complet. « Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame d’Atocha, Mgr saint Antoine de Padoue et Mgr saint Jacques de Compostelle prennent soin de vous: je reviendrai demain. » Candide, toujours étonné de tout ce qu’il avait vu, de tout ce qu’il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n’est pas ma main qu’il faut baiser, dit la vieille; je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. »
Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dormit. Le lendemain la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d’une autre pommade; elle lui apporte ensuite à dîner; elle revient sur le soir, et apporte à souper. Le surlendemain elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous? lui disait toujours Candide; qui vous a inspiré tant de bonté? quelles grâces puis-je vous rendre? » La bonne femme ne répondait jamais rien; elle revint sur le soir et n’apporta point à souper. « Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. » Elle le prend sous le bras, et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille: ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une petite porte. On ouvre; elle mène Candide, par un escalier dérobé, dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte, et s’en va. Candide croyait rêver, et regardait toute sa vie comme un songe funeste, et le moment présent comme un songe agréable.
La vieille reparut bientôt; elle soutenait avec peine une femme tremblante, d’une taille majestueuse, brillante de pierreries et couverte d’un voile. « Ôtez ce voile », dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche; il lève le voile d’une main timide. Quel moment! quelle surprise! il croit voir Mlle Cunégonde; il la voyait en effet, c’était elle-même. La force lui manque, il ne peut proférer une parole, il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d’eaux spiritueuses; ils reprennent leurs sens, ils se parlent: ce sont d’abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit, et les laisse en liberté. « Quoi! c’est vous, lui dit Candide, vous vivez! Je vous retrouve en Portugal! On ne vous a donc pas violée? On ne vous a point fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss me l’avait assuré? — Si fait, dit la belle Cunégonde; mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. — Mais votre père et votre mère ont-ils été tués? — Il n’est que trop vrai, dit Cunégonde en pleurant. — Et votre frère? — Mon frère a été tué aussi. — Et pourquoi êtes-vous en Portugal? et comment avez-vous su que j’y étais? et par quelle étrange aventure m’avez-vous fait conduire dans cette maison? — Je vous dirai tout cela, répliqua la dame; mais il faut auparavant que vous m’appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. »
Candide lui obéit avec un profond respect; et quoiqu’il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l’échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu’il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel; elle donna des larmes à la mort du bon anabaptiste et de Pangloss; après quoi elle parla en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole, et qui la dévorait des yeux.
CHAPITRE. VIII.
Histoire de Cunégonde.
« J’étais dans mon lit et je dormais profondément, quand il plut au ciel d’envoyer les Bulgares dans notre beau château de Thunder-ten-tronckh; ils égorgèrent mon père et mon frère, et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de six pieds, voyant qu’à ce spectacle j’avais perdu connaissance, se mit à me violer; cela me fit revenir, je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis, j’égratignai, je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d’usage: le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte encore la marque. — Hélas! j’espère bien la voir, dit le naïf Candide. — Vous la verrez, dit Cunégonde; mais continuons. — Continuez », dit Candide.
Elle reprit ainsi le fil de son histoire: « Un capitaine bulgare entra, il me vit toute sanglante, et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal, et le tua sur mon corps. Ensuite il me fit panser, et m’emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemises qu’il avait, je faisais sa cuisine; il me trouvait fort jolie, il faut l’avouer; et je ne nierai pas qu’il ne fût très bien fait, et qu’il n’eût la peau blanche et douce; d’ailleurs peu d’esprit, peu de philosophie: on voyait bien qu’il n’avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de trois mois, ayant perdu tout son argent et s’étant dégoûté de moi, il me vendit à un Juif nommé don Issacar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et qui aimait passionnément les femmes. Ce Juif s’attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher; je lui ai mieux résisté qu’au soldat bulgare. Une personne d’honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s’en affermit. Le Juif, pour m’apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J’avais cru jusque-là qu’il n’y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thunder-ten-tronckh; j’ai été détrompée.
« Le grand inquisiteur m’aperçut un jour à la messe, il me lorgna beaucoup, et me fit dire qu’il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais; je lui appris ma naissance; il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d’appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à don Issacar de me céder à monseigneur. Don Issacar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n’en voulut rien faire. L’inquisiteur le menaça d’un auto-da-fé. Enfin mon Juif, intimidé, conclut un marché, par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun: que le Juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du sabbat, et que l’inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a six mois que cette convention subsiste. Ce n’a pas été sans querelles; car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l’ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j’ai résisté jusqu’à présent à toutes les deux, et je crois que c’est pour cette raison que j’ai toujours été aimée.
« Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre, et pour intimider don Issacar, il plut à monseigneur l’inquisiteur de célébrer un auto-da-fé. Il me fit l’honneur de m’y inviter. Je fus très bien placée; on servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l’exécution. Je fus, à la vérité, saisie d’horreur en voyant brûler ces deux Juifs et cet honnête Biscayen qui avait épousé sa commère; mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis, dans un san-benito et sous une mitre, une figure qui ressemblait à celle de Pangloss! Je me frottai les yeux, je regardai attentivement, je le vis pendre; je tombai en faiblesse. A peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé tout nu: ce fut là le comble de l’horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai, avec vérité, que votre peau est encore plus blanche et d’un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m’accablaient, qui me dévoraient. Je m’écriai, je voulus dire: « Arrêtez, barbares! » mais la voix me manqua, et mes cris auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien fessé: « Comment se peut-il faire, disais-je, que l’aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l’un pour recevoir cent coups de fouet, et l’autre pour être pendu par l’ordre de monseigneur l’inquisiteur dont je suis la bien-aimée? Pangloss m’a donc bien cruellement trompée quand il me disait que tout va le mieux du monde. »
« Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même, et tantôt prête de mourir de faiblesse, j’avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l’insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu’il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain don Issacar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miserere en faux-bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louai Dieu qui vous ramenait à moi par tant d’épreuves. Je recommandai à ma vieille d’avoir soin de vous, et de vous amener ici dès qu’elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission; j’ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante; j’ai grand appétit; commençons par souper. »
Les voilà qui se mettent tous deux à table; et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé; ils y étaient quand le signor don Issacar, l’un des maîtres de la maison, arriva. C’était le jour du sabbat. Il venait jouir de ses droits, et expliquer son tendre amour.
CHAPITRE. IX.
Ce qu’il advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d’un juif.
Cet Issacar était le plus colérique Hébreu qu’on eût vu dans Israël depuis la captivité en Babylone. « Quoi! dit-il, chienne de Galiléenne, ce n’est pas assez de monsieur l’inquisiteur? Il faut que ce coquin partage aussi avec moi? » En disant cela il tire un long poignard dont il était toujours pourvu, et ne croyant pas que son adverse partie eût des armes, il se jette sur Candide; mais notre bon Vestphalien avait reçu une belle épée de la vieille avec l’habit complet. Il tire son épée, quoiqu’il eût les moeurs fort douces, et vous étend l’Israélite roide mort sur le carreau, aux pieds de la belle Cunégonde.
« Sainte Vierge! s’écria-t-elle, qu’allons-nous devenir? Un homme tué chez moi! si la justice vient, nous sommes perdus. — Si Pangloss n’avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité, car c’était un grand philosophe. A son défaut consultons la vieille. » Elle était fort prudente, et commençait à dire son avis, quand une autre petite porte s’ouvrit. Il était une heure après minuit, c’était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à monseigneur l’inquisiteur. Il entre et voit le fessé Candide l’épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée, et la vieille donnant des conseils.
Voici dans ce moment ce qui se passa dans l’âme de Candide, et comment il raisonna: « Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler; il pourra en faire autant de Cunégonde; il m’a fait fouetter impitoyablement; il est mon rival; je suis en train de tuer, il n’y a pas à balancer. » Ce raisonnement fut net et rapide, et sans donner le temps à l’inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d’outre en outre, et le jette à côté du Juif. « En voici bien d’une autre, dit Cunégonde; il n’y a plus de rémission; nous sommes excommuniés, notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en deux minutes un Juif et un prélat? — Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l’Inquisition, on ne se connaît plus. »
La vieille prit alors la parole et dit: « Il y a trois chevaux andalous dans l’écurie, avec leurs selles et leurs brides: que le brave Candide les prépare; madame a des moyadors et des diamants: montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et allons à Cadix; il fait le plus beau temps du monde, et c’est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. »
Aussitôt Candide selle les trois chevaux. Cunégonde, la vieille et lui font trente milles d’une traite. Pendant qu’ils s’éloignaient, la Sainte-Hermandad arrive dans la maison; on enterre monseigneur dans une belle église, et on jette Issacar à la voirie.
Candide, Cunégonde et la vieille étaient déjà dans la petite ville d’Avacéna, au milieu des montagnes de la Sierra-Morena; et ils parlaient ainsi dans un cabaret.
CHAPITRE. X.
Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix, et de leur embarquement.
« Qui a donc pu me voler mes pistoles et mes diamants? disait en pleurant Cunégonde; de quoi vivrons-nous? comment ferons-nous? où trouver des inquisiteurs et des Juifs qui m’en donnent d’autres? — Hélas! dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père cordelier qui coucha hier dans la même auberge que nous à Badajoz; Dieu me garde de faire un jugement téméraire! mais il entra deux fois dans notre chambre, et il partit longtemps avant nous. — Hélas! dit Candide, le bon Pangloss m’avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien, suivant ces principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde — Pas un maravédis, dit-elle. — Quel parti prendre? dit Candide. — Vendons un des chevaux, dit la vieille; je monterai en croupe derrière mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et nous arriverons à Cadix. »
Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins; il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucena, par Chillas, par Lebrixa, et arrivèrent enfin à Cadix. On y équipait une flotte, et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay, qu’on accusait d’avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d’Espagne et de Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l’exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d’adresse, de fierté, d’agilité, qu’on lui donna une compagnie d’infanterie à commander. Le voilà capitaine; il s’embarque avec Mlle Cunégonde, la vieille, deux valets et les deux chevaux andalous qui avaient appartenu à M. le grand inquisiteur de Portugal.
Pendant toute la traversée ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. « Nous allons dans un autre univers, disait Candide; c’est dans celui-là sans doute que tout est bien. Car il faut avouer qu’on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale. — Je vous aime de tout mon coeur, disait Cunégonde; mais j’ai encore l’âme tout effarouchée de ce que j’ai vu, de ce que j’ai éprouvé. — Tout ira bien, répliquait Candide; la mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe; elle est plus calme, les vents plus constants. C’est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. — Dieu le veuille! disait Cunégonde; mais j’ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon coeur est presque fermé à l’espérance. — Vous vous plaignez, leur dit la vieille; hélas! vous n’avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. » Cunégonde se mit presque à rire, et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être plus malheureuse qu’elle. « Hélas! lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n’ayez été violée par deux Bulgares, que vous n’ayez reçu deux coups de couteau dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos châteaux, qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères et deux pères, et que vous n’ayez vu deux de vos amants fouettés dans un auto-da-fé, je ne vois pas que vous puissiez l’emporter sur moi; ajoutez que je suis née baronne avec soixante et douze quartiers, et que j’ai été cuisinière. — Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance; et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. » Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l’esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes.
CHAPITRE. XI.
Histoire de la vieille.
« Je n’ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés d’écarlate; mon nez n’a pas toujours touché à mon menton, et je n’ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X, et de la princesse de Palestrine. On m’éleva jusqu’à quatorze ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n’auraient pas servi d’écurie; et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Vestphalie. Je croissais en beauté, en grâces, en talents, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. J’inspirais déjà de l’amour, ma gorge se formait; et quelle gorge! blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis; et quels yeux! quelles paupières! quels sourcils noirs! quelles flammes brillaient dans mes deux prunelles, et effaçaient la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m’habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par-devant et par-derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place.
« Je fus fiancée à un prince souverain de Massa-Carrara. Quel prince! aussi beau que moi, pétri de douceur et d’agréments, brillant d’esprit et brûlant d’amour. Je l’aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. C’était une pompe, une magnificence inouïe; c’étaient des fêtes, des carrousels, des opera-buffa continuels; et toute l’Italie fit pour moi des sonnets dont il n’y eut pas un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur, quand une vieille marquise qui avait été maîtresse de mon prince l’invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de deux heures avec des convulsions épouvantables. Mais ce n’est qu’une bagatelle. Ma mère, au désespoir, et bien moins affligée que moi, voulut s’arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaète. Nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l’autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu’un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape: ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes, et en demandant au corsaire une absolution in articulo mortis.
« Aussitôt on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d’honneur aussi, et moi aussi. C’est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c’est qu’ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes nous ne nous laissons mettre d’ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange: voilà comme on juge de tout quand on n’est pas sorti de son pays. J’appris bientôt que c’était pour voir si nous n’avions pas caché là quelques diamants: c’est un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J’ai su que MM. les religieux chevaliers de Malte n’y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turques; c’est une loi du droit des gens à laquelle on n’a jamais dérogé.
« Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d’être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle; nos filles d’honneur, nos simples femmes de chambre, avaient plus de charmes qu’on n’en peut trouver dans toute l’Afrique. Pour moi, j’étais ravissante, j’étais la beauté, la grâce même, et j’étais pucelle; je ne le fus pas longtemps: cette fleur qui avait été réservée pour le beau prince de Massa-Carrara me fut ravie par le capitaine corsaire; c’était un nègre abominable, qui croyait encore me faire beaucoup d’honneur. Certes, il fallait que Mme la princesse de Palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu’à notre arrivée à Maroc. Mais passons; ce sont des choses si communes qu’elles ne valent pas la peine qu’on en parle.
« Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. Cinquante fils de l’empereur Muley-Ismaël avaient chacun leur parti: ce qui produisait en effet cinquante guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. C’était un carnage continuel dans toute l’étendue de l’empire.
« A peine fûmes-nous débarqués que des noirs d’une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l’or, ce qu’il avait de plus précieux. Je fus témoin d’un combat tel que vous n’en voyez jamais dans vos climats d’Europe. Les peuples septentrionaux n’ont pas le sang assez ardent. Ils n’ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines; c’est du vitriol, c’est du feu qui coule dans celles des habitants du mont Atlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée, pour savoir à qui nous aurait. Un Maure saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche; un soldat maure la prit par une jambe, un de nos pirates la tenait par l’autre. Nos filles se trouvèrent presque toutes en un moment tirées ainsi à quatre soldats. Mon capitaine me tenait cachée derrière lui. Il avait le cimeterre au poing, et tuait tout ce qui s’opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué; et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l’étendue de plus de trois cents lieues, sans qu’on manquât aux cinq prières par jour ordonnées par Mahomet.
« Je me débarrassai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînai sous un grand oranger au bord d’un ruisseau voisin; j’y tombai d’effroi, de lassitude, d’horreur, de désespoir et de faim. Bientôt après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l’évanouissement que du repos. J’étais dans cet état de faiblesse et d’insensibilité, entre la mort et la vie, quand je me sentis pressée de quelque chose qui s’agitait sur mon corps. J’ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait, et qui disait entre ses dents: O che sciagura d’essere senza coglioni!
CHAPITRE XII.
Suite des malheurs de la vieille.
« Étonnée et ravie d’entendre la langue de ma patrie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu’il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l’instruisis en peu de mots des horreurs que j’avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m’emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu’il n’avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n’avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. « Je suis né à Naples, me dit-il, on y chaponne deux ou trois mille enfants tous les ans; les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner les États. On me fit cette opération avec un très grand succès, et j’ai été musicien de la chapelle de Mme la princesse de Palestrine. — De ma mère! m’écriai-je. — De votre mère! s’écria-t-il en pleurant. Quoi! vous seriez cette jeune princesse que j’ai élevée jusqu’à l’âge de six ans, et qui promettait déjà d’être aussi belle que vous êtes? — C’est moi-même; ma mère est à quatre cents pas d’ici, coupée en quartiers sous un tas de morts... »
« Je lui contai tout ce qui m’était arrivé; il me conta aussi ses aventures, et m’apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne, pour conclure avec ce monarque un traité, par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux, pour l’aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. « Ma mission est faite, me dit cet honnête eunuque; je vais m’embarquer à Ceuta, et je vous ramènerai en Italie. Ma che sciagura d’essere senza coglioni!»
« Je le remerciai avec des larmes d’attendrissement; et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger, et me vendit au dey de cette province. A peine fus-je vendue que cette peste qui a fait le tour de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe, se déclara dans Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblements de terre; mais, mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste?
— Jamais, répondit la baronne.
— Si vous l’aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu’elle est bien au-dessus d’un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique; j’en fus attaquée. Figurez vous quelle situation pour la fille d’un pape, âgée de quinze ans, qui en trois mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l’esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en quatre, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiférée dans Alger. Je n’en mourus pourtant pas. Mais mon eunuque et le dey, et presque tout le sérail d’Alger, périrent.
« Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dey. Un marchand m’acheta et me mena à Tunis, il me vendit à un autre marchand, qui me revendit à Tripoli; de Tripoli je fus revendue à Alexandrie, d’Alexandrie revendue à Smyrne, de Smyrne à Constantinople. J’appartins enfin à un aga des janissaires, qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azof contre les Russes qui l’assiégeaient.
« L’aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail, et nous logea dans un petit fort sur les Palus-Méotides, gardé par deux eunuques noirs et vingt soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azof fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l’âge; il ne resta que notre petit fort; les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les vingt janissaires avaient juré de ne se jamais rendre. Les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos deux eunuques, de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes.
« Nous avions un iman très pieux et très compatissant, qui leur fit un beau sermon par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait. « Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames, vous ferez très bonne chère; s’il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours; le ciel vous saura gré d’une action si charitable, et vous serez secourus. »
« Il avait beaucoup d’éloquence; il les persuada. On nous fit cette horrible opération. L’iman nous appliqua le même baume qu’on met aux enfants qu’on vient de circoncire. Nous étions toutes à la mort.
« A peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni que les Russes arrivent sur des bateaux plats; il ne réchappa pas un janissaire. Les Russes ne firent aucune attention à l’état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français: un d’eux, qui était fort adroit, prit soin de nous; il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que, quand les plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler; il nous assura que dans plusieurs sièges pareille chose était arrivée, et que c’était la loi de la guerre.
« Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. J’échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière, et qui me donnait vingt coups de fouet par jour. Mais ce seigneur ayant été roué au bout de deux ans avec une trentaine de boyards pour quelque tracasserie de cour, je profitai de cette aventure; je m’enfuis; je traversai toute la Russie; je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Vismar, à Leipsick, à Cassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam: j’ai vieilli dans la misère et dans l’opprobre, n’ayant que la moitié d’un derrière, me souvenant toujours que j’étais fille d’un pape; je voulus cent fois me tuer, mais j’aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes; car y a t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu’on veut toujours jeter par terre? d’avoir son être en horreur, et de tenir à son être? enfin de caresser le serpent qui nous dévore, jusqu’à ce qu’il nous ait mangé le coeur?
« J’ai vu dans les pays que le sort m’a fait parcourir, et dans les cabarets où j’ai servi, un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration; mais je n’en ai vu que douze qui aient mis volontairement fin à leur misère: trois nègres, quatre Anglais, quatre Genevois et un professeur allemand nommé Robeck. J’ai fini par être servante chez le Juif don Issacar; il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle; je me suis attachée à votre destinée, et j’ai été plus occupée de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs, si vous ne m’aviez pas un peu piquée, et s’il n’était d’usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j’ai de l’expérience, je connais le monde; donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous conter son histoire; et s’il s’en trouve un seul qui n’ait souvent maudit sa vie, qui ne se soit souvent dit à lui-même qu’il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première. »
CHAPITRE XIII.
Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille.
La belle Cunégonde, ayant entendu l’histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu’on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition; elle engagea tous les passagers l’un après l’autre à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. « C’est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume dans un auto-da-fé; il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvrent la terre et la mer et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. »
A mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos-Ayres. Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent chez le gouverneur Don Fernando d’Ibaraa, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza. Ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut, élevant si impitoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière, que tous ceux qui le saluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu’il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu’il fit fut de demander si elle n’était point la femme du capitaine. L’air dont il fit cette question alarma Candide: il n’osa pas dire qu’elle était sa femme, parce qu’en effet elle ne l’était point; il n’osait pas dire que c’était sa soeur, parce qu’elle ne l’était pas non plus; et quoique ce mensonge officieux eût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu’il pût être utile aux modernes, son âme était trop pure pour trahir la vérité. « Mlle Cunégonde, dit-il, doit me faire l’honneur de m’épouser, et nous supplions Votre Excellence de daigner faire notre noce. »
Don Fernando d’Ibaraa, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza, relevant sa moustache, sourit amèrement, et ordonna au capitaine Candide d’aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéit; le gouverneur demeura avec Mlle Cunégonde. Il lui déclara sa passion, lui protesta que le lendemain il l’épouserait à la face de l’Église, ou autrement, ainsi qu’il plairait à ses charmes. Cunégonde lui demanda un quart d’heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer.
La vieille dit à Cunégonde: « Mademoiselle, vous avez soixante et douze quartiers, et pas une obole; il ne tient qu’à vous d’être la femme du plus grand seigneur de l’Amérique méridionale, qui a une très belle moustache; est-ce à vous de vous piquer d’une fidélité à toute épreuve? Vous avez été violée par les Bulgares; un Juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces: les malheurs donnent des droits. J’avoue que, si j’étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d’épouser monsieur le gouverneur et de faire la fortune de M. le capitaine Candide. » Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l’âge et l’expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau; il portait un alcade et des alguazils, et voici ce qui était arrivé:
La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l’argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badajoz, lorsqu’elle fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquisiteur. Le cordelier, avant d’être pendu, avoua qu’il les avait volées; il indiqua les personnes et la route qu’elles prenaient. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On les suivit à Cadix; on envoya sans perdre temps un vaisseau à leur poursuite. Le vaisseau était déjà dans le port de Buenos-Ayres. Le bruit se répandit qu’un alcade allait débarquer, et qu’on poursuivait les meurtriers de monseigneur le grand inquisiteur. La prudente vieille vit dans l’instant tout ce qui était à faire. « Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n’avez rien à craindre; ce n’est pas vous qui avez tué monseigneur; et d’ailleurs le gouverneur, qui vous aime, ne souffrira pas qu’on vous maltraite; demeurez. » Elle court sur-le-champ à Candide: « Fuyez, dit-elle, ou dans une heure vous allez être brûlé. » Il n’y avait pas un moment à perdre; mais comment se séparer de Cunégonde, et où se réfugier?
CHAPITRE. XIV.
Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay.
Candide avait amené de Cadix un valet tel qu’on en trouve beaucoup sur les côtes d’Espagne et dans les colonies. C’était un quart d’Espagnol, né d’un métis dans le Tucuman; il avait été enfant de choeur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s’appelait Cacambo, et aimait fort son maître parce que son maître était un fort bon homme. Il sella au plus vite les deux chevaux andalous. « Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille; partons, et courons sans regarder derrière nous. » Candide versa des larmes. « O ma chère Cunégonde! faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces! Cunégonde amenée de si loin, que deviendrez-vous? — Elle deviendra ce qu’elle pourra, dit Cacambo; les femmes ne sont jamais embarrassées d’elles; Dieu y pourvoit; courons. — Où me mènes-tu? où allons-nous? que ferons-nous sans Cunégonde? disait Candide. — Par saint Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux jésuites; allons la faire pour eux: je sais assez les chemins, je vous mènerai dans leur royaume, ils seront charmés d’avoir un capitaine qui fasse l’exercice à la bulgare; vous ferez une fortune prodigieuse; quand on n’a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C’est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles.
— Tu as donc été déjà dans le Paraguay? dit Candide. — Eh vraiment oui! dit Cacambo; j’ai été cuistre dans le collège de l’Assomption, et je connais le gouvernement de Los Padres comme je connais les rues de Cadix. C’est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre; il est divisé en trente provinces. Los Padres y ont tout, et les peuples rien; c’est le chef-d’oeuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que Los Padres, qui font ici la guerre au roi d’Espagne et au roi de Portugal, et qui en Europe confessent ces rois; qui tuent ici des Espagnols, et qui à Madrid les envoient au ciel: cela me ravit; avançons; vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront Los Padres quand ils sauront qu’il leur vient un capitaine qui sait l’exercice bulgare! »
Dès qu’ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu’un capitaine demandait à parler à monseigneur le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguain courut aux pieds du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d’abord désarmés; on se saisit de leurs deux chevaux andalous. Les deux étrangers sont introduits au milieu de deux files de soldats; le commandant était au bout, le bonnet à trois cornes en tête, la robe retroussée, l’épée au côté, l’esponton à la main. Il fit un signe; aussitôt vingt-quatre soldats entourent les deux nouveaux venus. Un sergent leur dit qu’il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu’aucun Espagnol ouvre la bouche qu’en sa présence, et demeure plus de trois heures dans le pays. « Et où est le révérend père provincial? dit Cacambo. — Il est à la parade après avoir dit sa messe, répondit le sergent; et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans trois heures. — Mais, dit Cacambo, monsieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi, n’est point espagnol, il est allemand; ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa Révérence? »
Le sergent alla sur-le-champ rendre compte de ce discours au commandant. « Dieu soit béni! dit ce seigneur; puisqu’il est allemand, je peux lui parler; qu’on le mène dans ma feuillée. » Aussitôt on conduit Candide dans un cabinet de verdure orné d’une très jolie colonnade de marbre vert et or, et de treillages qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades, et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d’or; et tandis que les Paraguains mangèrent du maïs dans des écuelles de bois, en plein champ, à l’ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée.
C’était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l’oeil vif, l’oreille rouge, les lèvres vermeilles, l’air fier, mais d’une fierté qui n’était ni celle d’un Espagnol ni celle d’un jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes, qu’on leur avait saisies, ainsi que les deux chevaux andalous; Cacambo leur fit manger l’avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l’oeil sur eux, crainte de surprise.
Candide baisa d’abord le bas de la robe du commandant, ensuite ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand? lui dit le jésuite en cette langue. — Oui, mon Révérend Père », dit Candide. L’un et l’autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n’étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d’Allemagne êtes-vous? dit le jésuite. — De la sale province de Vestphalie, dit Candide: je suis né dans le château de Thunder-ten-tronckh. — Ô ciel! est il possible? s’écria le commandant. — Quel miracle! s’écria Candide. — Serait-ce vous? dit le commandant. — Cela n’est pas possible », dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse, ils s’embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi! serait-ce vous, mon Révérend Père? vous, le frère de la belle Cunégonde! vous, qui fûtes tué par les Bulgares! vous, le fils de monsieur le baron! vous, jésuite au Paraguay! Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Ô Pangloss! Pangloss! que vous seriez aise si vous n’aviez pas été pendu! »
Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguains qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et saint Ignace mille fois; il serrait Candide entre ses bras; leurs visages étaient baignés de pleurs. « Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, dit Candide, si je vous disais que Mlle Cunégonde, votre soeur, que vous avez crue éventrée, est pleine de santé. — Où? — Dans votre voisinage, chez M. le gouverneur de Buenos-Ayres; et je venais pour vous faire la guerre. » Chaque mot qu’ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps, en attendant le révérend père provincial; et le commandant parla ainsi à son cher Candide.
CHAPITRE. XV.
Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde.
« J’aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère, et violer ma soeur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette soeur adorable, et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, deux servantes et trois petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites, à deux lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l’eau bénite; elle était horriblement salée; il en entra quelques gouttes dans mes yeux; le père s’aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement: il mit la main sur mon coeur et le sentit palpiter; je fus secouru, et, au bout de trois semaines, il n’y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j’étais fort joli, je le devins encore davantage; aussi le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié; il me donna l’habit de novice; quelque temps après je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d’une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu’ils peuvent de jésuites espagnols; ils aiment mieux les étrangers, dont ils se croient plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré, en arrivant, du sous-diaconat et d’une lieutenance; je suis aujourd’hui colonel et prêtre. Nous recevrons vigoureusement les troupes du roi d’Espagne; je vous réponds qu’elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère soeur Cunégonde soit dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos-Ayres? » Candide l’assura par serment que rien n’était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler.
Le baron ne pouvait se lasser d’embrasser Candide, il l’appelait son frère, son sauveur. « Ah! peut-être, lui dit-il, nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueurs dans la ville, et reprendre ma soeur Cunégonde. — C’est tout ce que je souhaite, dit Candide; car je comptais l’épouser, et je l’espère encore. — Vous, insolent! répondit le baron, vous auriez l’impudence d’épouser ma soeur qui a soixante et douze quartiers! Je vous trouve bien effronté d’oser me parler d’un dessein si téméraire! » Candide, pétrifié d’un tel discours, lui répondit: « Mon Révérend Père, tous les quartiers du monde n’y font rien; j’ai tiré votre soeur des bras d’un Juif et d’un inquisiteur; elle m’a assez d’obligations, elle veut m’épouser. Maître Pangloss m’a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément je l’épouserai. — C’est ce que nous verrons, coquin! » dit le jésuite baron de Thunder-ten-tronckh, et en même temps il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide dans l’instant tire la sienne et l’enfonce jusqu’à la garde dans le ventre du baron jésuite; mais, en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer: « Hélas! mon Dieu, dit-il, j’ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère; je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà trois hommes que je tue; et dans ces trois il y a deux prêtres. »
Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la feuillée, accourut. « Il ne nous reste qu’à vendre cher notre vie, lui dit son maître: on va sans doute entrer dans la feuillée, il faut mourir les armes à la main. » Cacambo, qui en avait vu bien d’autres, ne perdit point la tête; il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort, et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d’oeil. « Galopons, mon maître; tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres; et nous aurons passé les frontières avant qu’on puisse courir après nous. » Il volait déjà en prononçant ces paroles, et en criant en espagnol: « Place, place pour le révérend père colonel. »
CHAPITRE. XVI.
Ce qu’il advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes et les sauvages nommés Oreillons.
Candide et son valet furent au-delà des barrières, et personne ne savait encore dans le camp la mort du jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s’enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu, où ils ne découvrirent aucune route. Enfin une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître leurs montures. Cacambo propose à son maître de manger, et lui en donne l’exemple. « Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon, quand j’ai tué le fils de monsieur le baron, et que je me vois condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie? à quoi me servira de prolonger mes misérables jours, puisque je dois les traîner loin d’elle dans les remords et dans le désespoir? et que dira le Journal de Trévoux? »
En parlant ainsi, il ne laissait pas de manger. Le soleil se couchait. Les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie; mais ils se levèrent précipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié; il avait appris à tirer chez les Bulgares, et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à deux coups, tire, et tue les deux singes. « Dieu soit loué, mon cher Cacambo! j’ai délivré d’un grand péril ces deux pauvres créatures; si j’ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l’ai bien réparé en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de très grands avantages dans le pays. »
Il allait continuer, mais sa langue devint percluse quand il vit ces deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leurs corps et remplir l’air des cris les plus douloureux. « Je ne m’attendais pas à tant de bonté d’âme », dit-il enfin à Cacambo; lequel lui répliqua: « Vous avez fait là un beau chef-d’oeuvre, mon maître; vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. — Leurs amants! serait-il possible? vous vous moquez de moi, Cacambo; le moyen de vous croire? — Mon cher maître, reprit Cacambo, vous êtes toujours étonné de tout; pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames? Ils sont des quarts d’hommes, comme je suis un quart d’Espagnol. — Hélas! reprit Candide, je me souviens d’avoir entendu dire à maître Pangloss qu’autrefois pareils accidents étaient arrivés, et que ces mélanges avaient produit des égipans, des faunes, des satyres; que plusieurs grands personnages de l’antiquité en avaient vu; mais je prenais cela pour des fables. — Vous devez être convaincu à présent, dit Cacambo, que c’est une vérité, et vous voyez comment en usent les personnes qui n’ont pas reçu une certaine éducation; tout ce que je crains, c’est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire. »
Ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s’enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo; et tous deux, après avoir maudit l’inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos-Ayres et le baron, s’endormirent sur de la mousse. A leur réveil, ils sentirent qu’ils ne pouvaient remuer; la raison en était que pendant la nuit les Oreillons, habitants du pays, à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garrottés avec des cordes d’écorce d’arbre. Ils étaient entourés d’une cinquantaine d’Oreillons tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de caillou: les uns faisaient bouillir une grande chaudière; les autres préparaient des broches, et tous criaient: « C’est un jésuite, c’est un jésuite! nous serons vengés, et nous ferons bonne chère; mangeons du jésuite, mangeons du jésuite! »
« Je vous l’avais bien dit, mon cher maître, s’écria tristement Cacambo, que ces deux filles nous joueraient d’un mauvais tour. » Candide, apercevant la chaudière et les broches, s’écria: « Nous allons certainement être rôtis ou bouillis. Ah! que dirait maître Pangloss, s’il voyait comme la pure nature est faite? Tout est bien; soit, mais j’avoue qu’il est bien cruel d’avoir perdu Mlle Cunégonde et d’être mis à la broche par des Oreillons. » Cacambo ne perdait jamais la tête. « Ne désespérez de rien, dit-il au désolé Candide; j’entends un peu le jargon de ces peuples, je vais leur parler. — Ne manquez pas, dit Candide, de leur représenter quelle est l’inhumanité affreuse de faire cuire des hommes, et combien cela est peu chrétien. »
— Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd’hui un jésuite: c’est très bien fait; rien n’est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c’est ainsi qu’on en agit dans toute la terre. Si nous n’usons pas du droit de le manger, c’est que nous avons d’ailleurs de quoi faire bonne chère; mais vous n’avez pas les mêmes ressources que nous; certainement il vaut mieux manger ses ennemis que d’abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais, messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jésuite en broche, et c’est votre défenseur, c’est l’ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays; monsieur que vous voyez est mon maître, et, bien loin d’être jésuite, il vient de tuer un jésuite, il en porte les dépouilles: voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe, portez-la à la première barrière du royaume de Los Padres; informez-vous si mon maître n’a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps; vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. Mais, si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les moeurs et les lois, pour ne nous pas faire grâce. »
Les Oreillons trouvèrent ce discours très raisonnable; ils députèrent deux notables pour aller en diligence s’informer de la vérité; les deux députés s’acquittèrent de leur commission en gens d’esprit, et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent leurs deux prisonniers, leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements, et les reconduisirent jusqu’aux confins de leurs États, en criant avec allégresse: « Il n’est point jésuite, il n’est point jésuite! »
Candide ne se lassait point d’admirer le sujet de sa délivrance. « Quel peuple! disait-il, quels hommes! quelles moeurs! si je n’avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d’épée au travers du corps du frère de Mlle Cunégonde, j’étais mangé sans rémission. Mais, après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m’ont fait mille honnêtetés dès qu’ils ont su que je n’étais pas jésuite. »
CHAPITRE. XVII.
Arrivée de Candide et de son valet au pays d’Eldorado, et ce qu’ils y virent.
Quand ils furent aux frontières des Oreillons: « Vous voyez, dit Cacambo à Candide, que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l’autre: croyez-moi, retournons en Europe par le plus court. — Comment y retourner? dit Candide, et où aller? si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Abares y égorgent tout; si je retourne en Portugal, j’y suis brûlé; si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons à tout moment d’être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que Mlle Cunégonde habite?
— Tournons vers la Cayenne, dit Cacambo: nous y trouverons des Français, qui vont par tout le monde; ils pourront nous aider. Dieu aura peut-être pitié de nous. »
Il n’était pas facile d’aller à la Cayenne: ils savaient bien à peu près de quel côté il fallait marcher; mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages, étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue; leurs provisions furent consumées; ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages, et se trouvèrent enfin auprès d’une petite rivière bordée de cocotiers, qui soutinrent leur vie et leurs espérances.
Cacambo, qui donnait toujours d’aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide: « Nous n’en pouvons plus, nous avons assez marché; j’aperçois un canot vide sur le rivage, emplissons-le de cocos, jetons-nous dans cette petite barque, laissons-nous aller au courant; une rivière mène toujours à quelque endroit habité. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. — Allons, dit Candide, recommandons-nous à la Providence. »
Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s’élargissait toujours; enfin elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s’élevaient jusqu’au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiesse de s’abandonner aux flots sous cette voûte. Le fleuve, resserré en cet endroit, les porta avec une rapidité et un bruit horrible. Au bout de vingt-quatre heures ils revirent le jour; mais leur canot se fracassa contre les écueils; il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieue entière; enfin ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin; partout l’utile était agréable. Les chemins étaient couverts ou plutôt ornés de voitures d’une forme et d’une matière brillante, portant des hommes et des femmes d’une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d’Andalousie, de Tétuan et de Méquinez.
« Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Vestphalie. » Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu’il rencontra. Quelques enfants du village, couverts de brocarts d’or tout déchirés, jouaient au palet à l’entrée du bourg; nos deux hommes de l’autre monde s’amusèrent à les regarder: leurs palets étaient d’assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Il prit envie aux voyageurs d’en ramasser quelques-uns; c’était de l’or, c’était des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. « Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palet. » Le magister du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l’école. « Voilà, dit Candide, le précepteur de la famille royale. »
Les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu, en laissant à terre leurs palets et tout ce qui avait servi à leurs divertissements. Candide les ramasse, court au précepteur, et les lui présente humblement, lui faisant entendre par signes que Leurs Altesses Royales avaient oublié leur où et leurs pierreries. Le magister du village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide avec beaucoup de surprise, et continua son chemin.
Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l’or, les rubis et les émeraudes. « Où sommes-nous? s’écria Candide; il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés, puisqu’on leur apprend à mépriser l’or et les pierreries. » Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village; elle était bâtie comme un palais d’Europe. Une foule de monde s’empressait à la porte, et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre, et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s’approcha de la porte, et entendit qu’on parlait péruvien; c’était sa langue maternelle: car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucuman, dans un village où l’on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d’interprète, dit-il à Candide; entrons, c’est ici un cabaret. »
Aussitôt deux garçons et deux filles de l’hôtellerie, vêtus de drap d’or, et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l’hôte. On servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait deux cents livres, deux singes rôtis d’un goût excellent, trois cents colibris dans un plat, et six cents oiseaux-mouches dans un autre; des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses; le tout dans des plats d’une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l’hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne de sucre.
Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d’une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte, et qui répondirent aux siennes d’une manière à le satisfaire.
Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écot en jetant sur la table de l’hôte deux de ces larges pièces d’or qu’il avait ramassées; l’hôte et l’hôtesse éclatèrent de rire, et se tinrent longtemps les côtés. Enfin ils se remirent: « Messieurs, dit l’hôte, nous voyons bien que vous êtes des étrangers; nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert en payement les cailloux de nos grands chemins. Vous n’avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n’est pas nécessaire d’en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici, parce que c’est un pauvre village; mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l’être. » Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l’hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays, disaient-ils l’un et l’autre, inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d’une espèce si différente de la nôtre? C’est probablement le pays où tout va bien; car il faut absolument qu’il y en ait de cette espèce. Et, quoi qu’en dit maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Vestphalie. »
CHAPITRE. XVIII.
Ce qu’ils virent dans le pays d’Eldorado.
Cacambo témoigna à son hôte toute sa curiosité; l’hôte lui dit: « Je suis fort ignorant, et je m’en trouve bien; mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour, qui est le plus savant homme du royaume, et le plus communicatif. » Aussitôt il mène Cacambo chez le vieillard. Candide ne jouait plus que le second personnage, et accompagnait son valet. Ils entrèrent dans une maison fort simple, car la porte n’était que d’argent, et les lambris des appartements n’étaient que d’or, mais travaillés avec tant de goût que les plus riches lambris ne l’effaçaient pas. L’antichambre n’était à la vérité incrustée que de rubis et d’émeraudes; mais l’ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien cette extrême simplicité.
Le vieillard reçut les deux étrangers sur un sopha matelassé de plumes de colibri, et leur fit présenter des liqueurs dans des vases de diamant; après quoi il satisfit à leur curiosité en ces termes:
« Je suis âgé de cent soixante et douze ans, et j’ai appris de feu mon père, écuyer du roi, les étonnantes révolutions du Pérou dont il avait été témoin. Le royaume où nous sommes est l’ancienne patrie des Incas, qui en sortirent très imprudemment pour aller subjuguer une partie du monde, et qui furent enfin détruits par les Espagnols.
« Les princes de leur famille qui restèrent dans leur pays natal furent plus sages; ils ordonnèrent, du consentement de la nation, qu’aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume; et c’est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont eu une connaissance confuse de ce pays, ils l’ont appelé El Dorado, et un Anglais, nommé le chevalier Raleigh, en a même approché il y a environ cent années; mais, comme nous sommes entourés de rochers inabordables et de précipices, nous avons toujours été jusqu’à présent à l’abri de la rapacité des nations de l’Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre, et qui, pour en avoir, nous tueraient tous jusqu’au dernier. »
La conversation fut longue; elle roula sur la forme du gouvernement, sur les moeurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. Enfin Candide, qui avait toujours du goût pour la métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion.
Le vieillard rougit un peu. « Comment donc, dit-il, en pouvez-vous douter? Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats? » Cacambo demanda humblement quelle était la religion d’Eldorado. Le vieillard rougit encore. « Est-ce qu’il peut y avoir deux religions? dit-il; nous avons, je crois, la religion de tout le monde: nous adorons Dieu du soir jusqu’au matin. — N’adorez-vous qu’un seul Dieu? dit Cacambo, qui servait toujours d’interprète aux doutes de Candide. — Apparemment, dit le vieillard, qu’il n’y en a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. » Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon vieillard; il voulut savoir comment on priait Dieu dans l’Eldorado. « Nous ne le prions point, dit le bon et respectable sage; nous n’avons rien à lui demander; il nous a donné tout ce qu’il nous faut; nous le remercions sans cesse. » Candide eut la curiosité de voir des prêtres; il fit demander où ils étaient. Le bon vieillard sourit. « Mes amis, dit-il, nous sommes tous prêtres; le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d’actions de grâces solennellement tous les matins; et cinq ou six mille musiciens les accompagnent. — Quoi! vous n’avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent, et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis? — Il faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard; nous sommes tous ici du même avis, et nous n’entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. » Candide à tous ces discours demeurait en extase, et disait en lui-même: « Ceci est bien différent de la Vestphalie et du château de monsieur le baron: si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n’aurait plus dit que le château de Thunder-ten-tronckh était ce qu’il y avait de mieux sur la terre; il est certain qu’il faut voyager. »
Après cette longue conversation, le bon vieillard fit atteler un carrosse à six moutons, et donna douze de ses domestiques aux deux voyageurs pour les conduire à la cour: « Excusez-moi, leur dit-il, si mon âge me prive de l’honneur de vous accompagner. Le roi vous recevra d’une manière dont vous ne serez pas mécontents, et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s’il y en a quelques-uns qui vous déplaisent. »
Candide et Cacambo montent en carrosse; les six moutons volaient, et en moins de quatre heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de deux cent vingt pieds de haut et de cent de large; il est impossible d’exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons où et pierreries.
Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d’un tissu de duvet de colibri; après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l’appartement de sa Majesté, au milieu de deux files chacune de mille musiciens, selon l’usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s’y prendre pour saluer sa Majesté; si on se jetait à genoux ou ventre à terre; si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière; si on léchait la poussière de la salle; en un mot, quelle était la cérémonie. « L’usage, dit le grand officier, est d’embrasser le roi et de le baiser des deux côtés. » Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper.
En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues, les marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau rose, celles de liqueurs de canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à celle du gérofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on ne plaidait jamais. Il s’informa s’il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de deux mille pas, toute pleine d’instruments de mathématique et de physique.
Après avoir parcouru, toute l’après-dînée, à peu près la millième partie de la ville, on les ramena chez le roi. Candide se mit à table entre sa Majesté, son valet Cacambo et plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère, et jamais on n’eut plus d’esprit à souper qu’en eut sa Majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, et quoique traduits, ils paraissaient toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n’était pas ce qui l’étonna le moins.
Ils passèrent un mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo: « Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes; mais enfin Mlle Cunégonde n’y est pas, et vous avez sans doute quelque maîtresse en Europe. Si nous restons ici, nous n’y serons que comme les autres; au lieu que si nous retournons dans notre monde seulement avec douze moutons chargés de cailloux d’Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble, nous n’aurons plus d’inquisiteurs à craindre, et nous pourrons aisément reprendre Mlle Cunégonde. »
Ce discours plut à Cacambo: on aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade de ce qu’on a vu dans ses voyages, que les deux heureux résolurent de ne plus l’être et de demander leur congé à sa Majesté.
« Vous faites une sottise, leur dit le roi; je sais bien que mon pays est peu de chose; mais, quand on est passablement quelque part, il faut y rester; je n’ai pas assurément le droit de retenir des étrangers; c’est une tyrannie qui n’est ni dans nos moeurs, ni dans nos lois: tous les hommes sont libres; partez quand vous voudrez, mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivés par miracle, et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont dix mille pieds de hauteur, et sont droites comme des murailles; elles occupent chacune en largeur un espace de plus de dix lieues; on ne peut en descendre que par des précipices. Cependant, puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d’en faire une qui puisse vous transporter commodément. Quand on vous aura conduits au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner; car mes sujets ont fait voeu de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils sont trop sages pour rompre leur voeu. Demandez-moi d’ailleurs tout ce qu’il vous plaira. — Nous ne demandons à Votre Majesté, dit Cacambo, que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux, et de la boue du pays. » Le roi rit. « Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d’Europe ont pour notre boue jaune; mais emportez-en tant que vous voudrez, et grand bien vous fasse. »
Il donna l’ordre sur-le-champ à ses ingénieurs de faire une machine pour guinder ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. Trois mille bons physiciens y travaillèrent; elle fut prête au bout de quinze jours, et ne coûta pas plus de vingt millions de livres sterling, monnaie du pays. On mit sur la machine Candide et Cacambo; il y avait deux grands moutons rouges sellés et bridés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes, vingt moutons de bât chargés de vivres, trente qui portaient des présents de ce que le pays a de plus curieux, et cinquante chargés d’or, de pierreries et de diamants. Le roi embrassa tendrement les deux vagabonds.
Ce fut un beau spectacle que leur départ, et la manière ingénieuse dont ils furent hissés, eux et leurs moutons, au haut des montagnes. Les physiciens prirent congé d’eux après les avoir mis en sûreté, et Candide n’eut plus d’autre désir et d’autre objet que d’aller présenter ses moutons à Mlle Cunégonde. « Nous avons, dit-il, de quoi payer le gouverneur de Buenos-Ayres, si Mlle Cunégonde peut être mise à prix. Marchons vers la Cayenne, embarquons-nous, et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. »
CHAPITRE. XIX.
Ce qui leur arriva à Surinam, et comment Candide fit connaissance avec Martin.
La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l’idée de se voir possesseur de plus de trésors que l’Asie, l’Europe et l’Afrique n’en pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. A la seconde journée deux de leurs moutons s’enfoncèrent dans des marais, et y furent abîmés avec leurs charges; deux autres moutons moururent de fatigue quelques jours après; sept ou huit périrent ensuite de faim dans un désert; d’autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après cent jours de marche, il ne leur resta que deux moutons. Candide dit à Cacambo: « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables; il n’y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mlle Cunégonde. — Je l’avoue, dit Cacambo; mais il nous reste encore deux moutons avec plus de trésors que n’en aura jamais le roi d’Espagne, et je vois de loin une ville que je soupçonne être Surinam, appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. »
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois? — J’attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. — Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi? — Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe: je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait: « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l’honneur d’être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas! je ne sais pas si j’ai fait leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m’ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. Or vous m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une manière plus horrible.
— Ô Pangloss! s’écria Candide, tu n’avais pas deviné cette abomination; c’en est fait, il faudra qu’à la fin je renonce à ton optimisme. — Qu’est-ce qu’optimisme? disait Cacambo. — Hélas! dit Candide, c’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son nègre, et en pleurant il entra dans Surinam.
La première chose dont ils s’informent, c’est s’il n’y a point au port quelque vaisseau qu’on pût envoyer à Buenos-Ayres. Celui à qui ils s’adressèrent était justement un patron espagnol, qui s’offrit à faire avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent l’y attendre avec leurs deux moutons.
Candide, qui avait le coeur sur les lèvres, conta à l’Espagnol toutes ses aventures, et lui avoua qu’il voulait enlever Mlle Cunégonde. « Je me garderai bien de vous passer à Buenos-Ayres, dit le patron: je serais pendu et vous aussi. La belle Cunégonde est la maîtresse favorite de monseigneur. » Ce fut un coup de foudre pour Candide; il pleura longtemps; enfin il tira à part Cacambo: « Voici, mon cher ami, lui dit-il, ce qu’il faut que tu fasses. Nous avons chacun dans nos poches pour cinq ou six millions de diamants; tu es plus habile que moi; va prendre Mlle Cunégonde à Buenos-Ayres. Si le gouverneur fait quelques difficultés, donne-lui un million; s’il ne se rend pas, donne-lui-en deux; tu n’as point tué d’inquisiteur, on ne se défiera point de toi. J’équiperai un autre vaisseau; j’irai t’attendre à Venise; c’est un pays libre où l’on n’a rien à craindre ni des Bulgares, ni des Abares, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. » Cacambo applaudit à cette sage résolution. Il était au désespoir de se séparer d’un bon maître, devenu son ami intime; mais le plaisir de lui être utile l’emporta sur la douleur de le quitter. Ils s’embrassèrent en versant des larmes. Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le jour même: c’était un très bon homme que ce Cacambo.
Candide resta encore quelque temps à Surinam, et attendit qu’un autre patron voulût le mener en Italie, lui et les deux moutons qui lui restaient. Il prit des domestiques, et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage; enfin M. Vanderdendur, maître d’un gros vaisseau, vint se présenter à lui. « Combien voulez-vous, demanda-t-il à cet homme, pour me mener en droiture à Venise, moi, mes gens, mon bagage, et les deux moutons que voilà? » Le patron s’accorda à dix mille piastres. Candide n’hésita pas.
« Oh! oh! dit à part soi le prudent Vanderdendur, cet étranger donne dix mille piastres tout d’un coup! il faut qu’il soit bien riche. » Puis, revenant un moment après, il signifia qu’il ne pouvait partir à moins de vingt mille. « Eh bien! vous les aurez », dit Candide.
— Ouais! se dit tout bas le marchand, cet homme donne vingt mille piastres aussi aisément que dix mille. » Il revint encore, et dit qu’il ne pouvait le conduire à Venise à moins de trente mille piastres. « Vous en aurez donc trente mille », répondit Candide.
— Oh! oh! se dit encore le marchand hollandais, trente mille piastres ne coûtent rien à cet homme-ci; sans doute les deux moutons portent des trésors immenses; n’insistons pas davantage: faisons-nous d’abord payer les trente mille piastres, et puis nous verrons. » Candide vendit deux petits diamants, dont le moindre valait plus que tout l’argent que demandait le patron. Il le paya d’avance. Les deux moutons furent embarqués. Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau à la rade; le patron prend son temps, met à la voile, démarre; le vent le favorise. Candide, éperdu et stupéfait, le perd bientôt de vue. « Hélas! cria-t-il, voilà un tour digne de l’ancien monde. » Il retourne au rivage, abîmé dans la douleur; car enfin il avait perdu de quoi faire la fortune de vingt monarques.
Il se transporte chez le juge hollandais; et comme il était un peu troublé, il frappe rudement à la porte; il entre, expose son aventure, et crie un peu plus haut qu’il ne convenait. Le juge commença par lui faire payer dix mille piastres pour le bruit qu’il avait fait. Ensuite il l’écouta patiemment, lui promit d’examiner son affaire sitôt que le marchand serait revenu, et se fit payer dix mille autres piastres pour les frais de l’audience.
Ce procédé acheva de désespérer Candide; il avait à la vérité essuyé des malheurs mille fois plus douloureux; mais le sang-froid du juge, et celui du patron dont il était volé, alluma sa bile, et le plongea dans une noire mélancolie. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur; il ne se nourrissait que d’idées tristes. Enfin, un vaisseau français étant sur le point de partir pour Bordeaux, comme il n’avait plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il loua une chambre du vaisseau à juste prix, et fit signifier dans la ville qu’il payerait le passage, la nourriture, et donnerait deux mille piastres à un honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui, à condition que cet homme serait le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province.
Il se présenta une foule de prétendants qu’une flotte n’aurait pu contenir. Candide voulant choisir entre les plus apparents, il distingua une vingtaine de personnes qui lui paraissaient assez sociables, et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les assembla dans son cabaret, et leur donna à souper, à condition que chacun ferait serment de raconter fidèlement son histoire, promettant de choisir celui qui lui paraîtrait le plus à plaindre et le plus mécontent de son état à plus juste titre, et de donner aux autres quelques gratifications.
La séance dura jusqu’à quatre heures du matin. Candide, en écoutant toutes leurs aventures, se ressouvenait de ce que lui avait dit la vieille en allant à Buenos-Ayres, et de la gageure qu’elle avait faite, qu’il n’y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fût arrivé de très grands malheurs. Il songeait à Pangloss à chaque aventure qu’on lui contait. « Ce Pangloss, disait-il, serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu’il fût ici. Certainement, si tout va bien, c’est dans Eldorado, et non pas dans le reste de la terre. » Enfin il se détermina en faveur d’un pauvre savant qui avait travaillé dix ans pour les libraires d’Amsterdam. Il jugea qu’il n’y avait point de métier au monde dont on dût être plus dégoûté.
Ce savant, qui était d’ailleurs un bon homme, avait été volé par sa femme, battu par son fils, et abandonné de sa fille qui s’était fait enlever par un Portugais. Il venait d’être privé d’un petit emploi duquel il subsistait; et les prédicants de Surinam le persécutaient parce qu’ils le prenaient pour un socinien. Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux que lui; mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage. Tous ses autres rivaux trouvèrent que Candide leur faisait une grande injustice; mais il les apaisa en leur donnant à chacun cent piastres.
CHAPITRE. XX.
Ce qui arriva sur mer à Candide et à Martin
Le vieux savant, qui s’appelait Martin, s’embarqua donc pour Bordeaux avec Candide. L’un et l’autre avaient beaucoup vu et beaucoup souffert; et quand le vaisseau aurait dû faire voile de Surinam au Japon par le cap de Bonne-Espérance, ils auraient eu de quoi s’entretenir du mal moral et du mal physique pendant tout le voyage.
Cependant Candide avait un grand avantage sur Martin, c’est qu’il espérait toujours revoir Mlle Cunégonde, et que Martin n’avait rien à espérer; de plus, il avait de l’or et des diamants; et, quoiqu’il eût perdu cent gros moutons rouges chargés des plus grands trésors de la terre, quoiqu’il eût toujours sur le coeur la friponnerie du patron hollandais, cependant, quand il songeait à ce qui lui restait dans ses poches, et quand il parlait de Cunégonde, surtout à la fin du repas, il penchait alors pour le système de Pangloss.
« Mais vous, monsieur Martin, dit-il au savant, que pensez-vous de tout cela? Quelle est votre idée sur le mal moral et le mal physique? — Monsieur, répondit Martin, mes prêtres m’ont accusé d’être socinien; mais la vérité du fait est que je suis manichéen. — Vous vous moquez de moi, dit Candide, il n’y a plus de manichéens dans le monde. — Il y a moi, dit Martin; je ne sais qu’y faire, mais je ne peux penser autrement. — Il faut que vous ayez le diable au corps, dit Candide. — Il se mêle si fort des affaires de ce monde, dit Martin, qu’il pourrait bien être dans mon corps, comme partout ailleurs; mais je vous avoue qu’en jetant la vue sur ce globe, ou plutôt sur ce globule, je pense que Dieu l’a abandonné à quelque être malfaisant; j’en excepte toujours Eldorado. Je n’ai guère vu de ville qui ne désirât la ruine de la ville voisine, point de famille qui ne voulût exterminer quelque autre famille. Partout les faibles ont en exécration les puissants devant lesquels ils rampent, et les puissants les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. Un million d’assassins enrégimentés, courant d’un bout de l’Europe à l’autre, exerce le meurtre et le brigandage avec discipline pour gagner son pain, parce qu’il n’a pas de métier plus honnête; et dans les villes qui paraissent jouir de la paix et où les arts fleurissent, les hommes sont dévorés de plus d’envie, de soins et d’inquiétudes qu’une ville assiégée n’éprouve de fléaux. Les chagrins secrets sont encore plus cruels que les misères publiques. En un mot, j’en ai tant vu, et tant éprouvé, que je suis manichéen.
— Il y a pourtant du bon, répliquait Candide. — Cela peut être, disait Martin, mais je ne le connais pas. »
Au milieu de cette dispute, on entendit un bruit de canon. Le bruit redouble de moment en moment. Chacun prend sa lunette. On aperçoit deux vaisseaux qui combattaient à la distance d’environ trois milles; le vent les amena l’un et l’autre si près du vaisseau français qu’on eut le plaisir de voir le combat tout à son aise. Enfin l’un des deux vaisseaux lâcha à l’autre une bordée si bas et si juste qu’il le coula à fond. Candide et Martin aperçurent distinctement une centaine d’hommes sur le tillac du vaisseau qui s’enfonçait; ils levaient tous les mains au ciel et jetaient des clameurs effroyables; en un moment tout fut englouti.
« Eh bien! dit Martin, voilà comme les hommes se traitent les uns les autres. — Il est vrai, dit Candide, qu’il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. » En parlant ainsi, il aperçut je ne sais quoi d’un rouge éclatant qui nageait auprès de son vaisseau. On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait être: c’était un de ses moutons. Candide eut plus de joie de retrouver ce mouton qu’il n’avait été affligé d’en perdre cent tous chargés de gros diamants d’Eldorado. Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vaisseau submergeant était espagnol, et que celui du vaisseau submergé était un pirate hollandais; c’était celui-là même qui avait volé Candide. Les richesses immenses dont ce scélérat s’était emparé furent ensevelies avec lui dans la mer, et il n’y eut qu’un mouton de sauvé. « Vous voyez, dit Candide à Martin, que le crime est puni quelquefois: ce coquin de patron hollandais a eu le sort qu’il méritait. — Oui, dit Martin, mais fallait-il que les passagers qui étaient sur son vaisseau périssent aussi? Dieu a puni ce fripon, le diable a noyé les autres. »
Cependant le vaisseau français et l’espagnol continuèrent leur route, et Candide continua ses conversations avec Martin. Ils disputèrent quinze jours de suite, et au bout de quinze jours ils étaient aussi avancés que le premier. Mais enfin ils parlaient, ils se communiquaient des idées, ils se consolaient. Candide caressait son mouton. « Puisque je t’ai retrouvé, dit-il, je pourrai bien retrouver Cunégonde. »
CHAPITRE. XXI.
Candide et Martin approchent des côtes de France et raisonnent.
On aperçut enfin les côtes de France. « Avez-vous jamais été en France, monsieur Martin? dit Candide. — Oui, dit Martin, j’ai parcouru plusieurs provinces. Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où l’on est trop rusé, d’autres où l’on est communément assez doux et assez bête, d’autres où l’on fait le bel esprit; et dans toutes, la principale occupation est l’amour, la seconde de médire, et la troisième de dire des sottises. — Mais, monsieur Martin, avez-vous vu Paris? — Oui, j’ai vu Paris; il tient de toutes ces espèces-là; c’est un chaos, c’est une presse dans laquelle tout le monde cherche le plaisir, et où presque personne ne le trouve, du moins à ce qu’il m’a paru. J’y ai séjourné peu; j’y fus volé, en arrivant, de tout ce que j’avais, par des filous, à la foire Saint-Germain; on me prit moi-même pour un voleur, et je fus huit jours en prison; après quoi je me fis correcteur d’imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied en Hollande. Je connus la canaille écrivante, la canaille cabalante, et la canaille convulsionnaire. On dit qu’il y a des gens fort polis dans cette ville-là; je le veux croire.
— Pour moi, je n’ai nulle curiosité de voir la France, dit Candide; vous devinez aisément que, quand on a passé un mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur la terre que Mlle Cunégonde; je vais l’attendre à Venise; nous traverserons la France pour aller en Italie; ne m’accompagnerez-vous pas? — Très volontiers, dit Martin; on dit que Venise n’est bonne que pour les nobles Vénitiens, mais que cependant on y reçoit très bien les étrangers quand ils ont beaucoup d’argent; je n’en ai point, vous en avez, je vous suivrai partout. — A propos, dit Candide, pensez-vous que la terre ait été originairement une mer, comme on l’assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau? — Je n’en crois rien du tout, dit Martin, non plus que de toutes les rêveries qu’on nous débite depuis quelque temps. — Mais à quelle fin ce monde a-t-il donc été formé? dit Candide. — Pour nous faire enrager, répondit Martin. — N’êtes-vous pas bien étonné, continua Candide, de l’amour que ces deux filles du pays des Oreillons avaient pour ces deux singes, et dont je vous ai conté l’aventure? — Point du tout, dit Martin; je ne vois pas ce que cette passion a d’étrange; j’ai tant vu de choses extraordinaires, qu’il n’y a plus rien d’extraordinaire. — Croyez-vous, dit Candide, que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils font aujourd’hui? qu’ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots? — Croyez-vous, dit Martin, que les éperviers aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé? — Oui, sans doute, dit Candide. — Eh bien! dit Martin, si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé le leur? — Oh! dit Candide, il y a bien de la différence, car le libre arbitre... » En raisonnant ainsi, ils arrivèrent à Bordeaux.
CHAPITRE. XXII.
Ce qui arriva en France à Candide et à Martin.
Candide ne s’arrêta dans Bordeaux qu’autant de temps qu’il en fallait pour vendre quelques cailloux du Dorado, et pour s’accommoder d’une bonne chaise à deux places; car il ne pouvait plus se passer de son philosophe Martin. Il fut seulement très fâché de se séparer de son mouton, qu’il laissa à l’Académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge; et le prix fut adjugé à un savant du Nord, qui démontra par A plus B, moins C, divisé par Z, que le mouton devait être rouge, et mourir de la clavelée.
Cependant tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui disaient: « Nous allons à Paris. » Cet empressement général lui donna enfin l’envie de voir cette capitale; ce n’était pas beaucoup se détourner du chemin de Venise.
Il entra par le faubourg Saint-Marceau, et crut être dans le plus vilain village de la Vestphalie.
A peine Candide fut-il dans son auberge qu’il fut attaqué d’une maladie légère causée par ses fatigues. Comme il avait au doigt un diamant énorme, et qu’on avait aperçu dans son équipage une cassette prodigieusement pesante, il eut aussitôt auprès de lui deux médecins qu’il n’avait pas mandés, quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas, et deux dévotes qui faisaient chauffer ses bouillons. Martin disait: « Je me souviens d’avoir été malade aussi à Paris dans mon premier voyage; j’étais fort pauvre: aussi n’eus-je ni amis, ni dévotes, ni médecins, et je guéris. »
Cependant, à force de médecines et de saignées, la maladie de Candide devint sérieuse. Un habitué du quartier vint avec douceur lui demander un billet payable au porteur pour l’autre monde; Candide n’en voulut rien faire. Les dévotes l’assurèrent que c’était une nouvelle mode; Candide répondit qu’il n’était point homme à la mode. Martin voulut jeter l’habitué par les fenêtres. Le clerc jura qu’on n’enterrerait point Candide. Martin jura qu’il enterrerait le clerc s’il continuait à les importuner. La querelle s’échauffa; Martin le prit par les épaules et le chassa rudement; ce qui causa un grand scandale, dont on fit un procès-verbal.
Candide guérit; et pendant sa convalescence il eut très bonne compagnie à souper chez lui. On jouait gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as ne lui vinssent; et Martin ne s’en étonnait pas.
Parmi ceux qui lui faisaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé périgourdin, l’un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l’histoire scandaleuse de la ville, et leur offrent des plaisirs à tout prix. Celui-ci mena d’abord Candide et Martin à la comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide se trouva placé auprès de quelques beaux esprits. Cela ne l’empêcha pas de pleurer à des scènes jouées parfaitement. Un des raisonneurs qui étaient à ses côtés lui dit dans un entracte: « Vous avez grand tort de pleurer: cette actrice est fort mauvaise; l’acteur qui joue avec elle est plus mauvais acteur encore; la pièce est encore plus mauvaise que les acteurs; l’auteur ne sait pas un mot d’arabe, et cependant la scène est en Arabie; et, de plus, c’est un homme qui ne croit pas aux idées innées: je vous apporterai demain vingt brochures contre lui. — Monsieur, combien avez-vous de pièces de théâtre en France? » dit Candide à l’abbé; lequel répondit: « Cinq ou six mille. — C’est beaucoup, dit Candide; combien y en a-t-il de bonnes? — Quinze ou seize, répliqua l’autre. — C’est beaucoup », dit Martin.
Candide fut très content d’une actrice qui faisait la reine Élisabeth dans une assez plate tragédie que l’on joue quelquefois. « Cette actrice, dit-il à Martin, me plaît beaucoup; elle a un faux air de Mlle Cunégonde; je serais bien aise de la saluer. » L’abbé périgourdin s’offrit à l’introduire chez elle. Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l’étiquette, et comment on traitait en France les reines d’Angleterre. « Il faut distinguer, dit l’abbé; en province, on les mène au cabaret; à Paris, on les respecte quand elles sont belles, et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. — Des reines à la voirie! dit Candide. — Oui vraiment, dit Martin; monsieur l’abbé a raison: j’étais à Paris quand Mlle Monime passa, comme on dit, de cette vie à l’autre; on lui refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture, c’est-à-dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière; elle fut enterrée toute seule de sa bande au coin de la rue de Bourgogne; ce qui dut lui faire une peine extrême, car elle pensait très noblement. — Cela est bien impoli, dit Candide. — Que voulez-vous? dit Martin; ces gens-ci sont ainsi faits. Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles, vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises, dans les spectacles de cette drôle de nation. — Est-il vrai qu’on rit toujours à Paris? dit Candide. — Oui, dit l’abbé, mais c’est en enrageant; car on s’y plaint de tout avec de grands éclats de rire; et même on y fait en riant les actions les plus détestables.
— Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui me disait tant de mal de la pièce où j’ai tant pleuré et des acteurs qui m’ont fait tant de plaisir? — C’est un mal vivant, répondit l’abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres; il hait quiconque réussit, comme les eunuques haïssent les jouissants: c’est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin; c’est un folliculaire. — Qu’appelez-vous folliculaire? dit Candide. — C’est, dit l’abbé, un faiseur de feuilles, un Fréron. »
C’est ainsi que Candide, Martin et le Périgourdin raisonnaient sur l’escalier, en voyant défiler le monde au sortir de la pièce. « Quoique je sois très empressé de revoir Mlle Cunégonde, dit Candide, je voudrais pourtant souper avec Mlle Clairon; car elle m’a paru admirable. »
L’abbé n’était pas homme à approcher de Mlle Clairon, qui ne voyait que bonne compagnie. « Elle est engagée pour ce soir, dit-il; mais j’aurai l’honneur de vous mener chez une dame de qualité, et là vous connaîtrez Paris comme si vous y aviez été quatre ans. »
Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame, au fond du faubourg Saint-honoré; on y était occupé d’un pharaon; douze tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes, registre cornu de leurs infortunes. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l’inquiétude sur celui du banquier, et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous les sept et le va de campagne, dont chaque joueur cornait ses cartes; elle les faisait décorner avec une attention sévère mais polie, et ne se fâchait point, de peur de perdre ses pratiques: la dame se faisait appeler la marquise de Parolignac. Sa fille, âgée de quinze ans, était au nombre des pontes et avertissait d’un clin d’oeil des friponneries de ces pauvres gens, qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L’abbé périgourdin, Candide et Martin entrèrent; personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda; tous étaient profondément occupés de leurs cartes. « Madame la baronne de Thunder-ten-tronckh était plus civile, » dit Candide.
Cependant l’abbé s’approcha de l’oreille de la marquise, qui se leva à moitié, honora Candide d’un sourire gracieux, et Martin d’un air de tête tout à fait noble; elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide, qui perdit cinquante mille francs en deux tailles; après quoi on soupa très gaiement, et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte; les laquais disaient entre eux, dans leur langage de laquais: « Il faut que ce soit quelque milord anglais. »
Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris: d’abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu’on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance; on parla même de livres nouveaux. « Avez-vous lu, dit l’abbé périgourdin, le roman du sieur Gauchat, docteur en théologie? — Oui, répondit un des convives, mais je n’ai pu l’achever. Nous avons une foule d’écrits impertinents, mais tous ensemble n’approchent pas de l’impertinence de Gauchat, docteur en théologie; je suis si rassasié de cette immensité de détestables livres qui nous inondent que je me suis mis à ponter au pharaon. — Et les Mélanges de l’archidiacre Trublet, qu’en dites-vous? dit l’abbé. — Ah! dit Mme de Parolignac, l’ennuyeux mortel! comme il vous dit curieusement tout ce que le monde sait! comme il discute pesamment ce qui ne vaut pas la peine d’être remarqué légèrement! comme il s’approprie sans esprit l’esprit des autres! comme il gâte ce qu’il pille! comme il me dégoûte! Mais il ne me dégoûtera plus: c’est assez d’avoir lu quelques pages de l’archidiacre. »
Il y avait à table un homme savant et de goût qui appuya ce que disait la marquise. On parla ensuite de tragédies; la dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu’on jouait quelquefois, et qu’on ne pouvait lire. L’homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt et n’avoir presque aucun mérite; il prouva en peu de mots que ce n’était pas assez d’amener une ou deux de ces situations qu’on trouve dans tous les romans, et qui séduisent toujours les spectateurs, mais qu’il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublime, et toujours naturel; connaître le coeur humain et le faire parler; être grand poète sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète; savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. « Quiconque, ajouta-t-il, n’observe pas toutes ces règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivains; il y a très peu de bonnes tragédies; les unes sont des idylles en dialogues bien écrits et bien rimés; les autres, des raisonnements politiques qui endorment, ou des amplifications qui rebutent; les autres, des rêves d’énergumène, en style barbare, des propos interrompus, de longues apostrophes aux dieux, parce qu’on ne sait point parler aux hommes, des maximes fausses, des lieux communs ampoulés. »
Candide écouta ce propos avec attention, et conçut une grande idée du discoureur; et, comme la marquise avait eu soin de le placer à côté d’elle, il s’approcha de son oreille, et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. « C’est un savant, dit la dame, qui ne ponte point, et que l’abbé m’amène quelquefois à souper; il se connaît parfaitement en tragédies et en livres, et il a fait une tragédie sifflée et un livre dont on n’a jamais vu hors de la boutique de son libraire qu’un exemplaire qu’il m’a dédié. — Le grand homme! dit Candide; c’est un autre Pangloss. »
Alors, se tournant vers lui, il lui dit: « Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral, et que rien ne pouvait être autrement? — Moi, monsieur, lui répondit le savant, je ne pense rien de tout cela: je trouve que tout va de travers chez nous; que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu’il fait, ni ce qu’il doit faire, et qu’excepté le souper, qui est assez gai et où il paraît assez d’union, tout le reste du temps se passe en querelles impertinentes: jansénistes contre molinistes, gens du parlement contre gens d’église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre maris, parents contre parents; c’est une guerre éternelle. »
Candide lui répliqua: « J’ai vu pis. Mais un sage, qui depuis a eu le malheur d’être pendu, m’apprit que tout cela est à merveille; ce sont des ombres à un beau tableau. — Votre pendu se moquait du monde, dit Martin; vos ombres sont des taches horribles. — Ce sont les hommes qui font les taches, dit Candide, et ils ne peuvent pas s’en dispenser. — Ce n’est donc pas leur faute, » dit Martin. La plupart des pontes, qui n’entendaient rien à ce langage, buvaient; et Martin raisonna avec le savant, et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame du logis.
Après soupé, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. « Eh bien! lui dit-elle, vous aimez donc toujours éperdument Mlle Cunégonde de Thunder-ten-tronckh? — Oui, madame, » répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un souris tendre: « Vous me répondez comme un jeune homme de Vestphalie; un Français m’aurait dit: « Il est vrai que j’ai aimé Mlle Cunégonde; mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. » — Hélas! madame, dit Candide, je répondrai comme vous voudrez. — Votre passion pour elle, dit la marquise, a commencé en ramassant son mouchoir; je veux que vous ramassiez ma jarretière. — De tout mon coeur, » dit Candide; et il la ramassa. « Mais je veux que vous me la remettiez, » dit la dame; et Candide la lui remit. « Voyez-vous, dit la dame, vous êtes étranger, je fais quelquefois languir mes amants de Paris quinze jours, mais je me rends à vous dès la première nuit, parce qu’il faut faire les honneurs de son pays à un jeune homme de Vestphalie. » La belle, ayant aperçu deux énormes diamants aux deux mains de son jeune étranger, les loua de si bonne foi que des doigts de Candide ils passèrent aux doigts de la marquise.
Candide, en s’en retournant avec son abbé périgourdin, sentit quelques remords d’avoir fait une infidélité à Mlle Cunégonde; monsieur l’abbé entra dans sa peine; il n’avait qu’une légère part aux cinquante mille livres perdues au jeu par Candide, et à la valeur des deux brillants moitié donnés, moitié extorqués. Son dessein était de profiter, autant qu’il le pourrait, des avantages que la connaissance de Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup de Cunégonde; et Candide lui dit qu’il demanderait bien pardon à cette belle de son infidélité, quand il la verrait à Venise.
Le Périgourdin redoublait de politesse et d’attentions, et prenait un intérêt tendre à tout ce que Candide disait, à tout ce qu’il faisait, à tout ce qu’il voulait faire.
« Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise? — Oui, monsieur l’abbé, dit Candide; il faut absolument que j’aille trouver Mlle Cunégonde. » Alors, engagé par le plaisir de parler de ce qu’il aimait, il conta, selon son usage, une partie de ses aventures avec cette illustre Vestphalienne.
« Je crois, dit l’abbé, que Mlle Cunégonde a bien de l’esprit, et qu’elle écrit des lettres charmantes? — Je n’en ai jamais reçu, dit Candide; car figurez-vous qu’ayant été chassé du château pour l’amour d’elle, je ne pus lui écrire; que bientôt après j’appris qu’elle était morte, qu’ensuite je la retrouvai, et que je la perdis, et que je lui ai envoyé à deux mille cinq cents lieues d’ici un exprès dont j’attends la réponse. »
L’abbé écoutait attentivement, et paraissait un peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux étrangers, après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain Candide reçut à son réveil une lettre conçue en ces termes:
« Monsieur, mon très cher amant, il y a huit jours que je suis malade en cette ville; j’apprends que vous y êtes. Je volerais dans vos bras si je pouvais remuer. J’ai su votre passage à Bordeaux; j’y ai laissé le fidèle Cacambo et la vieille, qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buenos-Ayres a tout pris, mais il me reste votre coeur. Venez, votre présence me rendra la vie, ou me fera mourir de plaisir. »
Cette lettre charmante, cette lettre inespérée, transporta Candide d’une joie inexprimable; et la maladie de sa chère Cunégonde l’accabla de douleur. Partagé entre ces deux sentiments, il prend son où et ses diamants, et se fait conduire avec Martin à l’hôtel où Mlle Cunégonde demeurait. Il entre en tremblant d’émotion, son coeur palpite, sa voix sanglote; il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire apporter de la lumière. « Gardez-vous-en bien, lui dit la suivante, la lumière la tue; » et soudain elle referme le rideau. « Ma chère Cunégonde, dit Candide en pleurant, comment vous portez-vous? si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. — Elle ne peut parler, » dit la suivante. La dame alors tire du lit une main potelée que Candide arrose longtemps de ses larmes, et qu’il remplit ensuite de diamants, en laissant un sac plein d’or sur le fauteuil.
Au milieu de ses transports arrive un exempt suivi de l’abbé périgourdin et d’une escouade. « Voilà donc, dit-il, ces deux étrangers suspects? » Il les fait incontinent saisir, et ordonne à ses braves de les traîner en prison. « Ce n’est pas ainsi qu’on traite les voyageurs dans le Dorado, dit Candide. — Je suis plus manichéen que jamais, dit Martin. — Mais, monsieur, où nous menez-vous? dit Candide. — Dans un cul de basse-fosse, » dit l’exempt.
Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la dame qui se prétendait Cunégonde était une friponne, monsieur l’abbé périgourdin un fripon qui avait abusé au plus vite de l’innocence de Candide, et l’exempt un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser.
Plutôt que de s’exposer aux procédures de la justice, Candide, éclairé par son conseil, et d’ailleurs toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde, propose à l’exempt trois petits diamants d’environ trois mille pistoles chacun. « Ah! monsieur, lui dit l’homme au bâton d’ivoire, eussiez-vous commis tous les crimes imaginables, vous êtes le plus honnête homme du monde; trois diamants! chacun de trois mille pistoles! Monsieur! je me ferais tuer pour vous, au lieu de vous mener dans un cachot. On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire; j’ai un frère à Dieppe en Normandie, je vais vous y mener; et si vous avez quelque diamant à lui donner, il aura soin de vous comme moi-même.
— Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers? » dit Candide. L’abbé périgourdin prit alors la parole et dit: « C’est parce qu’un gueux du pays d’Atrébatie a entendu dire des sottises: cela seul lui a fait commettre un parricide, non pas tel que celui de 1610 au mois de mai, mais tel que celui de 1594 au mois de décembre, et tel que plusieurs autres commis dans d’autres années et dans d’autres mois par d’autres gueux qui avaient entendu dire des sottises.»
L’exempt alors expliqua de quoi il s’agissait. « Ah, les monstres! s’écria Candide; quoi! de telles horreurs chez un peuple qui danse et qui chante! Ne pourrai-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres? J’ai vu des ours dans mon pays; je n’ai vu des hommes que dans le Dorado. Au nom de Dieu, monsieur l’exempt, menez-moi à Venise, où je dois attendre Mlle Cunégonde. — Je ne peux vous mener qu’en Basse-Normandie, » dit le barigel. Aussitôt il lui fait ôter ses fers, dit qu’il s’est mépris, renvoie ses gens et emmène à Dieppe Candide et Martin, et les laisse entre les mains de son frère. Il y avait un petit vaisseau hollandais à la rade. Le Normand, à l’aide de trois autres diamants, devenu le plus serviable des hommes, embarque Candide et ses gens dans le vaisseau qui allait faire voile pour Portsmouth en Angleterre. Ce n’était pas le chemin de Venise; mais Candide croyait être délivré de l’enfer, et il comptait bien reprendre la route de Venise à la première occasion.
CHAPITRE. XXIII.
Candide et Martin vont sur les côtes d’Angleterre; ce qu’ils y voient.
« Ah, Pangloss! Pangloss! Ah, Martin! Martin! Ah, ma chère Cunégonde! qu’est-ce que ce monde-ci? disait Candide sur le vaisseau hollandais. — Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin. — Vous connaissez l’Angleterre; y est-on aussi fou qu’en France? — C’est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s’il y a plus de gens à lier dans un pays que dans un autre, c’est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu’en général les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires. »
En causant ainsi ils abordèrent à Portsmouth; une multitude de peuple couvrait le rivage, et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés, sur le tillac d’un des vaisseaux de la flotte; quatre soldats, postés vis-à-vis de cet homme, lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne le plus paisiblement du monde, et toute l’assemblée s’en retourna extrêmement satisfaite. « Qu’est-ce donc que tout ceci? dit Candide, et quel démon exerce partout son empire? » Il demanda qui était ce gros homme qu’on venait de tuer en cérémonie. « C’est un amiral, lui répondit-on. — Et pourquoi tuer cet amiral? — C’est, lui dit-on, parce qu’il n’a pas fait tuer assez de monde; il a livré un combat à un amiral français, et on a trouvé qu’il n’était pas assez près de lui. — Mais, dit Candide, l’amiral français était aussi loin de l’amiral anglais que celui-ci l’était de l’autre! — Cela est incontestable, lui répliqua-t-on; mais dans ce pays-ci il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. »
Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu’il voyait, et de ce qu’il entendait, qu’il ne voulut pas seulement mettre pied à terre, et qu’il fit son marché avec le patron hollandais (dût-il le voler comme celui de Surinam) pour le conduire sans délai à Venise.
Le patron fut prêt au bout de deux jours. On côtoya la France; on passa à la vue de Lisbonne, et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée; enfin on aborda à Venise. « Dieu soit loué! dit Candide en embrassant Martin; c’est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu’il soit possible. »
CHAPITRE. XXIV.
De Paquette et de Frère Giroflée.
Dès qu’il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques: nulles nouvelles de Cacambo. « Quoi! disait-il à Martin, j’ai eu le temps de passer de Surinam à Bordeaux, d’aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l’Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise, et la belle Cunégonde n’est point venue! Je n’ai rencontré au lieu d’elle qu’une drôlesse et un abbé périgourdin! Cunégonde est morte sans doute, je n’ai plus qu’à mourir. Ah! il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez raison, mon cher Martin! tout n’est qu’illusion et calamité. »
Il tomba dans une mélancolie noire, et ne prit aucune part a l’opéra alla moda ni aux autres divertissements du carnaval; pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit: « Vous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu’un valet métis, qui a cinq ou six millions dans ses poches, ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l’amènera à Venise. Il la prendra pour lui, s’il la trouve. S’il ne la trouve pas, il en prendra une autre: je vous conseille d’oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. » Martin n’était pas consolant. La mélancolie de Candide augmenta, et Martin ne cessait de lui prouver qu’il y avait peu de vertu et peu de bonheur sur la terre, excepté peut-être dans Eldorado, où personne ne pouvait aller.
En disputant sur cette matière importante, et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc, qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais, potelé, vigoureux; ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantait; elle regardait amoureusement son théatin, et de temps en temps lui pinçait ses grosses joues. « Vous m’avouerez du moins, dit Candide à Martin, que ces gens-ci sont heureux. Je n’ai trouvé jusqu’à présent dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado, que des infortunés; mais, pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. — Je gage que non, dit Martin. — Il n’y a qu’à les prier à dîner, dit Candide, et vous verrez si je me trompe. »
Aussitôt il les aborde, il leur fait son compliment, et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des oeufs d’esturgeon, et à boire du vin de Montepulciano, du lacrima-christi, du chypre et du samos. La demoiselle rougit, le théatin accepta la partie, et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion qui furent obscurcis de quelques larmes. A peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide qu’elle lui dit: « Eh quoi! monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette! » A ces mots, Candide, qui ne l’avait pas considérée jusque-là avec attention, parce qu’il n’était occupé que de Cunégonde, lui dit: « Hélas! ma pauvre enfant, c’est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l’ai vu?
— Hélas! monsieur, c’est moi-même, dit Paquette; je vois que vous êtes instruit de tout. J’ai su les malheurs épouvantables arrivés à toute la maison de madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n’a guère été moins triste. J’étais fort innocente quand vous m’avez vue. Un cordelier qui était mon confesseur me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses; je fus obligée de sortir du château quelques temps après que monsieur le baron vous eut renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n’avait pas pris pitié de moi, j’étais morte. Je fus quelque temps par reconnaissance la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement; c’était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi la plus malheureuse de toutes les créatures d’être battue continuellement pour un homme que je n’aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d’être l’épouse d’un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d’un petit rhume, une médecine si efficace qu’elle en mourut en deux heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel; il prit la fuite, et moi je fus mise en prison. Mon innocence ne m’aurait pas sauvée si je n’avais été un peu jolie. Le juge m’élargit à condition qu’il succéderait au médecin. Je fus bientôt supplantée par une rivale, chassée sans récompense, et obligée de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes, et qui n’est pour nous qu’un abîme de misères. J’allai exercer la profession à Venise. Ah! monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c’est que d’être obligée de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé; d’être exposée à toutes les insultes, à toutes les avanies; d’être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant; d’être volée par l’un de ce qu’on a gagné avec l’autre; d’être rançonnée par les officiers de justice, et de n’avoir en perspective qu’une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier, vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. »
Paquette ouvrait ainsi son coeur au bon Candide, dans un cabinet, en présence de Martin, qui disait à Candide: « Vous voyez que j’ai déjà gagné la moitié de la gageure. »
Frère Giroflée était resté dans la salle à manger, et buvait un coup en attendant le dîner. « Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l’air si gai, si content, quand je vous ai rencontrée; vous chantiez, vous caressiez le théatin avec une complaisance naturelle; vous m’avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. — Ah! monsieur, répondit Paquette, c’est encore là une des misères du métier. J’ai été hier volée et battue par un officier, et il faut aujourd’hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. »
Candide n’en voulut pas davantage; il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théatin, le repas fut assez amusant, et sur la fin on se parla avec quelque confiance. « Mon Père, dit Candide au moine, vous me paraissez jouir d’une destinée que tout le monde doit envier; la fleur de la santé brille sur votre visage, votre physionomie annonce le bonheur; vous avez une très jolie fille pour votre récréation, et vous paraissez très content de votre état de théatin.
— Ma foi, monsieur, dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J’ai été tenté cent fois de mettre le feu au couvent, et d’aller me faire turc. Mes parents me forcèrent à l’âge de quinze ans d’endosser cette détestable robe, pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné que Dieu confonde! La jalousie, la discorde, la rage, habitent dans le couvent. Il est vrai que j’ai prêché quelques mauvais sermons qui m’ont valu un peu d’argent, dont le prieur me vole la moitié: le reste me sert à entretenir des filles; mais, quand je rentre le soir dans le monastère, je suis prêt de me casser la tête contre les murs du dortoir; et tous mes confrères sont dans le même cas. »
Martin se tournant vers Candide avec son sang-froid ordinaire: « Eh bien! lui dit-il, n’ai-je pas gagné la gageure tout entière? » Candide donna deux mille piastres à Paquette et mille piastres à frère Giroflée. « Je vous réponds, dit-il, qu’avec cela ils seront heureux. — Je n’en crois rien du tout, dit Martin; vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore. — Il en sera ce qui pourra, dit Candide; mais une chose me console, je vois qu’on retrouve souvent les gens qu’on ne croyait jamais retrouver; il se pourra bien faire qu’ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. — Je souhaite, dit Martin, qu’elle fasse un jour votre bonheur; mais c’est de quoi je doute fort. — Vous êtes bien dur, dit Candide. — C’est que j’ai vécu, dit Martin.
— Mais regardez ces gondoliers, dit Candide; ne chantent-ils pas sans cesse? — Vous ne les voyez pas dans leur ménage, avec leurs femmes et leurs marmots d’enfants, dit Martin. Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs. Il est vrai qu’à tout prendre le sort d’un gondolier est préférable à celui d’un doge; mais je crois la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d’être examiné.
— On parle, dit Candide, du sénateur Pococurante qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta, et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c’est un homme qui n’a jamais eu de chagrin. — Je voudrais voir une espèce si rare, » dit Martin. Candide aussitôt fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le lendemain.
CHAPITRE. XXV.
Visite chez le Seigneur Pococurante, noble vénitien.
Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta et arrivèrent au palais du noble Pococurante. Les jardins étaient bien entendus, et ornés de belles statues de marbre; le palais, d’une belle architecture. Le maître du logis, homme de soixante ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d’empressement, ce qui déconcerta Candide et ne déplut point à Martin.
D’abord deux filles jolies et proprement mises servirent du chocolat qu’elles firent très bien mousser. Candide ne put s’empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce et sur leur adresse. « Ce sont d’assez bonnes créatures, dit le sénateur Pococurante; je les fais quelquefois coucher dans mon lit, car je suis bien las des dames de la ville, de leurs coquetteries, de leurs jalousies, de leurs querelles, de leurs humeurs, de leurs petitesses, de leur orgueil, de leurs sottises, et des sonnets qu’il faut faire ou commander pour elles; mais, après tout, ces deux filles commencent fort à m’ennuyer. »
Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. « Ils sont de Raphaël, dit le sénateur; je les achetai fort cher par vanité il y a quelques années; on dit que c’est ce qu’il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du tout: la couleur en est très rembrunie; les figures ne sont pas assez arrondies, et ne sortent point assez; les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe; en un mot, quoi qu’on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n’aimerai un tableau que quand je croirai voir la nature elle-même: il n’y en a point de cette espèce. J’ai beaucoup de tableaux mais je ne les regarde plus. »
Pococurante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. « Ce bruit, dit Pococurante, peut amuser une demi-heure; mais, s’il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n’ose l’avouer. La musique aujourd’hui n’est plus que l’art d’exécuter des choses difficiles, et ce qui n’est que difficile ne plaît point à la longue.
« J’aimerais peut-être mieux l’opéra, si on n’avait pas trouvé le secret d’en faire un monstre qui me révolte. Ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique, où les scènes ne sont faites que pour amener, très mal à propos, deux ou trois chansons ridicules qui font valoir le gosier d’une actrice; se pâmera de plaisir qui voudra, ou qui pourra, en voyant un châtré fredonner le rôle de César et de Caton et se promener d’un air gauche sur des planches; pour moi, il y a longtemps que j’ai renoncé à ces pauvretés, qui font aujourd’hui la gloire de l’Italie, et que des souverains payent si chèrement. » Candide disputa un peu, mais avec discrétion. Martin fut entièrement de l’avis du sénateur.
On se mit à table, et après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loua l’illustrissime sur son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l’Allemagne. — Il ne fait pas les miennes, dit froidement Pococurante; on me fit accroire autrefois que j’avais du plaisir en le lisant; mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre, et qui à peine est une actrice de la pièce; cette Troie qu’on assiège et qu’on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. J’ai demandé quelquefois à des savants s’ils s’ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m’ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu’il fallait toujours l’avoir dans sa bibliothèque, comme un monument de l’antiquité, et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce.
— Votre Excellence ne pense pas ainsi de Virgile? dit Candide. — Je conviens, dit Pococurante, que le second, le quatrième et le sixième livre de son Énéide sont excellents; mais pour son pieux Énée, et le fort Cloanthe, et l’ami Achates, et le petit Ascanius, et l’imbécile roi Latinus, et la bourgeoise Amata, et l’insipide Lavinia, je ne crois pas qu’il y ait rien de si froid et de plus désagréable. J’aime mieux le Tasse et les contes à dormir debout de l’Arioste.
— Oserais-je vous demander, monsieur, dit Candide, si vous n’avez pas un grand plaisir à lire Horace? — Il y a des maximes, dit Pococurante, dont un homme du monde peut faire son profit, et qui, étant resserrées dans des vers énergiques, se gravent plus aisément dans la mémoire. Mais je me soucie fort peu de son voyage à Brindes, et de sa description d’un mauvais dîner, et de la querelle des crocheteurs entre je ne sais quel Rupilus, dont les paroles, dit-il, étaient pleines de pus, et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n’ai lu qu’avec un extrême dégoût ses vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières; et je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Mecenas que, s’il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sots admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi; je n’aime que ce qui est à mon usage. » Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu’il entendait; et Martin trouvait la façon de penser de Pococurante assez raisonnable.
« Oh! voici un Cicéron, dit Candide; pour ce grand homme-là, je pense que vous ne vous lassez point de le lire? — Je ne le lis jamais, répondit le Vénitien. Que m’importe qu’il ait plaidé pour Rabirius ou pour Cluentius? J’ai bien assez des procès que je juge; je me serais mieux accommodé de ses oeuvres philosophiques; mais, quand j’ai vu qu’il doutait de tout, j’ai conclu que j’en savais autant que lui, et que je n’avais besoin de personne pour être ignorant.
— Ah! voilà quatre-vingts volumes de recueils d’une académie des sciences, s’écria Martin; il se peut qu’il y ait là du bon. — Il y en aurait, dit Pococurante, si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l’art de faire des épingles; mais il n’y a dans tous ces livres que de vains systèmes et pas une seule chose utile.
— Que de pièces de théâtre je vois là! dit Candide; en italien, en espagnol, en français! — Oui, dit le sénateur, il y en a trois mille, et pas trois douzaines de bonnes. Pour ces recueils de sermons, qui tous ensemble ne valent pas une page de Sénèque, et tous ces gros volumes de théologie, vous pensez bien que je ne les ouvre jamais, ni moi ni personne. »
Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais. « Je crois, dit-il, qu’un républicain doit se plaire à la plupart de ces ouvrages, écrits si librement. — Oui, répondit Pococurante, il est beau d’écrire ce qu’on pense; c’est le privilège de l’homme. Dans toute notre Italie, on n’écrit que ce qu’on ne pense pas; ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antonins n’osent avoir une idée sans la permission d’un jacobin. Je serais content de la liberté qui inspire les génies anglais si la passion et l’esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d’estimable. »
Candide, apercevant un Milton, lui demanda s’il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme. « Qui? dit Pococurante, ce barbare qui fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèse en dix livres de vers durs? ce grossier imitateur des Grecs, qui défigure la création, et qui, tandis que Moïse représente l’Être éternel produisant le monde par la parole, fait prendre un grand compas par le Messiah dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage? Moi, j’estimerais celui qui a gâté l’enfer et le diable du Tasse; qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en pygmée; qui lui fait rebattre cent fois les mêmes discours; qui le fait disputer sur la théologie; qui, en imitant sérieusement l’invention comique des armes à feu de l’Arioste, fait tirer le canon dans le ciel par les diables? Ni moi, ni personne en Italie, n’a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances. Le Mariage du Péché et de la Mort et les couleuvres dont le péché accouche font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat, et sa longue description d’un hôpital n’est bonne que pour un fossoyeur. Ce poème obscur, bizarre et dégoûtant, fut méprisé à sa naissance; je le traite aujourd’hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains. Au reste, je dis ce que je pense, et je me soucie fort peu que les autres pensent comme moi. » Candide était affligé de ces discours; il respectait Homère, il aimait un peu Milton. « Hélas! dit-il tout bas à Martin, j’ai bien peur que cet homme-ci n’ait un souverain mépris pour nos poètes allemands. — Il n’y aurait pas grand mal à cela, dit Martin. — Oh, quel homme supérieur! disait encore Candide entre ses dents, quel grand génie que ce Pococurante! rien ne peut lui plaire. »
Après avoir fait ainsi la revue de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loua toutes les beautés. « Je ne sais rien de si mauvais goût, dit le maître: nous n’avons ici que des colifichets; mais je vais dès demain en faire planter un d’un dessin plus noble. »
Quand les deux curieux eurent pris congé de Son Excellence: « Or çà, dit Candide à Martin, vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu’il possède. — Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu’il est dégoûté de tout ce qu’il possède? Platon a dit, il y a longtemps, que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. — Mais, dit Candide, n’y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts où les autres hommes croient voir des beautés? — C’est-à-dire, reprit Martin, qu’il y a du plaisir à n’avoir pas de plaisir? — Oh bien! dit Candide, il n’y a donc d’heureux que moi, quand je reverrai Mlle Cunégonde. — C’est toujours bien fait d’espérer, » dit Martin.
Cependant les jours, les semaines s’écoulaient; Cacambo ne revenait point, et Candide était si abîmé dans sa douleur qu’il ne fit pas même réflexion que Paquette et frère Giroflée n’étaient pas venus seulement le remercier.
CHAPITRE. XXVI.
D’un souper que Candide et Martin firent avec six étrangers, et qui ils étaient.
Un soir que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie, un homme à visage couleur de suie l’aborda par-derrière, et, le prenant par le bras, lui dit: « Soyez prêt à partir avec nous... n’y manquez pas. » Il se retourne, et voit Cacambo. Il n’y avait que la vue de Cunégonde qui pût l’étonner et lui plaire davantage. Il fut sur le point de devenir fou de joie. Il embrasse son cher ami. « Cunégonde est ici, sans doute, où est-elle? Mène-moi vers elle, que je meure de joie avec elle. — Cunégonde n’est point ici, dit Cacambo, elle est à Constantinople. — Ah, Ciel! à Constantinople! mais, fût-elle à la Chine, j’y vole, partons. — Nous partirons après souper, reprit Cacambo, je ne peux vous en dire davantage; je suis esclave, mon maître m’attend; il faut que j’aille le servir à table: ne dites mot; soupez et tenez-vous prêt. »
Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d’avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir esclave, plein de l’idée de retrouver sa maîtresse, le coeur agité, l’esprit bouleversé, se mit à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ces aventures, et avec six étrangers qui étaient venus passer le carnaval à Venise.
Cacambo, qui versait à boire à l’un de ces six étrangers, s’approcha de l’oreille de son maître, sur la fin du repas, et lui dit: « Sire, Votre Majesté partira quand elle voudra, le vaisseau est prêt. » Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives, étonnés, se regardaient sans proférer une seule parole, lorsqu’un autre domestique, s’approchant de son maître, lui dit: « Sire, la chaise de Votre Majesté est à Padoue, et la barque est prête. » Le maître fit un signe, et le domestique partit. Tous les convives se regardèrent encore, et la surprise commune redoubla. Un troisième valet, s’approchant aussi d’un troisième étranger, lui dit: « Sire, croyez-moi, Votre Majesté ne doit pas rester ici plus longtemps: je vais tout préparer; » et aussitôt il disparut.
Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne fût une mascarade du carnaval. Un quatrième domestique dit au quatrième maître: « Votre Majesté partira quand elle voudra, » et sortit comme les autres. Le cinquième valet en dit autant au cinquième maître. Mais le sixième valet parla différemment au sixième étranger, qui était auprès de Candide; il lui dit: « Ma foi, Sire, on ne veut plus faire crédit à Votre Majesté, ni à moi non plus; et nous pourrions bien être coffrés cette nuit, vous et moi: je vais pourvoir à mes affaires; adieu. »
Tous les domestiques ayant disparu, les six étrangers, Candide et Martin demeurèrent dans un profond silence. Enfin Candide le rompit. « Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie: pourquoi êtes-vous tous rois? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin nous ne le sommes. »
Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole, et dit en italien: « Je ne suis point plaisant, je m’appelle Achmet III. J’ai été grand sultan plusieurs années; je détrônai mon frère; mon neveu m’a détrôné; on a coupé le cou à mes vizirs; j’achève ma vie dans le vieux sérail; mon neveu le grand sultan Mahmoud me permet de voyager quelquefois pour ma santé, et je suis venu passer le carnaval à Venise. »
Un jeune homme qui était auprès d’Achmet parla après lui, et dit: « Je m’appelle Ivan; j’ai été empereur de toutes les Russies; j’ai été détrôné au berceau; mon père et ma mère ont été enfermés; on m’a élevé en prison; j’ai quelquefois la permission de voyager, accompagné de ceux qui me gardent, et je suis venu passer le carnaval à Venise. »
Le troisième dit: « Je suis Charles-Édouard, roi d’Angleterre; mon père m’a cédé ses droits au royaume; j’ai combattu pour les soutenir; on a arraché le coeur à huit cents de mes partisans, et on leur en a battu les joues. J’ai été mis en prison; je vais à Rome faire une visite au roi mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père, et je suis venu passer le carnaval à Venise. »
Le quatrième prit alors la parole et dit: « Je suis roi des Polaques; le sort de la guerre m’a privé de mes États héréditaires; mon père a éprouvé les mêmes revers; je me résigne à la Providence comme le sultan Achmet, l’empereur Ivan et le roi Charles-Édouard, à qui Dieu donne une longue vie, et je suis venu passer le carnaval à Venise. »
Le cinquième dit: « Je suis aussi roi des Polaques; j’ai perdu mon royaume deux fois; mais la Providence m’a donné un autre État, dans lequel j’ai fait plus de bien que tous les rois des Sarmates ensemble n’en ont jamais pu faire sur les bords de la Vistule; je me résigne aussi à la Providence, et je suis venu passer le carnaval à Venise. »
Il restait au sixième monarque à parler. « Messieurs, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous; mais enfin j’ai été roi tout comme un autre. Je suis Théodore; on m’a élu roi en Corse; on m’a appelé Votre Majesté, et à présent, à peine m’appelle-t-on Monsieur. J’ai fait frapper de la monnaie, et je ne possède pas un denier; j’ai eu deux secrétaires d’État, et j’ai à peine un valet; je me suis vu sur un trône, et j’ai longtemps été à Londres en prison, sur la paille. J’ai bien peur d’être traité de même ici, quoique je sois venu comme Vos Majestés passer le carnaval à Venise. »
Les cinq autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion. Chacun d’eux donna vingt sequins au roi Théodore pour avoir des habits et des chemises; et Candide lui fit présent d’un diamant de deux mille sequins. « Quel est donc, disaient les cinq rois, ce simple particulier qui est en état de donner cent fois autant que chacun de nous, et qui le donne? »
Dans l’instant qu’on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie quatre altesses sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs États par le sort de la guerre, et qui venaient passer le reste du carnaval à Venise. Mais Candide ne prit pas seulement garde à ces nouveaux venus. Il n’était occupé que d’aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinople.
CHAPITRE. XXVII.
Voyage de Candide à Constantinople.
Le fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc qui allait reconduire le sultan Achmet à Constantinople qu’il recevrait Candide et Martin sur son bord. L’un et l’autre s’y rendirent après s’être prosternés devant sa misérable Hautesse. Candide, chemin faisant, disait à Martin: « Voilà pourtant six rois détrônés, avec qui nous avons soupé, et encore dans ces six rois il y en a un à qui j’ai fait l’aumône. Peut-être y a-t-il beaucoup d’autres princes plus infortunés. Pour moi, je n’ai perdu que cent moutons, et je vole dans les bras de Cunégonde. Mon cher Martin, encore une fois, Pangloss avait raison: tout est bien. — Je le souhaite, dit Martin. — Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venise. On n’avait jamais vu ni ouï conter que six rois détrônés soupassent ensemble au cabaret. — Cela n’est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. Il est très commun que des rois soient détrônés; et à l’égard de l’honneur que nous avons eu de souper avec eux, c’est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. Qu’importe avec qui l’on soupe, pourvu qu’on fasse bonne chère? »
A peine Candide fut-il dans le vaisseau qu’il sauta au cou de son ancien valet, de son ami Cacambo. « Eh bien! lui dit-il, que fait Cunégonde? Est-elle toujours un prodige de beauté? M’aime-t-elle toujours? Comment se porte-t-elle? Tu lui as sans doute acheté un palais à Constantinople?
— Mon cher maître, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la Propontide, chez un prince qui a très peu d’écuelles; elle est esclave dans la maison d’un ancien souverain nommé Ragotski, à qui le Grand Turc donne trois écus par jour dans son asile; mais ce qui est bien plus triste, c’est qu’elle a perdu sa beauté et qu’elle est devenue horriblement laide. — Ah! belle ou laide, dit Candide, je suis honnête homme, et mon devoir est de l’aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les cinq ou six millions que tu avais apportés? — Bon, dit Cacambo, ne m’en a-t-il pas fallu donner deux millions au señor don Fernando d’Ibaraa, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza, gouverneur de Buenos-Ayres, pour avoir la permission de reprendre mademoiselle Cunégonde? Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillés de tout le reste? Ce pirate ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan, à Milo, à Nicarie, à Samos, à Petra, aux Dardanelles, à Marmora, à Scutari? Cunégonde et la vieille servent chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je suis esclave du sultan détrôné. — Que d’épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres! dit Candide. Mais, après tout, j’ai encore quelques diamants; je délivrerai aisément Cunégonde. C’est bien dommage qu’elle soit devenue si laide. »
Ensuite, se tournant vers Martin: « Qui pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à plaindre, de l’empereur Achmet, de l’empereur Ivan, du roi Charles-Édouard, ou de moi? — Je n’en sais rien, dit Martin; il faudrait que je fusse dans vos coeurs pour le savoir. — Ah! dit Candide, si Pangloss était ici, il le saurait et nous l’apprendrait. — Je ne sais, dit Martin, avec quelles balances votre Pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes et apprécier leurs douleurs. Tout ce que je présume, c’est qu’il y a des millions d’hommes sur la terre cent fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard, l’empereur Ivan et le sultan Achmet. — Cela pourrait bien être, » dit Candide.
On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide commença par racheter Cacambo fort cher, et, sans perdre de temps, il se jeta dans une galère, avec ses compagnons, pour aller sur le rivage de la Propontide chercher Cunégonde, quelque laide qu’elle pût être.
Il y avait dans la chiourme deux forçats qui ramaient fort mal, et à qui le levanti patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerf de boeuf sur leurs épaules nues; Candide, par un mouvement naturel, les regarda plus attentivement que les autres galériens et s’approcha d’eux avec pitié. Quelques traits de leurs visages défigurés lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de Mlle Cunégonde. Cette idée l’émut et l’attrista. Il les considéra encore plus attentivement. « En vérité, dit-il à Cacambo, si je n’avais pas vu pendre maître Pangloss, et si je n’avais pas eu le malheur de tuer le baron, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. »
Au nom du baron et de Pangloss les deux forçats poussèrent un grand cri, s’arrêtèrent sur leur banc et laissèrent tomber leurs rames. Le levanti patron accourait sur eux, et les coups de nerf de boeuf redoublaient. « Arrêtez, arrêtez, Seigneur, s’écria Candide, je vous donnerai tant d’argent que vous voudrez. — Quoi! c’est Candide! disait l’un des forçats. — Quoi! c’est Candide! disait l’autre. — Est-ce un songe? dit Candide; veillé-je? suis-je dans cette galère? Est-ce là monsieur le baron que j’ai tué? Est-ce là maître Pangloss que j’ai vu pendre?
— C’est nous-mêmes, c’est nous-mêmes, répondaient-ils. — Quoi! c’est là ce grand philosophe? disait Martin. — Eh! Monsieur le levanti patron, dit Candide, combien voulez-vous d’argent pour la rançon de M. de Thunder-ten-tronckh, un des premiers barons de l’Empire, et de M. Pangloss, le plus profond métaphysicien d’Allemagne? — Chien de chrétien, répondit le levanti patron, puisque ses deux chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, ce qui est sans doute une grande dignité dans leurs pays, tu m’en donneras cinquante mille sequins. — Vous les aurez, monsieur, ramenez-moi comme un éclair à Constantinople, et vous serez payé sur-le-champ. Mais non, menez-moi chez Mlle Cunégonde. » Le levanti patron, sur la première offre de Candide, avait déjà tourné la proue vers la ville, et il faisait ramer plus vite qu’un oiseau ne fend les airs.
Candide embrassa cent fois le baron et Pangloss. « Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron? et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie après avoir été pendu? et pourquoi êtes-vous tous deux aux galères en Turquie? Est-il bien vrai que ma chère soeur soit dans ce pays? disait le baron. — Oui, répondait Cacambo. — Je revois donc mon cher Candide, » s’écriait Pangloss. Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s’embrassaient tous, ils parlaient tous à la fois. La galère volait, ils étaient déjà dans le port. On fit venir un Juif, à qui Candide vendit pour cinquante mille sequins un diamant de la valeur de cent mille, et qui lui jura par Abraham qu’il n’en pouvait donner davantage. Il paya incontinent la rançon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta aux pieds de son libérateur et les baigna de larmes; l’autre le remercia par un signe de tête, et lui promit de lui rendre cet argent à la première occasion. « Mais est-il bien possible que ma soeur soit en Turquie? disait-il. — Rien n’est si possible, reprit Cacambo, puis qu’elle écure la vaisselle chez un prince de Transylvanie. » On fit aussitôt venir deux Juifs; Candide vendit encore des diamants; et ils repartirent tous dans une autre galère pour aller délivrer Cunégonde.
CHAPITRE. XXVIII.
Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss, à Martin, etc...
« Pardon, encore une fois, dit Candide au baron; pardon, mon Révérend Père, de vous avoir donné un grand coup d’épée au travers du corps. — N’en parlons plus, dit le baron; je fus un peu trop vif, je l’avoue; mais, puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m’avez vu aux galères, je vous dirai qu’après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fus attaqué et enlevé par un parti espagnol; on me mit en prison à Buenos-Ayres dans le temps que ma soeur venait d’en partir. Je demandai à retourner à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour aller servir d’aumônier à Constantinople auprès de M. l’ambassadeur de France. Il n’y avait pas huit jours que j’étais entré en fonctions, quand je trouvai sur le soir un jeune icoglan très bien fait. Il faisait fort chaud: le jeune homme voulut se baigner; je pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que ce fût un crime capital pour un chrétien d’être trouvé tout nu avec un jeune musulman. Un cadi me fit donner cent coups de bâton sous la plante des pieds et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu’on ait fait une plus horrible injustice. Mais je voudrais bien savoir pourquoi ma soeur est dans la cuisine d’un souverain de Transylvanie réfugié chez les Turcs.
— Mais vous, mon cher Pangloss, dit Candide, comment se peut-il que je vous revoie? — Il est vrai, dit Pangloss, que vous m’avez vu pendre; je devais naturellement être brûlé; mais vous vous souvenez qu’il plut à verse lorsqu’on allait me cuire: l’orage fut si violent qu’on désespéra d’allumer le feu; je fus pendu, parce qu’on ne put mieux faire: un chirurgien acheta mon corps, m’emporta chez lui, et me disséqua. Il me fit d’abord une incision cruciale depuis le nombril jusqu’à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je l’avais été. L’exécuteur des hautes oeuvres de la sainte Inquisition, lequel était sous-diacre, brûlait à la vérité les gens à merveille, mais il n’était pas accoutumé à pendre: la corde était mouillée et glissa mal, elle fut nouée; enfin je respirais encore: l’incision cruciale me fit jeter un si grand cri que mon chirurgien tomba à la renverse, et, croyant qu’il disséquait le diable, il s’enfuit en mourant de peur, et tomba encore sur l’escalier en fuyant. Sa femme accourut au bruit, d’un cabinet voisin; elle me vit sur la table étendu avec mon incision cruciale: elle eut encore plus de peur que son mari, s’enfuit et tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j’entendis la chirurgienne qui disait au chirurgien: « Mon bon, de quoi vous avisez-vous aussi de disséquer un hérétique? Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-là? Je vais vite chercher un prêtre pour l’exorciser. » Je frémis à ce propos, et je ramassai le peu de forces qui me restaient, pour crier: « Ayez pitié de moi! » Enfin le barbier portugais s’enhardit; il recousit ma peau; sa femme même eut soin de moi; je fus sur pied au bout de quinze jours. Le barbier me trouva une condition, et me fit laquais d’un chevalier de Malte qui allait à Venise; mais mon maître n’ayant pas de quoi me payer, je me mis au service d’un marchand vénitien, et je le suivis à Constantinople.
« Un jour il me prit fantaisie d’entrer dans une mosquée; il n’y avait qu’un vieil iman et une jeune dévote très jolie qui disait ses patenôtres; sa gorge était toute découverte: elle avait entre ses deux tétons un beau bouquet de tulipes, de roses, d’anémones, de renoncules, d’hyacinthes et d’oreilles-d’ours; elle laissa tomber son bouquet; je le ramassai, et je le lui remis avec un empressement très respectueux. Je fus si longtemps à le lui remettre que l’iman se mit en colère, et voyant que j’étais chrétien, il cria à l’aide. On me mena chez le cadi, qui me fit donner cent coups de lattes sur la plante des pieds et m’envoya aux galères. Je fus enchaîné précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Il y avait dans cette galère quatre jeunes gens de Marseille, cinq prêtres napolitains, et deux moines de Corfou, qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours. Monsieur le baron prétendait qu’il avait essuyé une plus grande injustice que moi; je prétendais, moi, qu’il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d’une femme que d’être tout nu avec un icoglan. Nous disputions sans cesse, et nous recevions vingt coups de nerf de boeuf par jour, lorsque l’enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère, et que vous nous avez rachetés.
— Eh bien! mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups, et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? — Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin je suis philosophe: il ne me convient pas de me dédire, Leibnitz ne pouvant pas avoir tort, et l’harmonie préétablie étant d’ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile. »
CHAPITRE. XXIX.
Comment Candideretrouva Cunégonde et la vieille.
Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, qu’ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu’ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l’on peut éprouver lorsqu’on est aux galères en Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille, qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher.
Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula trois pas saisi d’horreur, et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide et son frère; on embrassa la vieille: Candide les racheta toutes deux.
Il y avait une petite métairie dans le voisinage: la vieille proposa à Candide de s’en accommoder, en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu’elle était enlaidie, personne ne l’en avait avertie: elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n’osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu’il allait se marier avec sa soeur. « Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre, cette infamie ne me sera jamais reprochée: les enfants de ma soeur ne pourraient entrer dans les chapitres d’Allemagne. Non, jamais ma soeur n’épousera qu’un baron de l’Empire. » Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes; il fut inflexible. « Maître fou, lui dit Candide, je t’ai réchappé des galères, j’ai payé ta rançon, j’ai payé celle de ta soeur; elle lavait ici des écuelles, elle est laide, j’ai la bonté d’en faire ma femme, et tu prétends encore t’y opposer! Je te retuerais si j’en croyais ma colère. — Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n’épouseras pas ma soeur de mon vivant. »
CHAPITRE. XXX. Conclusion
Candide, dans le fond de son coeur, n’avait aucune envie d’épouser Cunégonde. Mais l’impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage, et Cunégonde le pressait si vivement qu’il ne pouvait s’en dédire. Il consulta Pangloss, Martin et le fidèle Cacambo. Pangloss fit un beau mémoire par lequel il prouvait que le baron n’avait nul droit sur sa soeur, et qu’elle pouvait, selon toutes les lois de l’Empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclut à jeter le baron dans la mer. Cacambo décida qu’il fallait le rendre au levanti patron et le remettre aux galères; après quoi on l’enverrait à Rome au père général par le premier vaisseau. L’avis fut trouvé fort bon; la vieille l’approuva; on n’en dit rien à sa soeur; la chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d’attraper un jésuite et de punir l’orgueil d’un baron allemand.
Il était tout naturel d’imaginer qu’après tant de désastres, Candide, marié avec sa maîtresse et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant d’ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mènerait la vie du monde la plus agréable; mais il fut tant friponné par les Juifs qu’il ne lui resta plus rien que sa petite métairie; sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable; la vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin, et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d’Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu’on est également mal partout; il prenait les choses en patience. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d’effendis, de bachas, de cadis, qu’on envoyait en exil à Lemnos, à Mitylène, à Erzeroum. On voyait venir d’autres cadis, d’autres bachas, d’autres effendis, qui prenaient la place des expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes proprement empaillées qu’on allait présenter à la Sublime Porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations; et quand on ne disputait pas, l’ennui était si excessif que la vieille osa un jour leur dire: « Je voudrais savoir lequel est le pire, ou d’être violée cent fois par des pirates nègres, d’avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d’être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d’être disséqué, de ramer en galère, d’éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire? — C’est une grande question, » dit Candide.
Ce discours fit naître de nouvelles réflexions, et Martin surtout conclut que l’homme était né pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude, ou dans la léthargie de l’ennui. Candide n’en convenait pas, mais il n’assurait rien. Pangloss avouait qu’il avait toujours horriblement souffert; mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours, et n’en croyait rien.
Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide, et d’embarrasser Pangloss. C’est qu’ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée, qui étaient dans la plus extrême misère; ils avaient bien vite mangé leurs trois mille piastres, s’étaient quittés, s’étaient raccommodés, s’étaient brouillés, avaient été mis en prison, s’étaient enfuis, et enfin frère Giroflée s’était fait turc. Paquette continuait son métier partout, et n’y gagnait plus rien. « Je l’avais bien prévu, dit Martin à Candide, que vos présents seraient bientôt dissipés et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé de millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n’êtes pas plus heureux que frère Giroflée et Paquette. — Ah, ah! dit Pangloss à Paquette, le ciel vous ramène donc ici parmi nous, ma pauvre enfant! Savez-vous bien que vous m’avez coûté le bout du nez, un oeil et une oreille? Comme vous voilà faite! Et qu’est-ce que ce monde! » Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais.
Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux, qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie; ils allèrent le consulter; Pangloss porta la parole, et lui dit: « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l’homme a été formé.
— De quoi te mêles-tu? dit le derviche, est-ce là ton affaire? — Mais, mon Révérend Père, dit Candide, il y a horriblement de mal sur la terre. — Qu’importe, dit le derviche, qu’il y ait du mal ou du bien? Quand sa Hautesse envoie un vaisseau en Égypte, s’embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non? — Que faut-il donc faire? dit Pangloss. — Te taire, dit le derviche. — Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l’origine du mal, de la nature de l’âme et de l’harmonie préétablie. » Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez.
Pendant cette conversation, la nouvelle s’était répandue qu’on venait d’étrangler à Constantinople deux vizirs du banc et le muphti, et qu’on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d’orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le muphti qu’on venait d’étrangler. « Je n’en sais rien, répondit le bonhomme, et je n’ai jamais su le nom d’aucun muphti ni d’aucun vizir. J’ignore absolument l’aventure dont vous me parlez; je présume qu’en général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu’ils le méritent; mais je ne m’informe jamais de ce qu’on fait à Constantinople; je me contente d’y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison: ses deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu’ils faisaient eux-mêmes, du kaïmac piqué d’écorces de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Moka qui n’était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin.
« Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre? — Je n’ai que vingt arpents, répondit le Turc; je les cultive avec mes enfants; le travail éloigne de nous trois grands maux: l’ennui, le vice, et le besoin. »
Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin: « Ce bon vieillard me paraît s’être fait un sort bien préférable à celui des six rois avec qui nous avons eu l’honneur de souper. — Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes: car enfin Églon, roi des Moabites, fut assassiné par Aod; Absalon fut pendu par les cheveux et percé de trois dards; le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baaza; le roi Éla, par Zambri; Ochosias, par Jéhu; Athalia, par Joïada; les rois Joachim, Jéchonias, Sédécias, furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astyage, Darius, Denys de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Annibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d’Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les trois Henri de France, l’empereur Henri IV? Vous savez... — Je sais aussi, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin. — Vous avez raison, dit Pangloss: car, quand l’homme fut mis dans le jardin d’Éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu’il travaillât, ce qui prouve que l’homme n’est pas né pour le repos. — Travaillons sans raisonner, dit Martin; c’est le seul moyen de rendre la vie supportable. »
Toute la petite société entra dans ce louable dessein; chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide; mais elle devint une excellente pâtissière; Paquette broda; la vieille eut soin du linge. Il n’y eut pas jusqu’à frère Giroflée qui ne rendît service; il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme; et Pangloss disait quelquefois à Candide: « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles; car enfin, si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l’amour de Mlle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’Inquisition, si vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. — Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. »
Chapitre premier. Voyage d’un habitant du monde de l’étoile Sirius dans la planète de Saturne
Dans une de ces planètes qui tournent autour de l’étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d’esprit, que j’ai eu l’honneur de connaître dans le dernier voyage qu’il fit sur notre petite fourmilière ; il s’appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait huit lieues de haut : j’entends, par huit lieues, vingt-quatre mille pas géométriques de cinq pieds chacun.
Quelques algébristes, gens toujours utiles au public, prendront sur-le-champ la plume, et trouveront que, puisque monsieur Micromégas, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux pieds vingt-quatre mille pas, qui font cent vingt mille pieds de roi, et que nous autres, citoyens de la terre, nous n’avons guère que cinq pieds, et que notre globe a neuf mille lieues de tour, ils trouveront, dis- je, qu’il faut absolument que le globe qui l’a produit ait au juste vingt et un millions six cent mille fois plus de circonférence que notre petite terre. Rien n’est plus simple et plus ordinaire dans la nature. Les États de quelques souverains d’Allemagne ou d’Italie, dont on peut faire le tour en une demi- heure, comparés à l’empire de Turquie, de Moscovie ou de la Chine, ne sont qu’une très faible image des prodigieuses différences que la nature a mises dans tous les êtres.
La taille de Son Excellence étant de la hauteur que j’ai dite, tous nos sculpteurs et tous nos peintres conviendront sans peine que sa ceinture peut avoir cinquante mille pieds de roi de tour : ce qui fait une très jolie proportion.
Quant à son esprit, c’est un des plus cultivés que nous ayons ; il sait beaucoup de choses ; il en a inventé quelques-unes ; il n’avait pas encore deux cent cinquante ans, et il étudiait, selon la coutume, au collège des jésuites de sa planète, lorsqu’il devina, par la force de son esprit, plus de cinquante propositions d’Euclide. C’est dix-huit de plus que Blaise Pascal, lequel, après en avoir deviné trente-deux en se jouant, à ce que dit sa sœur, devint depuis un géomètre assez médiocre, et un fort mauvais métaphysicien. Vers les quatre cent cinquante ans, au sortir de l’enfance, il disséqua beaucoup de ces petits insectes qui n’ont pas cent pieds de diamètre, et qui se dérobent aux microscopes ordinaires ; il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le muphti de son pays, grand vétillard, et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l’hérésie, et le poursuivit vivement : il s’agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimaçons. Micromégas se défendit avec esprit ; il mit les femmes de son côté ; le procès dura deux cent vingt ans. Enfin le muphti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l’avaient pas lu, et l’auteur eut ordre de ne paraître à la cour de huit cents années.
Il ne fut que médiocrement affligé d’être banni d’une cour qui n’était remplie que de tracasseries et de petitesses. Il fit une chanson fort plaisante contre le muphti, dont celui-ci ne s’embarrassa guère ; et il se mit à voyager de planète en planète, pour achever de se former l’esprit et le cœur, comme l’on dit. Ceux qui ne voyagent qu’en chaise de poste ou en berline seront sans doute étonnés des équipages de là-haut car nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne concevons rien au-delà de nos usages. Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation, et toutes les forces attractives et répulsives. Il s’en servait si à propos que, tantôt à l’aide d’un rayon du soleil, tantôt par la commodité d’une comète, il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Il parcourut la voie lactée en peu de temps, et je suis obligé d’avouer qu’il ne vit jamais à travers les étoiles dont elle est semée ce beau ciel empyrée que l’illustre vicaire Derham se vante d’avoir vu au bout de sa lunette. Ce n’est pas que je prétende que Monsieur Derham ait mal vu, à Dieu ne plaise ! mais Micromégas était sur les lieux, c’est un bon observateur, et je ne veux contredire personne. Micromégas, après avoir bien tourné, arriva dans le globe de Saturne. Quelque accoutumé qu’il fût à voir des choses nouvelles, il ne put d’abord, en voyant la petitesse du globe et de ses habitants, se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquefois aux plus sages. Car enfin Saturne n’est guère que neuf cents fois plus gros que la terre, et les citoyens de ce pays-là sont des nains qui n’ont que mille toises de haut ou environ. Il s’en moqua un peu d’abord avec ses gens, à peu près comme un musicien italien se met à rire de la musique de Lulli quand il vient en France. Mais comme le Sirien avait un bon esprit, il comprit bien vite qu’un être pensant peut fort bien n’être pas ridicule pour n’avoir que six mille pieds de haut. Il se familiarisa avec les Saturniens, après les avoir étonnés. Il lia une étroite amitié avec le secrétaire de l’Académie de Saturne, homme de beaucoup d’esprit, qui n’avait à la vérité rien inventé, mais qui rendait un fort bon compte des inventions des autres, et qui faisait passablement de petits [vers] et de grands calculs. Je rapporterai ici, pour la satisfaction des lecteurs, une conversation singulière que Micromégas eut un jour avec M. le secrétaire.
Après que Son Excellence se fut couchée, et que le secrétaire se fut approché de son visage : « Il faut avouer, dit Micromégas, que la nature est bien variée. – Oui, dit le Saturnien ; la nature est comme un parterre dont les fleurs... – Ah ! dit l’autre, laissez là votre parterre. – Elle est, reprit le secrétaire, comme une assemblée de blondes et de brunes, dont les parures... – Eh ! qu’ai-je à faire de vos brunes ? dit l’autre. – Elle est donc comme une galerie de peintures dont les traits... – Eh non ! dit le voyageur ; encore une fois, la nature est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons ? – Pour vous plaire, répondit le secrétaire. – Je ne veux point qu’on me plaise, répondit le voyageur ; je veux qu’on m’instruise : commencez d’abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. – Nous en avons soixante et douze, dit l’académicien ; et nous nous plaignons tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins ; nous trouvons qu’avec nos soixante et douze sens, notre anneau, nos cinq lunes, nous sommes trop bornés ; et, malgré toute notre curiosité et le nombre assez grand de passions qui résultent de nos soixante et douze sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. – Je le crois bien, dit Micromégas ; car dans notre globe nous avons près de mille sens, et il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude, qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de chose, et qu’il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J’ai un peu voyagé ; j’ai vu des mortels fort au-dessous de nous ; j’en ai vu de fort supérieurs ; mais je n’en ai vu aucuns qui n’aient plus de désirs que de vrais besoins, et plus de besoins que de satisfaction. J’arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien ; mais jusqu’à présent personne ne m’a donné de nouvelles positives de ce pays-là. » Le Saturnien et le Sirien s’épuisèrent alors en conjectures ; mais, après beaucoup de raisonnements fort ingénieux et fort incertains, il en fallut revenir aux faits. « Combien de temps vivez-vous ? dit le Sirien. – Ah ! bien peu, répliqua le petit homme de Saturne. – C’est tout comme chez nous, dit le Sirien ; nous nous plaignons toujours du peu. Il faut que ce soit une loi universelle de la nature. – Hélas ! nous ne vivons, dit le Saturnien, que cinq cents grandes révolutions du soleil. (Cela revient à quinze mille ans ou environ, à compter à notre manière.) Vous voyez bien que c’est mourir presque au moment que l’on est né ; notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe un atome. À peine a-t-on commencé à s’instruire un peu que la mort arrive avant qu’on ait de l’expérience. Pour moi, je n’ose faire aucuns projets ; je me trouve comme une goutte d’eau dans un océan immense. Je suis honteux, surtout devant vous, de la figure ridicule que je fais dans ce monde. »
Micromégas lui repartit : « Si vous n’étiez pas philosophe, je craindrais de vous affliger en vous apprenant que notre vie est sept cents fois plus longue que la vôtre ; mais vous savez trop bien que quand il faut rendre son corps aux éléments, et ranimer la nature sous une autre forme, ce qui s’appelle mourir ; quand ce moment de métamorphose est venu, avoir vécu une éternité, ou avoir vécu un jour, c’est précisément la même chose. J’ai été dans les pays où l’on vit mille fois plus longtemps que chez moi, et j’ai trouvé qu’on y murmurait encore. Mais il y a partout des gens de bon sens qui savent prendre leur parti et remercier l’auteur de la nature. Il a répandu sur cet univers une profusion de variétés avec une espèce d’uniformité admirable. Par exemple tous les êtres pensants sont différents, et tous se ressemblent au fond par le don de la pensée et des désirs. La matière est partout étendue ; mais elle a dans chaque globe des propriétés diverses. Combien comptez-vous de ces propriétés diverses dans votre matière ? – Si vous parlez de ces propriétés, dit le Saturnien, sans lesquelles nous croyons que ce globe ne pourrait subsister tel qu’il est, nous en comptons trois cents, comme l’étendue, l’impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, la divisibilité, et le reste. – Apparemment, répliqua le voyageur, que ce petit nombre suffit aux vues que le Créateur avait sur votre petite habitation. J’admire en tout sa sagesse ; je vois partout des différences, mais aussi partout des proportions. Votre globe est petit, vos habitants le sont aussi ; vous avez peu de sensations ; votre matière a peu de propriétés ; tout cela est l’ouvrage de la Providence. De quelle couleur est votre soleil bien examiné ? – D’un blanc fort jaunâtre, dit le Saturnien ; et quand nous divisons un de ses rayons, nous trouvons qu’il contient sept couleurs. – Notre soleil tire sur le rouge, dit le Sirien, et nous avons trente-neuf couleurs primitives. Il n’y a pas un soleil, parmi tous ceux dont j’ai approché, qui se ressemble, comme chez vous il n’y a pas un visage qui ne soit différent de tous les autres ».
Après plusieurs questions de cette nature, il s’informa combien de substances essentiellement différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu’on n’en comptait qu’une trentaine, comme Dieu, l’espace, la matière, les êtres étendus qui sentent, les êtres étendus qui sentent et qui pensent, les êtres pensants qui n’ont point d’étendue, ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas, et le reste. Le Sirien, chez qui on en comptait trois cents, et qui en avait découvert trois mille autres dans ses voyages, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après s’être communiqué l’un à l’autre un peu de ce qu’ils savaient et beaucoup de ce qu’ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, ils résolurent de faire ensemble un petit voyage philosophique.
Nos deux philosophes étaient prêts à s’embarquer dans l’atmosphère de Saturne avec une fort jolie provision d’instruments mathématiques, lorsque la maîtresse du Saturnien, qui en eut des nouvelles, vint en larmes faire ses remontrances. C’était une jolie petite brune qui n’avait que six cent soixante toises, mais qui réparait par bien des agréments la petitesse de sa taille. « Ah ! cruel ! s’écria-t-elle, après t’avoir résisté quinze cents ans, lorsque enfin je commençais à me rendre, quand j’ai à peine passé cent ans entre tes bras, tu me quittes pour aller voyager avec un géant d’un autre monde ; va, tu n’es qu’un curieux, tu n’as jamais eu d’amour : si tu étais un vrai Saturnien, tu serais fidèle. Où vas-tu courir ? Que veux-tu ? Nos cinq lunes sont moins errantes que toi, notre anneau est moins changeant. Voilà qui est fait, je n’aimerai jamais plus personne. » Le philosophe l’embrassa, pleura avec elle, tout philosophe qu’il était ; et la dame, après s’être pâmée, alla se consoler avec un petit- maître du pays.
Cependant nos deux curieux partirent ; ils sautèrent d’abord sur l’anneau, qu’ils trouvèrent assez plat, comme l’a fort bien deviné un illustre habitant de notre petit globe ; de là ils allèrent de lune en lune. Une comète passait tout auprès de la dernière ; ils s’élancèrent sur elle avec leurs domestiques et leurs instruments. Quand ils eurent fait environ cent cinquante millions de lieues, ils rencontrèrent les satellites de Jupiter. Ils passèrent dans Jupiter même, et y restèrent une année, pendant laquelle ils apprirent de fort beaux secrets qui seraient actuellement sous presse sans messieurs les inquisiteurs, qui ont trouvé quelques propositions un peu dures. Mais j’en ai lu le manuscrit dans la bibliothèque de l’illustre archevêque de..., qui m’a laissé voir ses livres avec cette générosité et cette bonté qu’on ne saurait assez louer.
Mais revenons à nos voyageurs. En sortant de Jupiter, ils traversèrent un espace d’environ cent millions de lieues, et ils côtoyèrent la planète de Mars, qui, comme on sait, est cinq fois plus petite que notre petit globe ; ils virent deux lunes qui servent à cette planète, et qui ont échappé aux regards de nos astronomes. Je sais bien que le père Castel écrira, et même assez plaisamment, contre l’existence de ces deux lunes ; mais je m’en rapporte à ceux qui raisonnent par analogie. Ces bons philosophes-là savent combien il serait difficile que Mars, qui est si loin du soleil, se passât à moins de deux lunes. Quoi qu’il en soit, nos gens trouvèrent cela si petit qu’ils craignirent de n’y pas trouver de quoi coucher, et ils passèrent leur chemin comme deux voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de village et poussent jusqu’à la ville voisine. Mais le Sirien et son compagnon se repentirent bientôt. Ils allèrent longtemps, et ne trouvèrent rien. Enfin ils aperçurent une petite lueur : c’était la terre ; cela fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passèrent sur la queue de la comète, et, trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans, et arrivèrent à terre sur le bord septentrional de la mer Baltique, le cinq juillet mil sept cent trente-sept, nouveau style.
Après s’être reposés quelque temps, ils mangèrent à leur déjeuner deux montagnes, que leurs gens leur apprêtèrent assez proprement. Ensuite ils voulurent reconnaître le petit pays où ils étaient. Ils allèrent d’abord du nord au sud. Les pas ordinaires du Sirien et de ses gens étaient d’environ trente mille pieds de roi ; le nain de Saturne suivait de loin en haletant ; or il fallait qu’il fît environ douze pas, quand l’autre faisait une enjambée : figurez-vous (s’il est permis de faire de telles comparaisons) un très petit chien de manchon qui suivrait un capitaine des gardes du roi de Prusse.
Comme ces étrangers-là vont assez vite, ils eurent fait le tour du globe en trente-six heures ; le soleil, à la vérité, ou plutôt la terre, fait un pareil voyage en une journée ; mais il faut songer qu’on va bien plus à son aise quand on tourne sur son axe que quand on marche sur ses pieds. Les voilà donc revenus d’où ils étaient partis, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour eux, qu’on nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui, sous le nom du grand Océan, entoure la taupinière. Le nain n’en avait eu jamais qu’à mi-jambe, et à peine l’autre avait-il mouillé son talon. Ils firent tout ce qu’ils purent en allant et en revenant dessus et dessous pour tâcher d’apercevoir si ce globe était habité ou non. Ils se baissèrent, ils se couchèrent, ils tâtèrent partout ; mais leurs yeux et leurs mains n’étant point proportionnés aux petits êtres qui rampent ici, ils ne reçurent pas la moindre sensation qui pût leur faire soupçonner que nous et nos confrères les autres habitants de ce globe avons l’honneur d’exister.
Le nain, qui jugeait quelquefois un peu trop vite, décida d’abord qu’il n’y avait personne sur la terre. Sa première raison était qu’il n’avait vu personne. Micromégas lui fit sentir poliment que c’était raisonner assez mal : « Car, disait-il, vous ne voyez pas avec vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième grandeur que j’aperçois très distinctement ; concluez-vous de là que ces étoiles n’existent pas ? – Mais, dit le nain, j’ai bien tâté. – Mais, répondit l’autre, vous avez mal senti. – Mais, dit le nain, ce globe-ci est si mal construit, cela est si irrégulier et d’une forme qui me paraît si ridicule ! tout semble être ici dans le chaos : voyez-vous ces petits ruisseaux dont aucun ne va de droit fil, ces étangs qui ne sont ni ronds, ni carrés, ni ovales, ni sous aucune forme régulière ; tous ces petits grains pointus dont ce globe est hérissé, et qui m’ont écorché les pieds ? (Il voulait parler des montagnes.) Remarquez-vous encore la forme de tout le globe, comme il est plat aux pôles, comme il tourne autour du soleil d’une manière gauche, de façon que les climats des pôles sont nécessairement incultes ? En vérité, ce qui fait que je pense qu’il n’y a ici personne, c’est qu’il me paraît que des gens de bon sens ne voudraient pas y demeurer. – Eh bien, dit Micromégas, ce ne sont peut-être pas non plus des gens de bon sens qui l’habitent. Mais enfin il y a quelques apparence que ceci n’est pas fait pour rien. Tout vous paraît irrégulier ici, dites-vous, parce que tout est tiré au cordeau dans Saturne et dans Jupiter. Eh ! c’est peut-être par cette raison-là même qu’il y a ici un peu de confusion. Ne vous ai-je pas dit que dans mes voyages j’avais toujours remarqué de la variété ? » Le Saturnien répliqua à toutes ces raisons. La dispute n’eût jamais fini, si par bonheur Micromégas, en s’échauffant à parler, n’eût cassé le fil de son collier de diamants. Les diamants tombèrent ; c’étaient de jolis petits carats assez inégaux, dont les plus gros pesaient quatre cents livres, et les plus petits cinquante. Le nain en ramassa quelques-uns ; il s’aperçut, en les approchant de ses yeux, que ces diamants, de la façon dont ils étaient taillés, étaient d’excellents microscopes. Il prit donc un petit microscope de cent soixante pieds de diamètre, qu’il appliqua à sa prunelle ; et Micromégas en choisit un de deux mille cinq cent pieds. Ils étaient excellents ; mais d’abord on ne vit rien par leur secours : il fallait s’ajuster. Enfin l’habitant de Saturne vit quelque chose d’imperceptible qui remuait entre deux eaux dans la mer Baltique : c’était une baleine. Il la prit avec le petit doigt fort adroitement ; et la mettant sur l’ongle de son pouce, il la fit voir au Sirien, qui se mit à rire pour la seconde fois de l’excès de petitesse dont étaient les habitants de notre globe. Le Saturnien, convaincu que notre monde est habité, s’imagina bien vite qu’il ne l’était que par des baleines ; et comme il était grand raisonneur, il voulut deviner d’où un si petit atome tirait son mouvement, s’il avait des idées, une volonté, une liberté. Micromégas y fut fort embarrassé ; il examina l’animal fort patiemment, et le résultat de l’examen fut qu’il n’y avait pas moyen de croire qu’une âme fut logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à penser qu’il n’y a point d’esprit dans notre habitation, lorsqu’à l’aide du microscope ils aperçurent quelque chose d’aussi gros qu’une baleine qui flottait sur la mer Baltique. On sait que dans ce temps-là même une volée de philosophes revenait du cercle polaire, sous lequel ils avaient été faire des observations dont personne ne s’était avisé jusqu’alors. Les gazettes dirent que leur vaisseau échoua aux côtes de Botnie, et qu’ils eurent bien de la peine à se sauver ; mais on ne sait jamais dans ce monde le dessous des cartes. Je vais raconter ingénument comme la chose se passa, sans y rien mettre du mien, ce qui n’est pas un petit effort pour un historien.
Micromégas étendit la main tout doucement vers l’endroit où l’objet paraissait, et avançant deux doigts, et les retirant par la crainte de se tromper, puis les ouvrant et les serrant, il saisit fort adroitement le vaisseau qui portait ces messieurs, et le mit encore sur son ongle, sans le trop presser ; de peur de l’écraser. « Voici un animal bien différent du premier », dit le nain de Saturne ; le Sirien mit le prétendu animal dans le creux de sa main. Les passagers et les gens de l’équipage, qui s’étaient crus enlevés par un ouragan, et qui se croyaient sur une espèce de rocher, se mettent tous en mouvement ; les matelots prennent des tonneaux de vin, les jettent sur la main de Micromégas, et se précipitent après. Les géomètres prennent leurs quarts de cercle, leurs secteurs, et des filles laponnes, et descendent sur les doigts du Sirien. Ils en firent tant qu’il sentit enfin remuer quelque chose qui lui chatouillait les doigts : c’était un bâton ferré qu’on lui enfonçait d’un pied dans l’index ; il jugea, par ce picotement, qu’il était sorti quelque chose du petit animal qu’il tenait ; mais il n’en soupçonna pas d’abord davantage. Le microscope, qui faisait à peine discerner une baleine et un vaisseau, n’avait point de prise sur un être aussi imperceptible que des hommes. Je ne prétends choquer ici la vanité de personne, mais je suis obligé de prier les importants de faire ici une petite remarque avec moi ; c’est qu’en prenant la taille des hommes d’environ cinq pieds, nous ne faisons pas sur la terre une plus grande figure qu’en ferait sur une boule de dix pieds de tour un animal qui aurait à peu près la six cent millième partie d’un pouce en hauteur. Figurez-vous une substance qui pourrait tenir la terre dans sa main, et qui aurait des organes en proportion des nôtres ; et il se peut très bien faire qu’il y ait un grand nombre de ces substances : or concevez, je vous prie, ce qu’elles penseraient de ces batailles qui nous ont valu deux villages qu’il a fallu rendre.
Je ne doute pas que si quelque capitaine des grands grenadiers lit jamais cet ouvrage, il ne hausse de deux grands pieds au moins les bonnets de sa troupe ; mais je l’avertis qu’il aura beau faire, et que lui et les siens ne seront jamais que des infiniment petits.
Quelle adresse merveilleuse ne fallut-il donc pas à notre philosophe de Sirius pour apercevoir les atomes dont je viens de parler ? Quand Leuwenhoek et Hartsoeker virent les premiers, ou crurent voir, la graine dont nous sommes formés, ils ne firent pas à beaucoup près une si étonnante découverte. Quel plaisir sentit Micromégas en voyant remuer ces petites machines, en examinant tous leurs tours, en les suivant dans toutes leurs opérations ! comme il s’écria ! comme il mit avec joie un de ses microscopes dans les mains de son compagnon de voyage ! « Je les vois, disaient-ils tous deux à la fois ; ne les voyez-vous pas qui portent des fardeaux, qui se baissent, qui se relèvent ? » En parlant ainsi les mains leur tremblaient, par le plaisir de voir des objets si nouveaux, et par la crainte de les perdre. Le Saturnien, passant d’un excès de défiance à un excès de crédulité, crut apercevoir qu’ils travaillaient à la propagation. « Ah ! disait-il, j’ai pris la nature sur le fait ». Mais il se trompait sur les apparences : ce qui n’arrive que trop, soit qu’on se serve ou non de microscopes.
Micromégas, bien meilleur observateur que son nain, vit clairement que les atomes se parlaient ; et il le fit remarquer à son compagnon, qui, honteux de s’être mépris sur l’article de la génération, ne voulut point croire que de pareilles espèces pussent se communiquer des idées. Il avait le don des langues aussi bien que le Sirien ; il n’entendait point parler nos atomes, et il supposait qu’ils ne parlaient pas. D’ailleurs, comment ces êtres imperceptibles auraient-ils les organes de la voix, et qu’auraient-ils à dire ? Pour parler, il faut penser, ou à peu près ; mais s’ils pensaient, ils auraient donc l’équivalent d’une âme. Or, attribuer l’équivalent d’une âme à cette espèce, cela lui paraissait absurde. « Mais, dit le Sirien, vous avez cru tout à l’heure qu’ils faisaient l’amour ; est-ce que vous croyez qu’on puisse faire l’amour sans penser et sans proférer quelque parole, ou du moins sans se faire entendre ? Supposez- vous d’ailleurs qu’il soit plus difficile de produire un argument qu’un enfant ? Pour moi, l’un et l’autre me paraissent de grands mystères. – Je n’ose plus ni croire ni nier, dit le nain ; je n’ai plus d’opinion. Il faut tâcher d’examiner ces insectes, nous raisonnerons après. – C’est fort bien dit », reprit Micromégas ; et aussitôt il tira une paire de ciseaux dont il se coupa les ongles, et d’une rognure de l’ongle de son pouce, il fit sur-le-champ une espèce de grande trompette parlante, comme un vaste entonnoir, dont il mit le tuyau dans son oreille. La circonférence de l’entonnoir enveloppait le vaisseau et tout l’équipage. La voix la plus faible entrait dans les fibres circulaires de l’ongle ; de sorte que, grâce à son industrie, le philosophe de là-haut entendit parfaitement le bourdonnement de nos insectes de là-bas. En peu d’heures il parvint à distinguer les paroles, et enfin à entendre le français. Le nain en fit autant, quoique avec plus de difficulté. L’étonnement des voyageurs redoublait à chaque instant. Ils entendaient des mites parler d’assez bon sens : ce jeu de la nature leur paraissait inexplicable. Vous croyez bien que le Sirien et son nain brûlaient d’impatience de lier conversation avec les atomes ; il craignait que sa voix de tonnerre, et surtout celle de Micromégas, n’assourdît les mites sans en être entendue. Il fallait en diminuer la force. Ils se mirent dans la bouche des espèces de petits cure-dents, dont le bout fort effilé venait donner auprès du vaisseau. Le Sirien tenait le nain sur ses genoux, et le vaisseau avec l’équipage sur un ongle ; il baissait la tête et parlait bas. Enfin, moyennant toutes ces précautions et bien d’autres encore, il commença ainsi son discours :
« Insectes invisibles, que la main du Créateur s’est plu à faire naître dans l’abîme de l’infiniment petit, je le remercie de ce qu’il a daigné me découvrir des secrets qui semblaient impénétrables. Peut-être ne daignerait-on pas vous regarder à ma cour ; mais je ne méprise personne, et je vous offre ma protection. »
Si jamais il y a eu quelqu’un d’étonné, ce furent les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient deviner d’où elles partaient. L’aumônier du vaisseau récita les prières des exorcismes, les matelots jurèrent, et les philosophes du vaisseau firent un système ; mais quelque système qu’ils fissent, ils ne purent jamais deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui avait la voix plus douce que Micromégas, leur apprit alors en peu de mots à quelles espèces ils avaient affaire. Il leur conta le voyage de Saturne, les mit au fait de ce qu’était monsieur Micromégas ; et, après les avoir plaints d’être si petits, il leur demanda s’ils avaient toujours été dans ce misérable état si voisin de l’anéantissement, ce qu’ils faisaient dans un globe qui paraissait appartenir à des baleines, s’ils étaient heureux, s’ils multipliaient, s’ils avaient une âme, et cent autres questions de cette nature.
Un raisonneur de la troupe, plus hardi que les autres, et choqué de ce qu’on doutait de son âme, observa l’interlocuteur avec des pinnules braquées sur un quart de cercle, fit deux stations, et à la troisième il parla ainsi : « Vous croyez donc, monsieur, parce que vous avez mille toises depuis la tête jusqu’aux pieds, que vous êtes un... – Mille toises ! s’écria le nain ; juste ciel ! d’où peut-il savoir ma hauteur ? mille toises ! Il ne se trompe pas d’un pouce ; quoi ! cet atome m’a mesuré ! il est géomètre, il connaît ma grandeur ; et moi, qui ne le vois qu’à travers un microscope, je ne connais pas encore la sienne ! – Oui, je vous ai mesuré, dit le physicien, et je mesurerai bien encore votre grand compagnon. » La proposition fut acceptée ; Son Excellence se coucha de son long : car, s’il se fût tenu debout, sa tête eût été trop au-dessus des nuages. Nos philosophes lui plantèrent un grand arbre dans un endroit que le docteur Swift nommerait, mais que je me garderai bien d’appeler par son nom, à cause de mon grand respect pour les dames. Puis, par une suite de triangles liés ensemble, ils conclurent que ce qu’ils voyaient était en effet un jeune homme de cent vingt mille pieds de roi.
Alors Micromégas prononça ces paroles : « Je vois plus que jamais qu’il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente. Ô Dieu ! qui avez donné une intelligence à des substances qui paraissent si méprisables, l’infiniment petit vous coûte aussi peu que l’infiniment grand ; et, s’il est possible qu’il y ait des êtres plus petits que ceux-ci, ils peuvent encore avoir un esprit supérieur à ceux de ces superbes animaux que j’ai vus dans le ciel, dont le pied seul couvrirait le globe où je suis descendu. »
Un des philosophes lui répondit qu’il pouvait en toute sûreté croire qu’il est en effet des êtres intelligents beaucoup plus petits que l’homme. Il lui conta, non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux sur les abeilles, mais ce que Swammerdam a découvert, et ce que Réaumur a disséqué. Il lui apprit enfin qu’il y a des animaux qui sont pour les abeilles ce que les abeilles sont pour l’homme, ce que le Sirien lui-même était pour ces animaux si vastes dont il parlait, et ce que ces grands animaux sont pour d’autres substances devant lesquelles ils ne paraissent que comme des atomes. Peu à peu la conversation devint intéressante, et Micromégas parla ainsi.
« Ô atomes intelligents, dans qui l’Être éternel s’est plu à vous manifester son adresse et sa puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe : car, ayant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser ; c’est la véritable vie des esprits. Je n’ai vu nulle part le vrai bonheur ; mais il est ici, sans doute. » À ce discours, tous les philosophes secouèrent la tête ; et l’un d’eux, plus franc que les autres, avoua de bonne foi que, si l’on en excepte un petit nombre d’habitants fort peu considérés, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. « Nous avons plus de matière qu’il ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière ; et trop d’esprit, si le mal vient de l’esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu’à l’heure que je vous parle, il y a cent mille fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui tuent cent mille autres animaux couverts d’un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que, presque par toute la terre, c’est ainsi qu’on en use de temps immémorial ? » Le Sirien frémit, et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs animaux. « Il s’agit, dit le philosophe, de quelque tas de boue grand comme votre talon. Ce n’est pas qu’aucun de ces millions d’hommes qui se font égorger prétende un fétu sur ce tas de boue. Il ne s’agit que de savoir s’il appartiendra à un certain homme qu’on nomme Sultan, ou à un autre qu’on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l’un ni l’autre n’a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s’agit ; et presque aucun de ces animaux qui s’égorgent mutuellement n’a jamais vu l’animal pour lequel ils s’égorgent.
- Ah ! malheureux ! s’écria le Sirien avec indignation, peut-on concevoir cet excès de rage forcenée ! Il me prend envie de faire trois pas, et d’écraser de trois coups de pied toute cette fourmilière d’assassins ridicules. – Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on ; ils travaillent assez à leur ruine. Sachez qu’au bout de dix ans, il ne reste jamais la centième partie de ces misérables ; sachez que, quand même ils n’auraient pas tiré l’épée, la faim, la fatigue ou l’intempérance les emportent presque tous. D’ailleurs, ce n’est pas eux qu’il faut punir, ce sont ces barbares sédentaires qui du fond de leur cabinet ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre d’un million d’hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement. » Le voyageur se sentait ému de pitié pour la petite race humaine, dans laquelle il découvrait de si étonnants contrastes. « Puisque vous êtes du petit nombre de sages, dit-il à ces messieurs, et qu’apparemment vous ne tuez personne pour de l’argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous vous occupez. – Nous disséquons des mouches, dit le philosophe, nous mesurons des lignes, nous assemblons des nombres ; nous sommes d’accord sur deux ou trois points que nous entendons, et nous disputons sur deux ou trois mille que nous n’entendons pas. » Il prit aussitôt fantaisie au Sirien et au Saturnien d’interroger ces atomes pensants, pour savoir les choses dont ils convenaient. « Combien comptez-vous, dit-il, de l’étoile de la Canicule à la grande étoile des Gémeaux ? » Ils répondirent tous à la fois : « Trente-deux degrés et demi. – Combien comptez-vous d’ici à la lune ? – Soixante demi-diamètres de la terre en nombre rond. – Combien pèse votre air ? » Il croyait les attraper, mais tous lui dirent que l’air pèse environ neuf cents fois moins qu’un pareil volume de l’eau la plus légère, et dix-neuf cents fois moins que l’or de ducat. Le petit nain de Saturne, étonné de leurs réponses, fut tenté de prendre pour des sorciers ces mêmes gens auxquels il avait refusé une âme un quart d’heure auparavant.
Enfin Micromégas leur dit : « Puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c’est que votre âme, et comment vous formez vos idées. » Les philosophes parlèrent tous à la fois comme auparavant ; mais ils furent tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, l’autre prononçait le nom de Descartes ; celui-ci, de Malebranche ; cet autre, de Leibnitz ; cet autre, de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec confiance : « L’âme est un entéléchie, et une raison par qui elle a la puissance d’être ce qu’elle est. C’est ce que déclare expressément Aristote, page 633 de l’édition du Louvre. , etc. – Je n’entends pas trop bien le grec, dit le géant. – Ni moi non plus, dit la mite philosophique. – Pourquoi donc, reprit le Sirien, citez-vous un certain Aristote en grec ? – C’est, répliqua le savant, qu’il faut bien citer ce qu’on ne comprend point du tout dans la langue qu’on entend le moins. »
Le cartésien prit la parole, et dit : « L’âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques, et qui, en sortant de là, est obligée d’aller à l’école, et d’apprendre tout de nouveau ce qu’elle a si bien su, et qu’elle ne saura plus. – Ce n’était donc pas la peine, répondit l’animal de huit lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère, pour être si ignorante quand tu aurais de la barbe au menton. Mais qu’entends-tu par esprit ? – Que me demandez-vous là ? dit le raisonneur ; je n’en ai point d’idée ; on dit que ce n’est pas de la matière. – Mais sais-tu au moins ce que c’est que de la matière ? – Très bien, répondit l’homme. Par exemple cette pierre est grise, et d’une telle forme, elle a ses trois dimensions, elle est pesante et divisible. – Eh bien ! dit le Sirien, cette chose qui te paraît être divisible, pesante ; et grise, me dirais-tu bien ce que c’est ? Tu vois quelques attributs ; mais le fond de la chose, le connais-tu ? – Non, dit l’autre. – Tu ne sais donc point ce que c’est que la matière. »
Alors monsieur Micromégas, adressant la parole à un autre sage qu’il tenait sur son pouce, lui demanda ce que c’était que son âme, et ce qu’elle faisait. « Rien du tout, répondit le philosophe malebranchiste ; c’est Dieu qui fait tout pour moi : je vois tout en lui, je fais tout en lui ; c’est lui qui fait tout sans que je m’en mêle. – Autant vaudrait ne pas être, reprit le sage de Sirius. Et toi, mon ami, dit-il à un Leibnizien qui était là, qu’est-ce que ton âme ? – C’est, répondit le Leibnizien, une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne, ou bien, si vous voulez, c’est elle qui carillonne pendant que mon corps montre l’heure ; ou bien mon âme est le miroir de l’univers, et mon corps est la bordure du miroir : cela est clair ».
Un petit partisan de Locke était là tout auprès ; et quand on lui eut enfin adressé la parole : « Je ne sais pas, dit-il, comment je pense, mais je sais que je n’ai jamais pensé qu’à l’occasion de mes sens. Qu’il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c’est de quoi je ne doute pas ; mais qu’il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c’est de quoi je doute fort. Je révère la puissance éternelle ; il ne m’appartient pas de la borner : je n’affirme rien ; je me contente de croire qu’il y a plus de choses possibles qu’on ne pense. »
L’animal de Sirius sourit : il ne trouva pas celui-là le moins sage ; et le nain de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke sans l’extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un petit animalcule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes ; il dit qu’il savait tout le secret, que cela se trouvait dans la Somme de Saint Thomas ; il regarda de haut en bas les deux habitants célestes ; il leur soutint que leurs personnes, leurs mondes, leurs soleils, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l’homme. À ce discours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l’un sur l’autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux : leurs épaules et leurs ventres allaient et venaient, et dans ces convulsions le vaisseau, que le Sirien avait sur son ongle, tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces deux bonnes gens le cherchèrent longtemps ; enfin ils retrouvèrent l’équipage, et le rajustèrent fort proprement. Le Sirien reprit les petites mites ; il leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu’il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie écrit fort menu pour leur usage, et que, dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ : on le porta à Paris à l’Académie des sciences ; mais, quand le secrétaire l’eut ouvert, il ne vit rien qu’un livre tout blanc : « Ah ! dit-il, je m’en étais bien douté. »
Le goût de bien des lecteurs pour les choses frivoles, et l'envie de faire un volume de ce qui ne devrait remplir que peu de pages, sont cause que l'histoire des hommes célèbres est presque toujours gâtée par des détails inutiles et des contes populaires aussi faux qu'insipides. On y ajoute souvent des critiques injustes de leurs ouvrages. C'est ce qui est arrivé dans l'édition de Racine faite à Paris en 1728. On tâchera d'éviter cet écueil dans cette courte histoire de la vie de Molière ; on ne dira de sa propre personne que ce qu'on a cru vrai et digne d'être rapporté, et on ne hasardera sur ses ouvrages rien qui soit contraire aux sentiments du public éclairé.
Jean-Baptiste Poquelin naquit à Paris en 1620, dans une maison qui subsiste encore sous les piliers des halles. Son père, Jean-Baptiste Poquelin, valet de chambre tapissier chez le roi, marchand fripier, et Anne Boutet, sa mère, lui donnèrent une éducation trop conforme à leur état, auquel ils le destinaient : il resta jusqu'à quatorze ans dans leur boutique, n'ayant rien appris, outre son métier, qu'un peu à lire et à écrire. Ses parents obtinrent pour lui la survivance de leur charge chez le roi ; mais son génie l'appelait ailleurs. On a remarqué que presque tous ceux qui se sont fait un nom dans les beaux-arts les ont cultivés malgré leurs parents, et que la nature a toujours été en eux plus forte que l'éducation.
Poquelin avait un grand-père qui aimait la comédie, et qui le menait quelquefois à l'hôtel de Bourgogne. Le jeune homme sentit bientôt une aversion invincible pour sa profession. Son goût pour l'étude se développa ; il pressa son grand-père d'obtenir qu'on le mît au collège, et il arracha enfin le consentement de son père, qui le mit dans une pension, et l'envoya externe aux jésuites, avec la répugnance d'un bourgeois qui croyait la fortune de son fils perdue s'il étudiait.
Le jeune Poquelin fit au collège les progrès qu'on devait attendre de son empressement à y entrer. Il y étudia cinq années ; il y suivit le cours des classes d'Armand de Bourbon, premier prince de Conti, qui depuis fut le protecteur des lettres et de Molière.
Il y avait alors dans ce collège deux enfants qui eurent depuis beaucoup de réputation dans le monde. C'étaient Chapelle et Bernier ; celui-ci connu par ses voyages aux Indes, et l'autre célèbre par quelques vers naturels et aisés, qui lui ont fait d'autant plus de réputation qu'il ne rechercha pas celle d'auteur.
L'Huillier, homme de fortune, prenait un soin singulier de l'éducation du jeune Chapelle, son fils naturel ; et, pour lui donner de l'émulation, il faisait étudier avec lui le jeune Bernier, dont les parents étaient mal à leur aise. Au lieu même de donner à son fils naturel un précepteur ordinaire et pris au hasard, comme tant de pères en usent avec un fils légitime qui doit porter leur nom, il engagea le célèbre Gassendi à se charger de l'instruire.
Gassendi ayant démêlé de bonne heure le génie de Poquelin, l'associa aux études de Chapelle et de Bernier. Jamais plus illustre maître n'eut de plus dignes disciples. Il leur enseigna sa philosophie d'Epicure, qui, quoique aussi fausse que les autres, avait au moins plus de méthode et plus de vraisemblance que celle de l'école, et n'en avait pas la barbarie.
Poquelin continua de s'instruire sous Gassendi. Au sortir du collège, il reçut de ce philosophe les principes d'une morale plus utile que sa physique, et il s'écarta rarement de ces principes dans le cours de sa vie.
Son père étant devenu infirme et incapable de servir, il fut obligé d'exercer les fonctions de son emploi auprès du roi. Il suivit Louis XIII dans le voyage que ce monarque fit en Languedoc en 1641 ; et, de retour à Paris, sa passion pour la comédie, qui l'avait déterminé à faire ses études, se réveilla avec force.
Le théâtre commençait à fleurir alors : cette partie des belles-lettres, si méprisée quand elle est médiocre, contribue à la gloire d'un Etat quand elle est perfectionnée.
Avant l'année 1625, il n'y avait point de comédiens fixes à Paris. Quelques farceurs allaient, comme en Italie, de ville en ville : ils jouaient des pièces de Hardy, de Monchrétien, ou de Balthazar Baro.
Ces auteurs leur vendaient leurs ouvrages dix écus pièce.
Pierre Corneille tira le théâtre de la barbarie et de l'avilissement, vers l'année 1630. Ses premières comédies, qui étaient aussi bonnes pour son siècle qu'elles sont mauvaises pour le nôtre, furent cause qu'une troupe de comédiens s'établit à Paris. Bientôt après, la passion du cardinal de Richelieu pour les spectacles mit le goût de la comédie à la mode, et il y avait plus de sociétés particulières qui représentaient alors que nous n'en voyons aujourd'hui.
Poquelin s'associa avec quelques jeunes gens qui avaient du talent pour la déclamation ; ils jouaient au faubourg Saint-Germain et au quartier Saint-Paul. Cette société éclipsa bientôt toutes les autres ; on l'appela l'"Illustre Théâtre". On voit par une tragédie de ce temps-là, intitulée Artaxerce, d'un nommé Magnon, et imprimée en 1645, qu'elle fut représentée sur l'illustre théâtre.
Ce fut alors que Poquelin, sentant son génie, se résolut de s'y livrer tout entier, d'être à la fois comédien et auteur, et de tirer de ses talents de l'utilité et de la gloire.
On sait que chez les Athéniens les auteurs jouaient souvent dans leurs pièces, et qu'ils n'étaient point déshonorés pour parler avec grâce en public devant leurs concitoyens. Il fut plus encouragé par cette idée que retenu par les préjugés de son siècle. Il prit le nom de Molière, et il ne fit, en changeant de nom, que suivre l'exemple des comédiens d'Italie et de ceux de l'hôtel de Bourgogne. L'un, dont le nom de famille était le Grand, s'appelait Belleville dans la tragédie, et Turlupin dans la farce ; d'où vient le mot de "turlupinade". Hugues Guéret était connu, dans les pièces sérieuses, sous le nom de Fléchelles ; dans la farce, il jouait toujours un certain rôle qu'on appelait Gautier-Garguille ; de même, Arlequin et Scaramouche n'étaient connus que sous ce nom de théâtre. Il y avait déjà eu un comédien appelé Molière, auteur de la tragédie de "Polyxène" (1).
Le nouveau Molière fut ignoré pendant tout le temps que durèrent les guerres civiles en France ; il employa ces années à cultiver son talent et à préparer quelques pièces. Il avait fait un recueil de scènes italiennes, dont il faisait de petites comédies pour les provinces. Ces premiers essais, très informes, tenaient plus du mauvais théâtre italien, où il les avait pris, que de son génie, qui n'avait pas eu encore l'occasion de se développer tout entier. Le génie s'étend et se resserre par tout ce qui nous environne. Il fit donc pour la province "le Docteur amoureux", "les trois Docteurs rivaux", "le Maître d'école" ; ouvrages dont il ne reste que le titre. Quelques curieux ont conservé deux pièces de Molière dans ce genre : l'une est "le Médecin volant", et l'autre "la Jalousie de Barbouille". Elles sont en prose et écrites en entier. Il y a quelques phrases et quelques incidents de la première qui nous sont conservés dans "le Médecin malgré lui" ; et on trouve dans "la Jalousie de Barbouille" un canevas, quoique informe, du troisième acte de "George Dandin".
La première pièce régulière en cinq actes qu'il composa fut "l'Etourdi". Il représenta cette comédie à Lyon en 1653. Il y avait dans cette ville une troupe de comédiens de campagne, qui fut abandonnée dès que celle de Molière parut.
Quelques acteurs de cette ancienne troupe se joignirent à Molière, et il partit de Lyon pour les états de Languedoc avec une troupe assez complète, composée principalement de deux frères nommés Gros-René, de du Parc, d'un pâtissier (2) de la rue Saint-Honoré, de la du Parc, de la Béjart, et de la de Brie.
Le prince de Conti, qui tenait les états de Languedoc à Béziers, se souvint de Molière, qu'il avait vu au collège ; il lui donna une protection distinguée. Molière joua devant lui "l'Etourdi", "le Dépit amoureux", et "les Précieuses ridicules".
Cette petite pièce des "Précieuses", faite en province, prouve assez que son auteur n'avait eu en vue que les ridicules des provinciales ; mais il se trouva depuis que l'ouvrage pouvait corriger et la cour et la ville.
Molière avait alors trente-quatre ans ; c'est l'âge où Corneille fit "le Cid". Il est bien difficile de réussir avant cet âge dans le genre dramatique, qui exige la connaissance du monde et du cœur humain.
On prétend que le prince de Conti voulut alors faire Molière son secrétaire, et que, heureusement pour la gloire du théâtre français, Molière eut le courage de préférer son talent à un poste honorable. Si ce fait est vrai, il fait également honneur au prince et au comédien.
Après avoir couru quelque temps toutes les provinces, et avoir joué à Grenoble, à Lyon, à Rouen, il vint enfin à Paris en 1658. Le prince de Conti lui donna accès auprès de Monsieur, frère unique du roi Louis XIV ; Monsieur le présenta au roi et à la reine mère. Sa troupe et lui représentèrent la même année, devant leurs majestés, la tragédie de "Nicomède", sur un théâtre élevé par ordre du roi dans la salle des gardes du vieux Louvre.
Il y avait depuis quelques temps des comédiens établis à l'hôtel de Bourgogne. Ces comédiens assistèrent au début de la nouvelle troupe. Molière, après la représentation de "Nicomède", s'avança sur le bord du théâtre, et prit la liberté de faire au roi un discours par lequel il remerciait sa majesté de son indulgence, et louait adroitement les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, dont il devait craindre la jalousie : il finit en demandant la permission de donner une pièce d'un acte qu'il avait jouée en province.
La mode de représenter ces petites farces après de grandes pièces était perdue à l'hôtel de Bourgogne. Le roi agréa l'offre de Molière, et l'on joua dans l'instant "le Docteur amoureux". Depuis ce temps, l'usage a toujours continué de donner de ces pièces d'un acte ou de trois après les pièces de cinq.
On permit à la troupe de Molière de s'établir à Paris ; ils s'y fixèrent, et partagèrent le théâtre du Petit-Bourbon avec les comédiens italiens, qui en étaient en possession depuis quelques années.
La troupe de Molière jouait sur ce théâtre les mardis, les jeudis et les samedis ; et les Italiens, les autres jours.
La troupe de l'hôtel de Bourgogne ne jouait aussi que trois fois la semaine, excepté lorsqu'il y avait des pièces nouvelles.
Dès lors, la troupe de Molière prit le titre de "la Troupe de Monsieur", qui était son protecteur. Deux ans après, en 1660, il leur accorda la salle du Palais-Royal. Le cardinal de Richelieu l'avait fait bâtir pour la représentation de "Mirame", tragédie dans laquelle ce ministre avait composé plus de cinq cents vers. Cette salle est aussi mal construite que la pièce pour laquelle elle fut bâtie ; et je suis obligé de remarquer à cette occasion, que nous n'avons aujourd'hui aucun théâtre supportable : c'est une barbarie gothique que les Italiens nous reprochent avec raison. Les bonnes pièces sont en France, et les belles salles en Italie.
La troupe de Molière eut la jouissance de cette salle jusqu'à la mort de son chef. Elle fut alors accordée à ceux qui eurent le privilège de l'Opéra, quoique ce vaisseau soit moins propre encore pour le chant que pour la déclamation.
Depuis l'an 1658 jusqu'à 1673, c'est à dire en quinze années de temps, il donna toutes ses pièces, qui sont au nombre de trente. Il voulut jouer dans la tragédie, mais il n'y réussit pas ; il avait une volubilité dans la voix, et une espèce de hoquet qui ne pouvait convenir au genre sérieux, mais qui rendait son jeu comique plus plaisant. La femme (3) d'un des meilleurs comédiens que nous ayons eus a donné ce portrait-ci de Molière :
<< Il n'était ni trop gras ni trop maigre ; il avait la taille plus grande que petite, le port noble, la jambe belle ; il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts ; et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. A l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer ; et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leur mouvement naturel. >>
Molière se fit dans Paris un très grand nombre de partisans, et presque autant d'ennemis. Il accoutuma le public, en lui faisant connaître la bonne comédie, à le juger lui-même très sévèrement. Les mêmes spectateurs qui applaudissaient aux pièces médiocres des autres auteurs, relevaient les moindres défauts de Molière avec aigreur. Les hommes jugent de nous par l'attente qu'ils en ont conçue ; et le moindre défaut d'un auteur célèbre, joint avec les malignités du public, suffit pour faire tomber un bon ouvrage. Voilà pourquoi "Britannicus" et "les Plaideurs" de M. Racine furent si mal reçus ; voilà pourquoi "l'Avare", "le Misanthrope", "les Femmes savantes", "l'Ecole des Femmes" n'eurent d'abord aucun succès.
Louis XIV, qui avait un goût naturel et l'esprit très juste, sans l'avoir cultivé, ramena souvent, par son approbation, la cour et la ville aux pièces de Molière. Il eût été plus honorable pour la nation de n'avoir pas besoin des décisions de son prince pour bien juger. Molière eut des ennemis cruels, surtout les mauvais auteurs du temps, leurs protecteurs et leurs cabales : ils suscitèrent contre lui les dévots ; on lui imputa des livres scandaleux ; on l'accusa d'avoir joué des hommes puissants, tandis qu'il n'avait joué que les vices en général ; et il eût succombé sous ces accusations, si ce même roi, qui encouragea et qui soutint Racine et Despréaux, n'eût pas aussi protégé Molière.
Il n'eut à la vérité qu'une pension de mille livres, et sa troupe n'en eut qu'une de sept. La fortune qu'il fit par le succès de ses ouvrages le mit en état de n'avoir rien de plus à souhaiter ; ce qu'il retirait du théâtre, avec ce qu'il avait placé, allait à trente mille livres de rente ; somme qui, en ce temps-là, faisait presque le double de la valeur réelle de pareille somme d'aujourd'hui.
Le crédit qu'il avait auprès du roi paraît assez par le canonicat qu'il obtint pour le fils de son médecin. Ce médecin s'appelait Mauvilain. Tout le monde sait qu'étant un jour au dîner du roi : << Vous avez un médecin >>, dit le roi à Molière ; << que vous fait-il ? >> << Sire >>, répondit Molière, << Nous causons ensemble ; il m'ordonne des remèdes, je ne les fais point, et je guéris. >>
Il faisait de son bien un usage noble et sage ; il recevait chez lui des hommes de la meilleure compagnie, les Chapelle, les Jonsac, les Desbarreaux, etc., qui joignaient la volupté et la philosophie. Il avait une maison de campagne à Auteuil où il se délassait souvent avec eux des fatigues de sa profession, qui sont bien plus grandes qu'on ne pense. Le maréchal de Vivonne, connu par son esprit et par son amitié pour Despréaux, allait souvent chez Molière, et vivait avec lui comme Lélius avec Térence. Le grand Condé exigeait de lui qu'il le vînt voir souvent, et disait qu'il trouvait toujours à apprendre dans sa conversation.
Molière employait une partie de son revenu en libéralités, qui allaient beaucoup plus loin que ce qu'on appelle dans d'autres hommes "des charités". Il encourageait souvent par des présents considérables de jeunes auteurs qui marquaient du talent : c'est peut-être à Molière que la France doit Racine. Il engagea le jeune Racine, qui sortait de Port-Royal, à travailler pour le théâtre dès l'âge de dix-neuf ans. Il lui fit composer la tragédie de "Théagène et de Chariclée" ; et quoique cette pièce fût trop faible pour être jouée, il fit présent au jeune auteur de cent louis, et lui donna le plan des "Frères ennemis".
Il n'est peut-être pas inutile de dire qu'environ dans le même temps, c'est à dire en 1661, Racine ayant fait une ode sur le mariage de Louis XIV, M. Colbert lui envoya cent louis au nom du roi.
Il est triste pour l'honneur des lettres, que Molière et Racine aient été brouillés depuis : de si grands génies, dont l'un avait été le bienfaiteur de l'autre, devaient être toujours amis.
Il éleva et il forma un autre homme qui, par la supériorité de ses talents et par les dons singuliers qu'il avait reçus de la nature, mérite d'être connu de la postérité. C'est le comédien Baron, qui a été unique dans la tragédie et dans la comédie. Molière en prit soin comme de son propre fils.
Un jour, Baron vint lui annoncer qu'un comédien de campagne, que la pauvreté empêchait de se présenter, lui demandait quelques légers secours pour aller joindre sa troupe. Molière ayant su que c'était un nommé Mondorge, qui avait été son camarade, demanda à Baron combien il croyait qu'il fallait lui donner. Celui-ci répondit au hasard : << Quatre pistoles. -- Donnez lui quatre pistoles pour moi >>, lui dit Molière, << en voici vingt qu'il faut que vous lui donniez pour vous >> ; et il joignit à ce présent celui d'un habit magnifique. Ce sont de petits faits ; mais ils peignent le caractère.
Un autre trait mérite plus d'être rapporté. Il venait de donner l'aumône à un pauvre : un instant après, le pauvre court après lui, et lui dit : << Monsieur, vous n'aviez peut-être pas dessein de me donner un louis d'or : je viens vous le rendre. -- Tiens, mon ami >>, dit Molière, << en voilà un autre. >> ; et il s'écria : << Où la vertu va-t-elle se nicher ! >> Exclamation qui peut faire voir qu'il réfléchissait sur tout ce qui se présentait à lui, et qu'il étudiait partout la nature en homme qui la voulait peindre.
Molière, heureux par ses succès et par ses protecteurs, par ses amis et par sa fortune, ne le fut pas dans sa maison. Il avait épousé en 1661 une jeune fille née de la Béjart et d'un gentilhomme nommé Modène. On disait que Molière en était le père : le soin avec lequel on avait répandu cette calomnie, fit que plusieurs personnes prirent celui de la réfuter. On prouva que Molière n'avait connu la mère qu'après la naissance de cette fille. La disproportion d'âge et les dangers auxquels une comédienne jeune et belle est exposée rendirent ce mariage malheureux ; et Molière, tout philosophe qu'il était d'ailleurs, essuya dans son domestique les dégoûts, les amertumes, et quelquefois les ridicules qu'il avait si souvent joué sur le théâtre : tant il est vrai que les hommes qui sont au-dessus des autres par les talents, s'en rapprochent presque toujours par les faiblesses ; car pourquoi les talents nous mettraient-ils au-dessus de l'humanité ?
La dernière pièce qu'il composa fut "le Malade imaginaire". Il y avait quelque temps que sa poitrine était attaquée, et qu'il crachait quelquefois du sang. Le jour de la troisième représentation, il se sentit plus incommodé qu'auparavant : on lui conseilla de ne point jouer ; mais il voulut faire un effort sur lui-même, et cet effort lui coûta la vie.
Il lui prit une convulsion en prononçant "juro", dans le divertissement de la réception du malade imaginaire. On le rapporta mourant chez lui, rue de Richelieu. Il fut assisté quelques moments par deux de ces religieuses qui viennent quêter à Paris pendant le carême, et qu'il logeait chez lui. Il mourut entre leurs bras, étouffé par le sang qui lui sortait par la bouche, le 17 février 1673, âgé de cinquante-trois ans. Il ne laissa qu'une fille, qui avait beaucoup d'esprit. Sa veuve épousa un comédien nommé Guérin.
Le malheur qu'il avait eu de ne pouvoir mourir avec les secours de la religion et la prévention contre la comédie déterminèrent Harlay de Chanvalon, archevêque de Paris, si connu par ses intrigues galantes, à refuser la sépulture à Molière. Le roi le regrettait ; et ce monarque, dont il avait été le domestique et le pensionnaire, eut la bonté de prier l'archevêque de Paris de le faire inhumer dans une église. Le curé de Saint-Eustache, sa paroisse, ne voulut pas s'en charger. La populace, qui ne connaissait dans Molière que le comédien, et qui ignorait qu'il avait été un excellent auteur, un philosophe, un grand homme en son genre, s'attroupa en foule à la porte de sa maison le jour du convoi : sa veuve fut obligée de jeter de l'argent par les fenêtres ; et ces misérables, qui auraient, sans savoir pourquoi, troublé l'enterrement, accompagnèrent le corps avec respect.
La difficulté qu'on fit de lui donner la sépulture, et les injustices qu'il avait essuyées pendant sa vie, engagèrent le fameux père Bouhours à composer cette espèce d'épitaphe, qui, de toutes celles qu'on fit pour Molière, est la seule qui mérite d'être rapportée, et la seule qui ne soit pas dans cette fausse et mauvaise histoire qu'on a mise jusqu'ici au-devant de ses ouvrages :
Tu réformas et la ville et la cour ;
Mais quelle en fut la récompense ?
Les Français rougiront un jour
De leur peu de reconnaissance.
Il leur fallut un comédien
Qui mît à les polir sa gloire et son étude :
Mais, Molière, à ta gloire il ne manquerait rien,
Si, parmi les défauts que tu peignis si bien,
Tu les avais repris de leur ingratitude.
Non seulement j'ai omis dans cette Vie de Molière les contes populaires touchant Chapelle et ses amis ; mais je suis obligé de dire que ces contes, adoptés par Grimarest, sont très faux. Le feu duc de Sully, le dernier prince de Vendôme, l'abbé de Chaulieu, qui avaient beaucoup vécu avec Chapelle, m'ont assuré que toutes ces historiettes ne méritaient aucune créance.
Cliquez sur le bouton de droite
pour accéder aux livres gratuits de Voltaire.
Qu'il est dur de haïr ceux que l'on voudrait aimer.
Bien des erreurs sont nées d'une vérité dont on abuse.
Quand on ne voyage qu'en passant, on prend les abus pour les lois du pays. (Le Sottisier)
Les malheurs particuliers font le bien général ; de sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien. (Candide)
Il est à propos que le peuple soit guidé et non pas qu'il soit instruit. (Correspondance, à M. Damilaville)
La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille très folle d'une mère très sage.
Ce n'est pas que le suicide soit toujours de la folie. Mais en général, ce n'est pas dans un accès de raison que l'on se tue. (Correspondance, à M. Mariott)
C'est n'être bon à rien de n'être bon qu'à soi. (Mélanges, Sur la vraie Vertu)
Zadig se figurait alors les hommes tels qu'ils sont en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. (Zadig ou la Destinée)
Qui n'a pas l'esprit de son âge ; De son âge a tous le malheur. (Stances, à la marquise du Châtelet)
On a trouvé, en bonne politique, le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres. (Le Sottisier)
Dans ce pays, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. (Candide)
L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux. (Oedipe)
Ce n'est pas l'amour qu'il fallait peindre aveugle, c'est l'amour-propre. (Correspondance, à M. Damilaville)
Ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise : il fallait dire que tout est au mieux. (Candide)
J'ai fait un peu de bien ; c'est mon meilleur ouvrage. (Epîtres)
Zadig croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. (Zadig ou la Destinée)
Il n'y a point de grand conquérant qui ne soit grand politique. (Essai sur les mœurs, De l'Orient et de Gengis-Kan)
Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. (Zadig ou la Destinée)
Tout est dangereux ici-bas, et tout est nécessaire. (Zadig ou la Destinée)
Ils ne se servent de la pensée que pour autoriser leurs injustices et n'emploient les paroles que pour déguiser leurs pensées. (Dialogue, le Chapon et la Poularde)
Dieu ne doit pas pâtir des sottises du prêtre. (Epîtres)
Si l'homme était parfait, il serait Dieu. (Lettres philosophiques)
 Si Dieu nous a faits
à son image, nous le lui avons bien rendu. (Le Sottisier)
Si Dieu nous a faits
à son image, nous le lui avons bien rendu. (Le Sottisier)
Le secret d'ennuyer est celui de tout dire. (Sept discours en vers sur l'homme)
Le plus sûr est donc de n'être sûr de rien. (Singularités de la nature)
On doit des égards aux vivants ; on ne doit aux morts que la vérité. (Oedipe)
La patrie est aux lieux où l'âme est enchaînée. (Le Fanatisme ou Mahomet le prophète)
L'homme est né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude et dans la léthargie de l'ennui. (Candide)
Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme. (Correspondance, au comte d'Argental)
Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. (Discours en vers sur l'homme, De la liberté)
Cela est fort beau, mais j'ai du mal à croire que je descends d'une morue. (Les Colimaçons du R. P. L'Escarbotier)
N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle, et que les sages n'en aient pas ? Il faut être prudent, mais non pas timide. (Pensées détachées de M. l'abbé de Saint-Pierre)
Les femmes ressemblent aux girouettes : elles ne se fixent que quand elles se rouillent. (Le Sottisier)
Si la nature ne nous avait fait un peu frivoles, nous serions très malheureux ; c'est parce qu'on est frivole que la plupart des gens ne se pendent pas. (Correspondance, à la marquise du Deffant)
Ce que nous appelons le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu. (Dictionnaire philosophique)
L'intérêt que j'ai à croire une chose n'est pas une preuve de l'existence de cette chose. (Lettres philosophiques)
Le pape est une idole à qui on lie les mains et dont on baise les pieds. (Le Sottisier)
Le paradis terrestre est où je suis. (Satires, le Mondain)
La politique a sa source dans la perversité plus que dans la grandeur de l'esprit humain. (Le Sottisier)
En philosophie, il faut se défier de ce qu'on croit entendre trop aisément, aussi bien que des choses qu'on n'entend pas. (Lettres philosophiques)
Il semble que la populace ne mérite pas une religion raisonnable. (Essai sur les mœurs)
 Travaillons sans raisonner, dit
Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. (Candide)
Travaillons sans raisonner, dit
Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. (Candide)
Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier. (La Henriade)
Dieu fit du repentir la vertu des mortels. (Olympie)
C'est le privilège du vrai génie, et surtout du génie qui ouvre une carrière de faire impunément de grandes fautes. (Le Siècle de Louis XIV)
La vertu s'avilit à se justifier. (Oedipe)
Comme le despotisme est l'abus de la royauté, l'anarchie est l'abus de la démocratie.
L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. (Dictionnaire philosophique)
Il ne dépend pas de nous de n'être pas pauvres, mais il dépend toujours de nous de faire respecter notre pauvreté.
La beauté n'est qu'un piège tendu par la nature à la raison.
Le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin. (Candide)
Pour savoir se venger, il faut savoir souffrir. (Mérope)
Toujours du plaisir n'est pas du plaisir. (Zadig ou la Destinée)
Les soldats se mettent à genoux quand ils tirent : apparemment pour demander pardon du meurtre. (Le Sottisier)
Les vraies passions donnent des forces, en donnant du courage.
L'alphabet fut l'origine de toutes les connaissances de l'homme et de toutes ses sottises. (Dictionnaire philosophique)
Le courage n'est pas une vertu, mais une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes.
L'art de gouverner consiste à prendre le plus d'argent possible à une catégorie de citoyens afin de le donner à une autre.
Parmi ceux qui lisent, il y en a vingt qui lisent des romans, contre un qui étudie la philosophie. Le nombre de ceux qui pensent est excessivement petit, et ceux-là ne s'avisent pas de troubler le monde.
La politique est l'art de mentir à propos.
 Tes destins sont d'un
homme, et tes voeux sont d'un dieu.
Tes destins sont d'un
homme, et tes voeux sont d'un dieu.
J'approche tout doucement du moment où les philosophes et les imbéciles ont la même destinée.
Quiconque pense fait penser. (Fragments sur l'histoire)
Que chacun aille à Dieu par le chemin qui lui plaît.
Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes.
Femme sage est plus que femme belle.
Dieu nous a donné le vivre ; c'est à nous de nous donner le bien vivre. (Le Sottisier)
Il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. (Zadig ou la Destinée)
Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères.
Un seul mauvais exemple, une fois donné, est capable de corrompre toute une nation, et l'habitude devient une tyrannie. (Dictionnaire philosophique)
C'est le sort d'un héros d'être persécuté. (Tancrède)
Un lion mort ne vaut pas un moucheron qui respire.
Il n'y a rien de plus ridicule qu'un médecin qui ne meurt pas de vieillesse.
Les sauvages ne s'avisent point de se tuer par dégoût de la vie ; c'est un raffinement des gens d'esprit.
Il y a une autre canaille à laquelle on sacrifie tout, et cette canaille est le peuple. (Correspondance, au marquis de Condorcet)
Les bavards sont les plus discrets des hommes : ils parlent pour ne rien dire.
Le coeur ne vieillit pas, mais il est pénible de loger un dieu dans des ruines.
Le premier devin, fut le premier fripon qui rencontra un imbécile.
La femme coquette est l'agrément des autres et le mal de qui la possède. (Epîtres)
Par tout pays, la religion dominante, quand elle ne persécute point, engloutit à la longue toutes les autres. (Lettres philosophiques)
Les hommes se trompent, les grands hommes avouent qu'ils se sont trompés. (Le Sottisier)
Si mes amis sont heureux ; Je serai moins misérable. (Sur l'usage de la vie)
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire.
 Un instant de bonheur vaut mille ans
dans l'histoire. (Commentaire historique)
Un instant de bonheur vaut mille ans
dans l'histoire. (Commentaire historique)
Le plaisir donne ce que la sagesse promet.
Ni l'abstinence ni l'excès ne rendent un homme heureux.
Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur. (Dictionnaire philosophique)
Tout pouvoir périt par l'indulgence. (Alzire)
La raison est la fille du temps, et elle attend tout de son père. (L'Homme aux quarante écus)
Dieu ? Nous nous saluons mais nous ne nous parlons pas. (Correspondance)
La médisance est fille de l'amour-propre et de l'oisiveté. (Epîtres)
Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert.
Les rois sont avec leurs ministres comme les cocus avec leurs femmes : ils ne savent jamais ce qui se passe. (Le Sottisier)
Les injures atroces n'ont jamais fait de tort qu'à ceux qui les ont dites. (Conseil à Luis Racine)
Les Français ne sont pas faits pour la liberté. Ils en abuseraient. (Lettre au prince de Prusse)
Les Français parlent vite et agissent lentement. (Correspondance, au comte d'Argental)
La vérité est un fruit qui ne doit être cueilli que s'il est tout à fait mûr. (Correspondance, à la comtesse de Barcewitz)
On ne peut vivre dans le monde qu'avec des illusions ; et dès qu'on a un peu vécu, toutes les illusions s'envolent. (Correspondance)
Les préjugés sont la raison des sots. (Poème sur la Loi Naturelle)
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. (Candide)
Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d'hommes inutiles.
OU LA SAGESSE HUMAINE
1750
AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR
Nous tromper dans nos entreprises, C'est à quoi nous sommes sujets; Le matin je fais des projets, Et le long du jour, des sottises.
Ces petits vers conviennent assez à un grand nombre de raisonneurs; et c'est une chose assez plaisante de voir un grave directeur d'âmes finir par un procès criminel, conjointement avec un banqueroutier. A ce propos, nous réimprimons ici ce petit conte, qui est ailleurs; car il est bon qu'il soit partout.
MEMNON, ou LA SAGESSE HUMAINE.
Memnon conçut un jour le projet insensé d'être parfaitement sage. Il n'y a guère d'hommes à qui cette folie n'ait quelquefois passé par la tête. Memnon se dit à lui-même: Pour être très sage, et par conséquent très heureux, il n'y a qu'à être sans passions; et rien n'est plus aisé, comme on sait. Premièrement je n'aimerai jamais de femme; car, en voyant une beauté parfaite, je me dirai à moi-même: Ces joues-là se rideront un jour; ces beaux yeux seront bordés de rouge; cette gorge ronde deviendra plate et pendante; cette belle tête deviendra chauve. Or je n'ai qu'à la voir à présent des mêmes yeux dont je la verrai alors, et assurément cette tête ne fera pas tourner la mienne.
En second lieu je serai toujours sobre; j'aurai beau être tenté par la bonne chère, par des vins délicieux, par la séduction de la société; je n'aurai qu'à me représenter les suites des excès, une tête pesante, un estomac embarrassé, la perte de la raison, de la santé, et du temps, je ne mangerai alors que pour le besoin; ma santé sera toujours égale, mes idées toujours pures et lumineuses. Tout cela est si facile, qu'il n'y a aucun mérite à y parvenir.
Ensuite, disait Memnon, il faut penser un peu à ma fortune; mes désirs sont modérés; mon bien est solidement placé sur le receveur général des finances de Ninive; j'ai de quoi vivre dans l'indépendance: c'est là le plus grand des biens. Je ne serai jamais dans la cruelle nécessité de faire ma cour: je n'envierai personne, et personne ne m'enviera. Voilà qui est encore très aisé. J'ai des amis, continuait-il, je les conserverai, puisqu'ils n'auront rien à me disputer. Je n'aurai jamais d'humeur avec eux, ni eux avec moi; cela est sans difficulté.
Ayant fait ainsi son petit plan de sagesse dans sa chambre, Memnon mit la tête à la fenêtre. Il vit deux femmes qui se promenaient sous des platanes auprès de sa maison. L'une était vieille, et paraissait ne songer à rien; l'autre était jeune, jolie, et semblait fort occupée. Elle soupirait, elle pleurait, et n'en avait que plus de grâces. Notre sage fut touché, non pas de la beauté de la dame (il était bien sûr de ne pas sentir une telle faiblesse), mais de l'affliction où il la voyait. Il descendit, il aborda la jeune Ninivienne dans le dessein de la consoler avec sagesse. Cette belle personne lui conta, de l'air le plus naïf et le plus touchant, tout le mal que lui faisait un oncle qu'elle n'avait point; avec quels artifices il lui avait enlevé un bien qu'elle n'avait jamais possédé, et tout ce qu'elle avait à craindre de sa violence. Vous me paraissez un homme de si bon conseil, lui dit-elle, que si vous aviez la condescendance de venir jusque chez moi, et d'examiner mes affaires, je suis sûre que vous me tireriez du cruel embarras où je suis. Memnon n'hésita pas à la suivre, pour examiner sagement ses affaires, et pour lui donner un bon conseil.
La dame affligée le mena dans une chambre parfumée, et le fit asseoir avec elle poliment sur un large sofa, où ils se tenaient tous deux les jambes croisées vis-à-vis l'un de l'autre. La dame parla en baissant les yeux, dont il échappait quelquefois des larmes, et qui en se relevant rencontraient toujours les regards du sage Memnon. Ses discours étaient pleins d'un attendrissement qui redoublait toutes les fois qu'ils se regardaient. Memnon prenait ses affaires extrêmement à cœur, et se sentait de moment en moment la plus grande envie d'obliger une personne si honnête et si malheureuse. Ils cessèrent insensiblement, dans la chaleur de la conversation, d'être vis-à-vis l'un de l'autre. Leurs jambes ne furent plus croisées. Memnon la conseilla de si près, et lui donna des avis si tendres, qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre parler d'affaires, et qu'ils ne savaient plus où ils en étaient.
Comme ils en étaient là, arrive l'oncle, ainsi qu'on peut bien le penser: il était armé de la tête aux pieds; et la première chose qu'il dit fut qu'il allait tuer, comme de raison, le sage Memnon et sa nièce; la dernière qui lui échappa fut qu'il pouvait pardonner pour beaucoup d'argent. Memnon fut obligé de donner tout ce qu'il avait. On était heureux dans ce temps-là d'en être quitte à si bon marché; l'Amérique n'était pas encore découverte, et les dames affligées n'étaient pas à beaucoup près si dangereuses qu'elles le sont aujourd'hui.
Memnon, honteux et désespéré, rentra chez lui: il y trouva un billet qui l'invitait à dîner avec quelques uns de ses intimes amis. Si je reste seul chez moi, dit-il, j'aurai l'esprit occupé de ma triste aventure, je ne mangerai point; je tomberai malade; il vaut mieux aller faire avec mes amis intimes un repas frugal. J'oublierai, dans la douceur de leur société, la sottise que j'ai faite ce matin. Il va au rendez-vous; on le trouve un peu chagrin. On le fait boire pour dissiper sa tristesse. Un peu de vin pris modérément est un remède pour l'âme et pour le corps. C'est ainsi que pense le sage Memnon; et il s'enivre. On lui propose de jouer après le repas. Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête. Il joue; on lui gagne tout ce qu'il a dans sa bourse, et quatre fois autant sur sa parole. Une dispute s'élève sur le jeu, on s'échauffe: l'un de ses amis intimes lui jette à la tête un cornet, et lui crève un oeil. On rapporte chez lui le sage Memnon ivre, sans argent, et ayant un oeil de moins.
Il cuve un peu son vin; et dès qu'il a la tête plus libre, il envoie son valet chercher de l'argent chez le receveur général des finances de Ninive pour payer ses intimes amis: on lui dit que son débiteur a fait le matin une banqueroute frauduleuse qui met en alarme cent familles. Memnon, outré va à la cour avec un emplâtre sur l'oeil et un placet à la main pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Il rencontre dans un salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un air aisé des cerceaux de vingt-quatre pieds de circonférence. L'une d'elles, qui le connaissait un peu, dit en le regardant de côté: Ah, l'horreur! Une autre, qui le connaissait davantage, lui dit: Bonsoir, monsieur Memnon; mais vraiment, monsieur Memnon, je suis fort aise de vous voir; à propos, monsieur Memnon, pourquoi avez-vous perdu un oeil? Et elle passa sans attendre sa réponse. Memnon se cacha dans un coin, et attendit le moment où il put se jeter aux pieds du monarque. Ce moment arriva. Il baisa trois fois la terre, et présenta son placet. Sa gracieuse majesté le reçut très favorablement, et donna le mémoire à un de ses satrapes pour lui en rendre compte. Le satrape tire Memnon à part, et lui dit d'un air de hauteur, en ricanant amèrement: Je vous trouve un plaisant borgne, de vous adresser au roi plutôt qu'à moi, et encore plus plaisant d'oser demander justice contre un honnête banqueroutier que j'honore de ma protection, et qui est le neveu d'une femme de chambre de ma maîtresse. Abandonnez cette affaire-là, mon ami, si vous voulez conserver l'oeil qui vous reste.
Memnon, ayant ainsi renoncé le matin aux femmes, aux excès de table, au jeu, à toute querelle, et surtout à la cour, avait été avant la nuit trompé et volé par une belle dame, s'était enivré, avait joué, avait eu une querelle, s'était fait crever un oeil, et avait été à la cour, où l'on s'était moqué de lui.
Pétrifié d'étonnement et navré de douleur, il s'en retourne la mort dans le cœur. Il veut rentrer chez lui; il y trouve des huissiers qui démeublaient sa maison de la part de ses créanciers. Il reste presque évanoui sous un platane; il y rencontre la belle dame du matin, qui se promenait avec son cher oncle, et qui éclata de rire en voyant Memnon avec son emplâtre. La nuit vint; Memnon se coucha sur de la paille auprès des murs de sa maison. La fièvre le saisit; il s'endormit dans l'accès, et un esprit céleste lui apparut en songe.
Il était tout resplendissant de lumière. Il avait six belles ailes, mais ni pieds, ni tête, ni queue, et ne ressemblait à rien. Qui es-tu? lui dit Memnon. Ton bon génie, lui répondit l'autre. Rends-moi donc mon oeil, ma santé, ma maison, mon bien, ma sagesse, lui dit Memnon. Ensuite il lui conta comment il avait perdu tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous arrivent jamais dans le monde que nous habitons, dit l'esprit. Et quel monde habitez-vous? dit l'homme affligé. Ma patrie, répondit-il, est à cinq cents millions de lieues du soleil, dans une petite étoile auprès de Sirius, que tu vois d'ici. Le beau pays! dit Memnon: quoi! vous n'avez point chez vous de coquines qui trompent un pauvre homme, point d'amis intimes qui lui gagnent son argent et qui lui crèvent un oeil, point de banqueroutiers, point de satrapes qui se moquent de vous en vous refusant justice? Non, dit l'habitant de l'étoile, rien de tout cela. Nous ne sommes jamais trompés par les femmes, parce que nous n'en avons point; nous ne faisons point d'excès de table, parce que nous ne mangeons point; nous n'avons point de banqueroutiers, parce qu'il n'y a chez nous ni or ni argent; on ne peut nous crever les yeux, parce que nous n'avons point de corps à la façon des vôtres; et les satrapes ne nous font jamais d'injustice, parce que dans notre petite étoile tout le monde est égal.
Memnon lui dit alors: Monseigneur, sans femme et sans dîner, à quoi passez-vous votre temps? A veiller, dit le génie, sur les autres globes qui nous sont confiés: et je viens pour te consoler. Hélas! reprit Memnon, que ne veniez-vous la nuit passée pour m'empêcher de faire tant de folies? J'étais auprès d'Assan, ton frère aîné, dit l'être céleste. Il est plus à plaindre que toi. Sa gracieuse majesté le roi des Indes, à la cour duquel il a l'honneur d'être, lui a fait crever les deux yeux pour une petite indiscrétion, et il est actuellement dans un cachot, les fers aux pieds et aux mains. C'est bien la peine, dit Memnon, d'avoir un bon génie dans une famille, pour que de deux frères, l'un soit borgne, l'autre aveugle, l'un couché sur la paille, l'autre en prison. Ton sort changera, reprit l'animal de l'étoile. Il est vrai que tu seras toujours borgne; mais, à cela près, tu seras assez heureux, pourvu que tu ne fasses jamais le sot projet d'être parfaitement sage. C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir? s'écria Memnon en soupirant. Aussi impossible, lui répliqua l'autre, que d'être parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement puissant, parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous en sommes bien loin. Il y a un globe où tout cela se trouve; mais dans les cent mille millions de mondes qui sont dispersés dans l'étendue tout se suit par degrés. On a moins de sagesse et de plaisir dans le second que dans le premier, moins dans le troisième que dans le second, ainsi du reste jusqu'au dernier, où tout le monde est complètement fou. J'ai bien peur, dit Memnon, que notre petit globe terraqué ne soit précisément les Petites Maisons de l'univers dont vous me faites l'honneur de me parler. Pas tout à fait, dit l'esprit; mais il en approche: il faut que tout soit en sa place. Eh mais! dit Memnon, certains poètes, certains philosophes, ont donc grand tort de dire que tout est bien? Ils ont grande raison, dit le philosophe de là-haut, en considérant l'arrangement de l'univers entier. Ah! je ne croirai cela, répliqua le pauvre Memnon, que quand je ne serai plus borgne.
Puisque le dieu du jour en ses douze voyages
Habite tristement sa maison du Verseau,
Que les monts sont encor assiégés des orages,
Et que nos prés riants sont engloutis sous l'eau,
Je veux au coin du feu vous faire un nouveau conte.
Nos loisirs sont plus doux par nos amusements.
Je suis vieux, je l'avoue, et je n'ai point de honte
De goûter avec vous le plaisir des enfants.
Dans Bénévent jadis régnait un jeune prince
Plongé, dans la mollesse, ivre de son pouvoir,
Elevé comme un sot, et sans en rien savoir,
Méprisé des voisins, haï dans sa province.
Deux fripons gouvernaient cet état assez mince;
Ils avaient abruti l'esprit de monseigneur,
Aidés dans ce projet par son vieux confesseur;
Tous trois se relayaient. On lui faisait accroire
Qu'il avait des talents, des vertus, de la gloire,
Qu'un duc de Bénévent, dès qu'il était majeur,
Etait du monde entier l'amour et la terreur:
Qu'il pouvait conquérir l'Italie et la France,
Que son trésor ducal regorgeait de finance,
Qu'il avait plus d'argent que n'en eut Salomon,
Sur son terrain pierreux du torrent de Cédron.
Alamon (c'est le nom de ce prince imbécile)
Avalait cet encens, et sottement tranquille,
Entouré de bouffons, et d'insipides jeux,
Quand il avait dîné croyait son peuple heureux.
Il restait à la cour un brave militaire,
Emon, vieux serviteur du feu prince son père,
Qui, n'étant point payé, lui parlait librement,
Et prédisait malheur à son gouvernement.
Les ministres jaloux, qui bientôt le craignirent,
De ce pauvre honnête homme aisément se défirent;
Emon fut exilé; le maître n'en sut rien.
Le vieillard, confiné dans une métairie,
Cultivait sagement ses amis et son bien,
Et pleurait à la fois son maître et sa patrie.
Alamon loin de lui laissait couler sa vie
Dans l'insipidité de ses molles langueurs.
Des sots Bénéventins quelquefois les clameurs
Frappaient pour un moment son âme appesantie.
Ce bruit sourd et lointain, qu'avec peine il entend,
S'affaiblit dans sa course, et meurt en arrivant.
Le poids de la misère accablait la province;
Elle était dans les pleurs, Alamon dans l'ennui;
Les tyrans triomphaient. Dieu prit pitié de lui:
Il voulut qu'il aimât pour en faire un bon prince.
Il vit la jeune Amide, il la vit; l'entendit;
Il commença de vivre, et son coeur se sentit.
Il était beau, bien fait, et dans l'âge de plaire.
Son confesseur madré découvrit le mystère;
Il en fit un scrupule à son sot pénitent,
D'autant plus timoré qu'il était ignorant:
Et les deux scélérats qui tremblaient que leur maître
Ne se connût un jour, et vînt à les connaître,
Envoyèrent Amide avec le pauvre Emon.
Elle fit son paquet, et le trempa de larmes.
On n'osait résister. Le timide Alamon
Vainement attendri, s'arrachait à ses charmes,
Car son esprit flottant, d'un vain remords touché,
Commençant à s'ouvrir, n'était point débouché.
Comme elle allait partir, on entend: "Bas les armes!
A la fuite! à la mort! combattons! tout périt!
Alla! San Germano! Mahomet! Jésus-Christ!"
On voit un peuple entier fuyant de place en place;
Un guerrier en turban, plein de force et d'audace,
Suivi de Musulmans, le cimeterre en main,
Sur des morts entassés se frayant un chemin,
Portant dans le palais le fer avec les flammes,
Egorgeait les maris, mettait à part les femmes.
Cet homme avait marché de Cume à Bénévent
Sans que le ministère en eût le moindre vent;
La mort le devançait, et dans Rome la sainte
Saint Pierre avec Saint Paul était transi de crainte.
C'était, mes chers amis, le superbe Abdala,
Pour corriger l'église envoyé par Alla.
Dès qu'il fut au palais, tout fut mis dans les chaînes,
Princes, moines, valets, ministres, capitaines,
Tels que les fils d'Io, l'un à l'autre attachés,
Sont portés dans un char aux plus voisins marchés.
Tels étaient Monseigneur et ses référendaires,
Enchaînés par les pieds avec le confesseur,
Qui toujours se signant, et disant ses rosaires,
Leur prêchait la constance, et se mourait de peur.
Quand tout fut garotté, les vainqueurs partagèrent
Le butin qu'en trois lots les émirs arrangèrent:
Les hommes, les chevaux et les châsses des saints.
D'abord on dépouilla les bons Bénéventins.
Les tailleurs ont toujours déguisé la nature,
Ils sont trop charlatans, l'homme n'est point connu.
L'habit change les moeurs ainsi que la figure;
Pour juger d'un mortel il faut le voir tout nu.
Du chef des Musulmans le duc fut le partage;
Il était, comme on sait, dans la fleur de son âge;
Il paraissait robuste, on le fit muletier;
Il profita beaucoup dans ce nouveau métier.
Ses muscles énervés par l'infâme mollesse
Prirent dans le travail une heureuse vigueur;
Le malheur l'instruisit, il dompta la paresse,
Son avilissement fit naître sa valeur.
La valeur sans pouvoir est assez inutile;
C'est un tourment de plus. Déjà paisiblement
Abdala s'établit dans son appartement;
Boit le vin des vaincus malgré son évangile.
Les dames de la cour, les filles de la ville,
Conduites chaque nuit par son eunuque noir,
A son petit coucher arrivent à la file,
Attendent ses regards et briguent son mouchoir.
Les plaisirs partageaient les moments de sa vie.
Monseigneur cependant, au fond de l'écurie,
Avec ses compagnons ci-devant ses sujets,
Une étrille à la main prenait soin des mulets.
Pour comble de malheur il vit la belle Amide,
Que le noir circoncis, ministre de l'amour,
Au superbe Abdala conduisait à son tour.
Prêt à s'évanouir, il s'écria: "Perfide!
Ce malheur me manquait, voici mon dernier jour."
L'eunuque à ce discours ne pouvait rien comprendre;
Dans un autre langage Amide répondit,
D'un coup d'oeil douloureux, d'un regard noble et tendre,
Qui pénétrait à l'âme; et ce regard lui dit:
"Consolez-vous, vivez, songez à me défendre,
Vengez-moi, vengez-vous; votre nouvel emploi
Ne vous rend à mes yeux que plus digne de moi.
Alamon l'entendit, et reprit l'espérance.
Amide comparut devant son excellence;
Le corsaire jura que jusques à ce jour
Il avait en effet connu la jouissance,
Mais qu'en voyant Amide il connaissait l'amour.
Pour lui plaire encor plus elle fit résistance;
Et ces refus adroits annonçant les plaisirs,
En les faisant attendre, irritaient ses désirs.
Les femmes ont toujours des prétextes honnêtes:
"Je suis, lui dit Amide, au rang de vos conquêtes;
Vous êtes invincible en amour, aux combats,
Et tout est à vos pieds, ou veut être en vos bras;
Mais souffrez que trois jours mon bonheur se diffère;
Et pour me consoler de ces tristes délais,
A mon timide amour accordez deux bienfaits."
"Qu'ordonnez-vous? parlez, répondit le corsaire,
Il n'est rien que mon coeur refuse à vos attraits."
"Des faveurs que j'attends, dit-elle, la première
Est de faire donner deux cents coups d'étrivière
A trois Bénéventins que j'ai mandés exprès.
La seconde, seigneur, est d'avoir deux mulets,
Pour m'aller quelquefois promener en litière,
Avec un muletier qui soit selon mon choix."
Abdala répliqua: "Vos désirs sont mes lois."
Ainsi dit, ainsi fait; le très indigne prêtre
Et les deux conseillers corrupteurs de leur maître
Eurent chacun leur dose, au grand contentement
De tous les prisonniers, et de tout Bénévent.
Et le jeune Alamon goûta le bien suprême
D'être le muletier de la beauté qu'il aime.
"Ce n'est pas tout, dit-elle, il faut vaincre et régner.
La couronne ou la mort à présent vous appelle,
Vous avez du courage, Emon vous est fidèle,
Je veux aussi vous l'être, et ne rien épargner
Pour vous rendre honnête homme, et servir ma patrie.
Au fond de son exil allez trouver Emon;
Puisque vous avez tort, demandez-lui pardon;
Il donnera pour vous les restes de sa vie;
Tout sera préparé, revenez dans trois jours;
Hâtez-vous: vous savez que je suis destinée
Aux plaisirs d'Abdala la troisième journée.
Les moments sont bien chers à la guerre, en amours."
Alamon répondit: "Je vous aime, et j'y cours."
Il part. Le brave Emon, qu'avait instruit Amide,
Aimait son prince ingrat devenu malheureux;
Il avait rassemblé des amis généreux,
Et de soldats choisis une troupe intrépide.
Il embrassa son prince, ils pleurèrent tous deux;
Ils s'arment en secret, ils marchent en silence.
Amide parle aux siens, et réveille en leur coeur,
Tout esclaves qu'ils sont, des sentiments d'honneur.
Alamon réunit l'audace et la prudence;
Il devint un héros, sitôt qu'il combattit.
Le Turc aux voluptés livré sans défiance,
Surpris par les vaincus, à son tour se perdit.
Alamon triomphant au palais se rendit,
Au moment que le Turc, ignorant sa disgrâce,
Avec la belle Amide allait se mettre au lit.
Il rentra dans ses droits, et se mit à sa place.
Le confesseur arrive avec mes deux fripons,
Tout fraîchement sortis de leurs sales prisons,
Disant avoir tout fait, et n'ayant rien pu faire;
Ils pensaient conserver leur empire ordinaire.
Les lâches sont cruels: le moine conseilla
De faire au pied des murs empaler Abdala.
"Misérable! c'est vous qui méritez de l'être,
Dit le prince éclairé, prenant un ton de maître;
Dans un lâche repos vous m'aviez corrompu;
Je dois tout à ce Turc, et tout à ma maîtresse;
Vous m'aviez fait dévot, vous trompiez ma jeunesse.
Le malheur et l'amour me rendent ma vertu.
Allez, brave Abdala, je dois vous rendre grâce
D'avoir développé mon esprit et mon coeur.
De leçons désormais il faut que je me passe:
Je vous suis obligé, mais n'y revenez pas.
Soyez libre, partez; et si vos destinées
Vous donnent trois fripons pour régir vos états,
Envoyez-moi chercher; j'irai, n'en doutez pas,
Vous rendre les leçons que vous m'avez données."
La scène est à la Mecque.
Zopire, Phanor.
Zopire.
Qui ? Moi, baisser les yeux devant ses faux prodiges ! Moi, de ce fanatique encenser les prestiges ! L'honorer dans la Mecque après l'avoir banni ! Non. Que des justes dieux Zopire soit puni si tu vois cette main, jusqu'ici libre et pure, caresser la révolte et flatter l'imposture !
Phanor.
Nous chérissons en vous ce zèle paternel du chef auguste et saint du sénat d'Ismaël ; mais ce zèle est funeste ; et tant de résistance, sans lasser Mahomet, irrite sa vengeance. Contre ses attentats vous pouviez autrefois lever impunément le fer sacré des lois, et des embrasements d'une guerre immortelle étouffer sous vos pieds la première étincelle. Mahomet citoyen ne parut à vos yeux qu'un novateur obscur, un vil séditieux : aujourd'hui, c'est un prince ; il triomphe, il domine ; imposteur à la Mecque, et prophète à Médine, il sait faire adorer à trente nations tous ces mêmes forfaits qu'ici nous détestons. Que dis-je ? En ces murs même une troupe égarée, des poisons de l'erreur avec zèle enivrée, de ses miracles faux soutient l'illusion, répand le fanatisme et la sédition, appelle son armée, et croit qu'un dieu terrible l'inspire, le conduit, et le rend invincible. Tous nos vrais citoyens avec vous sont unis ; mais les meilleurs conseils sont-ils toujours suivis ? L'amour des nouveautés, le faux zèle, la crainte, de la Mecque alarmée ont désolé l'enceinte ; et ce peuple, en tout temps chargé de vos bienfaits, crie encore à son père, et demande la paix.
Zopire.
La paix avec ce traître ! Ah ! Peuple sans courage, n'en attendez jamais qu'un horrible esclavage : allez, portez en pompe, et servez à genoux l'idole dont le poids va vous écraser tous. Moi, je garde à ce fourbe une haine éternelle ; de mon coeur ulcéré la plaie est trop cruelle : lui-même a contre moi trop de ressentiments. Le cruel fit périr ma femme et mes enfants : et moi, jusqu'en son camp j'ai porté le carnage ; la mort de son fils même honora mon courage. Les flambeaux de la haine entre nous allumés jamais des mains du temps ne seront consumés.
Phanor.
Ne les éteignez point, mais cachez-en la flamme ; immolez au public les douleurs de votre âme. Quand vous verrez ces lieux par ses mains ravagés, vos malheureux enfants seront-ils mieux vengés ? Vous avez tout perdu, fils, frère, épouse, fille ; ne perdez point l'état : c'est là votre famille.
Zopire.
On ne perd les états que par timidité.
Phanor.
On périt quelquefois par trop de fermeté.
Zopire.
Périssons, s'il le faut.
Phanor.
Ah ! Quel triste courage, quand vous touchez au port, vous expose au naufrage ? Le ciel, vous le voyez, a remis en vos mains de quoi fléchir encor ce tyran des humains. Cette jeune Palmire en ses camps élevée, dans vos derniers combats par vous-même enlevée, semble un ange de paix descendu parmi nous, qui peut de Mahomet apaiser le courroux. Déjà par ses hérauts il l'a redemandée.
Zopire.
Tu veux qu'à ce barbare elle soit accordée ? Tu veux que d'un si cher et si noble trésor ses criminelles mains s'enrichissent encor ? Quoi ! Lorsqu'il nous apporte et la fraude et la guerre, lorsque son bras enchaîne et ravage la terre, les plus tendres appas brigueront sa faveur, et la beauté sera le prix de la fureur ! Ce n'est pas qu'à mon âge, aux bornes de ma vie, je porte à Mahomet une honteuse envie ; ce coeur triste et flétri, que les ans ont glacé, ne peut sentir les feux d'un désir insensé. Mais soit qu'en tous les temps un objet né pour plaire arrache de nos voeux l'hommage involontaire ; soit que, privé d'enfants, je cherche à dissiper cette nuit de douleurs qui vient m'envelopper ; je ne sais quel penchant pour cette infortunée remplit le vide affreux de mon âme étonnée. Soit faiblesse ou raison, je ne puis sans horreur la voir aux mains d'un monstre, artisan de l'erreur. Je voudrais qu'à mes voeux heureusement docile, elle-même en secret pût chérir cet asile ; je voudrais que son coeur, sensible à mes bienfaits, détestât Mahomet autant que je le hais. Elle veut me parler sous ces sacrés portiques, non loin de cet autel de nos dieux domestiques ; elle vient, et son front, siége de la candeur, annonce en rougissant les vertus de son coeur.
Zopire, Palmire.
Zopire.
Jeune et charmant objet dont le sort de la guerre, propice à ma vieillesse, honora cette terre, vous n'êtes point tombée en de barbares mains ; tout respecte avec moi vos malheureux destins, votre âge, vos beautés, votre aimable innocence. Parlez ; et s'il me reste encor quelque puissance, de vos justes désirs si je remplis les voeux, ces derniers de mes jours seront des jours heureux.
Palmire.
Seigneur, depuis deux mois sous vos lois prisonnière, je dus à mes destins pardonner ma misère ; vos généreuses mains s'empressent d'effacer les larmes que le ciel me condamne à verser. Par vous, par vos bienfaits, à parler enhardie, c'est de vous que j'attends le bonheur de ma vie. Aux voeux de Mahomet j'ose ajouter les miens : il vous a demandé de briser mes liens ; puissiez-vous l'écouter ! Et puissé-je lui dire qu'après le ciel et lui je dois tout à Zopire !
Zopire.
Ainsi de Mahomet vous regrettez les fers, ce tumulte des camps, ces horreurs des déserts, cette patrie errante, au trouble abandonnée ?
Palmire.
La patrie est aux lieux où l'âme est enchaînée. Mahomet a formé mes premiers sentiments, et ses femmes en paix guidaient mes faibles ans : leur demeure est un temple où ces femmes sacrées lèvent au ciel des mains de leur maître adorées. Le jour de mon malheur, hélas ! fut le seul jour où le sort des combats a troublé leur séjour : seigneur, ayez pitié d'une âme déchirée, toujours présente aux lieux dont je suis séparée.
Zopire.
J'entends : vous espérez partager quelque jour de ce maître orgueilleux et la main et l'amour.
Palmire.
Seigneur, je le révère, et mon âme tremblante croit voir dans Mahomet un dieu qui m'épouvante. Non, d'un si grand hymen mon coeur n'est point flatté ; tant d'éclat convient mal à tant d'obscurité.
Zopire.
Ah ! Qui que vous soyez, il n'est point né peut-être pour être votre époux, encor moins votre maître ; et vous semblez d'un sang fait pour donner des lois à l'arabe insolent qui marche égal aux rois.
Palmire.
Nous ne connaissons point l'orgueil de la naissance ; sans parents, sans patrie, esclaves dès l'enfance, dans notre égalité nous chérissons nos fers ; tout nous est étranger, hors le dieu que je sers.
Zopire.
Tout vous est étranger ! Cet état peut-il plaire ? Quoi ! Vous servez un maître, et n'avez point de père ? Dans mon triste palais, seul et privé d'enfants, j'aurais pu voir en vous l'appui de mes vieux ans ; le soin de vous former des destins plus propices eût adouci des miens les longues injustices. Mais non, vous abhorrez ma patrie et ma loi.
Palmire.
Comment puis-je être à vous ? Je ne suis point à moi. Vous aurez mes regrets, votre bonté m'est chère ; mais enfin Mahomet m'a tenu lieu de père.
Zopire.
Quel père ! Justes dieux ! Lui ? Ce monstre imposteur !
Palmire.
Ah ! Quels noms inouïs lui donnez-vous, seigneur ! Lui, dans qui tant d'états adorent leur prophète ! Lui, l'envoyé du ciel, et son seul interprète !
Zopire.
étrange aveuglement des malheureux mortels ! Tout m'abandonne ici pour dresser des autels à ce coupable heureux qu'épargna ma justice, et qui courut au trône, échappé du supplice.
Palmire.
Vous me faites frémir, seigneur ; et, de mes jours, je n'avais entendu ces horribles discours. Mon penchant, je l'avoue, et ma reconnaissance, vous donnaient sur mon coeur une juste puissance ; vos blasphèmes affreux contre mon protecteur à ce penchant si doux font succéder l'horreur.
Zopire.
ô superstition ! Tes rigueurs inflexibles privent d'humanité les coeurs les plus sensibles. Que je vous plains, Palmire ! Et que sur vos erreurs ma pitié malgré moi me fait verser de pleurs !
Palmire.
Et vous me refusez !
Zopire.
Oui. Je ne puis vous rendre au tyran qui trompa ce coeur flexible et tendre ; oui, je crois voir en vous un bien trop précieux, qui me rend Mahomet encor plus odieux.
Zopire, Palmire, Phanor.
Zopire.
Que voulez-vous, Phanor ?
Phanor.
Aux portes de la ville, d'où l'on voit de Moad la campagne fertile, Omar est arrivé.
Zopire.
Qui ? Ce farouche Omar, que l'erreur aujourd'hui conduit après son char, qui combattit longtemps le tyran qu'il adore, qui vengea son pays ?
Phanor.
Peut-être il l'aime encore. Moins terrible à nos yeux, cet insolent guerrier, portant entre ses mains le glaive et l'olivier, de la paix à nos chefs a présenté le gage. On lui parle ; il demande, il reçoit un otage. Séide est avec lui.
Palmire.
Grand dieu ! Destin plus doux ! Quoi ! Séide ?
Phanor.
Omar vient, il s'avance vers vous.
Zopire.
Il le faut écouter. Allez, jeune Palmire.
(Palmire sort.)
Omar devant mes yeux ! Qu'osera-t-il me dire ? ô dieux de mon pays, qui depuis trois mille ans protégiez d'Ismaël les généreux enfants ! Soleil, sacré flambeau, qui dans votre carrière, image de ces dieux, nous prêtez leur lumière, voyez et soutenez la juste fermeté que j'opposai toujours contre l'iniquité !
Zopire, Omar, Phanor, suite.
Zopire.
Eh bien ! Après six ans tu revois ta patrie, que ton bras défendit, que ton coeur a trahie. Ces murs sont encor pleins de tes premiers exploits. Déserteur de nos dieux, déserteur de nos lois, persécuteur nouveau de cette cité sainte, d'où vient que ton audace en profane l'enceinte ? Ministre d'un brigand qu'on dût exterminer, parle : que me veux-tu ?
Omar.
Je veux te pardonner. Le prophète d'un dieu, par pitié pour ton âge, pour tes malheurs passés, surtout pour ton courage, te présente une main qui pourrait t'écraser ; et j'apporte la paix qu'il daigne proposer.
Zopire.
Un vil séditieux prétend avec audace nous accorder la paix, et non demander grâce ! Souffrirez-vous, grands dieux ! qu'au gré de ses forfaits Mahomet nous ravisse ou nous rende la paix ? Et vous, qui vous chargez des volontés d'un traître, ne rougissez-vous point de servir un tel maître ? Ne l'avez-vous pas vu, sans honneur et sans biens, ramper au dernier rang des derniers citoyens ? Qu'alors il était loin de tant de renommée !
Omar.
à tes viles grandeurs ton âme accoutumée juge ainsi du mérite, et pèse les humains au poids que la fortune avait mis dans tes mains. Ne sais-tu pas encore, homme faible et superbe, que l'insecte insensible enseveli sous l'herbe, et l'aigle impérieux qui plane au haut du ciel, rentrent dans le néant aux yeux de l'éternel ? Les mortels sont égaux ; ce n'est point la naissance, c'est la seule vertu qui fait leur différence. Il est de ces esprits favorisés des cieux, qui sont tout par eux-même, et rien par leurs aïeux. Tel est l'homme, en un mot, que j'ai choisi pour maître ; lui seul dans l'univers a mérité de l'être ; tout mortel à sa loi doit un jour obéir, et j'ai donné l'exemple aux siècles à venir.
Zopire.
Je te connais, Omar : en vain ta politique vient m'étaler ici ce tableau fanatique : en vain tu peux ailleurs éblouir les esprits ; ce que ton peuple adore excite mes mépris. Bannis toute imposture, et d'un coup d'oeil plus sage regarde ce prophète à qui tu rends hommage ; vois l'homme en Mahomet ; conçois par quel degré tu fais monter aux cieux ton fantôme adoré. Enthousiaste ou fourbe, il faut cesser de l'être ; sers-toi de ta raison, juge avec moi ton maître : tu verras de chameaux un grossier conducteur, chez sa première épouse insolent imposteur, qui, sous le vain appât d'un songe ridicule, des plus vils des humains tente la foi crédule ; comme un séditieux à mes pieds amené, par quarante vieillards à l'exil condamné : trop léger châtiment qui l'enhardit au crime. De caverne en caverne il fuit avec Fatime. Ses disciples errants de cités en déserts, proscrits, persécutés, bannis, chargés de fers, promènent leur fureur, qu'ils appellent divine ; de leurs venins bientôt ils infectent Médine. Toi-même alors, toi-même, écoutant la raison, tu voulus dans sa source arrêter le poison. Je te vis plus heureux, et plus juste, et plus brave, attaquer le tyran dont je te vois l'esclave. S'il est un vrai prophète, osas-tu le punir ? S'il est un imposteur, oses-tu le servir ?
Omar.
Je voulus le punir quand mon peu de lumière méconnut ce grand homme entré dans la carrière : mais enfin, quand j'ai vu que Mahomet est né pour changer l'univers à ses pieds consterné ; quand mes yeux, éclairés du feu de son génie, le virent s'élever dans sa course infinie ; éloquent, intrépide, admirable en tout lieu, agir, parler, punir, ou pardonner en dieu ; j'associai ma vie à ses travaux immenses : des trônes, des autels en sont les récompenses. Je fus, je te l'avoue, aveugle comme toi. Ouvre les yeux, Zopire, et change ainsi que moi ; et, sans plus me vanter les fureurs de ton zèle, ta persécution si vaine et si cruelle, nos frères gémissants, notre dieu blasphémé, tombe aux pieds d'un héros par toi-même opprimé. Viens baiser cette main qui porte le tonnerre. Tu me vois après lui le premier de la terre ; le poste qui te reste est encore assez beau pour fléchir noblement sous ce maître nouveau. Vois ce que nous étions, et vois ce que nous sommes. Le peuple, aveugle et faible, est né pour les grands hommes, pour admirer, pour croire, et pour nous obéir. Viens régner avec nous, si tu crains de servir ; partage nos grandeurs au lieu de t'y soustraire ; et, las de l'imiter, fais trembler le vulgaire.
Zopire.
Ce n'est qu'à Mahomet, à ses pareils, à toi, que je prétends, Omar, inspirer quelque effroi. Tu veux que du sénat le shérif infidèle encense un imposteur, et couronne un rebelle ! Je ne te nierai point que ce fier séducteur n'ait beaucoup de prudence et beaucoup de valeur : je connais comme toi les talents de ton maître ; s'il était vertueux, c'est un héros peut-être : mais ce héros, Omar, est un traître, un cruel, et de tous les tyrans c'est le plus criminel. Cesse de m'annoncer sa trompeuse clémence ; le grand art qu'il possède est l'art de la vengeance. Dans le cour de la guerre un funeste destin le priva de son fils que fit périr ma main. Mon bras perça le fils, ma voix bannit le père ; ma haine est inflexible, ainsi que sa colère ; pour rentrer dans la Mecque, il doit m'exterminer, et le juste aux méchants ne doit point pardonner.
Omar.
Eh bien ! Pour te montrer que Mahomet pardonne, pour te faire embrasser l'exemple qu'il te donne, partage avec lui-même, et donne à tes tribus les dépouilles des rois que nous avons vaincus. Mets un prix à la paix, mets un prix à Palmire ; nos trésors sont à toi.
Zopire.
Tu penses me séduire, me vendre ici ma honte, et marchander la paix par ses trésors honteux, le prix de ses forfaits ? Tu veux que sous ses lois Palmire se remette ? Elle a trop de vertus pour être sa sujette ; et je veux l'arracher aux tyrans imposteurs, qui renversent les lois et corrompent les moeurs.
Omar.
Tu me parles toujours comme un juge implacable, qui sur son tribunal intimide un coupable. Pense et parle en ministre ; agis, traite avec moi comme avec l'envoyé d'un grand homme et d'un roi.
Zopire.
Qui l'a fait roi ? Qui l'a couronné ?
Omar.
La victoire. Ménage sa puissance, et respecte sa gloire. Aux noms de conquérant et de triomphateur, il veut joindre le nom de pacificateur, son armée est encore aux bords du Saïbare ; des murs où je suis né le siége se prépare ; sauvons, si tu m'en crois, le sang qui va couler : Mahomet veut ici te voir et te parler.
Zopire.
Lui ? Mahomet ?
Omar.
Lui-même ; il t'en conjure.
Zopire.
Traître ! Si de ces lieux sacrés j'étais l'unique maître, c'est en te punissant que j'aurais répondu.
Omar.
Zopire, j'ai pitié de ta fausse vertu. Mais puisqu'un vil sénat insolemment partage de ton gouvernement le fragile avantage, puisqu'il règne avec toi, je cours m'y présenter.
Zopire.
Je t'y suis ; nous verrons qui l'on doit écouter. Je défendrai mes lois, mes dieux, et ma patrie. Viens-y contre ma voix prêter ta voix impie au dieu persécuteur, effroi du genre humain, qu'un fourbe ose annoncer les armes à la main.
(à Phanor.)
toi, viens m'aider, Phanor, à repousser un traître : le souffrir parmi nous, et l'épargner, c'est l'être. Renversons ses desseins, confondons son orgueil ; préparons son supplice, ou creusons mon cercueil. Je vais, si le sénat m'écoute et me seconde, délivrer d'un tyran ma patrie et le monde.
Séide, Palmire.
Palmire.
Dans ma prison cruelle est-ce un dieu qui te guide ? Mes maux sont-ils finis ? Te revois-je, Séide ?
Séide.
ô charme de ma vie et de tous mes malheurs ! Palmire, unique objet qui m'a coûté des pleurs, depuis ce jour de sang qu'un ennemi barbare, près des camps du prophète, aux bords du Saïbare, vint arracher sa proie à mes bras tout sanglants ; qu'étendu loin de toi sur des corps expirants, mes cris mal entendus sur cette infâme rive invoquèrent la mort sourde à ma voix plaintive, ô ma chère Palmire, en quel gouffre d'horreur tes périls et ma perte ont abîmé mon coeur ! Que mes feux, que ma crainte, et mon impatience, accusaient la lenteur des jours de la vengeance ! Que je hâtais l'assaut si longtemps différé, cette heure de carnage, où, de sang enivré, je devais de mes mains brûler la ville impie où Palmire a pleuré sa liberté ravie ! Enfin de Mahomet les sublimes desseins, que n'ose approfondir l'humble esprit des humains, ont fait entrer Omar en ce lieu d'esclavage ; je l'apprends, et j'y vole. On demande un otage ; j'entre, je me présente ; on accepte ma foi, et je me rends captif, ou je meurs avec toi.
Palmire.
Séide, au moment même, avant que ta présence vînt de mon désespoir calmer la violence, je me jetais aux pieds de mon fier ravisseur. Vous voyez, ai-je dit, les secrets de mon coeur : ma vie est dans les camps dont vous m'avez tirée ; rendez-moi le seul bien dont je suis séparée. Mes pleurs, en lui parlant, ont arrosé ses pieds ; ses refus ont saisi mes esprits effrayés. J'ai senti dans mes yeux la lumière obscurcie : mon coeur, sans mouvement, sans chaleur, et sans vie, d'aucune ombre d'espoir n'était plus secouru ; tout finissait pour moi, quand Séide a paru.
Séide.
Quel est donc ce mortel insensible à tes larmes ?
Palmire.
C'est Zopire : il semblait touché de mes alarmes ; mais le cruel enfin vient de me déclarer que des lieux où je suis rien ne peut me tirer.
Séide.
Le barbare se trompe ; et Mahomet mon maître, et l'invincible Omar, et moi-même peut-être (car j'ose me nommer après ces noms fameux, pardonne à ton amant cet espoir orgueilleux), nous briserons ta chaîne, et tarirons tes larmes. Le dieu de Mahomet, protecteur de nos armes, le dieu dont j'ai porté les sacrés étendards, le dieu qui de Médine a détruit les remparts, renversera la Mecque à nos pieds abattue. Omar est dans la ville, et le peuple à sa vue n'a point fait éclater ce trouble et cette horreur qu'inspire aux ennemis un ennemi vainqueur ; au nom de Mahomet un grand dessein l'amène.
Palmire.
Mahomet nous chérit ; il briserait ma chaîne ; il unirait nos coeurs ; nos coeurs lui sont offerts : mais il est loin de nous, et nous sommes aux fers.
Palmire, Séide, Omar.
Omar.
Vos fers seront brisés, soyez pleins d'espérance ; le ciel vous favorise, et Mahomet s'avance.
Séide.
Lui ?
Palmire.
Notre auguste père ?
Omar.
Au conseil assemblé l'esprit de Mahomet par ma bouche a parlé. " Ce favori du dieu qui préside aux batailles, ce grand homme, ai-je dit, est né dans vos murailles. Il s'est rendu des rois le maître et le soutien, et vous lui refusez le rang de citoyen ! Vient-il vous enchaîner, vous perdre, vous détruire ? Il vient vous protéger, mais surtout vous instruire : il vient dans vos coeurs même établir son pouvoir. " plus d'un juge à ma voix a paru s'émouvoir ; les esprits s'ébranlaient : l'inflexible Zopire, qui craint de la raison l'inévitable empire, veut convoquer le peuple, et s'en faire un appui. On l'assemble ; j'y cours, et j'arrive avec lui : je parle aux citoyens, j'intimide, j'exhorte ; j'obtiens qu'à Mahomet on ouvre enfin la porte. Après quinze ans d'exil, il revoit ses foyers ; il entre accompagné des plus braves guerriers, d'Ali, d'Ammon, d'Hercide, et de sa noble élite ; il entre, et sur ses pas chacun se précipite ; chacun porte un regard, comme un coeur différent : l'un croit voir un héros, l'autre voir un tyran. Celui-ci le blasphème, et le menace encore ; cet autre est à ses pieds, les embrasse, et l'adore. Nous faisons retentir à ce peuple agité les noms sacrés de dieu, de paix, de liberté. De Zopire éperdu la cabale impuissante vomit en vain les feux de sa rage expirante. Au milieu de leurs cris, le front calme et serein, Mahomet marche en maître, et l'olive à la main : la trêve est publiée ; et le voici lui-même.
Mahomet, Omar, Ali, Hercide, Séide, Palmire, suite.
Mahomet.
Invincibles soutiens de mon pouvoir suprême, noble et sublime Ali, Morad, Hercide, Ammon, retournez vers ce peuple, instruisez-le en mon nom ; promettez, menacez ; que la vérité règne ; qu'on adore mon dieu, mais surtout qu'on le craigne. Vous, Séide, en ces lieux !
Séide.
ô mon père ! ô mon roi ! Le dieu qui vous inspire a marché devant moi. Prêt à mourir pour vous, prêt à tout entreprendre, j'ai prévenu votre ordre.
Mahomet.
Il eût fallu l'attendre. Qui fait plus qu'il ne doit ne sait point me servir. J'obéis à mon dieu ; vous, sachez m'obéir.
Palmire.
Ah ! Seigneur ! Pardonnez à son impatience. élevés près de vous dans notre tendre enfance, les mêmes sentiments nous animent tous deux : hélas ! Mes tristes jours sont assez malheureux ! Loin de vous, loin de lui, j'ai langui prisonnière ; mes yeux de pleurs noyés s'ouvraient à la lumière : empoisonneriez-vous l'instant de mon bonheur ?
Mahomet.
Palmire, c'est assez ; je lis dans votre coeur : que rien ne vous alarme, et rien ne vous étonne. Allez : malgré les soins de l'autel et du trône, mes yeux sur vos destins seront toujours ouverts ; je veillerai sur vous comme sur l'univers.
(à Séide.)
vous, suivez mes guerriers ; et vous, jeune Palmire, en servant votre dieu, ne craignez que Zopire.
Mahomet, Omar.
Mahomet.
Toi, reste, brave Omar : il est temps que mon coeur de ses derniers replis t'ouvre la profondeur. D'un siége encor douteux la lenteur ordinaire peut retarder ma course, et borner ma carrière : ne donnons point le temps aux mortels détrompés de rassurer leurs yeux de tant d'éclat frappés. Les préjugés, ami, sont les rois du vulgaire. Tu connais quel oracle et quel bruit populaire ont promis l'univers à l'envoyé d'un dieu, qui, reçu dans la Mecque, et vainqueur en tout lieu, entrerait dans ces murs en écartant la guerre : je viens mettre à profit les erreurs de la terre. Mais tandis que les miens, par de nouveaux efforts, de ce peuple inconstant font mouvoir les ressorts, de quel oeil revois-tu Palmire avec Séide ?
Omar.
Parmi tous ces enfants enlevés par Hercide, qui, formés sous ton joug, et nourris dans ta loi, n'ont de dieu que le tien, n'ont de père que toi, aucun ne te servit avec moins de scrupule, n'eut un coeur plus docile, un esprit plus crédule ; de tous tes musulmans ce sont les plus soumis.
Mahomet.
Cher Omar, je n'ai point de plus grands ennemis. Ils s'aiment, c'est assez.
Omar.
Blâmes-tu leurs tendresses ?
Mahomet.
Ah ! Connais mes fureurs et toutes mes faiblesses.
Omar.
Comment ?
Mahomet.
Tu sais assez quel sentiment vainqueur parmi mes passions règne au fond de mon coeur. Chargé du soin du monde, environné d'alarmes, je porte l'encensoir, et le sceptre, et les armes : ma vie est un combat, et ma frugalité asservit la nature à mon austérité : j'ai banni loin de moi cette liqueur traîtresse qui nourrit des humains la brutale mollesse : dans des sables brûlants, sur des rochers déserts, je supporte avec toi l'inclémence des airs : l'amour seul me console ; il est ma récompense, l'objet de mes travaux, l'idole que j'encense, le dieu de Mahomet ; et cette passion est égale aux fureurs de mon ambition. Je préfère en secret Palmire à mes épouses. Conçois-tu bien l'excès de mes fureurs jalouses, quand Palmire à mes pieds, par un aveu fatal, insulte à Mahomet, et lui donne un rival ?
Omar.
Et tu n'es pas vengé ?
Mahomet.
Juge si je dois l'être. Pour le mieux détester, apprends à le connaître. De mes deux ennemis apprends tous les forfaits : tous deux sont nés ici du tyran que je hais.
Omar.
Quoi ! Zopire...
Mahomet.
Est leur père : Hercide en ma puissance remit depuis quinze ans leur malheureuse enfance. J'ai nourri dans mon sein ces serpents dangereux ; déjà sans se connaître ils m'outragent tous deux. J'attisai de mes mains leurs feux illégitimes. Le ciel voulut ici rassembler tous les crimes. Je veux... leur père vient ; ses yeux lancent vers nous les regards de la haine, et les traits du courroux. Observe tout, Omar, et qu'avec son escorte le vigilant Hercide assiége cette porte. Reviens me rendre compte, et voir s'il faut hâter ou retenir les coups que je dois lui porter.
Zopire, Mahomet.
Zopire.
Ah ! quel fardeau cruel à ma douleur profonde ! Moi, recevoir ici cet ennemi du monde !
Mahomet.
Approche, et puisque enfin le ciel veut nous unir, vois Mahomet sans crainte, et parle sans rougir.
Zopire.
Je rougis pour toi seul, pour toi dont l'artifice a traîné ta patrie au bord du précipice ; pour toi de qui la main sème ici les forfaits, et fait naître la guerre au milieu de la paix. Ton nom seul parmi nous divise les familles, les époux, les parents, les mères et les filles ; et la trêve pour toi n'est qu'un moyen nouveau pour venir dans nos coeurs enfoncer le couteau. La discorde civile est partout sur ta trace. Assemblage inouï de mensonge et d'audace, tyran de ton pays, est-ce ainsi qu'en ce lieu tu viens donner la paix, et m'annoncer un dieu ?
Mahomet.
Si j'avais à répondre à d'autres qu'à Zopire, je ne ferais parler que le dieu qui m'inspire ; le glaive et l'alcoran, dans mes sanglantes mains, imposeraient silence au reste des humains ; ma voix ferait sur eux les effets du tonnerre, et je verrais leurs fronts attachés à la terre : mais je te parle en homme, et sans rien déguiser ; je me sens assez grand pour ne pas t'abuser. Vois quel est Mahomet : nous sommes seuls ; écoute : je suis ambitieux ; tout homme l'est, sans doute ; mais jamais roi, pontife, ou chef, ou citoyen, ne conçut un projet aussi grand que le mien. Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre, par les lois, par les arts, et surtout par la guerre ; le temps de l'Arabie est à la fin venu. Ce peuple généreux, trop longtemps inconnu, laissait dans ses déserts ensevelir sa gloire ; voici les jours nouveaux marqués pour la victoire. Vois du nord au midi l'univers désolé, la Perse encor sanglante, et son trône ébranlé, l'Inde esclave et timide, et l'Égypte abaissée, des murs de Constantin la splendeur éclipsée ; vois l'empire romain tombant de toutes parts, ce grand corps déchiré, dont les membres épars languissent dispersés sans honneur et sans vie : sur ces débris du monde élevons l'Arabie. Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers ; il faut un nouveau dieu pour l'aveugle univers. En Égypte Osiris, Zoroastre en Asie, chez les Crétois Minos, Numa dans l'Italie, à des peuples sans moeurs, et sans culte, et sans rois, donnèrent aisément d'insuffisantes lois. Je viens après mille ans changer ces lois grossières : j'apporte un joug plus noble aux nations entières : j'abolis les faux dieux ; et mon culte épuré de ma grandeur naissante est le premier degré. Ne me reproche point de tromper ma patrie ; je détruis sa faiblesse et son idolâtrie : sous un roi, sous un dieu, je viens la réunir ; et, pour la rendre illustre, il la faut asservir.
Zopire.
Voilà donc tes desseins ! C'est donc toi dont l'audace de la terre à ton gré prétend changer la face ! Tu veux, en apportant le carnage et l'effroi, commander aux humains de penser comme toi : tu ravages le monde, et tu prétends l'instruire. Ah ! si par des erreurs il s'est laissé séduire, si la nuit du mensonge a pu nous égarer, par quels flambeaux affreux veux-tu nous éclairer ? Quel droit as-tu reçu d'enseigner, de prédire, de porter l'encensoir, et d'affecter l'empire ?
Mahomet.
Le droit qu'un esprit vaste, et ferme en ses desseins, a sur l'esprit grossier des vulgaires humains.
Zopire.
Eh quoi ! Tout factieux qui pense avec courage doit donner aux mortels un nouvel esclavage ? Il a droit de tromper, s'il trompe avec grandeur ?
Mahomet.
Oui ; je connais ton peuple, il a besoin d'erreur ; ou véritable ou faux, mon culte est nécessaire. Que t'ont produit tes dieux ? Quel bien t'ont-ils pu faire ? Quels lauriers vois-tu croître au pied de leurs autels ? Ta secte obscure et basse avilit les mortels, énerve le courage, et rend l'homme stupide ; la mienne élève l'âme, et la rend intrépide : ma loi fait des héros.
Zopire.
Dis plutôt des brigands. Porte ailleurs tes leçons, l'école des tyrans ; va vanter l'imposture à Médine où tu règnes, où tes maîtres séduits marchent sous tes enseignes, où tu vois tes égaux à tes pieds abattus.
Mahomet.
Des égaux ! Dès longtemps Mahomet n'en a plus. Je fais trembler la Mecque, et je règne à Médine ; crois-moi, reçois la paix, si tu crains ta ruine.
Zopire.
La paix est dans ta bouche, et ton coeur en est loin : penses-tu me tromper ?
Mahomet.
Je n'en ai pas besoin. C'est le faible qui trompe, et le puissant commande. Demain j'ordonnerai ce que je te demande ; demain je puis te voir à mon joug asservi : aujourd'hui Mahomet veut être ton ami.
Zopire.
Nous amis ! Nous, cruel ! Ah ! Quel nouveau prestige ! Connais-tu quelque dieu qui fasse un tel prodige ?
Mahomet.
J'en connais un puissant, et toujours écouté, qui te parle avec moi.
Zopire.
Qui ?
Mahomet.
La nécessité, ton intérêt.
Zopire.
Avant qu'un tel noeud nous rassemble, les enfers et les cieux seront unis ensemble. L'intérêt est ton dieu, le mien est l'équité ; entre ces ennemis il n'est point de traité. Quel serait le ciment, réponds-moi, si tu l'oses, de l'horrible amitié qu'ici tu me proposes ? Réponds ; est-ce ton fils que mon bras te ravit ? Est-ce le sang des miens que ta main répandit ?
Mahomet.
Oui, ce sont tes fils même. Oui, connais un mystère dont seul dans l'univers je suis dépositaire : tu pleures tes enfants, ils respirent tous deux.
Zopire.
Ils vivraient ! Qu'as-tu dit ? ô ciel ! ô jour heureux ! Ils vivraient ! C'est de toi qu'il faut que je l'apprenne !
Mahomet.
élevés dans mon camp, tous deux sont dans ma chaîne.
Zopire.
Mes enfants dans tes fers ! Ils pourraient te servir !
Mahomet.
Mes bienfaisantes mains ont daigné les nourrir.
Zopire.
Quoi ! Tu n'as point sur eux étendu ta colère ?
Mahomet.
Je ne les punis point des fautes de leur père.
Zopire.
Achève, éclaircis-moi, parle, quel est leur sort ?
Mahomet.
Je tiens entre mes mains et leur vie et leur mort ; tu n'as qu'à dire un mot, et je t'en fais l'arbitre.
Zopire.
Moi, je puis les sauver ! à quel prix ? à quel titre ? Faut-il donner mon sang ? Faut-il porter leurs fers ?
Mahomet.
Non, mais il faut m'aider à tromper l'univers ; il faut rendre la Mecque, abandonner ton temple, de la crédulité donner à tous l'exemple, annoncer l'alcoran aux peuples effrayés, me servir en prophète, et tomber à mes pieds : je te rendrai ton fils, et je serai ton gendre.
Zopire.
Mahomet, je suis père, et je porte un coeur tendre. Après quinze ans d'ennuis, retrouver mes enfants, les revoir, et mourir dans leurs embrassements, c'est le premier des biens pour mon âme attendrie : mais s'il faut à ton culte asservir ma patrie, ou de ma propre main les immoler tous deux ; connais-moi, Mahomet, mon choix n'est pas douteux. Adieu.
Mahomet, seul.
Fier citoyen, vieillard inexorable, je serai plus que toi cruel, impitoyable.
Mahomet, Omar.
Omar.
Mahomet, il faut l'être, ou nous sommes perdus : les secrets des tyrans me sont déjà vendus. Demain la trêve expire, et demain l'on t'arrête : demain Zopire est maître, et fait tomber ta tête. La moitié du sénat vient de te condamner ; n'osant pas te combattre, on t'ose assassiner. Ce meurtre d'un héros, ils le nomment supplice ; et ce complot obscur, ils l'appellent justice.
Mahomet.
Ils sentiront la mienne ; ils verront ma fureur. La persécution fit toujours ma grandeur : Zopire périra.
Omar.
Cette tête funeste, en tombant à tes pieds, fera fléchir le reste. Mais ne perds point de temps.
Mahomet.
Mais, malgré mon courroux, je dois cacher la main qui va lancer les coups, et détourner de moi les soupçons du vulgaire.
Omar.
Il est trop méprisable.
Mahomet.
Il faut pourtant lui plaire ; et j'ai besoin d'un bras qui, par ma voix conduit, soit seul chargé du meurtre et m'en laisse le fruit.
Omar.
Pour un tel attentat je réponds de Séide.
Mahomet.
De lui ?
Omar.
C'est l'instrument d'un pareil homicide. Otage de Zopire, il peut seul aujourd'hui l'aborder en secret, et te venger de lui. Tes autres favoris, zélés avec prudence, pour s'exposer à tout ont trop d'expérience ; ils sont tous dans cet âge où la maturité fait tomber le bandeau de la crédulité ; il faut un coeur plus simple, aveugle avec courage, un esprit amoureux de son propre esclavage : la jeunesse est le temps de ces illusions. Séide est tout en proie aux superstitions ; c'est un lion docile à la voix qui le guide.
Mahomet.
Le frère de Palmire ?
Omar.
Oui, lui-même, oui, Séide, de ton fier ennemi le fils audacieux, de son maître offensé rival incestueux.
Mahomet.
Je déteste Séide, et son nom seul m'offense ; la cendre de mon fils me crie encor vengeance : mais tu connais l'objet de mon fatal amour ; tu connais dans quel sang elle a puisé le jour. Tu vois que dans ces lieux environnés d'abîmes je viens chercher un trône, un autel, des victimes ; qu'il faut d'un peuple fier enchanter les esprits, qu'il faut perdre Zopire, et perdre encor son fils. Allons, consultons bien mon intérêt, ma haine, l'amour, l'indigne amour, qui malgré moi m'entraîne, et la religion, à qui tout est soumis, et la nécessité, par qui tout est permis.
Séide, Palmire.
Palmire.
Demeure. Quel est donc ce secret sacrifice ? Quel sang a demandé l'éternelle justice ? Ne m'abandonne pas.
Séide.
Dieu daigne m'appeler : mon bras doit le servir, mon coeur va lui parler. Omar veut à l'instant, par un serment terrible, m'attacher de plus près à ce maître invincible : je vais jurer à Dieu de mourir pour sa loi, et mes seconds serments ne seront que pour toi.
Palmire.
D'où vient qu'à ce serment je ne suis point présente ? Si je t'accompagnais, j'aurais moins d'épouvante. Omar, ce même Omar, loin de me consoler, parle de trahison, de sang prêt à couler, des fureurs du sénat, des complots de Zopire. Les feux sont allumés, bientôt la trêve expire : le fer cruel est prêt ; on s'arme, on va frapper : le prophète l'a dit, il ne peut nous tromper. Je crains tout de Zopire, et je crains pour Séide.
Séide.
Croirai-je que Zopire ait un coeur si perfide ! Ce matin, comme otage à ses yeux présenté, j'admirais sa noblesse et son humanité ; je sentais qu'en secret une force inconnue enlevait jusqu'à lui mon âme prévenue : soit respect pour son nom, soit qu'un dehors heureux me cachât de son coeur les replis dangereux ; soit que, dans ces moments où je t'ai rencontrée, mon âme tout entière à son bonheur livrée, oubliant ses douleurs, et chassant tout effroi, ne connût, n'entendît, ne vît plus rien que toi ; je me trouvais heureux d'être auprès de Zopire. Je le hais d'autant plus qu'il m'avait su séduire : mais malgré le courroux dont je dois m'animer, qu'il est dur de haïr ceux qu'on voulait aimer !
Palmire.
Ah ! Que le ciel en tout a joint nos destinées ! Qu'il a pris soin d'unir nos âmes enchaînées ! Hélas, sans mon amour, sans ce tendre lien, sans cet instinct charmant qui joint mon coeur au tien, sans la religion que Mahomet m'inspire, j'aurais eu des remords en accusant Zopire.
Séide.
Laissons ces vains remords, et nous abandonnons à la voix de ce dieu qu'à l'envi nous servons. Je sors. Il faut prêter ce serment redoutable ; le dieu qui m'entendra nous sera favorable ; et le pontife-roi, qui veille sur nos jours, bénira de ses mains de si chastes amours. Adieu. Pour être à toi, je vais tout entreprendre.
Palmire.
D'un noir pressentiment je ne puis me défendre. Cet amour dont l'idée avait fait mon bonheur, ce jour tant souhaité n'est qu'un jour de terreur. Quel est donc ce serment qu'on attend de Séide ? Tout m'est suspect ici ; Zopire m'intimide. J'invoque Mahomet, et cependant mon coeur éprouve à son nom même une secrète horreur. Dans les profonds respects que ce héros m'inspire, je sens que je le crains presque autant que Zopire. Délivre-moi, grand dieu ! De ce trouble où je suis ? Craintive je te sers, aveugle je te suis : hélas ! Daigne essuyer les pleurs où je me noie !
Mahomet, Palmire.
Palmire.
C'est vous qu'à mon secours un dieu propice envoie, seigneur, Séide...
Mahomet.
Eh bien ! D'où vous vient cet effroi ? Et que craint-on pour lui, quand on est près de moi ?
Palmire.
ô ciel ! Vous redoublez la douleur qui m'agite. Quel prodige inouï ! Votre âme est interdite ; Mahomet est troublé pour la première fois.
Mahomet.
Je devrais l'être au moins du trouble où je vous vois. Est-ce ainsi qu'à mes yeux votre simple innocence ose avouer un feu qui peut-être m'offense ? Votre coeur a-t-il pu, sans être épouvanté, avoir un sentiment que je n'ai pas dicté ? Ce coeur que j'ai formé n'est-il plus qu'un rebelle, ingrat à mes bienfaits, à mes lois infidèle ?
Palmire.
Que dites-vous ? Surprise et tremblante à vos pieds, je baisse en frémissant mes regards effrayés. Eh quoi ! N'avez-vous pas daigné, dans ce lieu même, vous rendre à nos souhaits, et consentir qu'il m'aime ? Ces noeuds, ces chastes noeuds, que dieu formait en nous, sont un lien de plus qui nous attache à vous.
Mahomet.
Redoutez des liens formés par l'imprudence. Le crime quelquefois suit de près l'innocence. Le coeur peut se tromper ; l'amour et ses douceurs pourront coûter, Palmire, et du sang et des pleurs.
Palmire.
N'en doutez pas, mon sang coulerait pour Séide.
Mahomet.
Vous l'aimez à ce point ?
Palmire.
Depuis le jour qu'Hercide nous soumit l'un et l'autre à votre joug sacré, cet instinct tout-puissant, de nous-même ignoré, devançant la raison, croissant avec notre âge, du ciel, qui conduit tout, fut le secret ouvrage. Nos penchants, dites-vous, ne viennent que de lui. Dieu ne saurait changer : pourrait-il aujourd'hui réprouver un amour que lui-même il fit naître ? Ce qui fut innocent peut-il cesser de l'être ? Pourrais-je être coupable ?
Mahomet.
Oui. Vous devez trembler : attendez les secrets que je dois révéler ; attendez que ma voix veuille enfin vous apprendre ce qu'on peut approuver, ce qu'on doit se défendre. Ne croyez que moi seul.
Palmire.
Et qui croire que vous ? Esclave de vos lois, soumise, à vos genoux, mon coeur d'un saint respect ne perd point l'habitude.
Mahomet.
Trop de respect souvent mène à l'ingratitude.
Palmire.
Non, si de vos bienfaits je perds le souvenir, que Séide à vos yeux s'empresse à m'en punir !
Mahomet.
Séide !
Palmire.
Ah ! Quel courroux arme votre oeil sévère ?
Mahomet.
Allez, rassurez-vous, je n'ai point de colère. C'est éprouver assez vos sentiments secrets ; reposez-vous sur moi de vos vrais intérêts : je suis digne du moins de votre confiance. Vos destins dépendront de votre obéissance. Si j'eus soin de vos jours, si vous m'appartenez, méritez des bienfaits qui vous sont destinés. Quoi que la voix du ciel ordonne de Séide, affermissez ses pas où son devoir le guide : qu'il garde ses serments ; qu'il soit digne de vous.
Palmire.
N'en doutez point, mon père, il les remplira tous : je réponds de son coeur, ainsi que de moi-même. Séide vous adore encor plus qu'il ne m'aime ; il voit en vous son roi, son père, son appui : j'en atteste à vos pieds l'amour que j'ai pour lui. Je cours à vous servir encourager son âme.
Mahomet.
Quoi ! Je suis malgré moi confident de sa flamme ! Quoi ! Sa naïveté, confondant ma fureur, enfonce innocemment le poignard dans mon coeur ! Père, enfants, destinés au malheur de ma vie, race toujours funeste et toujours ennemie, vous allez éprouver, dans cet horrible jour, ce que peut à la fois ma haine et mon amour.
Mahomet, Omar.
Omar.
Enfin voici le temps et de ravir Palmire, et d'envahir la Mecque, et de punir Zopire : sa mort seule à tes pieds mettra nos citoyens ; tout est désespéré si tu ne le préviens. Le seul Séide ici te peut servir, sans doute ; il voit souvent Zopire, il lui parle, il l'écoute. Tu vois cette retraite, et cet obscur détour qui peut de ton palais conduire à son séjour ; là, cette nuit, Zopire à ses dieux fantastiques offre un encens frivole et des voeux chimériques. Là, Séide, enivré du zèle de ta loi, va l'immoler au dieu qui lui parle par toi.
Mahomet.
Qu'il l'immole, il le faut : il est né pour le crime : qu'il en soit l'instrument, qu'il en soit la victime. Ma vengeance, mes feux, ma loi, ma sûreté, l'irrévocable arrêt de la fatalité, tout le veut ; mais crois-tu que son jeune courage, nourri du fanatisme, en ait toute la rage ?
Omar.
Lui seul était formé pour remplir ton dessein. Palmire à te servir excite encor sa main. L'amour, le fanatisme, aveuglent sa jeunesse ; il sera furieux par excès de faiblesse.
Mahomet.
Par les noeuds des serments as-tu lié son coeur ?
Omar.
Du plus saint appareil la ténébreuse horreur, les autels, les serments, tout enchaîne Séide. J'ai mis un fer sacré dans sa main parricide, et la religion le remplit de fureur. Il vient.
Mahomet, Omar, Séide.
Mahomet.
Enfant d'un dieu qui parle à votre coeur, écoutez par ma voix sa volonté suprême : il faut venger son culte, il faut venger dieu même.
Séide.
Roi, pontife, et prophète, à qui je suis voué, maître des nations, par le ciel avoué, vous avez sur mon être une entière puissance ; éclairez seulement ma docile ignorance. Un mortel venger dieu !
Mahomet.
C'est par vos faibles mains qu'il veut épouvanter les profanes humains.
Séide.
Ah ! Sans doute ce dieu, dont vous êtes l'image, va d'un combat illustre honorer mon courage.
Mahomet.
Faites ce qu'il ordonne, il n'est point d'autre honneur. De ses décrets divins aveugle exécuteur, adorez et frappez ; vos mains seront armées par l'ange de la mort, et le dieu des armées.
Séide.
Parlez : quels ennemis vous faut-il immoler ? Quel tyran faut-il perdre ? Et quel sang doit couler ?
Mahomet.
Le sang du meurtrier que Mahomet abhorre, qui nous persécuta, qui nous poursuit encore, qui combattit mon dieu, qui massacra mon fils ; le sang du plus cruel de tous nos ennemis, de Zopire.
Séide.
De lui ! Quoi ! Mon bras...
Mahomet.
Téméraire, on devient sacrilége alors qu'on délibère. Loin de moi les mortels assez audacieux pour juger par eux-mêmes, et pour voir par leurs yeux ! Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire. Obéir en silence est votre seule gloire. Savez-vous qui je suis ? Savez-vous en quels lieux ma voix vous a chargé des volontés des cieux ? Si malgré ses erreurs et son idolâtrie, des peuples d'orient la Mecque est la patrie ; si ce temple du monde est promis à ma loi ; si dieu m'en a créé le pontife et le roi ; si la Mecque est sacrée, en savez-vous la cause ? Ibrahim y naquit, et sa cendre y repose : Ibrahim, dont le bras, docile à l'éternel, traîna son fils unique aux marches de l'autel, étouffant pour son dieu les cris de la nature. Et quand ce dieu par vous veut venger son injure, quand je demande un sang à lui seul adressé, quand dieu vous a choisi, vous avez balancé ! Allez, vil idolâtre, et né pour toujours l'être, indigne musulman, cherchez un autre maître. Le prix était tout prêt ; Palmire était à vous : mais vous bravez Palmire et le ciel en courroux. Lâche et faible instrument des vengeances suprêmes, les traits que vous portez vont tomber sur vous-mêmes ; fuyez, servez, rampez, sous mes fiers ennemis.
Séide.
Je crois entendre dieu ; tu parles : j'obéis.
Mahomet.
Obéissez, frappez : teint du sang d'un impie, méritez par sa mort une éternelle vie.
(à Omar.)
ne l'abandonne pas ; et, non loin de ces lieux, sur tous ses mouvements ouvre toujours les yeux.
Séide.
Immoler un vieillard de qui je suis l'otage, sans armes, sans défense, appesanti par l'âge ! N'importe ; une victime amenée à l'autel y tombe sans défense, et son sang plait au ciel. Enfin dieu m'a choisi pour ce grand sacrifice : j'en ai fait le serment ; il faut qu'il s'accomplisse. Venez à mon secours, ô vous, de qui le bras aux tyrans de la terre a donné le trépas ! Ajoutez vos fureurs à mon zèle intrépide ; affermissez ma main saintement homicide. Ange de Mahomet, ange exterminateur, mets ta férocité dans le fond de mon coeur ! Ah ! Que vois-je ?
Zopire, Séide.
Zopire.
à mes yeux tu te troubles, Séide ! Vois d'un oeil plus content le dessein qui me guide : otage infortuné, que le sort m'a remis, je te vois à regret parmi mes ennemis. La trêve a suspendu le moment du carnage ; ce torrent retenu peut s'ouvrir un passage : je ne t'en dis pas plus : mais mon coeur, malgré moi, a frémi des dangers assemblés près de toi. Cher Séide, en un mot, dans cette horreur publique, souffre que ma maison soit ton asile unique. Je réponds de tes jours ; ils me sont précieux ; ne me refuse pas.
Séide.
ô mon devoir ! ô cieux. Ah, Zopire ! Est-ce vous qui n'avez d'autre envie que de me protéger, de veiller sur ma vie ? Prêt à verser son sang, qu'ai-je ouï ? Qu'ai-je vu ? Pardonne, Mahomet, tout mon coeur s'est ému.
Zopire.
De ma pitié pour toi tu t'étonnes peut-être ; mais enfin je suis homme, et c'est assez de l'être pour aimer à donner des soins compatissants à des coeurs malheureux que l'on croit innocents. Exterminez, grands dieux, de la terre où nous sommes, quiconque avec plaisir répand le sang des hommes !
Séide.
Que ce langage est cher à mon coeur combattu ! L'ennemi de mon dieu connaît donc la vertu !
Zopire.
Tu la connais bien peu, puisque tu t'en étonnes. Mon fils, à quelle erreur, hélas ! Tu t'abandonnes ! Ton esprit, fasciné par les lois d'un tyran, pense que tout est crime hors d'être musulman. Cruellement docile aux leçons de ton maître, tu m'avais en horreur avant de me connaître ; avec un joug de fer, un affreux préjugé tient ton coeur innocent dans le piége engagé. Je pardonne aux erreurs où Mahomet t'entraîne ; mais peux-tu croire un dieu qui commande la haine ?
Séide.
Ah ! Je sens qu'à ce dieu je vais désobéir ; non, seigneur, non ; mon coeur ne saurait vous haïr.
Zopire, à part.
Hélas ! Plus je lui parle, et plus il m'intéresse ? Son âge, sa candeur, ont surpris ma tendresse. Se peut-il qu'un soldat de ce monstre imposteur ait trouvé malgré lui le chemin de mon coeur ?
(à Séide.)
quel es-tu ? De quel sang les dieux t'ont-ils fait naître ?
Séide.
Je n'ai point de parents, seigneur, je n'ai qu'un maître, que jusqu'à ce moment j'avais toujours servi, mais qu'en vous écoutant ma faiblesse a trahi.
Zopire.
Quoi ! Tu ne connais point de qui tu tiens la vie ?
Séide.
Son camp fut mon berceau ; son temple est ma patrie : je n'en connais point d'autre ; et, parmi ces enfants qu'en tribut à mon maître on offre tous les ans, nul n'a plus que Séide éprouvé sa clémence.
Zopire.
Je ne puis le blâmer de sa reconnaissance. Oui, les bienfaits, Séide, ont des droits sur un coeur. Ciel ! Pourquoi Mahomet fut-il son bienfaiteur ! Il t'a servi de père, aussi bien qu'à Palmire : d'où vient que tu frémis, et que ton coeur soupire ? Tu détournes de moi ton regard égaré ; de quelque grand remords tu sembles déchiré.
Séide.
Eh ! Qui n'en aurait pas dans ce jour effroyable !
Zopire.
Si tes remords sont vrais, ton coeur n'est plus coupable. Viens, le sang va couler ; je veux sauver le tien.
Séide.
Juste ciel ! Et c'est moi qui répandrais le sien ! ô serments ! ô Palmire ! ô vous, dieu des vengeances !
Zopire.
Remets-toi dans mes mains ; tremble, si tu balances ; pour la dernière fois, viens, ton sort en dépend.
Zopire, Séide, Omar, suite.
Omar, entrant avec précipitation.
Traître, que faites-vous ? Mahomet vous attend.
Séide.
Où suis-je ! ô ciel ! Où suis-je ! Et que dois-je résoudre ? D'un et d'autre côté je vois tomber la foudre. Où courir ? Où porter un trouble si cruel ? Où fuir ?
Omar.
Aux pieds du roi qu'a choisi l'éternel.
Séide.
Oui, j'y cours abjurer un serment que j'abhorre.
Zopire.
Ah, Séide ! Où vas-tu ? Mais il me fuit encore ; il sort désespéré, frappé d'un sombre effroi, et mon coeur qui le suit s'échappe loin de moi. Ses remords, ma pitié, son aspect, son absence, à mes sens déchirés font trop de violence. Suivons ses pas.
Zopire, Phanor.
Phanor.
Lisez ce billet important qu'un arabe en secret m'a donné dans l'instant.
Zopire.
Hercide ! Qu'ai-je lu ? Grands dieux ! Votre clémence répare-t-elle enfin soixante ans de souffrance ? Hercide veut me voir ! Lui, dont le bras cruel arracha mes enfants à ce sein paternel ! Ils vivent ! Mahomet les tient sous sa puissance, et Séide et Palmire ignorent leur naissance ! Mes enfants ! Tendre espoir, que je n'ose écouter ! Je suis trop malheureux, je crains de me flatter. Pressentiment confus, faut-il que je vous croie ? ô mon sang ! Où porter mes larmes et ma joie ? Mon coeur ne peut suffire à tant de mouvements ; je cours, et je suis prêt d'embrasser mes enfants. Je m'arrête, j'hésite, et ma douleur craintive prête à la voix du sang une oreille attentive. Allons. Voyons Hercide au milieu de la nuit ; qu'il soit sous cette voûte en secret introduit, au pied de cet autel, où les pleurs de ton maître ont fatigué les dieux, qui s'apaisent peut-être. Dieux, rendez-moi mes fils ! Dieux, rendez aux vertus deux coeurs nés généreux, qu'un traître a corrompus ! S'ils ne sont point à moi, si telle est ma misère, je les veux adopter, je veux être leur père.
Mahomet, Omar.
Omar.
Oui, de ce grand secret la trame est découverte ; ta gloire est en danger, ta tombe est entr'ouverte. Séide obéira : mais avant que son coeur, raffermi par ta voix, eût repris sa fureur, Séide a révélé cet horrible mystère.
Mahomet.
ô ciel !
Omar.
Hercide l'aime : il lui tient lieu de père.
Mahomet.
Eh bien ! Que pense Hercide ?
Omar.
Il paraît effrayé ; il semble pour Zopire avoir quelque pitié.
Mahomet.
Hercide est faible ; ami, le faible est bientôt traître. Qu'il tremble ! Il est chargé du secret de son maître. Je sais comme on écarte un témoin dangereux. Suis-je en tout obéi ?
Omar.
J'ai fait ce que tu veux.
Mahomet.
Préparons donc le reste. Il faut que dans une heure on nous traîne au supplice, ou que Zopire meure. S'il meurt, c'en est assez ; tout ce peuple éperdu adorera mon dieu, qui m'aura défendu. Voilà le premier pas ; mais sitôt que Séide aura rougi ses mains de ce grand homicide, réponds-tu qu'au trépas Séide soit livré ? Réponds-tu du poison qui lui fut préparé ?
Omar.
N'en doute point.
Mahomet.
Il faut que nos mystères sombres soient cachés dans la mort, et couverts de ses ombres. Mais tout prêt à frapper, prêt à percer le flanc dont Palmire a tiré la source de son sang, prends soin de redoubler son heureuse ignorance : épaississons la nuit qui voile sa naissance, pour son propre intérêt, pour moi, pour mon bonheur. Mon triomphe en tout temps est fondé sur l'erreur. Elle naquit en vain de ce sang que j'abhorre : on n'a point de parents alors qu'on les ignore. Les cris du sang, sa force, et ses impressions, des coeurs toujours trompés sont les illusions. La nature à mes yeux n'est rien que l'habitude ; celle de m'obéir fit son unique étude : je lui tiens lieu de tout. Qu'elle passe en mes bras, sur la cendre des siens, qu'elle ne connaît pas. Son coeur même en secret, ambitieux peut-être, sentira quelque orgueil à captiver son maître. Mais déjà l'heure approche où Séide en ces lieux doit m'immoler son père à l'aspect de ses dieux. Retirons-nous.
Omar.
Tu vois sa démarche égarée ; de l'ardeur d'obéir son âme est dévorée.
Mahomet, Omar, sur le devant, mais retirés de côté ; Séide, dans le fond.
Séide.
Il le faut donc remplir ce terrible devoir !
Mahomet.
Viens, et par d'autres coups assurons mon pouvoir.
(il sort avec Omar.)
Séide, seul.
à tout ce qu'ils m'ont dit je n'ai rien à répondre. Un mot de Mahomet suffit pour me confondre. Mais quand il m'accablait de cette sainte horreur, la persuasion n'a point rempli mon coeur. Si le ciel a parlé, j'obéirai sans doute ; mais quelle obéissance ! ô ciel ! Et qu'il en coûte !
Séide, Palmire.
Séide.
Palmire, que veux-tu ? Quel funeste transport ! Qui t'amène en ces lieux consacrés à la mort ?
Palmire.
Séide, la frayeur et l'amour sont mes guides ; mes pleurs baignent tes mains saintement homicides. Quel sacrifice horrible, hélas ! Faut-il offrir ? à Mahomet, à Dieu, tu vas donc obéir ?
Séide.
ô de mes sentiments souveraine adorée ! Parlez, déterminez ma fureur égarée ; éclairez mon esprit, et conduisez mon bras ; tenez-moi lieu d'un dieu que je ne comprends pas. Pourquoi m'a-t-il choisi ? Ce terrible prophète d'un ordre irrévocable est-il donc l'interprète !
Palmire.
Tremblons d'examiner. Mahomet voit nos coeurs, il entend nos soupirs, il observe mes pleurs. Chacun redoute en lui la divinité même, c'est tout ce que je sais ; le doute est un blasphème : et le dieu qu'il annonce avec tant de hauteur, Séide, est le vrai dieu, puisqu'il le rend vainqueur.
Séide.
Il l'est, puisque Palmire et le croit et l'adore. Mais mon esprit confus ne conçoit point encore comment ce dieu si bon, ce père des humains, pour un meurtre effroyable a réservé mes mains. Je ne le sais que trop que mon doute est un crime, qu'un prêtre sans remords égorge sa victime, que par la voix du ciel Zopire est condamné, qu'à soutenir ma loi j'étais prédestiné. Mahomet s'expliquait, il a fallu me taire ; et, tout fier de servir la céleste colère, sur l'ennemi de dieu je portais le trépas : un autre dieu, peut-être, a retenu mon bras. Du moins, lorsque j'ai vu ce malheureux Zopire, de ma religion j'ai senti moins l'empire. Vainement mon devoir au meurtre m'appelait ; à mon coeur éperdu l'humanité parlait. Mais avec quel courroux, avec quelle tendresse, Mahomet de mes sens accuse la faiblesse ! Avec quelle grandeur, et quelle autorité, sa voix vient d'endurcir ma sensibilité ! Que la religion est terrible et puissante ! J'ai senti la fureur en mon coeur renaissante ; Palmire, je suis faible, et du meurtre effrayé ; de ces saintes fureurs je passe à la pitié ; de sentiments confus une foule m'assiége : je crains d'être barbare, ou d'être sacrilége. Je ne me sens point fait pour être un assassin. Mais quoi ! Dieu me l'ordonne, et j'ai promis ma main ; j'en verse encor des pleurs de douleur et de rage. Vous me voyez, Palmire, en proie à cet orage, nageant dans le reflux des contrariétés, qui pousse et qui retient mes faibles volontés : c'est à vous de fixer mes fureurs incertaines : nos coeurs sont réunis par les plus fortes chaînes ; mais, sans ce sacrifice à mes mains imposé, le noeud qui nous unit est à jamais brisé ; ce n'est qu'à ce seul prix que j'obtiendrai Palmire.
Palmire.
Je suis le prix du sang du malheureux Zopire !
Séide.
Le ciel et Mahomet ainsi l'ont arrêté.
Palmire.
L'amour est-il donc fait pour tant de cruauté ?
Séide.
Ce n'est qu'au meurtrier que Mahomet te donne.
Palmire.
Quelle effroyable dot ! Mais si le ciel l'ordonne ? Si je sers et l'amour et la religion ?
Palmire.
Hélas !
Séide.
Vous connaissez la malédiction qui punit à jamais la désobéissance.
Palmire.
Si dieu même en tes mains a remis sa vengeance, s'il exige le sang que ta bouche a promis...
Séide.
Eh bien ! Pour être à toi que faut-il ?
Palmire.
Je frémis.
Séide.
Je t'entends ; son arrêt est parti de ta bouche.
Palmire.
Qui ? Moi ?
Séide.
Tu l'as voulu.
Palmire.
Dieu ! Quel arrêt farouche ! Que t'ai-je dit ?
Séide.
Le ciel vient d'emprunter ta voix ; c'est son dernier oracle, et j'accomplis ses lois. Voici l'heure où Zopire à cet autel funeste doit prier en secret des dieux que je déteste. Palmire, éloigne-toi.
Palmire.
Je ne puis te quitter. Ne vois point l'attentat qui va s'exécuter. Ces moments sont affreux. Va, fuis ; cette retraite est voisine des lieux qu'habite le prophète ! Va, dis-je.
Palmire.
Ce vieillard va donc être immolé !
Séide.
De ce grand sacrifice ainsi l'ordre est réglé ! Il le faut de ma main traîner sur la poussière, de trois coups dans le sein lui ravir la lumière, renverser dans son sang cet autel dispersé.
Palmire.
Lui, mourir par tes mains ! Tout mon sang s'est glacé. Le voici, juste ciel ! ...
(le fond du théâtre s'ouvre. On voit un autel.)
Zopire ; Séide, Palmire, sur le devant.
Zopire, près de l'autel.
ô dieux de ma patrie ! Dieux prêts à succomber sous une secte impie, c'est pour vous-même ici que ma débile voix vous implore aujourd'hui pour la dernière fois. La guerre va renaître, et ses mains meurtrières de cette faible paix vont briser les barrières. Dieux ! Si d'un scélérat vous respectez le sort...
Séide, à Palmire.
Tu l'entends qui blasphème ?
Zopire.
Accordez-moi la mort. Mais rendez-moi mes fils à mon heure dernière ; que j'expire en leurs bras ; qu'ils ferment ma paupière. Hélas ! Si j'en croyais mes secrets sentiments, si vos mains en ces lieux ont conduit mes enfants...
Palmire, à Séide.
Que dit-il ? Ses enfants !
Zopire.
ô mes dieux que j'adore ! Je mourrais du plaisir de les revoir encore. Arbitre des destins, daignez veiller sur eux ; qu'ils pensent comme moi, mais qu'ils soient plus heureux !
Séide.
Il court à ses faux dieux ! Frappons.
(il tire son poignard.)
Palmire.
Que vas-tu faire ? Hélas !
Séide.
Servir le ciel, te mériter, te plaire. Ce glaive à notre dieu vient d'être consacré ; que l'ennemi de dieu soit par lui massacré ! Marchons. Ne vois-tu pas dans ces demeures sombres ces traits de sang, ce spectre, et ces errantes ombres ?
Palmire.
Que dis-tu ?
Séide.
Je vous suis, ministres du trépas : vous me montrez l'autel ; vous conduisez mon bras. Allons.
Palmire.
Non ; trop d'horreur entre nous deux s'assemble. Demeure.
Séide.
Il n'est plus temps ; avançons : l'autel tremble.
Palmire.
Le ciel se manifeste, il n'en faut pas douter.
Séide.
Me pousse-t-il au meurtre, ou veut-il m'arrêter ? Du prophète de dieu la voix se fait entendre ; il me reproche un coeur trop flexible et trop tendre ; Palmire !
Palmire.
Eh bien ?
Séide.
Au ciel adressez tous vos voeux. Je vais frapper.
(il sort, et va derrière l'autel où est Zopire.)
Palmire.
Je meurs ! ô moment douloureux ! Quelle effroyable voix dans mon âme s'élève ! D'où vient que tout mon sang malgré moi se soulève ? Si le ciel veut un meurtre, est-ce à moi d'en juger ? Est-ce à moi de m'en plaindre, et de l'interroger ? J'obéis. D'où vient donc que le remords m'accable ? Ah ! Quel coeur sait jamais s'il est juste ou coupable ? Je me trompe, ou les coups sont portés cette fois ; j'entends les cris plaintifs d'une mourante voix. Séide... hélas ! ...
Séide revient d'un air égaré.
Où suis-je ? Et quelle voix m'appelle ? Je ne vois point Palmire ; un dieu m'a privé d'elle.
Palmire.
Eh quoi ! Méconnais-tu celle qui vit pour toi ?
Séide.
Où sommes-nous ?
Palmire.
Eh bien ! Cette effroyable loi, cette triste promesse est-elle enfin remplie ?
Séide.
Que me dis-tu ?
Palmire.
Zopire a-t-il perdu la vie ?
Séide.
Qui ? Zopire ?
Palmire.
Ah ! Grand dieu ! Dieu de sang altéré, ne persécutez point son esprit égaré. Fuyons d'ici.
Séide.
Je sens que mes genoux s'affaissent.
(il s'assied.)
ah ! Je revois le jour, et mes forces renaissent. Quoi ! C'est vous ?
Palmire.
Qu'as-tu fait ?
Séide, se relevant.
Moi ! Je viens d'obéir... d'un bras désespéré je viens de le saisir. Par ses cheveux blanchis j'ai traîné ma victime. ô ciel ! Tu l'as voulu ! Peux-tu vouloir un crime ? Tremblant, saisi d'effroi, j'ai plongé dans son flanc ce glaive consacré qui dut verser son sang. J'ai voulu redoubler ; ce vieillard vénérable a jeté dans mes bras un cri si lamentable ! La nature a tracé dans ses regards mourants un si grand caractère, et des traits si touchants ! ... de tendresse et d'effroi mon âme s'est remplie, et, plus mourant que lui, je déteste ma vie.
Palmire.
Fuyons vers Mahomet qui doit nous protéger : près de ce corps sanglant vous êtes en danger. Suivez-moi.
Séide.
Je ne puis. Je me meurs. Ah ! Palmire ! ...
Palmire.
Quel trouble épouvantable à mes yeux le déchire !
Séide, en pleurant.
Ah ! Si tu l'avais vu, le poignard dans le sein, s'attendrir à l'aspect de son lâche assassin ! Je fuyais. Croirais-tu que sa voix affaiblie pour m'appeler encore a ranimé sa vie ? Il retirait ce fer de ses flancs malheureux. Hélas ! Il m'observait d'un regard douloureux. " cher Séide, a-t-il dit, infortuné Séide ! " cette voix, ces regards, ce poignard homicide, ce vieillard attendri, tout sanglant à mes pieds, poursuivent devant toi mes regards effrayés. Qu'avons-nous fait ?
Palmire.
On vient, je tremble pour ta vie. Fuis au nom de l'amour et du noeud qui nous lie.
Séide.
Va, laisse-moi. Pourquoi cet amour malheureux m'a-t-il pu commander ce sacrifice affreux ? Non, cruelle ! Sans toi, sans ton ordre suprême, je n'aurais pu jamais obéir au ciel même. De quel reproche horrible oses-tu m'accabler ! Hélas ! Plus que le tien mon coeur se sent troubler. Cher amant, prends pitié de Palmire éperdue !
Séide.
Palmire ! Quel objet vient effrayer ma vue ?
(Zopire paraît, appuyé sur l'autel, après s'être relevé derrière cet autel où il a reçu le coup.)
c'est cet infortuné luttant contre la mort, qui vers nous tout sanglant se traîne avec effort.
Séide.
Eh quoi ! Tu vas à lui ?
Palmire.
De remords dévorée, je cède à la pitié dont je suis déchirée. Je n'y puis résister ; elle entraîne mes sens.
Zopire, avançant et soutenu par elle.
Hélas ! Servez de guide à mes pas languissants !
(il s'assied.)
Séide, ingrat ! C'est toi qui m'arraches la vie ! Tu pleures ! Ta pitié succède à ta furie !
Zopire, Séide, Palmire, Phanor.
Phanor.
Ciel ! Quels affreux objets se présentent à moi !
Zopire.
Si je voyais Hercide ! ... ah ! Phanor, est-ce toi ? Voilà mon assassin.
Phanor.
ô crime ! Affreux mystère ! Assassin malheureux, connaissez votre père !
Séide.
Qui ?
Palmire.
Lui ?
Séide.
Mon père ?
Zopire.
ô ciel !
Phanor.
Hercide est expirant : il me voit, il m'appelle, il s'écrie en mourant : " s'il en est encor temps, préviens un parricide ; cours arracher ce fer à la main de Séide. Malheureux confident d'un horrible secret, je suis puni, je meurs des mains de Mahomet : cours, hâte-toi d'apprendre au malheureux Zopire que Séide est son fils, et frère de Palmire. "
Séide.
Vous !
Palmire.
Mon frère ?
Zopire.
ô mes fils ! ô nature ! ô mes dieux ! Vous ne me trompiez pas quand vous parliez pour eux. Vous m'éclairiez sans doute. Ah ! Malheureux Séide ! Qui t'a pu commander cet affreux homicide ?
Séide, se jetant à genoux.
L'amour de mon devoir et de ma nation, et ma reconnaissance, et ma religion ; tout ce que les humains ont de plus respectable m'inspira des forfaits le plus abominable. Rendez, rendez ce fer à ma barbare main.
Palmire, à genoux, arrêtant le bras de Séide.
Ah, mon père ! Ah, seigneur ! Plongez-le dans mon sein. J'ai seule à ce grand crime encouragé Séide ; l'inceste était pour nous le prix du parricide.
Séide.
Le ciel n'a point pour nous d'assez grands châtiments. Frappez vos assassins.
Zopire, en les embrassant.
J'embrasse mes enfants. Le ciel voulut mêler, dans les maux qu'il m'envoie, le comble des horreurs au comble de la joie. Je bénis mon destin ; je meurs, mais vous vivez. ô vous, qu'en expirant mon coeur a retrouvés, Séide, et vous, Palmire, au nom de la nature, par ce reste de sang qui sort de ma blessure, par ce sang paternel, par vous, par mon trépas, vengez-vous, vengez-moi ; mais ne vous perdez pas. L'heure approche, mon fils, où la trêve rompue laissait à mes desseins une libre étendue : les dieux de tant de maux ont pris quelque pitié ; le crime de tes mains n'est commis qu'à moitié. Le peuple avec le jour en ces lieux va paraître ; mon sang va les conduire ; ils vont punir un traître. Attendons ces moments.
Séide.
Ah ! Je cours de ce pas vous immoler ce monstre, et hâter mon trépas ; me punir, vous venger.
Zopire, Séide, Palmire, Phanor, Omar, suite.
Omar.
Qu'on arrête Séide ! Secourez tous Zopire ; enchaînez l'homicide. Mahomet n'est venu que pour venger les lois.
Zopire.
Ciel ! Quel comble du crime ! Et qu'est-ce que je vois ?
Séide.
Mahomet me punir ?
Palmire.
Eh quoi ! Tyran farouche, après ce meurtre horrible ordonné par ta bouche !
Omar.
On n'a rien ordonné.
Séide.
Va, j'ai bien mérité cet exécrable prix de ma crédulité.
Omar.
Soldats, obéissez.
Palmire.
Non ; arrêtez. Perfide !
Omar.
Madame, obéissez, si vous aimez Séide. Mahomet vous protége, et son juste courroux, prêt à tout foudroyer, peut s'arrêter par vous. Auprès de votre roi, madame, il faut me suivre.
Palmire.
Grand dieu ! De tant d'horreurs que la mort me délivre !
(on emmène Palmire et Séide.)
Zopire, à Phanor.
On les enlève ! ô ciel ! ô père malheureux ! Le coup qui m'assassine est cent fois moins affreux.
Phanor.
Déjà le jour renaît ; tout le peuple s'avance ; on s'arme, on vient à vous, on prend votre défense.
Zopire.
Quoi ! Séide est mon fils !
Phanor.
N'en doutez point.
Zopire.
Hélas ! ô forfaits ! ô nature ! ... allons, soutiens mes pas, je meurs. Sauvez, grands dieux ! De tant de barbarie mes deux enfants que j'aime, et qui m'ôtent la vie.
Mahomet, Omar ; suite, dans le fond.
Omar.
Zopire est expirant, et ce peuple éperdu levait déjà son front dans la poudre abattu. Tes prophètes et moi, que ton esprit inspire, nous désavouons tous le meurtre de Zopire. Ici, nous l'annonçons à ce peuple en fureur comme un coup du très-haut qui s'arme en ta faveur ; là, nous en gémissons ; nous promettons vengeance : nous vantons ta justice, ainsi que ta clémence. Partout on nous écoute, on fléchit à ton nom ; et ce reste importun de la sédition n'est qu'un bruit passager de flots après l'orage, dont le courroux mourant frappe encor le rivage quand la sérénité règne aux plaines du ciel.
Mahomet.
Imposons à ces flots un silence éternel. As-tu fait des remparts approcher mon armée ?
Omar.
Elle a marché la nuit vers la ville alarmée ; Osman la conduisait par de secrets chemins.
Mahomet.
Faut-il toujours combattre, ou tromper les humains ! Séide ne sait point qu'aveugle en sa furie il vient d'ouvrir le flanc dont il reçut la vie ?
Omar.
Qui pourrait l'en instruire ? Un éternel oubli tient avec ce secret Hercide enseveli : Séide va le suivre, et son trépas commence. J'ai détruit l'instrument qu'employa ta vengeance. Tu sais que dans son sang ses mains ont fait couler le poison qu'en sa coupe on avait su mêler. Le châtiment sur lui tombait avant le crime ; et tandis qu'à l'autel il traînait sa victime, tandis qu'au sein d'un père il enfonçait son bras, dans ses veines, lui-même, il portait son trépas. Il est dans la prison, et bientôt il expire. Cependant en ces lieux j'ai fait garder Palmire. Palmire à tes desseins va même encor servir : croyant sauver Séide, elle va t'obéir. Je lui fais espérer la grâce de Séide. Le silence est encor sur sa bouche timide ; son coeur toujours docile, et fait pour t'adorer, en secret seulement n'osera murmurer. Législateur, prophète, et roi dans ta patrie, Palmire achèvera le bonheur de ta vie. Tremblante, inanimée, on l'amène à tes yeux.
Mahomet.
Va rassembler mes chefs, et revole en ces lieux.
Mahomet, Palmire ; suite de Palmire et de Mahomet.
Palmire.
Ciel ! Où suis-je ? Ah, grand dieu !
Mahomet.
Soyez moins consternée ; j'ai du peuple et de vous pesé la destinée, le grand événement qui vous remplit d'effroi, Palmire, est un mystère entre le ciel et moi. De vos indignes fers à jamais dégagée, vous êtes en ces lieux libre, heureuse, et vengée. Ne pleurez point Séide, et laissez à mes mains le soin de balancer le destin des humains. Ne songez plus qu'au vôtre ; et si vous m'êtes chère, si Mahomet sur vous jeta des yeux de père, sachez qu'un sort plus noble, un titre encor plus grand, si vous le méritez, peut-être vous attend. Portez vos yeux hardis au faîte de la gloire ; de Séide et du reste étouffez la mémoire : vos premiers sentiments doivent tous s'effacer à l'aspect des grandeurs où vous n'osiez penser. Il faut que votre coeur à mes bontés réponde, et suive en tout mes lois, lorsque j'en donne au monde.
Palmire.
Qu'entends-je ? Quelles lois, ô ciel ! Et quels bienfaits ! Imposteur teint de sang, que j'abjure à jamais, bourreau de tous les miens, va, ce dernier outrage manquait à ma misère, et manquait à ta rage. Le voilà donc, grand dieu ! Ce prophète sacré, ce roi que je servis, ce dieu que j'adorai ! Monstre, dont les fureurs et les complots perfides de deux coeurs innocents ont fait deux parricides ; de ma faible jeunesse infâme séducteur, tout souillé de mon sang, tu prétends à mon coeur ? Mais tu n'as pas encore assuré ta conquête ; le voile est déchiré, la vengeance s'apprête. Entends-tu ces clameurs ? Entends-tu ces éclats ? Mon père te poursuit des ombres du trépas. Le peuple se soulève ; on s'arme en ma défense ; leurs bras vont à ta rage arracher l'innocence. Puissé-je de mes mains te déchirer le flanc, voir mourir tous les tiens, et nager dans leur sang ! Puissent la Mecque ensemble, et Médine, et l'Asie, punir tant de fureur et tant d'hypocrisie ? Que le monde, par toi séduit et ravagé, rougisse de ses fers, les brise, et soit vengé ! Que ta religion, qui fonda l'imposture, soit l'éternel mépris de la race future ! Que l'enfer, dont tes cris menaçaient tant de fois quiconque osait douter de tes indignes lois ; que l'enfer, que ces lieux de douleur et de rage, pour toi seul préparés, soient ton juste partage ! Voilà les sentiments qu'on doit à tes bienfaits, l'hommage, les serments, et les voeux que je fais !
Mahomet.
Je vois qu'on m'a trahi ; mais quoi qu'il en puisse être, et qui que vous soyez, fléchissez sous un maître. Apprenez que mon coeur...
Mahomet, Palmire, Omar, Ali, suite.
Omar.
On sait tout, Mahomet : Hercide en expirant révéla ton secret. Le peuple en est instruit ; la prison est forcée ; tout s'arme, tout s'émeut : une foule insensée, élevant contre toi ses hurlements affreux, porte le corps sanglant de son chef malheureux. Séide est à leur tête ; et, d'une voix funeste, les excite à venger ce déplorable reste. Ce corps, souillé de sang, est l'horrible signal qui fait courir ce peuple à ce combat fatal. Il s'écrie en pleurant : " je suis un parricide ! " la douleur le ranime, et la rage le guide. Il semble respirer pour se venger de toi. On déteste ton dieu, tes prophètes, ta loi. Ceux même qui devaient dans la Mecque alarmée faire ouvrir, cette nuit, la porte à ton armée, de la fureur commune avec zèle enivrés, viennent lever sur toi leurs bras désespérés. On n'entend que les cris de mort et de vengeance.
Palmire.
Achève, juste ciel ! Et soutiens l'innocence. Frappe.
Mahomet, à Omar.
Eh bien ! Que crains-tu ?
Omar.
Tu vois quelques amis, qui contre les dangers comme moi raffermis, mais vainement armés contre un pareil orage, viennent tous à tes pieds mourir avec courage.
Mahomet.
Seul je les défendrai. Rangez-vous près de moi, et connaissez enfin qui vous avez pour roi.
Mahomet, Omar, sa suite, d'un côté ; Séide et le peuple, de l'autre ; Palmire, au milieu.
Séide, un poignard à la main, mais déjà affaibli par le poison.
Peuple, vengez mon père, et courez à ce traître.
Mahomet.
Peuple, né pour me suivre, écoutez votre maître.
Séide.
N'écoutez point ce monstre, et suivez-moi... grands dieux ! Quel nuage épaissi se répand sur mes yeux !
(il avance, il chancelle.)
frappons... ciel ! Je me meurs.
Mahomet.
Je triomphe.
Palmire, courant à lui.
Ah, mon frère ! N'auras-tu pu verser que le sang de ton père ?
Séide.
Avançons. Je ne puis... quel dieu vient m'accabler ?
(il tombe entre les bras des siens.)
Mahomet.
Ainsi tout téméraire à mes yeux doit trembler. Incrédules esprits, qu'un zèle aveugle inspire, qui m'osez blasphémer, et qui vengez Zopire, ce seul bras que la terre apprit à redouter, ce bras peut vous punir d'avoir osé douter. Dieu qui m'a confié sa parole et sa foudre, si je me veux venger, va vous réduire en poudre. Malheureux ! Connaissez son prophète et sa loi, et que ce dieu soit juge entre Séide et moi. De nous deux, à l'instant, que le coupable expire !
Palmire.
Mon frère ! Eh quoi ! Sur eux ce monstre a tant d'empire ! Ils demeurent glacés, ils tremblent à sa voix. Mahomet, comme un dieu, leur dicte encor ses lois : et toi, Séide, aussi ! Séide, entre les bras des siens. Le ciel punit ton frère. Mon crime était horrible autant qu'involontaire ; en vain la vertu même habitait dans mon coeur. Toi, tremble, scélérat ! Si dieu punit l'erreur, vois quel foudre il prépare aux artisans des crimes : tremble ; son bras s'essaie à frapper ses victimes. Détournez d'elle, ô dieu ! Cette mort qui me suit !
Palmire.
Non, peuple, ce n'est point un dieu qui le poursuit ; non ; le poison sans doute...
Mahomet, en l'interrompant, et s'adressant au peuple.
Apprenez, infidèles, à former contre moi des trames criminelles : aux vengeances des cieux reconnaissez mes droits. La nature et la mort ont entendu ma voix. La mort, qui m'obéit, qui, prenant ma défense, sur ce front pâlissant a tracé ma vengeance ; la mort est, à vos yeux, prête à fondre sur vous. Ainsi mes ennemis sentiront mon courroux ; ainsi je punirai les erreurs insensées, les révoltes du coeur, et les moindres pensées. Si ce jour luit pour vous, ingrats, si vous vivez, rendez grâce au pontife à qui vous le devez. Fuyez, courez au temple apaiser ma colère.
(le peuple se retire.)
Palmire, revenant à elle.
Arrêtez. Le barbare empoisonna mon frère. Monstre, ainsi son trépas t'aura justifié ! à force de forfaits tu t'es déifié. Malheureux assassin de ma famille entière, ôte-moi de tes mains ce reste de lumière. ô frère ! ô triste objet d'un amour plein d'horreurs ! Que je te suive au moins !
(elle se jette sur le poignard de son frère, et s'en frappe.)
Mahomet.
Qu'on l'arrête !
Palmire.
Je meurs. Je cesse de te voir, imposteur exécrable. Je me flatte, en mourant, qu'un dieu plus équitable réserve un avenir pour les coeurs innocents. Tu dois régner ; le monde est fait pour les tyrans.
Mahomet.
Elle m'est enlevée... ah ! Trop chère victime ! Je me vois arracher le seul prix de mon crime. De ses jours pleins d'appas détestable ennemi, vainqueur et tout-puissant, c'est moi qui suis puni. Il est donc des remords ! ô fureur ! ô justice ! Mes forfaits dans mon coeur ont donc mis mon supplice ! Dieu, que j'ai fait servir au malheur des humains, adorable instrument de mes affreux desseins, toi que j'ai blasphémé, mais que je crains encore, je me sens condamné, quand l'univers m'adore. Je brave en vain les traits dont je me sens frapper. J'ai trompé les mortels, et ne puis me tromper. Père, enfants malheureux, immolés à ma rage, vengez la terre et vous, et le ciel que j'outrage. Arrachez-moi ce jour, et ce perfide coeur, ce coeur né pour haïr, qui brûle avec fureur.
(à Omar.)
et toi, de tant de honte étouffe la mémoire ; cache au moins ma faiblesse, et sauve encor ma gloire : je dois régir en dieu l'univers prévenu ; mon empire est détruit si l'homme est reconnu.
ou Mahomet le prophète
ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
La scène est à la Mecque.
Zopire, Phanor.
Zopire.
Qui ? Moi, baisser les yeux devant ses faux prodiges ! Moi, de ce fanatique encenser les prestiges ! L'honorer dans la Mecque après l'avoir banni ! Non. Que des justes dieux Zopire soit puni si tu vois cette main, jusqu'ici libre et pure, caresser la révolte et flatter l'imposture !
Phanor.
Nous chérissons en vous ce zèle paternel du chef auguste et saint du sénat d'Ismaël ; mais ce zèle est funeste ; et tant de résistance, sans lasser Mahomet, irrite sa vengeance. Contre ses attentats vous pouviez autrefois lever impunément le fer sacré des lois, et des embrasements d'une guerre immortelle étouffer sous vos pieds la première étincelle. Mahomet citoyen ne parut à vos yeux qu'un novateur obscur, un vil séditieux : aujourd'hui, c'est un prince ; il triomphe, il domine ; imposteur à la Mecque, et prophète à Médine, il sait faire adorer à trente nations tous ces mêmes forfaits qu'ici nous détestons. Que dis-je ? En ces murs même une troupe égarée, des poisons de l'erreur avec zèle enivrée, de ses miracles faux soutient l'illusion, répand le fanatisme et la sédition, appelle son armée, et croit qu'un dieu terrible l'inspire, le conduit, et le rend invincible. Tous nos vrais citoyens avec vous sont unis ; mais les meilleurs conseils sont-ils toujours suivis ? L'amour des nouveautés, le faux zèle, la crainte, de la Mecque alarmée ont désolé l'enceinte ; et ce peuple, en tout temps chargé de vos bienfaits, crie encore à son père, et demande la paix.
Zopire.
La paix avec ce traître ! Ah ! Peuple sans courage, n'en attendez jamais qu'un horrible esclavage : allez, portez en pompe, et servez à genoux l'idole dont le poids va vous écraser tous. Moi, je garde à ce fourbe une haine éternelle ; de mon coeur ulcéré la plaie est trop cruelle : lui-même a contre moi trop de ressentiments. Le cruel fit périr ma femme et mes enfants : et moi, jusqu'en son camp j'ai porté le carnage ; la mort de son fils même honora mon courage. Les flambeaux de la haine entre nous allumés jamais des mains du temps ne seront consumés.
Phanor.
Ne les éteignez point, mais cachez-en la flamme ; immolez au public les douleurs de votre âme. Quand vous verrez ces lieux par ses mains ravagés, vos malheureux enfants seront-ils mieux vengés ? Vous avez tout perdu, fils, frère, épouse, fille ; ne perdez point l'état : c'est là votre famille.
Zopire.
On ne perd les états que par timidité.
Phanor.
On périt quelquefois par trop de fermeté.
Zopire.
Périssons, s'il le faut.
Phanor.
Ah ! Quel triste courage, quand vous touchez au port, vous expose au naufrage ? Le ciel, vous le voyez, a remis en vos mains de quoi fléchir encor ce tyran des humains. Cette jeune Palmire en ses camps élevée, dans vos derniers combats par vous-même enlevée, semble un ange de paix descendu parmi nous, qui peut de Mahomet apaiser le courroux. Déjà par ses hérauts il l'a redemandée.
Zopire.
Tu veux qu'à ce barbare elle soit accordée ? Tu veux que d'un si cher et si noble trésor ses criminelles mains s'enrichissent encor ? Quoi ! Lorsqu'il nous apporte et la fraude et la guerre, lorsque son bras enchaîne et ravage la terre, les plus tendres appas brigueront sa faveur, et la beauté sera le prix de la fureur ! Ce n'est pas qu'à mon âge, aux bornes de ma vie, je porte à Mahomet une honteuse envie ; ce coeur triste et flétri, que les ans ont glacé, ne peut sentir les feux d'un désir insensé. Mais soit qu'en tous les temps un objet né pour plaire arrache de nos voeux l'hommage involontaire ; soit que, privé d'enfants, je cherche à dissiper cette nuit de douleurs qui vient m'envelopper ; je ne sais quel penchant pour cette infortunée remplit le vide affreux de mon âme étonnée. Soit faiblesse ou raison, je ne puis sans horreur la voir aux mains d'un monstre, artisan de l'erreur. Je voudrais qu'à mes voeux heureusement docile, elle-même en secret pût chérir cet asile ; je voudrais que son coeur, sensible à mes bienfaits, détestât Mahomet autant que je le hais. Elle veut me parler sous ces sacrés portiques, non loin de cet autel de nos dieux domestiques ; elle vient, et son front, siége de la candeur, annonce en rougissant les vertus de son coeur.
Zopire, Palmire.
Zopire.
Jeune et charmant objet dont le sort de la guerre, propice à ma vieillesse, honora cette terre, vous n'êtes point tombée en de barbares mains ; tout respecte avec moi vos malheureux destins, votre âge, vos beautés, votre aimable innocence. Parlez ; et s'il me reste encor quelque puissance, de vos justes désirs si je remplis les voeux, ces derniers de mes jours seront des jours heureux.
Palmire.
Seigneur, depuis deux mois sous vos lois prisonnière, je dus à mes destins pardonner ma misère ; vos généreuses mains s'empressent d'effacer les larmes que le ciel me condamne à verser. Par vous, par vos bienfaits, à parler enhardie, c'est de vous que j'attends le bonheur de ma vie. Aux voeux de Mahomet j'ose ajouter les miens : il vous a demandé de briser mes liens ; puissiez-vous l'écouter ! Et puissé-je lui dire qu'après le ciel et lui je dois tout à Zopire !
Zopire.
Ainsi de Mahomet vous regrettez les fers, ce tumulte des camps, ces horreurs des déserts, cette patrie errante, au trouble abandonnée ?
Palmire.
La patrie est aux lieux où l'âme est enchaînée. Mahomet a formé mes premiers sentiments, et ses femmes en paix guidaient mes faibles ans : leur demeure est un temple où ces femmes sacrées lèvent au ciel des mains de leur maître adorées. Le jour de mon malheur, hélas ! fut le seul jour où le sort des combats a troublé leur séjour : seigneur, ayez pitié d'une âme déchirée, toujours présente aux lieux dont je suis séparée.
Zopire.
J'entends : vous espérez partager quelque jour de ce maître orgueilleux et la main et l'amour.
Palmire.
Seigneur, je le révère, et mon âme tremblante croit voir dans Mahomet un dieu qui m'épouvante. Non, d'un si grand hymen mon coeur n'est point flatté ; tant d'éclat convient mal à tant d'obscurité.
Zopire.
Ah ! Qui que vous soyez, il n'est point né peut-être pour être votre époux, encor moins votre maître ; et vous semblez d'un sang fait pour donner des lois à l'arabe insolent qui marche égal aux rois.
Palmire.
Nous ne connaissons point l'orgueil de la naissance ; sans parents, sans patrie, esclaves dès l'enfance, dans notre égalité nous chérissons nos fers ; tout nous est étranger, hors le dieu que je sers.
Zopire.
Tout vous est étranger ! Cet état peut-il plaire ? Quoi ! Vous servez un maître, et n'avez point de père ? Dans mon triste palais, seul et privé d'enfants, j'aurais pu voir en vous l'appui de mes vieux ans ; le soin de vous former des destins plus propices eût adouci des miens les longues injustices. Mais non, vous abhorrez ma patrie et ma loi.
Palmire.
Comment puis-je être à vous ? Je ne suis point à moi. Vous aurez mes regrets, votre bonté m'est chère ; mais enfin Mahomet m'a tenu lieu de père.
Zopire.
Quel père ! Justes dieux ! Lui ? Ce monstre imposteur !
Palmire.
Ah ! Quels noms inouïs lui donnez-vous, seigneur ! Lui, dans qui tant d'états adorent leur prophète ! Lui, l'envoyé du ciel, et son seul interprète !
Zopire.
étrange aveuglement des malheureux mortels ! Tout m'abandonne ici pour dresser des autels à ce coupable heureux qu'épargna ma justice, et qui courut au trône, échappé du supplice.
Palmire.
Vous me faites frémir, seigneur ; et, de mes jours, je n'avais entendu ces horribles discours. Mon penchant, je l'avoue, et ma reconnaissance, vous donnaient sur mon coeur une juste puissance ; vos blasphèmes affreux contre mon protecteur à ce penchant si doux font succéder l'horreur.
Zopire.
ô superstition ! Tes rigueurs inflexibles privent d'humanité les coeurs les plus sensibles. Que je vous plains, Palmire ! Et que sur vos erreurs ma pitié malgré moi me fait verser de pleurs !
Palmire.
Et vous me refusez !
Zopire.
Oui. Je ne puis vous rendre au tyran qui trompa ce coeur flexible et tendre ; oui, je crois voir en vous un bien trop précieux, qui me rend Mahomet encor plus odieux.
Zopire, Palmire, Phanor.
Zopire.
Que voulez-vous, Phanor ?
Phanor.
Aux portes de la ville, d'où l'on voit de Moad la campagne fertile, Omar est arrivé.
Zopire.
Qui ? Ce farouche Omar, que l'erreur aujourd'hui conduit après son char, qui combattit longtemps le tyran qu'il adore, qui vengea son pays ?
Phanor.
Peut-être il l'aime encore. Moins terrible à nos yeux, cet insolent guerrier, portant entre ses mains le glaive et l'olivier, de la paix à nos chefs a présenté le gage. On lui parle ; il demande, il reçoit un otage. Séide est avec lui.
Palmire.
Grand dieu ! Destin plus doux ! Quoi ! Séide ?
Phanor.
Omar vient, il s'avance vers vous.
Zopire.
Il le faut écouter. Allez, jeune Palmire.
(Palmire sort.)
Omar devant mes yeux ! Qu'osera-t-il me dire ? ô dieux de mon pays, qui depuis trois mille ans protégiez d'Ismaël les généreux enfants ! Soleil, sacré flambeau, qui dans votre carrière, image de ces dieux, nous prêtez leur lumière, voyez et soutenez la juste fermeté que j'opposai toujours contre l'iniquité !
Zopire, Omar, Phanor, suite.
Zopire.
Eh bien ! Après six ans tu revois ta patrie, que ton bras défendit, que ton coeur a trahie. Ces murs sont encor pleins de tes premiers exploits. Déserteur de nos dieux, déserteur de nos lois, persécuteur nouveau de cette cité sainte, d'où vient que ton audace en profane l'enceinte ? Ministre d'un brigand qu'on dût exterminer, parle : que me veux-tu ?
Omar.
Je veux te pardonner. Le prophète d'un dieu, par pitié pour ton âge, pour tes malheurs passés, surtout pour ton courage, te présente une main qui pourrait t'écraser ; et j'apporte la paix qu'il daigne proposer.
Zopire.
Un vil séditieux prétend avec audace nous accorder la paix, et non demander grâce ! Souffrirez-vous, grands dieux ! qu'au gré de ses forfaits Mahomet nous ravisse ou nous rende la paix ? Et vous, qui vous chargez des volontés d'un traître, ne rougissez-vous point de servir un tel maître ? Ne l'avez-vous pas vu, sans honneur et sans biens, ramper au dernier rang des derniers citoyens ? Qu'alors il était loin de tant de renommée !
Omar.
à tes viles grandeurs ton âme accoutumée juge ainsi du mérite, et pèse les humains au poids que la fortune avait mis dans tes mains. Ne sais-tu pas encore, homme faible et superbe, que l'insecte insensible enseveli sous l'herbe, et l'aigle impérieux qui plane au haut du ciel, rentrent dans le néant aux yeux de l'éternel ? Les mortels sont égaux ; ce n'est point la naissance, c'est la seule vertu qui fait leur différence. Il est de ces esprits favorisés des cieux, qui sont tout par eux-même, et rien par leurs aïeux. Tel est l'homme, en un mot, que j'ai choisi pour maître ; lui seul dans l'univers a mérité de l'être ; tout mortel à sa loi doit un jour obéir, et j'ai donné l'exemple aux siècles à venir.
Zopire.
Je te connais, Omar : en vain ta politique vient m'étaler ici ce tableau fanatique : en vain tu peux ailleurs éblouir les esprits ; ce que ton peuple adore excite mes mépris. Bannis toute imposture, et d'un coup d'oeil plus sage regarde ce prophète à qui tu rends hommage ; vois l'homme en Mahomet ; conçois par quel degré tu fais monter aux cieux ton fantôme adoré. Enthousiaste ou fourbe, il faut cesser de l'être ; sers-toi de ta raison, juge avec moi ton maître : tu verras de chameaux un grossier conducteur, chez sa première épouse insolent imposteur, qui, sous le vain appât d'un songe ridicule, des plus vils des humains tente la foi crédule ; comme un séditieux à mes pieds amené, par quarante vieillards à l'exil condamné : trop léger châtiment qui l'enhardit au crime. De caverne en caverne il fuit avec Fatime. Ses disciples errants de cités en déserts, proscrits, persécutés, bannis, chargés de fers, promènent leur fureur, qu'ils appellent divine ; de leurs venins bientôt ils infectent Médine. Toi-même alors, toi-même, écoutant la raison, tu voulus dans sa source arrêter le poison. Je te vis plus heureux, et plus juste, et plus brave, attaquer le tyran dont je te vois l'esclave. S'il est un vrai prophète, osas-tu le punir ? S'il est un imposteur, oses-tu le servir ?
Omar.
Je voulus le punir quand mon peu de lumière méconnut ce grand homme entré dans la carrière : mais enfin, quand j'ai vu que Mahomet est né pour changer l'univers à ses pieds consterné ; quand mes yeux, éclairés du feu de son génie, le virent s'élever dans sa course infinie ; éloquent, intrépide, admirable en tout lieu, agir, parler, punir, ou pardonner en dieu ; j'associai ma vie à ses travaux immenses : des trônes, des autels en sont les récompenses. Je fus, je te l'avoue, aveugle comme toi. Ouvre les yeux, Zopire, et change ainsi que moi ; et, sans plus me vanter les fureurs de ton zèle, ta persécution si vaine et si cruelle, nos frères gémissants, notre dieu blasphémé, tombe aux pieds d'un héros par toi-même opprimé. Viens baiser cette main qui porte le tonnerre. Tu me vois après lui le premier de la terre ; le poste qui te reste est encore assez beau pour fléchir noblement sous ce maître nouveau. Vois ce que nous étions, et vois ce que nous sommes. Le peuple, aveugle et faible, est né pour les grands hommes, pour admirer, pour croire, et pour nous obéir. Viens régner avec nous, si tu crains de servir ; partage nos grandeurs au lieu de t'y soustraire ; et, las de l'imiter, fais trembler le vulgaire.
Zopire.
Ce n'est qu'à Mahomet, à ses pareils, à toi, que je prétends, Omar, inspirer quelque effroi. Tu veux que du sénat le shérif infidèle encense un imposteur, et couronne un rebelle ! Je ne te nierai point que ce fier séducteur n'ait beaucoup de prudence et beaucoup de valeur : je connais comme toi les talents de ton maître ; s'il était vertueux, c'est un héros peut-être : mais ce héros, Omar, est un traître, un cruel, et de tous les tyrans c'est le plus criminel. Cesse de m'annoncer sa trompeuse clémence ; le grand art qu'il possède est l'art de la vengeance. Dans le cour de la guerre un funeste destin le priva de son fils que fit périr ma main. Mon bras perça le fils, ma voix bannit le père ; ma haine est inflexible, ainsi que sa colère ; pour rentrer dans la Mecque, il doit m'exterminer, et le juste aux méchants ne doit point pardonner.
Omar.
Eh bien ! Pour te montrer que Mahomet pardonne, pour te faire embrasser l'exemple qu'il te donne, partage avec lui-même, et donne à tes tribus les dépouilles des rois que nous avons vaincus. Mets un prix à la paix, mets un prix à Palmire ; nos trésors sont à toi.
Zopire.
Tu penses me séduire, me vendre ici ma honte, et marchander la paix par ses trésors honteux, le prix de ses forfaits ? Tu veux que sous ses lois Palmire se remette ? Elle a trop de vertus pour être sa sujette ; et je veux l'arracher aux tyrans imposteurs, qui renversent les lois et corrompent les moeurs.
Omar.
Tu me parles toujours comme un juge implacable, qui sur son tribunal intimide un coupable. Pense et parle en ministre ; agis, traite avec moi comme avec l'envoyé d'un grand homme et d'un roi.
Zopire.
Qui l'a fait roi ? Qui l'a couronné ?
Omar.
La victoire. Ménage sa puissance, et respecte sa gloire. Aux noms de conquérant et de triomphateur, il veut joindre le nom de pacificateur, son armée est encore aux bords du Saïbare ; des murs où je suis né le siége se prépare ; sauvons, si tu m'en crois, le sang qui va couler : Mahomet veut ici te voir et te parler.
Zopire.
Lui ? Mahomet ?
Omar.
Lui-même ; il t'en conjure.
Zopire.
Traître ! Si de ces lieux sacrés j'étais l'unique maître, c'est en te punissant que j'aurais répondu.
Omar.
Zopire, j'ai pitié de ta fausse vertu. Mais puisqu'un vil sénat insolemment partage de ton gouvernement le fragile avantage, puisqu'il règne avec toi, je cours m'y présenter.
Zopire.
Je t'y suis ; nous verrons qui l'on doit écouter. Je défendrai mes lois, mes dieux, et ma patrie. Viens-y contre ma voix prêter ta voix impie au dieu persécuteur, effroi du genre humain, qu'un fourbe ose annoncer les armes à la main.
(à Phanor.)
toi, viens m'aider, Phanor, à repousser un traître : le souffrir parmi nous, et l'épargner, c'est l'être. Renversons ses desseins, confondons son orgueil ; préparons son supplice, ou creusons mon cercueil. Je vais, si le sénat m'écoute et me seconde, délivrer d'un tyran ma patrie et le monde.
Séide, Palmire.
Palmire.
Dans ma prison cruelle est-ce un dieu qui te guide ? Mes maux sont-ils finis ? Te revois-je, Séide ?
Séide.
ô charme de ma vie et de tous mes malheurs ! Palmire, unique objet qui m'a coûté des pleurs, depuis ce jour de sang qu'un ennemi barbare, près des camps du prophète, aux bords du Saïbare, vint arracher sa proie à mes bras tout sanglants ; qu'étendu loin de toi sur des corps expirants, mes cris mal entendus sur cette infâme rive invoquèrent la mort sourde à ma voix plaintive, ô ma chère Palmire, en quel gouffre d'horreur tes périls et ma perte ont abîmé mon coeur ! Que mes feux, que ma crainte, et mon impatience, accusaient la lenteur des jours de la vengeance ! Que je hâtais l'assaut si longtemps différé, cette heure de carnage, où, de sang enivré, je devais de mes mains brûler la ville impie où Palmire a pleuré sa liberté ravie ! Enfin de Mahomet les sublimes desseins, que n'ose approfondir l'humble esprit des humains, ont fait entrer Omar en ce lieu d'esclavage ; je l'apprends, et j'y vole. On demande un otage ; j'entre, je me présente ; on accepte ma foi, et je me rends captif, ou je meurs avec toi.
Palmire.
Séide, au moment même, avant que ta présence vînt de mon désespoir calmer la violence, je me jetais aux pieds de mon fier ravisseur. Vous voyez, ai-je dit, les secrets de mon coeur : ma vie est dans les camps dont vous m'avez tirée ; rendez-moi le seul bien dont je suis séparée. Mes pleurs, en lui parlant, ont arrosé ses pieds ; ses refus ont saisi mes esprits effrayés. J'ai senti dans mes yeux la lumière obscurcie : mon coeur, sans mouvement, sans chaleur, et sans vie, d'aucune ombre d'espoir n'était plus secouru ; tout finissait pour moi, quand Séide a paru.
Séide.
Quel est donc ce mortel insensible à tes larmes ?
Palmire.
C'est Zopire : il semblait touché de mes alarmes ; mais le cruel enfin vient de me déclarer que des lieux où je suis rien ne peut me tirer.
Séide.
Le barbare se trompe ; et Mahomet mon maître, et l'invincible Omar, et moi-même peut-être (car j'ose me nommer après ces noms fameux, pardonne à ton amant cet espoir orgueilleux), nous briserons ta chaîne, et tarirons tes larmes. Le dieu de Mahomet, protecteur de nos armes, le dieu dont j'ai porté les sacrés étendards, le dieu qui de Médine a détruit les remparts, renversera la Mecque à nos pieds abattue. Omar est dans la ville, et le peuple à sa vue n'a point fait éclater ce trouble et cette horreur qu'inspire aux ennemis un ennemi vainqueur ; au nom de Mahomet un grand dessein l'amène.
Palmire.
Mahomet nous chérit ; il briserait ma chaîne ; il unirait nos coeurs ; nos coeurs lui sont offerts : mais il est loin de nous, et nous sommes aux fers.
Palmire, Séide, Omar.
Omar.
Vos fers seront brisés, soyez pleins d'espérance ; le ciel vous favorise, et Mahomet s'avance.
Séide.
Lui ?
Palmire.
Notre auguste père ?
Omar.
Au conseil assemblé l'esprit de Mahomet par ma bouche a parlé. " Ce favori du dieu qui préside aux batailles, ce grand homme, ai-je dit, est né dans vos murailles. Il s'est rendu des rois le maître et le soutien, et vous lui refusez le rang de citoyen ! Vient-il vous enchaîner, vous perdre, vous détruire ? Il vient vous protéger, mais surtout vous instruire : il vient dans vos coeurs même établir son pouvoir. " plus d'un juge à ma voix a paru s'émouvoir ; les esprits s'ébranlaient : l'inflexible Zopire, qui craint de la raison l'inévitable empire, veut convoquer le peuple, et s'en faire un appui. On l'assemble ; j'y cours, et j'arrive avec lui : je parle aux citoyens, j'intimide, j'exhorte ; j'obtiens qu'à Mahomet on ouvre enfin la porte. Après quinze ans d'exil, il revoit ses foyers ; il entre accompagné des plus braves guerriers, d'Ali, d'Ammon, d'Hercide, et de sa noble élite ; il entre, et sur ses pas chacun se précipite ; chacun porte un regard, comme un coeur différent : l'un croit voir un héros, l'autre voir un tyran. Celui-ci le blasphème, et le menace encore ; cet autre est à ses pieds, les embrasse, et l'adore. Nous faisons retentir à ce peuple agité les noms sacrés de dieu, de paix, de liberté. De Zopire éperdu la cabale impuissante vomit en vain les feux de sa rage expirante. Au milieu de leurs cris, le front calme et serein, Mahomet marche en maître, et l'olive à la main : la trêve est publiée ; et le voici lui-même.
Mahomet, Omar, Ali, Hercide, Séide, Palmire, suite.
Mahomet.
Invincibles soutiens de mon pouvoir suprême, noble et sublime Ali, Morad, Hercide, Ammon, retournez vers ce peuple, instruisez-le en mon nom ; promettez, menacez ; que la vérité règne ; qu'on adore mon dieu, mais surtout qu'on le craigne. Vous, Séide, en ces lieux !
Séide.
ô mon père ! ô mon roi ! Le dieu qui vous inspire a marché devant moi. Prêt à mourir pour vous, prêt à tout entreprendre, j'ai prévenu votre ordre.
Mahomet.
Il eût fallu l'attendre. Qui fait plus qu'il ne doit ne sait point me servir. J'obéis à mon dieu ; vous, sachez m'obéir.
Palmire.
Ah ! Seigneur ! Pardonnez à son impatience. élevés près de vous dans notre tendre enfance, les mêmes sentiments nous animent tous deux : hélas ! Mes tristes jours sont assez malheureux ! Loin de vous, loin de lui, j'ai langui prisonnière ; mes yeux de pleurs noyés s'ouvraient à la lumière : empoisonneriez-vous l'instant de mon bonheur ?
Mahomet.
Palmire, c'est assez ; je lis dans votre coeur : que rien ne vous alarme, et rien ne vous étonne. Allez : malgré les soins de l'autel et du trône, mes yeux sur vos destins seront toujours ouverts ; je veillerai sur vous comme sur l'univers.
(à Séide.)
vous, suivez mes guerriers ; et vous, jeune Palmire, en servant votre dieu, ne craignez que Zopire.
Mahomet, Omar.
Mahomet.
Toi, reste, brave Omar : il est temps que mon coeur de ses derniers replis t'ouvre la profondeur. D'un siége encor douteux la lenteur ordinaire peut retarder ma course, et borner ma carrière : ne donnons point le temps aux mortels détrompés de rassurer leurs yeux de tant d'éclat frappés. Les préjugés, ami, sont les rois du vulgaire. Tu connais quel oracle et quel bruit populaire ont promis l'univers à l'envoyé d'un dieu, qui, reçu dans la Mecque, et vainqueur en tout lieu, entrerait dans ces murs en écartant la guerre : je viens mettre à profit les erreurs de la terre. Mais tandis que les miens, par de nouveaux efforts, de ce peuple inconstant font mouvoir les ressorts, de quel oeil revois-tu Palmire avec Séide ?
Omar.
Parmi tous ces enfants enlevés par Hercide, qui, formés sous ton joug, et nourris dans ta loi, n'ont de dieu que le tien, n'ont de père que toi, aucun ne te servit avec moins de scrupule, n'eut un coeur plus docile, un esprit plus crédule ; de tous tes musulmans ce sont les plus soumis.
Mahomet.
Cher Omar, je n'ai point de plus grands ennemis. Ils s'aiment, c'est assez.
Omar.
Blâmes-tu leurs tendresses ?
Mahomet.
Ah ! Connais mes fureurs et toutes mes faiblesses.
Omar.
Comment ?
Mahomet.
Tu sais assez quel sentiment vainqueur parmi mes passions règne au fond de mon coeur. Chargé du soin du monde, environné d'alarmes, je porte l'encensoir, et le sceptre, et les armes : ma vie est un combat, et ma frugalité asservit la nature à mon austérité : j'ai banni loin de moi cette liqueur traîtresse qui nourrit des humains la brutale mollesse : dans des sables brûlants, sur des rochers déserts, je supporte avec toi l'inclémence des airs : l'amour seul me console ; il est ma récompense, l'objet de mes travaux, l'idole que j'encense, le dieu de Mahomet ; et cette passion est égale aux fureurs de mon ambition. Je préfère en secret Palmire à mes épouses. Conçois-tu bien l'excès de mes fureurs jalouses, quand Palmire à mes pieds, par un aveu fatal, insulte à Mahomet, et lui donne un rival ?
Omar.
Et tu n'es pas vengé ?
Mahomet.
Juge si je dois l'être. Pour le mieux détester, apprends à le connaître. De mes deux ennemis apprends tous les forfaits : tous deux sont nés ici du tyran que je hais.
Omar.
Quoi ! Zopire...
Mahomet.
Est leur père : Hercide en ma puissance remit depuis quinze ans leur malheureuse enfance. J'ai nourri dans mon sein ces serpents dangereux ; déjà sans se connaître ils m'outragent tous deux. J'attisai de mes mains leurs feux illégitimes. Le ciel voulut ici rassembler tous les crimes. Je veux... leur père vient ; ses yeux lancent vers nous les regards de la haine, et les traits du courroux. Observe tout, Omar, et qu'avec son escorte le vigilant Hercide assiége cette porte. Reviens me rendre compte, et voir s'il faut hâter ou retenir les coups que je dois lui porter.
Zopire, Mahomet.
Zopire.
Ah ! quel fardeau cruel à ma douleur profonde ! Moi, recevoir ici cet ennemi du monde !
Mahomet.
Approche, et puisque enfin le ciel veut nous unir, vois Mahomet sans crainte, et parle sans rougir.
Zopire.
Je rougis pour toi seul, pour toi dont l'artifice a traîné ta patrie au bord du précipice ; pour toi de qui la main sème ici les forfaits, et fait naître la guerre au milieu de la paix. Ton nom seul parmi nous divise les familles, les époux, les parents, les mères et les filles ; et la trêve pour toi n'est qu'un moyen nouveau pour venir dans nos coeurs enfoncer le couteau. La discorde civile est partout sur ta trace. Assemblage inouï de mensonge et d'audace, tyran de ton pays, est-ce ainsi qu'en ce lieu tu viens donner la paix, et m'annoncer un dieu ?
Mahomet.
Si j'avais à répondre à d'autres qu'à Zopire, je ne ferais parler que le dieu qui m'inspire ; le glaive et l'alcoran, dans mes sanglantes mains, imposeraient silence au reste des humains ; ma voix ferait sur eux les effets du tonnerre, et je verrais leurs fronts attachés à la terre : mais je te parle en homme, et sans rien déguiser ; je me sens assez grand pour ne pas t'abuser. Vois quel est Mahomet : nous sommes seuls ; écoute : je suis ambitieux ; tout homme l'est, sans doute ; mais jamais roi, pontife, ou chef, ou citoyen, ne conçut un projet aussi grand que le mien. Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre, par les lois, par les arts, et surtout par la guerre ; le temps de l'Arabie est à la fin venu. Ce peuple généreux, trop longtemps inconnu, laissait dans ses déserts ensevelir sa gloire ; voici les jours nouveaux marqués pour la victoire. Vois du nord au midi l'univers désolé, la Perse encor sanglante, et son trône ébranlé, l'Inde esclave et timide, et l'Égypte abaissée, des murs de Constantin la splendeur éclipsée ; vois l'empire romain tombant de toutes parts, ce grand corps déchiré, dont les membres épars languissent dispersés sans honneur et sans vie : sur ces débris du monde élevons l'Arabie. Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers ; il faut un nouveau dieu pour l'aveugle univers. En Égypte Osiris, Zoroastre en Asie, chez les Crétois Minos, Numa dans l'Italie, à des peuples sans moeurs, et sans culte, et sans rois, donnèrent aisément d'insuffisantes lois. Je viens après mille ans changer ces lois grossières : j'apporte un joug plus noble aux nations entières : j'abolis les faux dieux ; et mon culte épuré de ma grandeur naissante est le premier degré. Ne me reproche point de tromper ma patrie ; je détruis sa faiblesse et son idolâtrie : sous un roi, sous un dieu, je viens la réunir ; et, pour la rendre illustre, il la faut asservir.
Zopire.
Voilà donc tes desseins ! C'est donc toi dont l'audace de la terre à ton gré prétend changer la face ! Tu veux, en apportant le carnage et l'effroi, commander aux humains de penser comme toi : tu ravages le monde, et tu prétends l'instruire. Ah ! si par des erreurs il s'est laissé séduire, si la nuit du mensonge a pu nous égarer, par quels flambeaux affreux veux-tu nous éclairer ? Quel droit as-tu reçu d'enseigner, de prédire, de porter l'encensoir, et d'affecter l'empire ?
Mahomet.
Le droit qu'un esprit vaste, et ferme en ses desseins, a sur l'esprit grossier des vulgaires humains.
Zopire.
Eh quoi ! Tout factieux qui pense avec courage doit donner aux mortels un nouvel esclavage ? Il a droit de tromper, s'il trompe avec grandeur ?
Mahomet.
Oui ; je connais ton peuple, il a besoin d'erreur ; ou véritable ou faux, mon culte est nécessaire. Que t'ont produit tes dieux ? Quel bien t'ont-ils pu faire ? Quels lauriers vois-tu croître au pied de leurs autels ? Ta secte obscure et basse avilit les mortels, énerve le courage, et rend l'homme stupide ; la mienne élève l'âme, et la rend intrépide : ma loi fait des héros.
Zopire.
Dis plutôt des brigands. Porte ailleurs tes leçons, l'école des tyrans ; va vanter l'imposture à Médine où tu règnes, où tes maîtres séduits marchent sous tes enseignes, où tu vois tes égaux à tes pieds abattus.
Mahomet.
Des égaux ! Dès longtemps Mahomet n'en a plus. Je fais trembler la Mecque, et je règne à Médine ; crois-moi, reçois la paix, si tu crains ta ruine.
Zopire.
La paix est dans ta bouche, et ton coeur en est loin : penses-tu me tromper ?
Mahomet.
Je n'en ai pas besoin. C'est le faible qui trompe, et le puissant commande. Demain j'ordonnerai ce que je te demande ; demain je puis te voir à mon joug asservi : aujourd'hui Mahomet veut être ton ami.
Zopire.
Nous amis ! Nous, cruel ! Ah ! Quel nouveau prestige ! Connais-tu quelque dieu qui fasse un tel prodige ?
Mahomet.
J'en connais un puissant, et toujours écouté, qui te parle avec moi.
Zopire.
Qui ?
Mahomet.
La nécessité, ton intérêt.
Zopire.
Avant qu'un tel noeud nous rassemble, les enfers et les cieux seront unis ensemble. L'intérêt est ton dieu, le mien est l'équité ; entre ces ennemis il n'est point de traité. Quel serait le ciment, réponds-moi, si tu l'oses, de l'horrible amitié qu'ici tu me proposes ? Réponds ; est-ce ton fils que mon bras te ravit ? Est-ce le sang des miens que ta main répandit ?
Mahomet.
Oui, ce sont tes fils même. Oui, connais un mystère dont seul dans l'univers je suis dépositaire : tu pleures tes enfants, ils respirent tous deux.
Zopire.
Ils vivraient ! Qu'as-tu dit ? ô ciel ! ô jour heureux ! Ils vivraient ! C'est de toi qu'il faut que je l'apprenne !
Mahomet.
élevés dans mon camp, tous deux sont dans ma chaîne.
Zopire.
Mes enfants dans tes fers ! Ils pourraient te servir !
Mahomet.
Mes bienfaisantes mains ont daigné les nourrir.
Zopire.
Quoi ! Tu n'as point sur eux étendu ta colère ?
Mahomet.
Je ne les punis point des fautes de leur père.
Zopire.
Achève, éclaircis-moi, parle, quel est leur sort ?
Mahomet.
Je tiens entre mes mains et leur vie et leur mort ; tu n'as qu'à dire un mot, et je t'en fais l'arbitre.
Zopire.
Moi, je puis les sauver ! à quel prix ? à quel titre ? Faut-il donner mon sang ? Faut-il porter leurs fers ?
Mahomet.
Non, mais il faut m'aider à tromper l'univers ; il faut rendre la Mecque, abandonner ton temple, de la crédulité donner à tous l'exemple, annoncer l'alcoran aux peuples effrayés, me servir en prophète, et tomber à mes pieds : je te rendrai ton fils, et je serai ton gendre.
Zopire.
Mahomet, je suis père, et je porte un coeur tendre. Après quinze ans d'ennuis, retrouver mes enfants, les revoir, et mourir dans leurs embrassements, c'est le premier des biens pour mon âme attendrie : mais s'il faut à ton culte asservir ma patrie, ou de ma propre main les immoler tous deux ; connais-moi, Mahomet, mon choix n'est pas douteux. Adieu.
Mahomet, seul.
Fier citoyen, vieillard inexorable, je serai plus que toi cruel, impitoyable.
Mahomet, Omar.
Omar.
Mahomet, il faut l'être, ou nous sommes perdus : les secrets des tyrans me sont déjà vendus. Demain la trêve expire, et demain l'on t'arrête : demain Zopire est maître, et fait tomber ta tête. La moitié du sénat vient de te condamner ; n'osant pas te combattre, on t'ose assassiner. Ce meurtre d'un héros, ils le nomment supplice ; et ce complot obscur, ils l'appellent justice.
Mahomet.
Ils sentiront la mienne ; ils verront ma fureur. La persécution fit toujours ma grandeur : Zopire périra.
Omar.
Cette tête funeste, en tombant à tes pieds, fera fléchir le reste. Mais ne perds point de temps.
Mahomet.
Mais, malgré mon courroux, je dois cacher la main qui va lancer les coups, et détourner de moi les soupçons du vulgaire.
Omar.
Il est trop méprisable.
Mahomet.
Il faut pourtant lui plaire ; et j'ai besoin d'un bras qui, par ma voix conduit, soit seul chargé du meurtre et m'en laisse le fruit.
Omar.
Pour un tel attentat je réponds de Séide.
Mahomet.
De lui ?
Omar.
C'est l'instrument d'un pareil homicide. Otage de Zopire, il peut seul aujourd'hui l'aborder en secret, et te venger de lui. Tes autres favoris, zélés avec prudence, pour s'exposer à tout ont trop d'expérience ; ils sont tous dans cet âge où la maturité fait tomber le bandeau de la crédulité ; il faut un coeur plus simple, aveugle avec courage, un esprit amoureux de son propre esclavage : la jeunesse est le temps de ces illusions. Séide est tout en proie aux superstitions ; c'est un lion docile à la voix qui le guide.
Mahomet.
Le frère de Palmire ?
Omar.
Oui, lui-même, oui, Séide, de ton fier ennemi le fils audacieux, de son maître offensé rival incestueux.
Mahomet.
Je déteste Séide, et son nom seul m'offense ; la cendre de mon fils me crie encor vengeance : mais tu connais l'objet de mon fatal amour ; tu connais dans quel sang elle a puisé le jour. Tu vois que dans ces lieux environnés d'abîmes je viens chercher un trône, un autel, des victimes ; qu'il faut d'un peuple fier enchanter les esprits, qu'il faut perdre Zopire, et perdre encor son fils. Allons, consultons bien mon intérêt, ma haine, l'amour, l'indigne amour, qui malgré moi m'entraîne, et la religion, à qui tout est soumis, et la nécessité, par qui tout est permis.
Séide, Palmire.
Palmire.
Demeure. Quel est donc ce secret sacrifice ? Quel sang a demandé l'éternelle justice ? Ne m'abandonne pas.
Séide.
Dieu daigne m'appeler : mon bras doit le servir, mon coeur va lui parler. Omar veut à l'instant, par un serment terrible, m'attacher de plus près à ce maître invincible : je vais jurer à Dieu de mourir pour sa loi, et mes seconds serments ne seront que pour toi.
Palmire.
D'où vient qu'à ce serment je ne suis point présente ? Si je t'accompagnais, j'aurais moins d'épouvante. Omar, ce même Omar, loin de me consoler, parle de trahison, de sang prêt à couler, des fureurs du sénat, des complots de Zopire. Les feux sont allumés, bientôt la trêve expire : le fer cruel est prêt ; on s'arme, on va frapper : le prophète l'a dit, il ne peut nous tromper. Je crains tout de Zopire, et je crains pour Séide.
Séide.
Croirai-je que Zopire ait un coeur si perfide ! Ce matin, comme otage à ses yeux présenté, j'admirais sa noblesse et son humanité ; je sentais qu'en secret une force inconnue enlevait jusqu'à lui mon âme prévenue : soit respect pour son nom, soit qu'un dehors heureux me cachât de son coeur les replis dangereux ; soit que, dans ces moments où je t'ai rencontrée, mon âme tout entière à son bonheur livrée, oubliant ses douleurs, et chassant tout effroi, ne connût, n'entendît, ne vît plus rien que toi ; je me trouvais heureux d'être auprès de Zopire. Je le hais d'autant plus qu'il m'avait su séduire : mais malgré le courroux dont je dois m'animer, qu'il est dur de haïr ceux qu'on voulait aimer !
Palmire.
Ah ! Que le ciel en tout a joint nos destinées ! Qu'il a pris soin d'unir nos âmes enchaînées ! Hélas, sans mon amour, sans ce tendre lien, sans cet instinct charmant qui joint mon coeur au tien, sans la religion que Mahomet m'inspire, j'aurais eu des remords en accusant Zopire.
Séide.
Laissons ces vains remords, et nous abandonnons à la voix de ce dieu qu'à l'envi nous servons. Je sors. Il faut prêter ce serment redoutable ; le dieu qui m'entendra nous sera favorable ; et le pontife-roi, qui veille sur nos jours, bénira de ses mains de si chastes amours. Adieu. Pour être à toi, je vais tout entreprendre.
Palmire.
D'un noir pressentiment je ne puis me défendre. Cet amour dont l'idée avait fait mon bonheur, ce jour tant souhaité n'est qu'un jour de terreur. Quel est donc ce serment qu'on attend de Séide ? Tout m'est suspect ici ; Zopire m'intimide. J'invoque Mahomet, et cependant mon coeur éprouve à son nom même une secrète horreur. Dans les profonds respects que ce héros m'inspire, je sens que je le crains presque autant que Zopire. Délivre-moi, grand dieu ! De ce trouble où je suis ? Craintive je te sers, aveugle je te suis : hélas ! Daigne essuyer les pleurs où je me noie !
Mahomet, Palmire.
Palmire.
C'est vous qu'à mon secours un dieu propice envoie, seigneur, Séide...
Mahomet.
Eh bien ! D'où vous vient cet effroi ? Et que craint-on pour lui, quand on est près de moi ?
Palmire.
ô ciel ! Vous redoublez la douleur qui m'agite. Quel prodige inouï ! Votre âme est interdite ; Mahomet est troublé pour la première fois.
Mahomet.
Je devrais l'être au moins du trouble où je vous vois. Est-ce ainsi qu'à mes yeux votre simple innocence ose avouer un feu qui peut-être m'offense ? Votre coeur a-t-il pu, sans être épouvanté, avoir un sentiment que je n'ai pas dicté ? Ce coeur que j'ai formé n'est-il plus qu'un rebelle, ingrat à mes bienfaits, à mes lois infidèle ?
Palmire.
Que dites-vous ? Surprise et tremblante à vos pieds, je baisse en frémissant mes regards effrayés. Eh quoi ! N'avez-vous pas daigné, dans ce lieu même, vous rendre à nos souhaits, et consentir qu'il m'aime ? Ces noeuds, ces chastes noeuds, que dieu formait en nous, sont un lien de plus qui nous attache à vous.
Mahomet.
Redoutez des liens formés par l'imprudence. Le crime quelquefois suit de près l'innocence. Le coeur peut se tromper ; l'amour et ses douceurs pourront coûter, Palmire, et du sang et des pleurs.
Palmire.
N'en doutez pas, mon sang coulerait pour Séide.
Mahomet.
Vous l'aimez à ce point ?
Palmire.
Depuis le jour qu'Hercide nous soumit l'un et l'autre à votre joug sacré, cet instinct tout-puissant, de nous-même ignoré, devançant la raison, croissant avec notre âge, du ciel, qui conduit tout, fut le secret ouvrage. Nos penchants, dites-vous, ne viennent que de lui. Dieu ne saurait changer : pourrait-il aujourd'hui réprouver un amour que lui-même il fit naître ? Ce qui fut innocent peut-il cesser de l'être ? Pourrais-je être coupable ?
Mahomet.
Oui. Vous devez trembler : attendez les secrets que je dois révéler ; attendez que ma voix veuille enfin vous apprendre ce qu'on peut approuver, ce qu'on doit se défendre. Ne croyez que moi seul.
Palmire.
Et qui croire que vous ? Esclave de vos lois, soumise, à vos genoux, mon coeur d'un saint respect ne perd point l'habitude.
Mahomet.
Trop de respect souvent mène à l'ingratitude.
Palmire.
Non, si de vos bienfaits je perds le souvenir, que Séide à vos yeux s'empresse à m'en punir !
Mahomet.
Séide !
Palmire.
Ah ! Quel courroux arme votre oeil sévère ?
Mahomet.
Allez, rassurez-vous, je n'ai point de colère. C'est éprouver assez vos sentiments secrets ; reposez-vous sur moi de vos vrais intérêts : je suis digne du moins de votre confiance. Vos destins dépendront de votre obéissance. Si j'eus soin de vos jours, si vous m'appartenez, méritez des bienfaits qui vous sont destinés. Quoi que la voix du ciel ordonne de Séide, affermissez ses pas où son devoir le guide : qu'il garde ses serments ; qu'il soit digne de vous.
Palmire.
N'en doutez point, mon père, il les remplira tous : je réponds de son coeur, ainsi que de moi-même. Séide vous adore encor plus qu'il ne m'aime ; il voit en vous son roi, son père, son appui : j'en atteste à vos pieds l'amour que j'ai pour lui. Je cours à vous servir encourager son âme.
Mahomet.
Quoi ! Je suis malgré moi confident de sa flamme ! Quoi ! Sa naïveté, confondant ma fureur, enfonce innocemment le poignard dans mon coeur ! Père, enfants, destinés au malheur de ma vie, race toujours funeste et toujours ennemie, vous allez éprouver, dans cet horrible jour, ce que peut à la fois ma haine et mon amour.
Mahomet, Omar.
Omar.
Enfin voici le temps et de ravir Palmire, et d'envahir la Mecque, et de punir Zopire : sa mort seule à tes pieds mettra nos citoyens ; tout est désespéré si tu ne le préviens. Le seul Séide ici te peut servir, sans doute ; il voit souvent Zopire, il lui parle, il l'écoute. Tu vois cette retraite, et cet obscur détour qui peut de ton palais conduire à son séjour ; là, cette nuit, Zopire à ses dieux fantastiques offre un encens frivole et des voeux chimériques. Là, Séide, enivré du zèle de ta loi, va l'immoler au dieu qui lui parle par toi.
Mahomet.
Qu'il l'immole, il le faut : il est né pour le crime : qu'il en soit l'instrument, qu'il en soit la victime. Ma vengeance, mes feux, ma loi, ma sûreté, l'irrévocable arrêt de la fatalité, tout le veut ; mais crois-tu que son jeune courage, nourri du fanatisme, en ait toute la rage ?
Omar.
Lui seul était formé pour remplir ton dessein. Palmire à te servir excite encor sa main. L'amour, le fanatisme, aveuglent sa jeunesse ; il sera furieux par excès de faiblesse.
Mahomet.
Par les noeuds des serments as-tu lié son coeur ?
Omar.
Du plus saint appareil la ténébreuse horreur, les autels, les serments, tout enchaîne Séide. J'ai mis un fer sacré dans sa main parricide, et la religion le remplit de fureur. Il vient.
Mahomet, Omar, Séide.
Mahomet.
Enfant d'un dieu qui parle à votre coeur, écoutez par ma voix sa volonté suprême : il faut venger son culte, il faut venger dieu même.
Séide.
Roi, pontife, et prophète, à qui je suis voué, maître des nations, par le ciel avoué, vous avez sur mon être une entière puissance ; éclairez seulement ma docile ignorance. Un mortel venger dieu !
Mahomet.
C'est par vos faibles mains qu'il veut épouvanter les profanes humains.
Séide.
Ah ! Sans doute ce dieu, dont vous êtes l'image, va d'un combat illustre honorer mon courage.
Mahomet.
Faites ce qu'il ordonne, il n'est point d'autre honneur. De ses décrets divins aveugle exécuteur, adorez et frappez ; vos mains seront armées par l'ange de la mort, et le dieu des armées.
Séide.
Parlez : quels ennemis vous faut-il immoler ? Quel tyran faut-il perdre ? Et quel sang doit couler ?
Mahomet.
Le sang du meurtrier que Mahomet abhorre, qui nous persécuta, qui nous poursuit encore, qui combattit mon dieu, qui massacra mon fils ; le sang du plus cruel de tous nos ennemis, de Zopire.
Séide.
De lui ! Quoi ! Mon bras...
Mahomet.
Téméraire, on devient sacrilége alors qu'on délibère. Loin de moi les mortels assez audacieux pour juger par eux-mêmes, et pour voir par leurs yeux ! Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire. Obéir en silence est votre seule gloire. Savez-vous qui je suis ? Savez-vous en quels lieux ma voix vous a chargé des volontés des cieux ? Si malgré ses erreurs et son idolâtrie, des peuples d'orient la Mecque est la patrie ; si ce temple du monde est promis à ma loi ; si dieu m'en a créé le pontife et le roi ; si la Mecque est sacrée, en savez-vous la cause ? Ibrahim y naquit, et sa cendre y repose : Ibrahim, dont le bras, docile à l'éternel, traîna son fils unique aux marches de l'autel, étouffant pour son dieu les cris de la nature. Et quand ce dieu par vous veut venger son injure, quand je demande un sang à lui seul adressé, quand dieu vous a choisi, vous avez balancé ! Allez, vil idolâtre, et né pour toujours l'être, indigne musulman, cherchez un autre maître. Le prix était tout prêt ; Palmire était à vous : mais vous bravez Palmire et le ciel en courroux. Lâche et faible instrument des vengeances suprêmes, les traits que vous portez vont tomber sur vous-mêmes ; fuyez, servez, rampez, sous mes fiers ennemis.
Séide.
Je crois entendre dieu ; tu parles : j'obéis.
Mahomet.
Obéissez, frappez : teint du sang d'un impie, méritez par sa mort une éternelle vie.
(à Omar.)
ne l'abandonne pas ; et, non loin de ces lieux, sur tous ses mouvements ouvre toujours les yeux.
Séide.
Immoler un vieillard de qui je suis l'otage, sans armes, sans défense, appesanti par l'âge ! N'importe ; une victime amenée à l'autel y tombe sans défense, et son sang plait au ciel. Enfin dieu m'a choisi pour ce grand sacrifice : j'en ai fait le serment ; il faut qu'il s'accomplisse. Venez à mon secours, ô vous, de qui le bras aux tyrans de la terre a donné le trépas ! Ajoutez vos fureurs à mon zèle intrépide ; affermissez ma main saintement homicide. Ange de Mahomet, ange exterminateur, mets ta férocité dans le fond de mon coeur ! Ah ! Que vois-je ?
Zopire, Séide.
Zopire.
à mes yeux tu te troubles, Séide ! Vois d'un oeil plus content le dessein qui me guide : otage infortuné, que le sort m'a remis, je te vois à regret parmi mes ennemis. La trêve a suspendu le moment du carnage ; ce torrent retenu peut s'ouvrir un passage : je ne t'en dis pas plus : mais mon coeur, malgré moi, a frémi des dangers assemblés près de toi. Cher Séide, en un mot, dans cette horreur publique, souffre que ma maison soit ton asile unique. Je réponds de tes jours ; ils me sont précieux ; ne me refuse pas.
Séide.
ô mon devoir ! ô cieux. Ah, Zopire ! Est-ce vous qui n'avez d'autre envie que de me protéger, de veiller sur ma vie ? Prêt à verser son sang, qu'ai-je ouï ? Qu'ai-je vu ? Pardonne, Mahomet, tout mon coeur s'est ému.
Zopire.
De ma pitié pour toi tu t'étonnes peut-être ; mais enfin je suis homme, et c'est assez de l'être pour aimer à donner des soins compatissants à des coeurs malheureux que l'on croit innocents. Exterminez, grands dieux, de la terre où nous sommes, quiconque avec plaisir répand le sang des hommes !
Séide.
Que ce langage est cher à mon coeur combattu ! L'ennemi de mon dieu connaît donc la vertu !
Zopire.
Tu la connais bien peu, puisque tu t'en étonnes. Mon fils, à quelle erreur, hélas ! Tu t'abandonnes ! Ton esprit, fasciné par les lois d'un tyran, pense que tout est crime hors d'être musulman. Cruellement docile aux leçons de ton maître, tu m'avais en horreur avant de me connaître ; avec un joug de fer, un affreux préjugé tient ton coeur innocent dans le piége engagé. Je pardonne aux erreurs où Mahomet t'entraîne ; mais peux-tu croire un dieu qui commande la haine ?
Séide.
Ah ! Je sens qu'à ce dieu je vais désobéir ; non, seigneur, non ; mon coeur ne saurait vous haïr.
Zopire, à part.
Hélas ! Plus je lui parle, et plus il m'intéresse ? Son âge, sa candeur, ont surpris ma tendresse. Se peut-il qu'un soldat de ce monstre imposteur ait trouvé malgré lui le chemin de mon coeur ?
(à Séide.)
quel es-tu ? De quel sang les dieux t'ont-ils fait naître ?
Séide.
Je n'ai point de parents, seigneur, je n'ai qu'un maître, que jusqu'à ce moment j'avais toujours servi, mais qu'en vous écoutant ma faiblesse a trahi.
Zopire.
Quoi ! Tu ne connais point de qui tu tiens la vie ?
Séide.
Son camp fut mon berceau ; son temple est ma patrie : je n'en connais point d'autre ; et, parmi ces enfants qu'en tribut à mon maître on offre tous les ans, nul n'a plus que Séide éprouvé sa clémence.
Zopire.
Je ne puis le blâmer de sa reconnaissance. Oui, les bienfaits, Séide, ont des droits sur un coeur. Ciel ! Pourquoi Mahomet fut-il son bienfaiteur ! Il t'a servi de père, aussi bien qu'à Palmire : d'où vient que tu frémis, et que ton coeur soupire ? Tu détournes de moi ton regard égaré ; de quelque grand remords tu sembles déchiré.
Séide.
Eh ! Qui n'en aurait pas dans ce jour effroyable !
Zopire.
Si tes remords sont vrais, ton coeur n'est plus coupable. Viens, le sang va couler ; je veux sauver le tien.
Séide.
Juste ciel ! Et c'est moi qui répandrais le sien ! ô serments ! ô Palmire ! ô vous, dieu des vengeances !
Zopire.
Remets-toi dans mes mains ; tremble, si tu balances ; pour la dernière fois, viens, ton sort en dépend.
Zopire, Séide, Omar, suite.
Omar, entrant avec précipitation.
Traître, que faites-vous ? Mahomet vous attend.
Séide.
Où suis-je ! ô ciel ! Où suis-je ! Et que dois-je résoudre ? D'un et d'autre côté je vois tomber la foudre. Où courir ? Où porter un trouble si cruel ? Où fuir ?
Omar.
Aux pieds du roi qu'a choisi l'éternel.
Séide.
Oui, j'y cours abjurer un serment que j'abhorre.
Zopire.
Ah, Séide ! Où vas-tu ? Mais il me fuit encore ; il sort désespéré, frappé d'un sombre effroi, et mon coeur qui le suit s'échappe loin de moi. Ses remords, ma pitié, son aspect, son absence, à mes sens déchirés font trop de violence. Suivons ses pas.
Zopire, Phanor.
Phanor.
Lisez ce billet important qu'un arabe en secret m'a donné dans l'instant.
Zopire.
Hercide ! Qu'ai-je lu ? Grands dieux ! Votre clémence répare-t-elle enfin soixante ans de souffrance ? Hercide veut me voir ! Lui, dont le bras cruel arracha mes enfants à ce sein paternel ! Ils vivent ! Mahomet les tient sous sa puissance, et Séide et Palmire ignorent leur naissance ! Mes enfants ! Tendre espoir, que je n'ose écouter ! Je suis trop malheureux, je crains de me flatter. Pressentiment confus, faut-il que je vous croie ? ô mon sang ! Où porter mes larmes et ma joie ? Mon coeur ne peut suffire à tant de mouvements ; je cours, et je suis prêt d'embrasser mes enfants. Je m'arrête, j'hésite, et ma douleur craintive prête à la voix du sang une oreille attentive. Allons. Voyons Hercide au milieu de la nuit ; qu'il soit sous cette voûte en secret introduit, au pied de cet autel, où les pleurs de ton maître ont fatigué les dieux, qui s'apaisent peut-être. Dieux, rendez-moi mes fils ! Dieux, rendez aux vertus deux coeurs nés généreux, qu'un traître a corrompus ! S'ils ne sont point à moi, si telle est ma misère, je les veux adopter, je veux être leur père.
Mahomet, Omar.
Omar.
Oui, de ce grand secret la trame est découverte ; ta gloire est en danger, ta tombe est entr'ouverte. Séide obéira : mais avant que son coeur, raffermi par ta voix, eût repris sa fureur, Séide a révélé cet horrible mystère.
Mahomet.
ô ciel !
Omar.
Hercide l'aime : il lui tient lieu de père.
Mahomet.
Eh bien ! Que pense Hercide ?
Omar.
Il paraît effrayé ; il semble pour Zopire avoir quelque pitié.
Mahomet.
Hercide est faible ; ami, le faible est bientôt traître. Qu'il tremble ! Il est chargé du secret de son maître. Je sais comme on écarte un témoin dangereux. Suis-je en tout obéi ?
Omar.
J'ai fait ce que tu veux.
Mahomet.
Préparons donc le reste. Il faut que dans une heure on nous traîne au supplice, ou que Zopire meure. S'il meurt, c'en est assez ; tout ce peuple éperdu adorera mon dieu, qui m'aura défendu. Voilà le premier pas ; mais sitôt que Séide aura rougi ses mains de ce grand homicide, réponds-tu qu'au trépas Séide soit livré ? Réponds-tu du poison qui lui fut préparé ?
Omar.
N'en doute point.
Mahomet.
Il faut que nos mystères sombres soient cachés dans la mort, et couverts de ses ombres. Mais tout prêt à frapper, prêt à percer le flanc dont Palmire a tiré la source de son sang, prends soin de redoubler son heureuse ignorance : épaississons la nuit qui voile sa naissance, pour son propre intérêt, pour moi, pour mon bonheur. Mon triomphe en tout temps est fondé sur l'erreur. Elle naquit en vain de ce sang que j'abhorre : on n'a point de parents alors qu'on les ignore. Les cris du sang, sa force, et ses impressions, des coeurs toujours trompés sont les illusions. La nature à mes yeux n'est rien que l'habitude ; celle de m'obéir fit son unique étude : je lui tiens lieu de tout. Qu'elle passe en mes bras, sur la cendre des siens, qu'elle ne connaît pas. Son coeur même en secret, ambitieux peut-être, sentira quelque orgueil à captiver son maître. Mais déjà l'heure approche où Séide en ces lieux doit m'immoler son père à l'aspect de ses dieux. Retirons-nous.
Omar.
Tu vois sa démarche égarée ; de l'ardeur d'obéir son âme est dévorée.
Mahomet, Omar, sur le devant, mais retirés de côté ; Séide, dans le fond.
Séide.
Il le faut donc remplir ce terrible devoir !
Mahomet.
Viens, et par d'autres coups assurons mon pouvoir.
(il sort avec Omar.)
Séide, seul.
à tout ce qu'ils m'ont dit je n'ai rien à répondre. Un mot de Mahomet suffit pour me confondre. Mais quand il m'accablait de cette sainte horreur, la persuasion n'a point rempli mon coeur. Si le ciel a parlé, j'obéirai sans doute ; mais quelle obéissance ! ô ciel ! Et qu'il en coûte !
Séide, Palmire.
Séide.
Palmire, que veux-tu ? Quel funeste transport ! Qui t'amène en ces lieux consacrés à la mort ?
Palmire.
Séide, la frayeur et l'amour sont mes guides ; mes pleurs baignent tes mains saintement homicides. Quel sacrifice horrible, hélas ! Faut-il offrir ? à Mahomet, à Dieu, tu vas donc obéir ?
Séide.
ô de mes sentiments souveraine adorée ! Parlez, déterminez ma fureur égarée ; éclairez mon esprit, et conduisez mon bras ; tenez-moi lieu d'un dieu que je ne comprends pas. Pourquoi m'a-t-il choisi ? Ce terrible prophète d'un ordre irrévocable est-il donc l'interprète !
Palmire.
Tremblons d'examiner. Mahomet voit nos coeurs, il entend nos soupirs, il observe mes pleurs. Chacun redoute en lui la divinité même, c'est tout ce que je sais ; le doute est un blasphème : et le dieu qu'il annonce avec tant de hauteur, Séide, est le vrai dieu, puisqu'il le rend vainqueur.
Séide.
Il l'est, puisque Palmire et le croit et l'adore. Mais mon esprit confus ne conçoit point encore comment ce dieu si bon, ce père des humains, pour un meurtre effroyable a réservé mes mains. Je ne le sais que trop que mon doute est un crime, qu'un prêtre sans remords égorge sa victime, que par la voix du ciel Zopire est condamné, qu'à soutenir ma loi j'étais prédestiné. Mahomet s'expliquait, il a fallu me taire ; et, tout fier de servir la céleste colère, sur l'ennemi de dieu je portais le trépas : un autre dieu, peut-être, a retenu mon bras. Du moins, lorsque j'ai vu ce malheureux Zopire, de ma religion j'ai senti moins l'empire. Vainement mon devoir au meurtre m'appelait ; à mon coeur éperdu l'humanité parlait. Mais avec quel courroux, avec quelle tendresse, Mahomet de mes sens accuse la faiblesse ! Avec quelle grandeur, et quelle autorité, sa voix vient d'endurcir ma sensibilité ! Que la religion est terrible et puissante ! J'ai senti la fureur en mon coeur renaissante ; Palmire, je suis faible, et du meurtre effrayé ; de ces saintes fureurs je passe à la pitié ; de sentiments confus une foule m'assiége : je crains d'être barbare, ou d'être sacrilége. Je ne me sens point fait pour être un assassin. Mais quoi ! Dieu me l'ordonne, et j'ai promis ma main ; j'en verse encor des pleurs de douleur et de rage. Vous me voyez, Palmire, en proie à cet orage, nageant dans le reflux des contrariétés, qui pousse et qui retient mes faibles volontés : c'est à vous de fixer mes fureurs incertaines : nos coeurs sont réunis par les plus fortes chaînes ; mais, sans ce sacrifice à mes mains imposé, le noeud qui nous unit est à jamais brisé ; ce n'est qu'à ce seul prix que j'obtiendrai Palmire.
Palmire.
Je suis le prix du sang du malheureux Zopire !
Séide.
Le ciel et Mahomet ainsi l'ont arrêté.
Palmire.
L'amour est-il donc fait pour tant de cruauté ?
Séide.
Ce n'est qu'au meurtrier que Mahomet te donne.
Palmire.
Quelle effroyable dot ! Mais si le ciel l'ordonne ? Si je sers et l'amour et la religion ?
Palmire.
Hélas !
Séide.
Vous connaissez la malédiction qui punit à jamais la désobéissance.
Palmire.
Si dieu même en tes mains a remis sa vengeance, s'il exige le sang que ta bouche a promis...
Séide.
Eh bien ! Pour être à toi que faut-il ?
Palmire.
Je frémis.
Séide.
Je t'entends ; son arrêt est parti de ta bouche.
Palmire.
Qui ? Moi ?
Séide.
Tu l'as voulu.
Palmire.
Dieu ! Quel arrêt farouche ! Que t'ai-je dit ?
Séide.
Le ciel vient d'emprunter ta voix ; c'est son dernier oracle, et j'accomplis ses lois. Voici l'heure où Zopire à cet autel funeste doit prier en secret des dieux que je déteste. Palmire, éloigne-toi.
Palmire.
Je ne puis te quitter. Ne vois point l'attentat qui va s'exécuter. Ces moments sont affreux. Va, fuis ; cette retraite est voisine des lieux qu'habite le prophète ! Va, dis-je.
Palmire.
Ce vieillard va donc être immolé !
Séide.
De ce grand sacrifice ainsi l'ordre est réglé ! Il le faut de ma main traîner sur la poussière, de trois coups dans le sein lui ravir la lumière, renverser dans son sang cet autel dispersé.
Palmire.
Lui, mourir par tes mains ! Tout mon sang s'est glacé. Le voici, juste ciel ! ...
(le fond du théâtre s'ouvre. On voit un autel.)
Zopire ; Séide, Palmire, sur le devant.
Zopire, près de l'autel.
ô dieux de ma patrie ! Dieux prêts à succomber sous une secte impie, c'est pour vous-même ici que ma débile voix vous implore aujourd'hui pour la dernière fois. La guerre va renaître, et ses mains meurtrières de cette faible paix vont briser les barrières. Dieux ! Si d'un scélérat vous respectez le sort...
Séide, à Palmire.
Tu l'entends qui blasphème ?
Zopire.
Accordez-moi la mort. Mais rendez-moi mes fils à mon heure dernière ; que j'expire en leurs bras ; qu'ils ferment ma paupière. Hélas ! Si j'en croyais mes secrets sentiments, si vos mains en ces lieux ont conduit mes enfants...
Palmire, à Séide.
Que dit-il ? Ses enfants !
Zopire.
ô mes dieux que j'adore ! Je mourrais du plaisir de les revoir encore. Arbitre des destins, daignez veiller sur eux ; qu'ils pensent comme moi, mais qu'ils soient plus heureux !
Séide.
Il court à ses faux dieux ! Frappons.
(il tire son poignard.)
Palmire.
Que vas-tu faire ? Hélas !
Séide.
Servir le ciel, te mériter, te plaire. Ce glaive à notre dieu vient d'être consacré ; que l'ennemi de dieu soit par lui massacré ! Marchons. Ne vois-tu pas dans ces demeures sombres ces traits de sang, ce spectre, et ces errantes ombres ?
Palmire.
Que dis-tu ?
Séide.
Je vous suis, ministres du trépas : vous me montrez l'autel ; vous conduisez mon bras. Allons.
Palmire.
Non ; trop d'horreur entre nous deux s'assemble. Demeure.
Séide.
Il n'est plus temps ; avançons : l'autel tremble.
Palmire.
Le ciel se manifeste, il n'en faut pas douter.
Séide.
Me pousse-t-il au meurtre, ou veut-il m'arrêter ? Du prophète de dieu la voix se fait entendre ; il me reproche un coeur trop flexible et trop tendre ; Palmire !
Palmire.
Eh bien ?
Séide.
Au ciel adressez tous vos voeux. Je vais frapper.
(il sort, et va derrière l'autel où est Zopire.)
Palmire.
Je meurs ! ô moment douloureux ! Quelle effroyable voix dans mon âme s'élève ! D'où vient que tout mon sang malgré moi se soulève ? Si le ciel veut un meurtre, est-ce à moi d'en juger ? Est-ce à moi de m'en plaindre, et de l'interroger ? J'obéis. D'où vient donc que le remords m'accable ? Ah ! Quel coeur sait jamais s'il est juste ou coupable ? Je me trompe, ou les coups sont portés cette fois ; j'entends les cris plaintifs d'une mourante voix. Séide... hélas ! ...
Séide revient d'un air égaré.
Où suis-je ? Et quelle voix m'appelle ? Je ne vois point Palmire ; un dieu m'a privé d'elle.
Palmire.
Eh quoi ! Méconnais-tu celle qui vit pour toi ?
Séide.
Où sommes-nous ?
Palmire.
Eh bien ! Cette effroyable loi, cette triste promesse est-elle enfin remplie ?
Séide.
Que me dis-tu ?
Palmire.
Zopire a-t-il perdu la vie ?
Séide.
Qui ? Zopire ?
Palmire.
Ah ! Grand dieu ! Dieu de sang altéré, ne persécutez point son esprit égaré. Fuyons d'ici.
Séide.
Je sens que mes genoux s'affaissent.
(il s'assied.)
ah ! Je revois le jour, et mes forces renaissent. Quoi ! C'est vous ?
Palmire.
Qu'as-tu fait ?
Séide, se relevant.
Moi ! Je viens d'obéir... d'un bras désespéré je viens de le saisir. Par ses cheveux blanchis j'ai traîné ma victime. ô ciel ! Tu l'as voulu ! Peux-tu vouloir un crime ? Tremblant, saisi d'effroi, j'ai plongé dans son flanc ce glaive consacré qui dut verser son sang. J'ai voulu redoubler ; ce vieillard vénérable a jeté dans mes bras un cri si lamentable ! La nature a tracé dans ses regards mourants un si grand caractère, et des traits si touchants ! ... de tendresse et d'effroi mon âme s'est remplie, et, plus mourant que lui, je déteste ma vie.
Palmire.
Fuyons vers Mahomet qui doit nous protéger : près de ce corps sanglant vous êtes en danger. Suivez-moi.
Séide.
Je ne puis. Je me meurs. Ah ! Palmire ! ...
Palmire.
Quel trouble épouvantable à mes yeux le déchire !
Séide, en pleurant.
Ah ! Si tu l'avais vu, le poignard dans le sein, s'attendrir à l'aspect de son lâche assassin ! Je fuyais. Croirais-tu que sa voix affaiblie pour m'appeler encore a ranimé sa vie ? Il retirait ce fer de ses flancs malheureux. Hélas ! Il m'observait d'un regard douloureux. " cher Séide, a-t-il dit, infortuné Séide ! " cette voix, ces regards, ce poignard homicide, ce vieillard attendri, tout sanglant à mes pieds, poursuivent devant toi mes regards effrayés. Qu'avons-nous fait ?
Palmire.
On vient, je tremble pour ta vie. Fuis au nom de l'amour et du noeud qui nous lie.
Séide.
Va, laisse-moi. Pourquoi cet amour malheureux m'a-t-il pu commander ce sacrifice affreux ? Non, cruelle ! Sans toi, sans ton ordre suprême, je n'aurais pu jamais obéir au ciel même. De quel reproche horrible oses-tu m'accabler ! Hélas ! Plus que le tien mon coeur se sent troubler. Cher amant, prends pitié de Palmire éperdue !
Séide.
Palmire ! Quel objet vient effrayer ma vue ?
(Zopire paraît, appuyé sur l'autel, après s'être relevé derrière cet autel où il a reçu le coup.)
c'est cet infortuné luttant contre la mort, qui vers nous tout sanglant se traîne avec effort.
Séide.
Eh quoi ! Tu vas à lui ?
Palmire.
De remords dévorée, je cède à la pitié dont je suis déchirée. Je n'y puis résister ; elle entraîne mes sens.
Zopire, avançant et soutenu par elle.
Hélas ! Servez de guide à mes pas languissants !
(il s'assied.)
Séide, ingrat ! C'est toi qui m'arraches la vie ! Tu pleures ! Ta pitié succède à ta furie !
Zopire, Séide, Palmire, Phanor.
Phanor.
Ciel ! Quels affreux objets se présentent à moi !
Zopire.
Si je voyais Hercide ! ... ah ! Phanor, est-ce toi ? Voilà mon assassin.
Phanor.
ô crime ! Affreux mystère ! Assassin malheureux, connaissez votre père !
Séide.
Qui ?
Palmire.
Lui ?
Séide.
Mon père ?
Zopire.
ô ciel !
Phanor.
Hercide est expirant : il me voit, il m'appelle, il s'écrie en mourant : " s'il en est encor temps, préviens un parricide ; cours arracher ce fer à la main de Séide. Malheureux confident d'un horrible secret, je suis puni, je meurs des mains de Mahomet : cours, hâte-toi d'apprendre au malheureux Zopire que Séide est son fils, et frère de Palmire. "
Séide.
Vous !
Palmire.
Mon frère ?
Zopire.
ô mes fils ! ô nature ! ô mes dieux ! Vous ne me trompiez pas quand vous parliez pour eux. Vous m'éclairiez sans doute. Ah ! Malheureux Séide ! Qui t'a pu commander cet affreux homicide ?
Séide, se jetant à genoux.
L'amour de mon devoir et de ma nation, et ma reconnaissance, et ma religion ; tout ce que les humains ont de plus respectable m'inspira des forfaits le plus abominable. Rendez, rendez ce fer à ma barbare main.
Palmire, à genoux, arrêtant le bras de Séide.
Ah, mon père ! Ah, seigneur ! Plongez-le dans mon sein. J'ai seule à ce grand crime encouragé Séide ; l'inceste était pour nous le prix du parricide.
Séide.
Le ciel n'a point pour nous d'assez grands châtiments. Frappez vos assassins.
Zopire, en les embrassant.
J'embrasse mes enfants. Le ciel voulut mêler, dans les maux qu'il m'envoie, le comble des horreurs au comble de la joie. Je bénis mon destin ; je meurs, mais vous vivez. ô vous, qu'en expirant mon coeur a retrouvés, Séide, et vous, Palmire, au nom de la nature, par ce reste de sang qui sort de ma blessure, par ce sang paternel, par vous, par mon trépas, vengez-vous, vengez-moi ; mais ne vous perdez pas. L'heure approche, mon fils, où la trêve rompue laissait à mes desseins une libre étendue : les dieux de tant de maux ont pris quelque pitié ; le crime de tes mains n'est commis qu'à moitié. Le peuple avec le jour en ces lieux va paraître ; mon sang va les conduire ; ils vont punir un traître. Attendons ces moments.
Séide.
Ah ! Je cours de ce pas vous immoler ce monstre, et hâter mon trépas ; me punir, vous venger.
Zopire, Séide, Palmire, Phanor, Omar, suite.
Omar.
Qu'on arrête Séide ! Secourez tous Zopire ; enchaînez l'homicide. Mahomet n'est venu que pour venger les lois.
Zopire.
Ciel ! Quel comble du crime ! Et qu'est-ce que je vois ?
Séide.
Mahomet me punir ?
Palmire.
Eh quoi ! Tyran farouche, après ce meurtre horrible ordonné par ta bouche !
Omar.
On n'a rien ordonné.
Séide.
Va, j'ai bien mérité cet exécrable prix de ma crédulité.
Omar.
Soldats, obéissez.
Palmire.
Non ; arrêtez. Perfide !
Omar.
Madame, obéissez, si vous aimez Séide. Mahomet vous protége, et son juste courroux, prêt à tout foudroyer, peut s'arrêter par vous. Auprès de votre roi, madame, il faut me suivre.
Palmire.
Grand dieu ! De tant d'horreurs que la mort me délivre !
(on emmène Palmire et Séide.)
Zopire, à Phanor.
On les enlève ! ô ciel ! ô père malheureux ! Le coup qui m'assassine est cent fois moins affreux.
Phanor.
Déjà le jour renaît ; tout le peuple s'avance ; on s'arme, on vient à vous, on prend votre défense.
Zopire.
Quoi ! Séide est mon fils !
Phanor.
N'en doutez point.
Zopire.
Hélas ! ô forfaits ! ô nature ! ... allons, soutiens mes pas, je meurs. Sauvez, grands dieux ! De tant de barbarie mes deux enfants que j'aime, et qui m'ôtent la vie.
Mahomet, Omar ; suite, dans le fond.
Omar.
Zopire est expirant, et ce peuple éperdu levait déjà son front dans la poudre abattu. Tes prophètes et moi, que ton esprit inspire, nous désavouons tous le meurtre de Zopire. Ici, nous l'annonçons à ce peuple en fureur comme un coup du très-haut qui s'arme en ta faveur ; là, nous en gémissons ; nous promettons vengeance : nous vantons ta justice, ainsi que ta clémence. Partout on nous écoute, on fléchit à ton nom ; et ce reste importun de la sédition n'est qu'un bruit passager de flots après l'orage, dont le courroux mourant frappe encor le rivage quand la sérénité règne aux plaines du ciel.
Mahomet.
Imposons à ces flots un silence éternel. As-tu fait des remparts approcher mon armée ?
Omar.
Elle a marché la nuit vers la ville alarmée ; Osman la conduisait par de secrets chemins.
Mahomet.
Faut-il toujours combattre, ou tromper les humains ! Séide ne sait point qu'aveugle en sa furie il vient d'ouvrir le flanc dont il reçut la vie ?
Omar.
Qui pourrait l'en instruire ? Un éternel oubli tient avec ce secret Hercide enseveli : Séide va le suivre, et son trépas commence. J'ai détruit l'instrument qu'employa ta vengeance. Tu sais que dans son sang ses mains ont fait couler le poison qu'en sa coupe on avait su mêler. Le châtiment sur lui tombait avant le crime ; et tandis qu'à l'autel il traînait sa victime, tandis qu'au sein d'un père il enfonçait son bras, dans ses veines, lui-même, il portait son trépas. Il est dans la prison, et bientôt il expire. Cependant en ces lieux j'ai fait garder Palmire. Palmire à tes desseins va même encor servir : croyant sauver Séide, elle va t'obéir. Je lui fais espérer la grâce de Séide. Le silence est encor sur sa bouche timide ; son coeur toujours docile, et fait pour t'adorer, en secret seulement n'osera murmurer. Législateur, prophète, et roi dans ta patrie, Palmire achèvera le bonheur de ta vie. Tremblante, inanimée, on l'amène à tes yeux.
Mahomet.
Va rassembler mes chefs, et revole en ces lieux.
Mahomet, Palmire ; suite de Palmire et de Mahomet.
Palmire.
Ciel ! Où suis-je ? Ah, grand dieu !
Mahomet.
Soyez moins consternée ; j'ai du peuple et de vous pesé la destinée, le grand événement qui vous remplit d'effroi, Palmire, est un mystère entre le ciel et moi. De vos indignes fers à jamais dégagée, vous êtes en ces lieux libre, heureuse, et vengée. Ne pleurez point Séide, et laissez à mes mains le soin de balancer le destin des humains. Ne songez plus qu'au vôtre ; et si vous m'êtes chère, si Mahomet sur vous jeta des yeux de père, sachez qu'un sort plus noble, un titre encor plus grand, si vous le méritez, peut-être vous attend. Portez vos yeux hardis au faîte de la gloire ; de Séide et du reste étouffez la mémoire : vos premiers sentiments doivent tous s'effacer à l'aspect des grandeurs où vous n'osiez penser. Il faut que votre coeur à mes bontés réponde, et suive en tout mes lois, lorsque j'en donne au monde.
Palmire.
Qu'entends-je ? Quelles lois, ô ciel ! Et quels bienfaits ! Imposteur teint de sang, que j'abjure à jamais, bourreau de tous les miens, va, ce dernier outrage manquait à ma misère, et manquait à ta rage. Le voilà donc, grand dieu ! Ce prophète sacré, ce roi que je servis, ce dieu que j'adorai ! Monstre, dont les fureurs et les complots perfides de deux coeurs innocents ont fait deux parricides ; de ma faible jeunesse infâme séducteur, tout souillé de mon sang, tu prétends à mon coeur ? Mais tu n'as pas encore assuré ta conquête ; le voile est déchiré, la vengeance s'apprête. Entends-tu ces clameurs ? Entends-tu ces éclats ? Mon père te poursuit des ombres du trépas. Le peuple se soulève ; on s'arme en ma défense ; leurs bras vont à ta rage arracher l'innocence. Puissé-je de mes mains te déchirer le flanc, voir mourir tous les tiens, et nager dans leur sang ! Puissent la Mecque ensemble, et Médine, et l'Asie, punir tant de fureur et tant d'hypocrisie ? Que le monde, par toi séduit et ravagé, rougisse de ses fers, les brise, et soit vengé ! Que ta religion, qui fonda l'imposture, soit l'éternel mépris de la race future ! Que l'enfer, dont tes cris menaçaient tant de fois quiconque osait douter de tes indignes lois ; que l'enfer, que ces lieux de douleur et de rage, pour toi seul préparés, soient ton juste partage ! Voilà les sentiments qu'on doit à tes bienfaits, l'hommage, les serments, et les voeux que je fais !
Mahomet.
Je vois qu'on m'a trahi ; mais quoi qu'il en puisse être, et qui que vous soyez, fléchissez sous un maître. Apprenez que mon coeur...
Mahomet, Palmire, Omar, Ali, suite.
Omar.
On sait tout, Mahomet : Hercide en expirant révéla ton secret. Le peuple en est instruit ; la prison est forcée ; tout s'arme, tout s'émeut : une foule insensée, élevant contre toi ses hurlements affreux, porte le corps sanglant de son chef malheureux. Séide est à leur tête ; et, d'une voix funeste, les excite à venger ce déplorable reste. Ce corps, souillé de sang, est l'horrible signal qui fait courir ce peuple à ce combat fatal. Il s'écrie en pleurant : " je suis un parricide ! " la douleur le ranime, et la rage le guide. Il semble respirer pour se venger de toi. On déteste ton dieu, tes prophètes, ta loi. Ceux même qui devaient dans la Mecque alarmée faire ouvrir, cette nuit, la porte à ton armée, de la fureur commune avec zèle enivrés, viennent lever sur toi leurs bras désespérés. On n'entend que les cris de mort et de vengeance.
Palmire.
Achève, juste ciel ! Et soutiens l'innocence. Frappe.
Mahomet, à Omar.
Eh bien ! Que crains-tu ?
Omar.
Tu vois quelques amis, qui contre les dangers comme moi raffermis, mais vainement armés contre un pareil orage, viennent tous à tes pieds mourir avec courage.
Mahomet.
Seul je les défendrai. Rangez-vous près de moi, et connaissez enfin qui vous avez pour roi.
Mahomet, Omar, sa suite, d'un côté ; Séide et le peuple, de l'autre ; Palmire, au milieu.
Séide, un poignard à la main, mais déjà affaibli par le poison.
Peuple, vengez mon père, et courez à ce traître.
Mahomet.
Peuple, né pour me suivre, écoutez votre maître.
Séide.
N'écoutez point ce monstre, et suivez-moi... grands dieux ! Quel nuage épaissi se répand sur mes yeux !
(il avance, il chancelle.)
frappons... ciel ! Je me meurs.
Mahomet.
Je triomphe.
Palmire, courant à lui.
Ah, mon frère ! N'auras-tu pu verser que le sang de ton père ?
Séide.
Avançons. Je ne puis... quel dieu vient m'accabler ?
(il tombe entre les bras des siens.)
Mahomet.
Ainsi tout téméraire à mes yeux doit trembler. Incrédules esprits, qu'un zèle aveugle inspire, qui m'osez blasphémer, et qui vengez Zopire, ce seul bras que la terre apprit à redouter, ce bras peut vous punir d'avoir osé douter. Dieu qui m'a confié sa parole et sa foudre, si je me veux venger, va vous réduire en poudre. Malheureux ! Connaissez son prophète et sa loi, et que ce dieu soit juge entre Séide et moi. De nous deux, à l'instant, que le coupable expire !
Palmire.
Mon frère ! Eh quoi ! Sur eux ce monstre a tant d'empire ! Ils demeurent glacés, ils tremblent à sa voix. Mahomet, comme un dieu, leur dicte encor ses lois : et toi, Séide, aussi ! Séide, entre les bras des siens. Le ciel punit ton frère. Mon crime était horrible autant qu'involontaire ; en vain la vertu même habitait dans mon coeur. Toi, tremble, scélérat ! Si dieu punit l'erreur, vois quel foudre il prépare aux artisans des crimes : tremble ; son bras s'essaie à frapper ses victimes. Détournez d'elle, ô dieu ! Cette mort qui me suit !
Palmire.
Non, peuple, ce n'est point un dieu qui le poursuit ; non ; le poison sans doute...
Mahomet, en l'interrompant, et s'adressant au peuple.
Apprenez, infidèles, à former contre moi des trames criminelles : aux vengeances des cieux reconnaissez mes droits. La nature et la mort ont entendu ma voix. La mort, qui m'obéit, qui, prenant ma défense, sur ce front pâlissant a tracé ma vengeance ; la mort est, à vos yeux, prête à fondre sur vous. Ainsi mes ennemis sentiront mon courroux ; ainsi je punirai les erreurs insensées, les révoltes du coeur, et les moindres pensées. Si ce jour luit pour vous, ingrats, si vous vivez, rendez grâce au pontife à qui vous le devez. Fuyez, courez au temple apaiser ma colère.
(le peuple se retire.)
Palmire, revenant à elle.
Arrêtez. Le barbare empoisonna mon frère. Monstre, ainsi son trépas t'aura justifié ! à force de forfaits tu t'es déifié. Malheureux assassin de ma famille entière, ôte-moi de tes mains ce reste de lumière. ô frère ! ô triste objet d'un amour plein d'horreurs ! Que je te suive au moins !
(elle se jette sur le poignard de son frère, et s'en frappe.)
Mahomet.
Qu'on l'arrête !
Palmire.
Je meurs. Je cesse de te voir, imposteur exécrable. Je me flatte, en mourant, qu'un dieu plus équitable réserve un avenir pour les coeurs innocents. Tu dois régner ; le monde est fait pour les tyrans.
Mahomet.
Elle m'est enlevée... ah ! Trop chère victime ! Je me vois arracher le seul prix de mon crime. De ses jours pleins d'appas détestable ennemi, vainqueur et tout-puissant, c'est moi qui suis puni. Il est donc des remords ! ô fureur ! ô justice ! Mes forfaits dans mon coeur ont donc mis mon supplice ! Dieu, que j'ai fait servir au malheur des humains, adorable instrument de mes affreux desseins, toi que j'ai blasphémé, mais que je crains encore, je me sens condamné, quand l'univers m'adore. Je brave en vain les traits dont je me sens frapper. J'ai trompé les mortels, et ne puis me tromper. Père, enfants malheureux, immolés à ma rage, vengez la terre et vous, et le ciel que j'outrage. Arrachez-moi ce jour, et ce perfide coeur, ce coeur né pour haïr, qui brûle avec fureur.
(à Omar.)
et toi, de tant de honte étouffe la mémoire ; cache au moins ma faiblesse, et sauve encor ma gloire : je dois régir en dieu l'univers prévenu ; mon empire est détruit si l'homme est reconnu.
Vision de Babouc écrite par lui-même.
Parmi les génies, qui président aux empires du monde, Ituriel tient un des premiers rangs, et il a le département de la haute Asie. Il descendit un matin dans la demeure du Scythe Babouc, sur le rivage de l'Oxus, et lui dit: "Babouc, les folies et les excès des Perses ont attiré notre colère: il s'est tenu hier une assemblée des génies de la haute Asie pour savoir si on châtierait Persépolis, ou si on la détruirait. Va dans cette ville, examine tout; tu reviendras m'en rendre un compte fidèle, et je me déterminerai, sur ton rapport, à corriger la ville ou à l'exterminer. - Mais, seigneur, dit humblement Babouc, je n'ai jamais été en Perse; je n'y connais personne. - Tant mieux, dit l'ange, tu ne seras point partial; tu a reçu du Ciel le discernement et j'y ajoute le don d'inspirer la confiance; marche, regarde, écoute, observe, et ne crains rien; tu seras partout bien reçu."
Babouc monta sur son chameau et partit avec ses serviteurs. Au bout de quelques journées, il rencontra vers les plaines de Sennaar l'armée persane, qui allait combattre l'armée indienne. Il s'adressa d'abord à un soldat qu'il trouva écarté. Il lui parla, et lui demanda quel était le sujet de la guerre. "Par tous les dieux, dit le soldat, je n'en sais rien. Ce n'est pas mon affaire: mon métier est de tuer et d'être tué pour gagner ma vie; il n'importe qui je serve. Je pourrais bien même dès demain passer dans le camp des Indiens: car on dit qu'ils donnent près d'une demi drachme de cuivre par jour à leurs soldats de plus que nous n'en avons dans ce maudit service de Perse. Si vous voulez savoir pourquoi on se bat, parlez à mon capitaine."
Babouc ayant fait un petit présent au soldat entra dans le camp. Il fit bientôt connaissance avec le capitaine, et lui demanda le sujet de la guerre. "Comment voulez-vous que je le sache? dit le capitaine, et que m'importe ce beau sujet? J'habite à deux cents lieues de Persépolis; j'entends dire que la guerre est déclarée; j'abandonne aussitôt ma famille, et je vais chercher, selon notre coutume, la fortune ou la mort, attendu que je n'ai rien à faire. - Mais vos camarades, dit Babouc, ne sont-ils pas un peu plus instruits que vous? - Non, dit l'officier; il n'y a guère que nos principaux satrapes qui savent bien précisément pourquoi on s'égorge."
Babouc, étonné, s'introduisit chez les généraux; il entra dans leur familiarité. L'un d'eux lui dit enfin: "La cause de cette guerre, qui désole depuis vingt ans l'Asie, vient originairement d'une querelle entre un eunuque d'une femme du grand roi de Perse, et un commis d'un bureau du grand roi des Indes. Il s'agissait d'un droit qui revenait à peu près à la trentième partie d'une darique. Le premier ministre des Indes et le nôtre soutinrent dignement les droits de leurs maîtres. La querelle s'échauffa. On mit de part et d'autre en campagne une armée d'un million de soldats. Il faut recruter cette armée tous les ans de plus de quatre cent mille hommes. Les meurtres, les incendies, les ruines, les dévastations, se multiplient; l'univers souffre, et l'acharnement continue. Notre premier ministre et celui des Indes protestent souvent qu'ils n'agissent que pour le bonheur du genre humain; et à chaque protestation il y a toujours quelque ville détruite et quelques provinces ravagées."
Le lendemain, sur un bruit qui se répandit que la paix allait être conclue, le général persan et le général indien s'empressèrent de donner bataille; elle fut sanglante. Babouc en vit toutes les fautes et toutes les abominations; il fut témoin des manœuvres des principaux satrapes, qui firent ce qu'ils purent pour faire battre leur chef. Il vit des officiers tués par leurs propres troupes; il vit des soldats qui achevaient d'égorger leurs camarades expirants pour leur arracher quelques lambeaux sanglants, déchirés et couverts de fange. Il entra dans les hôpitaux où l'on transportait les blessés, dont la plupart expiraient par la négligence inhumaine de ceux mêmes que le roi de Perse payait chèrement pour les secourir. "Sont-ce là des hommes, s'écria Babouc, ou des bêtes féroces? Ah! je vois bien que Persépolis sera détruite."
Occupé de cette pensée, il passa dans le camp des Indiens: il y fut aussi bien reçu que dans celui des Perses, selon ce qui lui avait été prédit; mais il y vit tous les mêmes excès qui l'avaient saisi d'horreur. "Oh, oh! dit-il en lui-même, si l'ange Ituriel veut exterminer les Persans, il faut donc que l'ange des Indes détruise aussi les Indiens." S'étant ensuite informé plus en détail de ce qui s'était passé dans l'une et l'autre armée, il apprit des actions de générosité, de grandeur d'âme, d'humanité, qui l'étonnèrent et le ravirent. "Inexplicables humains, s'écria-t-il, comment pouvez-vous réunir tant de bassesse et de grandeur, tant de vertus et de crimes?"
Cependant la paix fut déclarée. Les chefs des deux armées, dont aucun n'avait remporté la victoire, mais qui, pour leur seul intérêt, avaient fait verser le sang de tant d'hommes, leurs semblables, allèrent briguer dans leurs cours des récompenses. On célébra la paix dans des écrits publics qui n'annonçaient que le retour de la vertu et de la félicité sur la terre. "Dieu soit loué! dit Babouc; Persépolis sera le séjour de l'innocence épurée; elle ne sera point détruite comme le voulaient ces vilains génies: courons sans tarder dans cette capitale de l'Asie."
Il arriva dans cette ville immense par l'ancienne entrée, qui était toute barbare, et dont la rusticité dégoûtante offensait les yeux. Toute cette partie de la ville se ressentait du temps où elle avait été bâtie: car, malgré l'opiniâtreté des hommes à louer l'antique aux dépens du moderne, il faut avouer qu'en tout genre les premiers essais sont toujours grossiers.
Babouc se mêla dans la foule d'un peuple composé de ce qu'il y avait de plus sale et de plus laid dans les deux sexes. Cette foule se précipitait d'un air hébété dans un enclos vaste et sombre. Au bourdonnement continuel, au mouvement qu'il y remarqua, à l'argent que quelques personnes donnaient à d'autres pour avoir droit de s'asseoir, il crut être dans un marché où l'on vendait des chaises de pailles; mais bientôt, voyant que plusieurs femmes se mettaient à genoux, en faisant semblant de regarder fixement devant elles, et en regardant les hommes de côté, il s'aperçut qu'il était dans un temple. Des voix aigres, rauques, sauvages, discordantes, faisaient retentir la voûte de sons mal articulés qui faisaient le même effet que les voix des onagres quand elles répondent, dans les plaines des Pictaves, au cornet à bouquin qui les appelle. Il se bouchait les oreilles; mais il fut près de se boucher encore les yeux et le nez quand il vit entrer dans ce temple des ouvriers avec des pinces et des pelles. Ils remuèrent une large pierre, et jetèrent à droite et à gauche une terre dont s'exhalait une odeur empestée; ensuite on vint poser un mort dans cette ouverture, et on remit la pierre par-dessus.
"Quoi! s'écria Babouc, ces peuples enterrent leurs morts dans les mêmes lieux où ils adorent la Divinité! Quoi! leurs temples sont pavés de cadavres! Je ne m'étonne plus de ces maladies pestilentielles qui désolent souvent Persépolis. La pourriture des morts, et celle de tant de vivants rassemblés et pressés dans le même lieu, est capable d'empoisonner le globe terrestre. Ah! la vilaine ville que Persépolis! Apparemment que les anges veulent la détruire pour en rebâtir une plus belle, et pour la peupler d'habitants moins malpropres, et qui chantent mieux. La Providence peut avoir ses raisons; laissons-la faire."
Cependant le soleil approchait du haut de sa carrière. Babouc devait aller dîner à l'autre bout de la ville, chez une dame pour laquelle son mari, officier de l'armée, lui avait donné des lettres. Il fit d'abord plusieurs tours dans Persépolis; il vit d'autres temples mieux bâtis et mieux ornés, remplis d'un peuple poli, et retentissant d'une musique harmonieuse; il remarqua des fontaines publiques, lesquelles, quoique mal placées, frappaient les yeux par leur beauté; des places où semblaient respirer en bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné la Perse; d'autres places où il entendait le peuple s'écrier: "Quand verrons-nous ici le maître que nous chérissons?" Il admira les ponts magnifiques élevés sur le fleuve, les quais superbes et commodes, les palais bâtis à droite et à gauche, une maison immense où des milliers de vieux soldats blessés et vainqueurs rendaient chaque jour grâces au Dieu des armées. Il entra enfin chez la dame, qui l'attendait à dîner avec une compagnie d'honnêtes gens. La maison était propre et ornée, le repas délicieux, la dame jeune, belle, spirituelle, engageante, la compagnie digne d'elle; et Babouc disait en lui-même à tout moment: "L'ange Ituriel se moque du monde de vouloir détruire une ville si charmante."
Cependant il s'aperçut que la dame, qui avait commencé par lui demander tendrement des nouvelles de son mari, parlait plus tendrement encore, sur la fin du repas, à un jeune mage. Il vit un magistrat qui, en présence de sa femme, pressait avec vivacité une veuve; et cette veuve indulgente avait une main passée autour du cou du magistrat, tandis qu'elle tendait l'autre à un jeune citoyen très beau et très modeste. La femme du magistrat se leva de table la première pour aller entretenir dans un cabinet voisin son directeur, qui arrivait trop tard et qu'on avait attendu à dîner; et le directeur, homme éloquent, lui parla dans ce cabinet avec tant de véhémence et d'onction que la dame avait, quand elle revint, les yeux humides, les joues enflammées, la démarche mal assurée, la parole tremblante.
Alors Babouc commença à craindre que le génie Ituriel n'eût raison. Le talent qu'il avait d'attirer la confiance le mit dès le jour même dans les secrets de la dame: elle lui confia son goût pour le jeune mage, et l'assura que dans toutes les maisons de Persépolis il trouverait l'équivalent de ce qu'il avait vu dans la sienne. Babouc conclut qu'une telle société ne pouvait subsister; que la jalousie, la discorde, la vengeance, devaient désoler toutes les maisons; que les larmes et le sang devaient couler tous les jours; que certainement les maris tueraient les galants de leurs femmes, ou en seraient tués; et qu'enfin Ituriel faisait fort bien de détruire tout d'un coup une ville abandonnée à de continuels désastres.
Il était plongé dans ces idées funestes, quand il se présenta à la porte un homme grave en manteau noir, qui demanda humblement à parler au jeune magistrat. Celui-ci, sans se lever, sans le regarder, lui donna fièrement, et d'un air distrait, quelques papiers, et le congédia. Babouc demanda quel était cet homme. La maîtresse de la maison lui dit tout bas: "C'est un des meilleurs avocats de la ville; il y a cinquante ans qu'il étudie les lois. Monsieur, qui n'a que vingt-cinq ans, et qui est satrape de loi depuis deux jours, lui donne à faire l'extrait d'un procès qu'il doit juger, qu'il n'a pas encore examiné. - Ce jeune étourdi fait sagement, dit Babouc, de demander conseil à un vieillard; mais pourquoi n'est-ce pas ce vieillard qui est juge? - Vous vous moquez, lui dit-on; jamais ceux qui ont vieilli dans les emplois laborieux et subalternes ne parviennent aux dignités. Ce jeune homme a une grande charge, parce que son père est riche, et qu'ici le droit de rendre la justice s'achète comme une métairie. - O mœurs! ô malheureuse ville! s'écria Babouc; voilà le comble du désordre; sans doute ceux qui ont ainsi acheté le droit de juger vendent leurs jugements: je ne vois ici que des abîmes d'iniquité."
Comme il marquait ainsi sa douleur et sa surprise, un jeune guerrier, qui était revenu ce jour même de l'armée, lui dit: "Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on achète les emplois de la robe? J'ai bien acheté, moi, le droit d'affronter la mort à la tête de deux mille hommes, que je commande; il m'en a coûté quarante mille dariques d'or, cette année, pour coucher sur la terre trente nuits de suite en habit rouge, et pour recevoir ensuite deux bons coups de flèches dont je me sens encore. Si je me ruine pour servir l'empereur persan, que je n'ai jamais vu, M. le satrape de robe peut bien payer quelque chose pour avoir le plaisir de donner audience à des plaideurs." Babouc, indigné, ne put s'empêcher de condamner dans son cœur un pays où l'on mettait à l'encan les dignités de la paix et de la guerre; il conclut précipitamment que l'on y devait ignorer absolument la guerre et les lois, et que, quand même Ituriel n'exterminerait pas ces peuples, ils périraient par leur détestable administration.
Sa mauvaise opinion augmenta encore à l'arrivée d'un gros homme qui, ayant salué très familièrement toute la compagnie, s'approcha du jeune officier, et lui dit: "Je ne peux vous prêter que cinquante mille dariques d'or, car, en vérité, les douanes de l'empire ne m'en ont rapporté que trois cent mille cette année." Babouc s'informa quel était cet homme qui se plaignait de gagner si peu; il apprit qu'il y avait dans Persépolis quarante rois plébéiens qui tenaient à bail l'empire de Perse, et qui en rendaient quelque chose au monarque.
Après dîner, il alla dans un des plus superbes temples de la ville; il s'assit au milieu d'une troupe de femmes et d'hommes qui étaient venus là pour passer le temps. Un mage parut dans une machine élevée, qui parla longtemps du vice et de la vertu. Ce mage divisa en plusieurs parties ce qui n'avait pas besoin d'être divisé; il prouva méthodiquement tout ce qui était clair; il enseigna tout ce qu'on savait. Il se passionna froidement, et sortit suant et hors d'haleine. Toute l'assemblée alors se réveilla, et crut avoir assisté à une instruction. Babouc dit: "Voilà un homme qui a fait de son mieux pour ennuyer deux ou trois cents de ses concitoyens; mais son intention était bonne, et il n'y a pas là de quoi détruire Persépolis."
Au sortir de cette assemblée, on le mena voir une fête publique qu'on donnait tous les jours de l'année: c'était dans une espèce de basilique, au fond de laquelle on voyait un palais. Les plus belles citoyennes de Persépolis, les plus considérables satrapes, rangés avec ordre, formaient un spectacle si beau que Babouc crut d'abord que c'était là toute la fête. Deux ou trois personnes, qui paraissaient des rois et des reines, parurent bientôt dans le vestibule de ce palais; leur langage était très différent de celui du peuple; il était mesuré, harmonieux, et sublime. Personne ne dormait, on écoutait dans un profond silence, qui n'était interrompu que par les témoignages de la sensibilité et de l'admiration publique. Le devoir des rois, l'amour de la vertu, les dangers des passions, étaient exprimés par des traits si vifs et si touchants que Babouc versa des larmes. Il ne douta pas que ces héros et ces héroïnes, ces rois et ces reines qu'il venait d'entendre, ne fussent les prédicateurs de l'empire; il se proposa même d'engager Ituriel à les venir entendre, bien sûr qu'un tel spectacle les réconcilierait pour jamais avec la ville.
Dès que cette fête fut finie, il voulut voir la principale reine qui avait débité dans ce beau palais une morale si noble et si pure; il se fit introduire chez Sa Majesté; on le mena par un petit escalier, au second étage, dans un appartement mal meublé, où il trouva une femme mal vêtue qui lui dit, d'un air noble et pathétique: "Ce métier-ci ne me donne pas de quoi vivre; un des princes que vous avez vus m'a fait un enfant; j'accoucherai bientôt; je manque d'argent et sans argent on n'accouche point." Babouc lui donna cent dariques d'or, en disant: "S'il n'y avait que ce mal-là dans la ville, Ituriel aurait tort de se tant fâcher."
De là il alla passer sa soirée chez des marchands de magnificences inutiles. Un homme intelligent, avec lequel il avait fait connaissance, l'y mena; il acheta ce qui lui plut, et on le lui vendit avec politesse beaucoup plus qu'il ne valait. Son ami, de retour chez lui, lui fit voir combien on le trompait. Babouc mit sur ses tablettes le nom du marchand, pour le faire distinguer par Ituriel au jour de la punition de la ville. Comme il écrivait, on frappa à sa porte; c'était le marchand lui-même qui venait lui rapporter sa bourse, que Babouc avait laissée par mégarde sur son comptoir. "Comment se peut-il, s'écria Babouc, que vous soyez si fidèle et si généreux, après n'avoir pas eu de honte de me vendre des colifichets quatre fois au-dessus de leur valeur? - Il n'y a aucun négociant un peu connu dans cette ville, lui répondit le marchand, qui ne fût venu vous rapporter votre bourse; mais on vous a trompé quand on vous a dit que je vous avais vendu ce que vous avez pris chez moi quatre fois plus qu'il ne vaut: je vous l'ai vendu dix fois davantage, et cela est si vrai que, si dans un mois vous voulez le revendre, vous n'en aurez pas même ce dixième. Mais rien n'est plus juste; c'est la fantaisie des hommes qui met le prix à ces choses frivoles; c'est cette fantaisie qui fait vivre cent ouvriers que j'emploie; c'est elle qui me donne une belle maison, un char commode, des chevaux; c'est elle qui excite l'industrie, qui entretient le goût, la circulation, et l'abondance. Je vend aux nations voisines les mêmes bagatelles plus chèrement qu'à vous, et par là je suis utile à l'empire." Babouc, après avoir un peu rêvé, le raya de ses tablettes.
Babouc, fort incertain sur ce qu'il devait penser de Persépolis, résolut de voir les mages et les lettrés: car les uns étudient la sagesse, et les autres la religion; et il se flatta que ceux-là obtiendraient grâce pour le reste du peuple. Dès le lendemain matin il se transporta dans un collège de mages. L'archimandrite lui avoua qu'il avait cent mille écus de rente pour avoir fait vœu de pauvreté, et qu'il exerçait un empire assez étendu en vertu de son vœu d'humilité; après quoi il laissa Babouc entre les mains d'un petit frère qui lui fit les honneurs.
Tandis que ce frère lui montrait les magnificences de cette maison de pénitence, un bruit se répandit qu'il était venu pour réformer toutes ces maisons. Aussitôt il reçut des mémoires de chacune d'elles; et les mémoires disaient tous en substance: "Conservez-nous, et détruisez toutes les autres." A entendre leurs apologies, ces sociétés étaient toutes nécessaires; à entendre leurs accusations réciproques, elles méritaient toutes d'être anéanties. Il admirait comme il n'y en avait aucune d'elles qui, pour édifier l'univers, ne voulût en avoir l'empire. Alors il se présenta un petit homme qui était un demi-mage, et qui lui dit: "Je vois bien que l'œuvre va s'accomplir, car Zerdust est revenu sur la terre; les petites filles prophétisent en se faisant donner des coups de pincettes par-devant et le fouet par-derrière. Ainsi nous vous demandons votre protection contre le grand-lama. - Comment! dit Babouc, contre ce pontife-roi qui réside au Thibet? - Contre lui-même. - Vous lui faites donc la guerre, et vous levez contre lui des armées? - Non; mais il dit que l'homme est libre et nous n'en croyons rien; nous écrivons contre lui de petits livres qu'il ne lit pas: à peine a-t-il entendu parler de nous; il nous a seulement fait condamner, comme un maître ordonne qu'on échenille les arbres de ses jardins." Babouc frémit de la folie de ces hommes qui faisaient profession de sagesse, des intrigues de ceux qui avaient renoncé au monde, de l'ambition et de la convoitise orgueilleuse de ceux qui enseignaient l'humilité et le désintéressement; il conclut qu'Ituriel avait de bonnes raisons pour détruire toute cette engeance.
Retiré chez lui, il envoya chercher des livres nouveaux pour adoucir son chagrin, et il pria quelques lettrés à dîner pour se réjouir. Il en vint deux fois plus qu'il n'en avait demandé, comme les guêpes que le miel attire. Ces parasites se pressaient de manger et de parler; ils louaient deux sortes de personnes, les morts et eux-mêmes, et jamais leurs contemporains, excepté le maître de la maison. Si quelqu'un d'eux disait un bon mot, les autres baissaient les yeux et se mordaient les lèvres de douleur de ne l'avoir pas dit. Ils avaient moins de dissimulation que les mages, parce qu'ils n'avaient pas de si grands objets d'ambition. Chacun d'eux briguait une place de valet et une réputation de grand homme; ils se disaient en face des choses insultantes, qu'ils croyaient des traits d'esprit. Ils avaient eu quelque connaissance de la mission de Babouc. L'un d'eux le pria tout bas d'exterminer un auteur qui ne l'avait pas assez loué il y avait cinq ans; un autre demanda la perte d'un citoyen qui n'avait jamais ri à ses comédies; un troisième demanda l'extinction de l'Académie, parce qu'il n'avait jamais pu parvenir à y être admis. Le repas fini, chacun d'eux s'en alla seul, car il n'y avait pas dans toutes la troupe deux hommes qui pussent se souffrir, ni même se parler ailleurs que chez les riches qui les invitaient à leur table. Babouc jugea qu'il n'y aurait pas grand mal quand cette vermine périrait dans la destruction générale.
Dès qu'il se fut défait d'eux, il se mit à lire quelques livres nouveaux. Il y reconnut l'esprit de ses convives. Il vit surtout avec indignation ces gazettes de la médisance, ces archives du mauvais goût, que l'envie, la bassesse et la faim ont dictées; ces lâches satires où l'on ménage le vautour et où l'on déchire la colombe; ces romans dénués d'imagination, où l'on voit tant de portraits de femmes que l'auteur ne connaît pas.
Il jeta au feu tous ces détestables écrits, et sortit pour aller le soir à la promenade. On le présenta à un vieux lettré qui n'était point venu grossir le nombre de ses parasites. Ce lettré fuyait toujours la foule, connaissait les hommes, en faisait usage, et se communiquait avec discrétion. Babouc lui parla avec douleur de ce qu'il avait lu et de ce qu'il avait vu.
"Vous avez lu des choses bien méprisables, lui dit le sage lettré; mais dans tous les temps, et dans tous les pays, et dans tous les genres, le mauvais fourmille, et le bon est rare. Vous avez reçu chez vous le rebut de la pédanterie, parce que, dans toutes les professions, ce qu'il y a de plus indigne de paraître est toujours ce qui se présente avec le plus d'impudence. Les véritables sages vivent entre eux retirés et tranquilles; il y a encore parmi nous des hommes et des livres dignes de votre attention." Dans le temps qu'il parlait ainsi, un autre lettré les joignit; leurs discours furent si agréables et si instructifs, si élevés au-dessus des préjugés et si conformes à la vertu, que Babouc avoua n'avoir jamais rien entendu de pareil. "Voilà des hommes, disait-il tout bas, à qui l'ange Ituriel n'osera toucher, ou il sera bien impitoyable."
Accommodé avec les lettrés, il était toujours en colère contre le reste de la nation. "Vous êtes étranger, lui dit l'homme judicieux qui lui parlait; les abus se présentent à vos yeux en foule, et le bien, qui est caché et qui résulte quelquefois de ces abus mêmes, vous échappe." Alors il apprit que parmi les lettrés il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas envieux, et que parmi les mages mêmes il y en avait de vertueux. Il conçut à la fin que ces grands corps, qui semblaient en se choquant préparer leurs communes ruines, étaient au fond des institutions salutaires; que chaque société de mages était un frein à ses rivales; que si ces émules différaient dans quelques opinions, ils enseignaient tous la même morale, qu'ils instruisaient le peuple, et qu'ils vivaient soumis aux lois, semblables aux précepteurs qui veillent sur le fils de la maison, tandis que le maître veille sur eux-mêmes. Il en pratiqua plusieurs, et vit des âmes célestes. Il apprit même que parmi les fous qui prétendaient faire la guerre au grand lama, il y avait eu de très grands hommes. Il soupçonna enfin qu'il pourrait bien en être des mœurs de Persépolis comme des édifices, dont les uns lui avaient paru dignes de pitié, et les autres l'avaient ravi en admiration.
Il dit à son lettré: "Je connais très bien que ces mages, que j'avais crus si dangereux, sont en effet très utiles, surtout quand un gouvernement sage les empêche de se rendre trop nécessaires; mais vous m'avouerez au moins que vos jeunes magistrats, qui achètent une charge de juge dès qu'ils ont appris à monter à cheval, doivent étaler dans les tribunaux tout ce que l'impertinence a de plus ridicule, et tout ce que l'iniquité a de plus pervers; il vaudrait mieux sans doute donner ces places gratuitement à ces vieux jurisconsultes qui ont passé toute leur vie à peser le pour et le contre."
Le lettré lui répliqua: "Vous avez vu notre armée avant d'arriver à Persépolis; vous savez que nos jeunes officiers se battent très bien, quoiqu'ils aient acheté leurs charges: peut-être verrez-vous que nos jeunes magistrats ne jugent pas mal, quoiqu'ils aient payé pour juger."
Il le mena le lendemain au grand tribunal, où l'on devait rendre un arrêt important. La cause était connue de tout le monde. Tous ces vieux avocats qui en parlaient étaient flottants dans leurs opinions; ils alléguaient cent lois, dont aucune n'était applicable au fond de la question; ils regardaient l'affaire par cent côtés, dont aucun n'était dans son vrai jour: les juges décidèrent plus vite que les avocats ne doutèrent. Leur jugement fut presque unanime; ils jugèrent bien, parce qu'ils suivaient les lumières de la raison; et les autres avaient opiné mal parce qu'ils n'avaient consulté que leurs livres.
Babouc conclut qu'il y avait souvent de très bonnes choses dans les abus. Il vit dès le jour même que les richesses des financiers, qui l'avaient tant révolté, pouvaient produire un effet excellent, car, l'empereur ayant eu besoin d'argent, il trouva en une heure, par leur moyen, ce qu'il n'aurait pas eu en six mois par les voies ordinaires; il vit que ces gros nuages, enflés de la rosée de la terre, lui rendaient en pluie ce qu'ils en recevaient. D'ailleurs, les enfants de ces hommes nouveaux, souvent mieux élevés que ceux des familles plus anciennes, valaient quelquefois beaucoup mieux: car rien n'empêche qu'on ne soit un bon juge, un brave guerrier, un homme d'Etat habile, quand on a eu un père bon calculateur.
Insensiblement Babouc faisait grâce à l'avidité du financier, qui n'est pas au fond plus avide que les autres hommes, et qui est nécessaire. Il excusait la folie de se ruiner pour juger et pour se battre, folie qui produit de grands magistrats et des héros. Il pardonnait à l'envie des lettrés, parmi lesquels il se trouvait des hommes qui éclairaient le monde; il se réconciliait avec les mages ambitieux et intrigants, chez lesquels il y avait plus de grandes vertus encore que de petits vices; mais il lui restait bien des griefs, et surtout les galanteries des dames, et les désolations qui en devaient être la suite le remplissaient d'inquiétude et d'effroi.
Comme il voulait pénétrer dans toutes les conditions humaines, il se fit mener chez un ministre; mais il tremblait toujours en chemin que quelque femme ne fût assassinée en sa présence par son mari. Arrivé chez l'homme d'Etat, il resta deux heures dans l'antichambre sans être annoncé, et deux heures encore après l'avoir été. Il se promettait bien dans cet intervalle de recommander à l'ange Ituriel et le ministre et ses insolents huissiers. L'antichambre était remplie de dames de tout étage, de mages de toutes couleurs, de juges, de marchands, d'officiers, de pédants; tous se plaignaient du ministre. L'avare et l'usurier disaient: "Sans doute cet homme-là pille les provinces"; le capricieux lui reprochait d'être bizarre; le voluptueux disait: "Il ne songe qu'à ses plaisirs"; l'intrigant se flattait de le voir bientôt perdu par une cabale; les femmes espéraient qu'on leur donneraient bientôt un ministre plus jeune.
Babouc entendait leurs discours; il ne put s'empêcher de dire: "Voilà un homme bien heureux, il a tous ses ennemis dans son antichambre; il écrase de son pouvoir ceux qui l'envient; il voit à ses pieds ceux qui le détestent." Il entra enfin; il vit un petit vieillard courbé sous le poids des années et des affaires, mais encore vif et plein d'esprit.
Babouc lui plut, et il parut à Babouc un homme estimable. La conversation devint intéressante. Le ministre lui avoua qu'il était un homme très malheureux, qu'il passait pour riche, et qu'il était pauvre; qu'on le croyait tout puissant, et qu'il était toujours contredit; qu'il n'avait guère obligé que des ingrats, et que dans un travail continuel de quarante années il avait eu à peine un moment de consolation. Babouc en fut touché, et pensa que, si cet homme avait fait des fautes, et si l'ange Ituriel voulait le punir, il ne fallait pas l'exterminer, mais seulement lui laisser sa place.
Tandis qu'il parlait au ministre entre brusquement la belle dame chez qui Babouc avait dîné; on voyait dans ses yeux et sur son front les symptômes de la douleur et de la colère. Elle éclata en reproches contre l'homme d'Etat, elle versa des larmes; elle se plaignit avec amertume de ce qu'on avait refusé à son mari une place où sa naissance lui permettait d'aspirer, et que ses services et ses blessures méritaient; elle s'exprima avec tant de force, elle mit tant de grâce dans ses plaintes, elle détruisit les objections avec tant d'adresse, elle fit valoir les raisons avec tant d'éloquence, qu'elle ne sortit point de la chambre sans avoir fait la fortune de son mari.
Babouc lui donna la main: "Est-il possible, madame, lui dit-il, que vous vous soyez donné toute cette peine pour un homme que vous n'aimez point, et dont vous avez tout à craindre? - Un homme que je n'aime point! s'écria-t-elle; sachez que mon mari est le meilleur ami que j'aie au monde, qu'il n'y a rien que je ne lui sacrifie, hors mon amant; et qu'il ferait tout pour moi, hors de quitter sa maîtresse. Je veux vous la faire connaître: c'est une femme charmante, pleine d'esprit, et du meilleur caractère du monde; nous soupons ensemble ce soir avec mon mari et mon petit mage, venez partager notre joie."
La dame mena Babouc chez elle. Le mari qui était enfin arrivé plongé dans la douleur, revit sa femme avec des transports d'allégresse et de reconnaissance: il embrassait tour à tour sa femme, sa maîtresse, le petit mage, et Babouc. L'union, la gaieté, l'esprit, et les grâces, furent l'âme de ce repas. "Apprenez, lui dit la belle dame chez laquelle il soupait, que celles qu'on appelle quelquefois de malhonnêtes femmes ont presque toujours le mérite d'un très honnête homme; et pour vous en convaincre, venez demain dîner avec moi chez la belle Téone. Il y a quelques vieilles vestales qui la déchirent; mais elle fait plus de bien qu'elles toutes ensemble. Elle ne commettrait pas une légère injustice pour le grand intérêt; elle ne donne à son amant que des conseils généreux; elle n'est occupée que de sa gloire: il rougirait devant elle s'il avait laissé échapper une occasion de faire du bien, car rien n'encourage plus aux actions vertueuses que d'avoir pour témoin et pour juge de sa conduite une maîtresse dont on veut mériter l'estime."
Babouc ne manqua pas au rendez-vous. Il vit une maison où régnaient tous les plaisirs. Téone régnait sur eux; elle savait parler à chacun son langage. Son esprit naturel mettait à son aise celui des autres; elle plaisait sans presque le vouloir; elle était aussi aimable que bienfaisante; et, ce qui augmentait le prix de toutes ses bonnes qualités, elle était belle.
Babouc, tout Scythe et tout envoyé qu'il était d'un génie, s'aperçut que, s'il restait encore à Persépolis, il oublierait Ituriel pour Téone. Il s'affectionnait à la ville, dont le peuple était poli, doux et bienfaisant, quoique léger, médisant, et plein de vanité. Il craignait que Persépolis ne fût condamnée; il craignait même le compte qu'il allait rendre.
Voici comme il s'y prit pour rendre ce compte. Il fit faire par le meilleur fondeur de la ville une petite statue composée de tous les métaux, des terres et des pierres les plus précieuses et les plus viles; il la porta à Ituriel: "Casserez-vous, dit-il, cette jolie statue parce que tout n'y est pas or et diamants?" Ituriel entendit à demi-mot; il résolut de ne pas même songer à corriger Persépolis, et de laisser aller le monde comme il va "car, dit-il, si tout n'est pas bien, tout est passable". On laissa donc subsister Persépolis, et Babouc fut bien loin de se plaindre, comme Jonas, qui se fâcha de ce qu'on ne détruisait pas Ninive. Mais quand on a été trois jours dans le corps d'une baleine, on n'est pas de si bonne humeur que quand on a été à l'opéra, à la comédie, et qu'on a soupé en bonne compagnie.
PREMIÈRE LETTRE SUR LES QUAKERS.
J'ai cru que la doctrine et l'histoire d'un peuple si extraordinaire méritaient la curiosité d'un homme raisonnable. Pour m'en instruire, j'allai trouver un plus célèbres quakers d'Angleterre, qui, après avoir été trente ans dans le commerce, avait su mettre des bornes à sa fortune et à ses désirs, et s'était retiré dans une campagne auprès de Londres. Je fus le chercher dans sa retraite ; c'était une maison petite, mais bien bâtie, pleine de propreté sans ornement. Le quaker était un vieillard frais qui n'avait jamais eu de maladie, parce qu'il n'avait jamais connu les passions ni l'intempérance : je n'ai point vu en ma vie d'air plus noble ni plus engageant que le sien. Il était vêtu, comme tous ceux de sa religion, d'un habit sans plis dans les côtés et sans boutons sur les poches ni sur les manches, et portait un grand chapeau à bords rabattus, comme nos ecclésiastiques ; il me reçut avec son chapeau sur la tête, et s'avança vers moi sans faire la moindre inclination de corps ; mais il y avait plus de politesse dans l'air ouvert et humain de son visage qu'il n'y en a dans l'usage de tirer une jambe derrière l'autre et de porter à la main ce qui est fait pour couvrir la tête. « Ami, me dit-il, je vois que tu es un étranger ; si je puis t'être de quelque utilité, tu n'as qu'à parler. --- Monsieur, lui dis-je, en me courbant le corps et en glissant un pied vers lui, selon notre coutume, je me flatte que ma juste curiosité ne vous déplaira pas, et que vous voudrez bien me faire l'honneur de m'instruire de votre religion. Les gens de ton pays, me répond-il, font trop de compliments et de révérences ; mais je n'en ai encore vu aucun qui ait eu la même curiosité que toi. Entre, et dînons d'abord ensemble. Je fis encore quelques mauvais compliments, parce qu'on ne se défait pas de ses habitudes tout d'un coup ; et, après un repas sain et frugal, qui commença et qui finit par une prière à Dieu, je me mis à interroger mon homme. Je débutai par la question que de bons catholiques ont faite plus d'une fois aux huguenots : « Mon cher Monsieur, lui dis-je, êtes- vous baptisé ? --- Non, me répondit le quaker, et mes confrères ne le sont point. --- Comment, morbleu, repris-je, vous n'êtes donc pas chrétiens ? --- Mon fils, repartit-il d'un ton doux, ne jure point ; nous sommes chrétiens et tâchons d'être bons chrétiens, mais nous ne pensons pas que le christianisme consiste à jeter de l'eau froide sur la tête, avec un peu de sel. --- Eh ! ventrebleu, repris-je, outré de cette impiété, vous avez donc oublié que Jésus-Christ fut baptisé par Jean ? --- Ami, point de jurements, encore un coup, dit le bénin quaker. Le Christ reçut le baptême de Jean, mais il ne baptisa jamais personne ; nous ne sommes pas les disciples de Jean, mais du Christ. --- Hélas ! dis-je, comme vous seriez brûlé en pays d'inquisition, pauvre homme !... Eh ! pour l'amour de Dieu, que je vous baptise et que je vous fasse chrétien ! --- S'il ne fallait que cela pour condescendre à ta faiblesse, nous le ferions volontiers, repartit-il gravement ; nous ne condamnons personne pour user de la cérémonie du Baptême, mais nous croyons que ceux qui professent une religion toute sainte et toute spirituelle doivent s'abstenir, autant qu'ils le peuvent, des cérémonies judaïques. --- En voici bien d'un autre, m'écriai-je ! Des cérémonies judaïques ! --- Oui, mon fils, continua-t-il, et si judaïques que plusieurs juifs encore aujourd'hui usent quelquefois du Baptême de Jean. Consulte l'Antiquité ; elle t'apprendra que Jean ne fit que renouveler cette pratique, laquelle était en usage longtemps avant lui parmi les Hébreux, comme le pèlerinage de la Mecque l'était parmi les ismaélites. Jésus voulut bien recevoir le Baptême de Jean, de même qu'il s'était soumis à la Circoncision ; mais, et la Circoncision, et le lavement d'eau doivent être tous deux abolis par le Baptême du Christ, ce Baptême de l'esprit, cette ablution de l'âme qui sauve les hommes. Aussi le précurseur Jean disait : Je vous baptise à la vérité avec de l'eau, mais un autre viendra après moi, plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne de porter les sandales ; celui-là vous baptisera avec le feu et le Saint-Esprit. Aussi le grand Apôtre des Gentils, Paul, écrit aux Corinthiens : Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile ; aussi ce même Paul ne baptisa jamais avec de l'eau que deux personnes, encore fut-ce malgré lui ; il circoncit son disciple Timothée ; les autres Apôtres circoncisaient aussi tous ceux qui voulaient. Es-tu circoncis ? ajouta-t-il. Je lui répondis que je n'avais pas cet honneur. « Eh bien, dit-il, l'ami, tu es chrétien sans être circoncis, et moi, sans être baptisé.
Voilà comme mon saint homme abusait assez spécieusement de trois ou quatre de la Sainte Écriture, qui semblaient favoriser sa secte ; mais il oubliait de la meilleure foi du monde une centaine de passages qui l'écrasaient. Je me gardai bien de lui rien contester ; il n'y a rien à gagner avec un enthousiaste : il ne faut point s'aviser de dire à un homme les défauts de sa maîtresse, ni à un plaideur le faible de sa cause, ni des raisons à un illuminé ; ainsi je passai à d'autres questions. « ¸ l'égard de la Communion, lui dis-je, comment en usez-vous ? --- Nous n'en usons point, dit-il. --- Quoi ! point de Communion ? --- Non, point d'autre que celle des coeurs. Alors il me cita encore les Écritures. Il me fit un fort beau sermon contre la Communion, et me parla d'un ton inspiré pour me prouver que tous les Sacrements étaient tous d'invention humaine, et que le mot de Sacrement ne se trouvait pas une seule fois dans l'Évangile. « Pardonne, dit-il, à mon ignorance, je ne t'ai pas apporté la centième partie des preuves de ma religion ; mais tu peux les voir dans l'exposition de notre foi par Robert Barclay : c'est un des meilleurs livres qui soient jamais sortis de la main des hommes. Nos ennemis conviennent qu'il est très dangereux, cela prouve combien il est raisonnable. Je lui promis de lire ce livre, et mon quaker me crut déjà converti.
Ensuite il me rendit raison en peu de mots de quelques singularités qui exposent cette secte au mépris des autres. « Avoue, dit-il, que tu as eu bien de la peine à t'empêcher de rire quand j'ai répondu à toutes tes civilités avec mon chapeau sur ma tête et en te tutoyant ; cependant tu me parais trop instruit pour ignorer que du temps du Christ aucune nation ne tombait dans le ridicule de substituer le pluriel au singulier. On disait à César Auguste : je t'aime, je te prie, je te remercie ; il ne souffrait pas même qu'on l'appelât monsieur, Dominus. Ce ne fut que très longtemps après lui que les hommes s'avisèrent de se faire appeler vous au lieu de tu, comme s'ils étaient doubles, et d'usurper les titres impertinents de Grandeur, d'Éminence, de Sainteté, que des vers de terre donnent à d'autres vers de terre, en les assurant qu'ils sont, avec un profond respect et une fausseté infâme, leurs très humbles et très obéissants serviteurs. C'est pour être plus sur nos gardes contre cet indigne commerce de mensonges et de flatteries que nous tutoyons également les rois et les savetiers, que nous ne saluons personne, n'ayant pour les hommes que de la charité, et du respect que pour les lois.
« Nous portons aussi un habit un peu différent des autres hommes, afin que ce pour nous un avertissement continuel de ne leur pas ressembler. Les autres les marques de leurs dignités, et nous, celles de l'humilité chrétienne ; nous fuyons les assemblées de plaisir, les spectacles, le jeu ; car nous serions bien à plaindre de remplir de ces bagatelles des coeurs en qui Dieu doit habiter ; nous ne faisons jamais de serments, pas même en justice ; nous pensons que le nom du Très-Haut ne doit pas être prostitué dans les débats des hommes. Lorsqu'il faut que nous comparaissions devant les magistrats pour les affaires des autres (car nous n'avons jamais de procès), nous affirmons la vérité par un oui ou par un non, et les juges nous en croient sur notre simple parole, tandis que tant de chrétiens se parjurent sur l'Évangile. Nous n'allons jamais à la guerre ; ce n'est pas que nous craignions la mort, au contraire nous bénissons le moment qui nous unit à l'Être des Êtres ; mais c'est que nous ne sommes ni loups, ni tigres, ni dogues, mais hommes, mais chrétiens. Notre Dieu, qui nous a ordonné d'aimer nos ennemis et de souffrir sans murmure, ne veut pas sans doute que nous passions la mer pour aller égorger nos frères, parce que des meurtriers vêtus de rouge, avec un bonnet haut de deux pieds, enrôlent des citoyens en faisant du bruit avec deux petits bâtons sur une peau d'âne bien tendue ; et lorsque après des batailles gagnées tout Londres brille d'illuminations, que le ciel est enflammé de fusées, que l'air retentit du bruit des actions de grâces, des cloches, des orgues, des canons, nous gémissons en silence sur ces meurtres qui causent la publique allégresse.
Telle fut à peu près la conversation que j'eus avec cet homme singulier ; mais je fus bien plus surpris quand, le dimanche suivant, il me mena à l'église des quakers. Ils ont plusieurs chapelles à Londres ; celle où j'allai est près de ce fameux pilier qu'on appelle le Monument. On était déjà assemblé lorsque j'entrai avec mon conducteur. Il y avait environ quatre cents hommes dans l'église, et trois cents femmes : les femmes se cachaient le visage avec leur éventail ; les hommes étaient couverts de leurs larges chapeaux ; tous étaient assis, tous dans un profond silence. Je passai au milieu d'eux sans qu'un seul levât les yeux sur moi. Ce silence dura un quart d'heure. Enfin un d'eux se leva, ôta son chapeau, et, après quelques grimaces et quelques soupirs, débita, moitié avec la bouche, moitié avec le nez, un galimatias tiré de l'Évangile, à ce qu'il croyait, où ni lui ni personne n'entendait rien. Quand ce faiseur de contorsions eut fini son beau monologue, et que l'assemblée se fut séparée toute édifiée et toute stupide, je demandai à mon homme pourquoi les plus sages d'entre eux souffraient de pareilles sottises. « Nous sommes obligés de les tolérer, me dit-il, parce que nous ne pouvons pas savoir si un homme qui se lève pour parler sera inspiré par l'esprit ou par la folie ; dans le doute, nous écoutons tout patiemment, nous permettons même aux femmes de parler. Deux ou trois de nos dévotes se trouvent souvent inspirées à la fois, et c'est alors qu'il se fait un beau bruit dans la maison du Seigneur. --- Vous n'avez donc point de prêtres ? lui dis-je. --- Non, mon ami, dit le quaker, et nous nous en trouvons bien. À Dieu ne plaise que nous osions ordonner à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit le dimanche à l'exclusion des autres fidèles. Grâce au Ciel nous sommes les seuls sur la terre qui n'ayons point de prêtres. Voudrais-tu nous ôter une distinction si heureuse ? Pourquoi abandonnerions-nous notre enfant à des nourrices mercenaires, quand nous avons du lait à lui donner ? Celles-ci domineraient bientôt dans la maison, et opprimeraient la mère et l'enfant. Dieu a dit : Vous avez reçu gratis, donnez gratis. Irons-nous après cette parole marchander l'Évangile, vendre l'Esprit Saint, et faire d'une assemblée de chrétiens une boutique de marchands ? Nous ne donnons point d'argent à des hommes vêtus de noir pour assister nos pauvres, pour enterrer nos morts, pour prêcher les fidèles ; ces saints emplois nous sont trop chers pour nous en décharger sur d'autres.
--- Mais comment pouvez-vous discerner insistai-je, si c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime dans vos discours ? --- Quiconque, dit-il, priera Dieu de l'éclairer, et qui annoncera des vérités évangéliques qu'il sentira, que celui-là soit sûr que Dieu l'inspire. Alors il m'accabla de citations de l'Écriture, qui démontraient, selon lui, qu'il n'y a point de christianisme sans une révélation immédiate, et il ajouta ces paroles remarquables : « Quand tu fais mouvoir un de tes membres, est-ce ta propre force qui le remue? Non sans doute, car ce membre a souvent des mouvements involontaires. C'est donc celui qui a créé ton corps qui meut ce corps de terre. Et les idées que reçoit ton âme, est-ce toi qui les formes ? Encore moins, car elles viennent malgré toi. C'est donc le Créateur de ton âme qui te donne tes idées ; mais, comme il a laissé à ton coeur la liberté, il donne à ton esprit les idées que ton coeur mérite ; tu vis dans Dieu, tu agis, tu penses dans Dieu ; tu n'as donc qu'à ouvrir les yeux à cette lumière qui éclaire tous les hommes ; alors tu verras la vérité, et la feras voir. --- Eh ! voilà le père Malebranche tout pur ! m'écriai-je. --- Je connais ton Malebranche, dit-il ; il était un peu quaker, mais il ne l'était pas assez. Ce sont là les choses les plus importantes que j'ai apprises touchant la doctrine des quakers. Dans la première lettre vous aurez leur histoire, que vous trouverez encore plus singulière que leur doctrine.
Vous avez déjà vu que les quakers datent depuis Jésus-Christ, qui fut, selon eux, le premier quaker. La religion, disent-ils, fut corrompue presque après sa mort, et resta dans cette corruption environ seize cents années ; mais il y avait toujours quelques quakers cachés dans le monde, qui prenaient soin du feu sacré éteint partout ailleurs, jusqu'à ce qu'enfin cette lumière s'étendit en Angleterre en l'an 1642.
Ce fut dans le temps que trois ou quatre sectes déchiraient la Grande-Bretagne par des guerres civiles entreprises au nom de Dieu, qu'un nommé Georges Fox, du comté de Leicester, fils d'un ouvrier en soie, s'avisa de prêcher en vrai apôtre, à ce qu'il prétendait, c'est-à-dire sans savoir ni lire ni écrire ; c'était un jeune homme de vingt-cinq ans, de moeurs irréprochables, et saintement fou. Il était vêtu de cuir depuis les pieds jusqu'à la tête ; il allait de village en village, criant contre la guerre et contre le clergé. S'il n'avait prêché que contre les gens de guerre, il n'avait rien à craindre ; mais il attaquait les gens d'Église : il fut bientôt mis en prison. On le mena à Derby devant le juge de Paix. Fox se présenta au juge avec son bonnet de cuir sur la tête. Un sergent lui donna un grand soufflet, en lui disant : « Gueux, sais-tu pas qu'il faut paraître nu-tête devant Monsieur le Juge ? Fox tendit l'autre joue, et pria le sergent de vouloir bien donner un autre soufflet pour l'amour de Dieu. Le juge de Derby voulut lui faire prêter serment avant de l'interroger. « Mon ami, sache, dit-il au juge, que je ne prends jamais le nom de Dieu en vain. Le juge, voyant que cet homme le tutoyait, l'envoya aux Petites-Maisons de Derby pour y être fouetté. Georges Fox alla, en louant Dieu, à l'hôpital des fous, où l'on ne manqua pas d'exécuter à la rigueur la sentence du juge. Ceux qui lui infligèrent la pénitence du fouet furent bien surpris quand il les pria de lui appliquer encore quelques coups de verges pour le bien de son âme. Ces messieurs ne se firent pas prier ; Fox eut sa double dose, dont il les remercia très cordialement. Il se mit à les prêcher ; d'abord on rit, ensuite on l'écouta ; et, comme l'enthousiasme est une maladie qui se gagne, plusieurs furent persuadés, et ceux qui l'avaient fouetté devinrent ses premiers disciples.
Délivré de sa prison, il courut les champs avec une douzaine de prosélytes, prêchant toujours contre le clergé, et fouetté de temps en temps. Un jour, étant mis au pilori, il harangua tout le peuple avec tant de force qu'il convertit une cinquantaine d'auditeurs, et mit le reste tellement dans ses intérêts qu'on le tira en tumulte du trou où il était ; on alla chercher le curé anglican dont le crédit avait fait condamner Fox à ce supplice, et on le piloria à sa place.
Il osa bien convertir quelques soldats de Cromwell, qui quittèrent le métier des armes et refusèrent de prêter le serment. Cromwell ne voulait pas d'une secte où l'on ne se battait point, de même que Sixte-Quint augurait mal d'une secte, dove non si chiavava. Il se servit de son pouvoir pour persécuter ces venus, on en remplissait les prisons ; mais les persécutions ne servent presque jamais qu'à faire des prosélytes : ils sortaient des prisons affermis dans leur créance et suivis de leurs geôliers qu'ils avaient convertis. Mais voici ce qui contribua le plus à étendre la secte. Fox se croyait inspiré. Il crut par conséquent devoir parler d'une manière différente des autres hommes ; il se mit à trembler, à faire des contorsions et des grimaces, à retenir son haleine, à la pousser avec violence ; la prêtresse de Delphes, n'eût pas mieux fait. En peu de temps il acquit une grande habitude d'inspiration, et bientôt après il ne fut guère en son pouvoir de parler autrement. Ce fut le premier don qu'il communiqua à ses disciples. Ils firent de bonne foi toutes les grimaces de leur maître ; ils tremblaient de toutes leurs forces au moment de l'inspiration. De là ils eurent le nom de quakers, qui signifie trembleurs. Le petit peuple s'amusait à les contrefaire. On tremblait, on parlait du nez, on avait des convulsions, et on croyait avoir le Saint-Esprit. Il leur fallait quelques miracles, ils en firent.
Le patriarche Fox dit publiquement à un juge de Paix, en présence d'une grande assemblée : « Ami, prends garde à toi ; Dieu te punira bientôt de persécuter les saints. Ce juge était un ivrogne qui buvait tous les jours trop de mauvaise bière et d'eau-de-vie ; il mourut d'apoplexie deux jours après, précisément comme il venait de signer un ordre pour envoyer quelques quakers en prison. Cette mort soudaine ne fut point attribuée à l'intempérance du juge ; tout le monde la regarda comme un effet des prédictions du saint homme.
Cette mort fit plus de quakers que mille sermons et autant de convulsions n'en auraient pu faire. Cromwell, voyant que leur nombre augmentait tous les jours, voulut les attirer à son parti : il leur fit offrir de l'argent, mais ils furent incorruptibles ; et il dit un jour que cette religion était la seule contre laquelle il n'avait pu prévaloir avec des guinées.
Ils furent quelquefois persécutés sous Charles II, non pour leur religion, mais pour ne vouloir pas payer les dîmes au clergé, pour tutoyer les magistrats, et refuser de prêter les serments prescrits par la Loi.
Enfin Robert Barclay, Écossais, présenta au roi, en 1675, son Apologie des Quakers, ouvrage aussi bon qu'il pouvait l'être. L'Épître dédicatoire à Charles II contient, non de basses flatteries, mais des vérités hardies et des conseils justes.
« Tu as goûté, dit-il à Charles à la fin de cette Épître, de la douceur et de l'amertume, de la prospérité et des plus grands malheurs ; tu as été chassé des pays où tu règnes ; tu as senti le poids de l'oppression, et tu dois savoir combien l'oppresseur est détestable devant Dieu et devant les hommes. Que si, après tant d'épreuves et de bénédictions, ton coeur s'endurcissait et oubliait le Dieu qui s'est souvenu de toi dans tes disgrâces, ton crime en serait plus grand et ta condamnation plus terrible. Au lieu donc d'écouter les flatteurs de ta cour, écoute la voix de ta conscience, qui ne te flattera jamais. Je suis ton fidèle ami et sujet BARCLAY.
Ce qui est plus étonnant, c'est que cette lettre, écrite à un roi par un particulier obscur, eut son effet, et la persécution cessa.
Environ ce temps parut l'illustre Guillaume Penn, qui établit la puissance des quakers en Amérique, et qui les aurait rendus respectables en Europe, si les hommes pouvaient respecter la vertu sous des apparences ridicules ; il était fils unique du chevalier Penn, vice-amiral d'Angleterre et favori du duc d'York, depuis Jacques Il.
Guillaume Penn, à l'âge de quinze ans, rencontra un quaker à Oxford, où il faisait ses études ; ce quaker le persuada, et le jeune homme, qui était vif, naturellement éloquent, et qui avait de la noblesse dans sa physionomie et dans ses manières, gagna bientôt quelques-uns de ses camarades. Il établit insensiblement une société de jeunes quakers qui s'assemblaient chez lui ; de sorte qu'il se trouva chef de secte à l'âge de seize ans.
De retour chez le vice-amiral son père au sortir du collège, au lieu de se mettre à genoux devant lui et de lui demander sa bénédiction, selon l'usage des Anglais, il l'aborda le chapeau sur la tête, et lui dit : « Je suis fort aise, l'ami, de te voir en bonne santé. Le vice-amiral crut que son fils était devenu fol ; il s'aperçut bientôt qu'il était quaker. Il mit en usage tous les moyens que la prudence humaine peut employer pour l'engager à vivre comme un autre ; le jeune homme ne répondit à son père qu'en l'exhortant à se faire quaker lui-même.
Enfin le père se relâcha à ne lui demander autre chose, sinon qu'il allât voir le roi et le duc d'York le chapeau sous le bras, et qu'il ne les tutoyât point. Guillaume répondit que sa conscience ne le lui permettait pas, et le père, indigné et au désespoir, le chassa de sa maison. Le jeune Penn remercia Dieu de ce qu'il souffrait déjà pour sa cause ; il alla prêcher dans la Cité ; il y fit beaucoup de prosélytes.
Les prêches des ministres éclaircissaient tous les jours ; et comme Penn était jeune, beau et bien fait, les femmes de la cour et de la ville accouraient dévotement pour l'entendre. Le patriarche Georges Fox vint du fond de l'Angleterre le voir à Londres sur sa réputation ; tous deux résolurent de faire des missions dans les pays étrangers. Ils s'embarquèrent pour la Hollande, après avoir laissé des ouvriers en assez bon nombre pour avoir soin de la vigne de Londres. Leurs travaux eurent un heureux succès à Amsterdam ; mais ce qui leur fit le plus d'honneur et ce qui mit le plus leur humilité en danger, fut la réception que leur fit la princesse Palatine Elisabeth, tante de Georges ler, roi d'Angleterre, femme illustre par son esprit et par son savoir, et à qui Descartes avait dédié son roman de philosophie.
Elle était alors retirée à la Haye, où elle vit ces amis, car c'est ainsi qu'on appelait alors les quakers en Hollande ; elle eut plusieurs conférences avec eux, ils prêchèrent souvent chez elle, et, s'ils ne firent pas d'elle une parfaite quakresse, ils avouèrent au moins qu'elle n'était pas loin du royaume des Cieux.
Les amis semèrent aussi en Allemagne, mais ils recueillirent peu. On ne goûta pas la mode de tutoyer, dans un pays où il faut toujours avoir à la bouche les termes d'Altesse et d'Excellence. Penn repassa bientôt en Angleterre, sur la nouvelle de la maladie de son père ; il vint recueillir ses derniers soupirs. vice-amiral se réconcilia avec lui et l'embrassa avec tendresse, quoiqu'il fût d'une différente religion ; Guillaume l'exhorta en vain à ne point recevoir le Sacrement et à mourir quaker ; et le vieux bonhomme recommanda inutilement à Guillaume d'avoir des boutons sur ses manches et des ganses à son chapeau.
Guillaume hérita de grands biens, parmi lesquels il se trouvait des dettes de la Couronne, pour des avances faites par le vice-amiral dans des expéditions maritimes. Rien n'était moins assuré alors que l'argent dû par le roi ; Penn fut obligé d'aller tutoyer Charles II et ses ministres plus d'une fois pour son paiement. Le gouvernement lui donna, en 1680, au lieu d'argent, la propriété et la souveraineté d'une province d'Amérique, au sud de Maryland : voilà un quaker devenu souverain. Il partit pour ses nouveaux États avec deux vaisseaux chargés de quakers qui le suivirent. On appela dès lors le pays Pennsylvania, du nom de Penn. Il y fonda la ville de Philadelphie, qui est aujourd'hui très Il commença par faire une ligue avec les Américains ses voisins. C'est le seul traité entre ces peuples et les chrétiens qui n'ait point été juré, et qui n'ait point été rompu. Le nouveau souverain fut aussi le législateur de la Pennsylvanie ; il donna des lois très sages, dont aucune n'a été changée depuis lui. La Première est de ne maltraiter personne au sujet de la religion, et de regarder comme frères tous ceux qui croient un dieu.
À peine eut-il établi son gouvernement que plusieurs marchands de l'Amérique vinrent peupler cette colonie. Les naturels du pays, au lieu de fuir dans les forêts, s'accoutumèrent insensiblement avec les pacifiques quakers : autant ils détestaient les autres chrétiens conquérants et destructeurs de l'Amérique, ils aimaient ces nouveaux venus. En peu de temps un grand nombre de ces prétendus sauvages, charmés de la douceur de ces voisins, vinrent en foule demander à Guillaume Penn de les recevoir au nombre de ses vassaux. C'était un spectacle bien nouveau qu'un souverain que tout le monde tutoyait, et à qui on parlait le chapeau sur la tête, un gouvernement sans prêtres, un peuple sans armes, des citoyens tous égaux, à la magistrature près, et des voisins sans jalousie.
Guillaume Penn pouvait se vanter d'avoir apporté sur la terre l'âge d'or dont on parle tant, et qui n'a vraisemblablement existé qu'en Pennsylvanie. Il revint en Angleterre pour les affaires de son nouveau pays, après la mort de Charles II. Le roi Jacques, qui avait aimé son père, eut la même affection pour le fils, et ne le considéra plus comme un sectaire obscur, mais comme un très grand homme. La politique du roi s'accordait en cela avec son goût ; il avait envie de flatter les quakers en abolissant les lois faites contre les non-conformistes, afin de pouvoir introduire la religion catholique à la faveur de cette liberté. Toutes les sectes d'Angleterre virent le piège, et ne s'y laissèrent pas prendre ; elles sont toujours réunies contre le catholicisme, leur ennemi commun. Mais Penn ne crut pas devoir renoncer à ses principes pour favoriser des protestants qui le haïssaient, contre un roi qui l'aimait. Il avait établi la liberté de conscience en Amérique ; il n'avait pas envie de paraître vouloir la détruire en Europe ; il demeura donc fidèle à Jacques II, au point qu'il fut généralement accusé d'être jésuite. Cette calomnie l'affligea sensiblement ; il fut obligé de s'en justifier par des écrits publics. Cependant, le malheureux Jacques II, qui comme presque tous les Stuarts était un composé de grandeur et de faiblesse, et qui comme eux en fit trop et trop peu, perdit son royaume sans qu'on pût dire comment la chose arriva.
Toutes les sectes anglaises reçurent de Guillaume III et de son Parlement cette même liberté qu'elles n'avaient pas voulu tenir des mains de Jacques. Ce fut alors que les quakers commencèrent à jouir, par la force des lois, de tous les privilèges dont ils sont en possession aujourd'hui. Penn, après avoir vu enfin secte établie sans contradiction dans le pays de sa naissance, retourna en Pennsylvanie. Les siens et les Américains le reçurent avec des larmes de joie comme un père qui revenait voir ses enfants. Toutes ses lois avaient été religieusement observées pendant son absence, ce qui n'était arrivé à aucun avant lui. Il resta quelques années à Philadelphie ; il en partit enfin malgré lui pour aller solliciter à Londres des avantages nouveaux en faveur du commerce des Pennsylvains ; il vécut depuis à Londres jusqu'à une extrême vieillesse, considéré comme le chef d'un peuple et d'une religion. Il n'est qu'en 1718.
On conserva à ses descendants la propriété et le gouvernement de la Pennsylvanie, et ils vendirent au roi le gouvernement pour douze mille pièces. Les affaires du roi ne lui permirent d'en payer que mille. Un lecteur français croira peut-être que le ministère paya le reste en promesses et s'empara toujours du gouvernement : point du tout ; la Couronne n'ayant pu satisfaire dans le temps marqué au paiement de la somme entière, le contrat fut déclaré nul, et la famille de Penn rentra dans ses droits.
Je ne puis deviner quel sera le sort de la religion des quakers en Amérique ; mais je vois qu'elle dépérit tous les jours à Londres. Par tout pays, la religion dominante, quand elle ne persécute point, engloutit à la longue toutes les autres. Les quakers ne peuvent être membres du Parlement, ni posséder aucun office, parce qu'il faudrait prêter serment et qu'ils ne veulent point jurer. Ils sont réduits à la nécessité de gagner de l'argent par le commerce ; leurs enfants, enrichis par l'industrie de leurs pères, veulent jouir, avoir des honneurs, des boutons et des manchettes ; ils sont honteux d'être appelés quakers, et se font protestants pour être à la mode.
C'est ici le pays des sectes. Un Anglais, comme homme libre, va au Ciel par le chemin qui lui plaît.
Cependant, quoique chacun puisse ici servir Dieu à sa mode, leur véritable religion, celle où l'on fait fortune, est la secte des épiscopaux, appelée l'Église anglicane, ou l'Église par excellence. On ne peut avoir d'emploi, ni en Angleterre ni en Irlande, sans être du nombre des fidèles anglicans ; cette raison, qui est une excellente preuve, a converti tant de non-conformistes, qu'aujourd'hui il n'y a pas la vingtième partie de la nation qui soit hors du giron de l'Église dominante.
Le clergé anglican a retenu beaucoup des cérémonies catholiques, et surtout celle de recevoir les dîmes avec une attention très scrupuleuse. Ils ont aussi la pieuse ambition d'être les maîtres.
De plus, ils fomentent autant qu'ils peuvent dans leurs ouailles un saint zèle contre les non-conformistes. Ce zèle était assez vif sous le gouvernement des Tories, dans les dernières années de la reine Anne ; mais il ne s'étendait pas plus loin qu'à casser quelquefois les vitres des chapelles hérétiques ; car la rage des sectes a fini en Angleterre avec les guerres civiles, et ce n'était plus, sous la reine Anne, que les bruits sourds d'une mer encore agitée longtemps après la tempête. Quand les Whigs et les Tories déchirèrent leur pays, comme autrefois les Guelfes et les Gibelins, il fallut bien que la religion entrât dans les partis. Les Tories étaient pour l'Épiscopat ; les Whigs le voulaient abolir, mais ils se sont contentés de l'abaisser quand ils ont été les maîtres.
Du temps que le comte Harley d'Oxford et milord Bolingbroke faisaient boire la santé des Tories, l'Église anglicane les regardait comme les défenseurs de ses saints privilèges. L'assemblée du bas clergé, qui est une espèce de Chambre des Communes composée d'ecclésiastiques, avait alors quelque crédit ; elle jouissait au moins de la liberté de s'assembler, de raisonner de controverse, et de faire brûler de temps en temps quelques livres impies, c'est-à-dire écrits contre elle. Le ministère, qui est whig aujourd'hui, ne permet pas seulement à ces messieurs de tenir leur assemblée ; ils sont réduits, dans de leur paroisse, au triste emploi de prier Dieu pour le gouvernement, qu'ils ne seraient pas fâchés de troubler. Quant aux évêques, qui sont vingt-six en tout, ils ont séance dans la Chambre Haute en dépit des Whigs, parce que le vieil abus de les regarder comme barons subsiste encore ; mais ils n'ont pas plus de pouvoir dans la Chambre que les ducs et pairs dans le Parlement de Paris. Il y a une clause dans le serment que l'on prête à l'État, laquelle exerce bien la patience chrétienne de ces messieurs.
On y promet d'être de l'Église, comme elle est établie par la Loi. Il n'y a guère d'évêque, de doyen, d'archiprêtre, qui ne pense être de droit divin ; c'est donc un grand sujet de mortification pour eux d'être obligés d'avouer qu'ils tiennent tout d'une misérable loi faite par des profanes laïques. Un (le P. Courayer) a écrit depuis peu un livre pour prouver la validité et la succession des ordinations anglicanes. Cet ouvrage a été proscrit en France ; mais croyez-vous qu'il ait plu au ministère d'Angleterre ? Point du tout. Ces maudits Whigs se soucient très peu que la succession épiscopale ait été chez eux ou non, et que l'évêque Parker ait été consacré dans un cabaret (comme on le veut) ou dans une église ; ils aiment mieux que les évêques tirent leur autorité du Parlement plutôt que des Apôtres. Le lord B*** dit que cette idée de droit divin ne servirait qu'à faire des tyrans en camail et en rochet, mais que la loi fait des citoyens.
À l'égard des moeurs, le clergé anglican est plus réglé que celui de France, et en voici la cause : tous les ecclésiastiques sont élevés dans l'Université d'Oxford ou dans celle de Cambridge, loin de la corruption de la capitale ; ils ne sont appelés aux dignités de l'Église que très tard, et dans un âge où les hommes n'ont d'autres passions que l'avarice, lorsque leur ambition manque d'aliments. Les emplois sont ici la récompense des longs services dans l'Église aussi bien que dans l'Armée ; on n'y voit point de jeunes gens évêques ou colonels au sortir du collège. De plus, les prêtres sont presque tous mariés ; la mauvaise grâce contractée dans l'Université et le peu de commerce qu'on a ici avec les femmes font que d'ordinaire un évêque est forcé de se contenter de la sienne. Les prêtres vont quelquefois au cabaret, parce que l'usage le leur permet, et s'ils s'enivrent, c'est sérieusement et sans scandale.
Cet être indéfinissable, qui n'est ni ecclésiastique ni séculier, en un mot ce que l'on appelle un abbé, est une espèce inconnue en Angleterre ; les ecclésiastiques sont tous ici réservés et presque tous pédants. Quand ils apprennent qu'en France de jeunes gens, connus par leurs débauches et élevés à la prélature par des intrigues de femmes, font publiquement l'amour, s'égaient à composer des chansons tendres, donnent tous les jours des soupers délicats et longs, et de là vont implorer les lumières du Saint-Esprit, et se nomment hardiment les successeurs des Apôtres, ils remercient Dieu d'être protestants. Mais ce sont de vilains hérétiques, à brûler à tous les diables, comme dit maître François Rabelais ; c'est pourquoi je ne me mêle de leurs affaires.
La religion anglicane ne s'étend qu'en Angleterre et en Irlande. Le presbytéranisme est la religion dominante en Écosse. Ce presbytéranisme n'est autre chose que le calvinisme pur, tel qu'il avait été établi en France et qu'il subsiste à Genève. Comme les prêtres de cette secte ne reçoivent de leurs églises que des gages très médiocres, et que par conséquent, ils ne peuvent vivre dans le même luxe que les évêques, ils ont pris le parti naturel de crier contre des honneurs où ils ne peuvent atteindre. Figurez-vous l'orgueilleux Diogène qui foulait aux pieds l'orgueil de Platon : les presbytériens d'Écosse ne ressemblent pas mal à ce fier et gueux raisonneur. Ils traitèrent le roi Charles il avec bien moins d'égards que Diogène n'avait traité Alexandre. Car lorsqu'ils prirent les armes pour lui contre Cromwell qui les avait trompés, ils firent essuyer à ce pauvre roi quatre sermons par jour ; ils lui défendaient de jouer ; ils le mettaient en pénitence ; si bien que Charles se lassa bientôt d'être roi de ces pédants, et s'échappa de leurs mains comme un écolier se sauve du collège.
Devant un jeune et vif bachelier [français], criaillant le matin dans les écoles de Théologie, et le soir chantant avec les dames, un théologien anglican est un Caton ; mais ce Caton paraît un galant devant un presbytérien d'Écosse. Ce dernier affecte une démarche grave, un air fâché, porte un vaste chapeau, un long manteau par-dessus un habit court, prêche du nez, et donne le nom de la prostituée de Babylone à toutes les églises où quelques ecclésiastiques sont assez heureux pour avoir cinquante mille livres de rente, et où le peuple est assez bon pour le souffrir et pour les appeler Monseigneur, Votre Grandeur, Votre Éminence.
Ces Messieurs, qui ont aussi quelques églises en Angleterre, ont mis les airs graves et sévères à la mode en ce pays. C'est à eux qu'on doit la sanctification du dimanche dans les trois royaumes ; il est défendu ce jour-là de travailler et de se divertir, ce qui est le double de la sévérité des églises catholiques ; point d'opéra, point de comédies, point de concerts à Londres le dimanche ; les cartes même y sont si expressément défendues qu'il n'y a que les personnes de qualité et ce qu'on appelle les honnêtes gens qui ce jour-là. Le reste de la nation va au sermon, au cabaret et chez les filles de joie.
Quoique la secte épiscopale et la presbytérienne soient les deux dominantes dans la Grande-Bretagne, toutes les autres y sont bien venues et vivent assez bien ensemble, pendant que la plupart de leurs prédicants se détestent réciproquement avec presque autant de cordialité qu'un janséniste damne un jésuite.
Entrez dans la Bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours ; vous y voyez rassemblés les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion, et ne donnent le nom qu'à ceux qui font banqueroute ; là, le presbytérien se fie à l'anabaptiste, et l'anglican reçoit la promesse du quaker. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire ; celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom du Père par le Fils au Saint-Esprit ; celui-là fait couper le prépuce de son fils et fait marmotter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point ; ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête, et tous sont contents.
S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre ; s'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et heureuses.
Il y a ici une petite secte composée d'ecclésiastiques et de quelques séculiers très savants, qui ne prennent ni le nom d'ariens ni celui de sociniens, mais qui ne sont point du tout de l'avis de saint Athanase sur le chapitre de la Trinité, et qui vous disent nettement que le Père est plus grand que le Fils.
Vous souvenez-vous d'un certain évêque orthodoxe qui, pour convaincre un empereur de la consubstantiation, s'avisa de prendre le fils de l'empereur sous le menton, et de lui tirer le nez en présence de sa sacrée Majesté ? L'empereur allait se fâcher contre l'évêque, quand le bonhomme lui dit ces belles et convaincantes paroles : « Seigneur, si Votre Majesté est en colère de ce que l'on manque de respect à son Fils, comment pensez-vous que Dieu le Père traitera ceux qui refusent à Jésus-Christ les titres qui lui sont dus ? Les gens dont je vous parle disent que le saint évêque était fort mal avisé, que son argument n'était rien moins que concluant, et que l'empereur devait lui répondre : « Apprenez qu'il y a deux façons de me manquer de respect : la première, de ne rendre pas assez d'honneur à mon Fils ; et la seconde, de lui en rendre autant qu'à moi.
Quoi qu'il en soit, le parti d'Arius commence à revivre en Angleterre, aussi bien qu'en Hollande et en Pologne. Le grand monsieur Newton faisait à cette opinion l'honneur de la favoriser ; ce philosophe pensait que les unitaires raisonnaient plus géométriquement que nous. Mais le plus ferme patron de la arienne est l'illustre docteur Clarke. Cet homme est d'une vertu rigide et d'un caractère doux, plus amateur de ses opinions que passionné pour faire des prosélytes, uniquement occupé de calculs et de démonstrations, une vraie machine à raisonnements.
C'est lui qui est l'auteur d'un livre assez peu entendu, mais estimé, sur l'existence de Dieu, et d'un autre, plus intelligible, mais assez méprisé, sur la vérité de la religion chrétienne.
Il ne s'est point engagé dans de belles disputes scolastiques, que notre ami... appelle de vénérables billevesées ; il s'est contenté de faire imprimer un livre qui contient tous les témoignages des premiers siècles pour et contre les unitaires, et a laissé au lecteur le soin de compter les voix et de juger. Ce livre du docteur lui a attiré beaucoup de partisans, mais l'a empêché d'être archevêque de Cantorbéry ; je crois que le docteur s'est trompé dans son calcul, et qu'il valait mieux être primat d'Angleterre que curé arien.
Vous voyez quelles révolutions arrivent dans les opinions comme dans les empires. Le parti d'Arius, après trois cents ans de triomphe et douze siècles d'oubli, renaît enfin de sa cendre ; mais il prend très mal son temps de reparaître dans un âge où le monde est rassasié de disputes et de sectes. Celle-ci est encore trop petite pour obtenir la liberté des assemblées publiques ; elle l'obtiendra sans doute, si elle devient plus nombreuse ; mais on est si tiède à présent sur tout cela qu'il n'y a plus guère de fortune à pour une religion nouvelle ou renouvelée : n'est-ce pas une chose plaisante que Luther, Calvin, Zwingle, tous écrivains qu'on ne peut lire, aient fondé des sectes qui partagent l'Europe, que l'ignorant Mahomet ait donné une religion à l'Asie et à l'Afrique, et que messieurs Newton, Clarke, Locke, Le Clerc, etc., les plus grands philosophes et les meilleures plumes de leur temps, aient pu à peine venir à bout d'établir un petit troupeau qui même diminue tous les jours?
Voilà ce que c'est que de venir au monde à propos. Si le cardinal de Retz reparaissait aujourd'hui, il n'ameuterait pas dix femmes dans Paris.
Si Cromwell renaissait, lui qui a fait couper la tête à son roi et s'est fait souverain, serait un simple marchand de Londres.
Les membres du Parlement d'Angleterre aiment à se comparer aux anciens Romains autant qu'ils le peuvent.
Il n'y a pas longtemps que M. Shipping, dans la Chambre des Communes, commença son discours par ces mots : La majesté du peuple anglais serait blessée, etc. La singularité de l'expression causa un grand éclat de rire ; mais, sans se déconcerter, il répéta les mêmes paroles d'un air ferme, et on ne rit plus. J'avoue que je ne vois rien de commun entre la majesté du peuple anglais et celle du peuple romain, encore moins entre leurs gouvernements. Il y a un sénat à Londres, dont quelques membres sont soupçonnés, quoique à tort sans doute, de vendre leurs voix dans l'occasion, comme on faisait à Rome : voilà toute la ressemblance. D'ailleurs les deux nations me paraissent entièrement différentes, soit en bien, soit en mal. On n'a jamais connu chez les Romains la folie horrible des guerres de religion ; cette abomination était réservée à des dévôts prêcheurs d'humilité et de patience. Marius et Sylla, Pompée et César, Antoine et Auguste ne se battaient point pour décider si le Flamen devait porter sa chemise par-dessus sa robe, ou sa robe par-dessus sa chemise, et si les poulets sacrés devaient manger et boire, ou bien manger seulement, pour qu'on prît les augures. Les Anglais se sont fait pendre autrefois à leurs assises, et se sont détruits en bataille rangée pour des querelles de pareille espèce ; la secte des épiscopaux et le presbytéranisme ont tourné pour un temps ces têtes sérieuses. Je m'imagine que pareille sottise ne leur arrivera plus ; ils me paraissent devenir sages à leurs dépens, et je ne leur vois nulle envie de s'égorger dorénavant pour des syllogismes.
Voici une différence plus essentielle entre Rome et l'Angleterre, qui met tout l'avantage du côté de la dernière : c'est que le fruit des guerres civiles à Rome a été l'esclavage, et celui des troubles d'Angleterre, la liberté. La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui, d'efforts en efforts, ait enfin établi ce gouvernement sage où le Prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal, où les seigneurs sont grands sans insolence et sans et où le peuple partage le gouvernement sans confusion.
La Chambre des Pairs et celle des Communes sont les arbitres de la nation, le Roi est le sur-arbitre. Cette balance manquait aux Romains : les grands et le peuple étaient toujours en division à Rome, sans qu'il y eût un pouvoir mitoyen qui pût les accorder. Le Sénat de Rome, qui avait l'injuste et punissable orgueil de ne vouloir rien partager avec les plébéiens, ne connaissait d'autre secret, pour les éloigner du gouvernement, que de les occuper toujours dans les guerres étrangères. Ils regardaient le peuple comme une bête féroce qu'il fallait lâcher sur leurs voisins de peur qu'elle ne dévorât ses maîtres. Ainsi le plus grand défaut du gouvernement des Romains en fit des conquérants ; c'est parce qu'ils étaient malheureux chez eux qu'ils devinrent les maîtres du monde, jusqu'à ce qu'enfin leurs divisions les rendirent esclaves.
Le gouvernement d'Angleterre n'est point fait pour un si grand éclat, ni pour une fin si funeste ; son but n'est point la brillante folie de faire des conquêtes, mais d'empêcher que ses voisins n'en fassent. Ce peuple n'est pas seulement jaloux de sa liberté, il l'est encore de celle des autres. Les Anglais étaient acharnés contre Louis XIV, uniquement parce qu'ils lui croyaient de l'ambition. Ils lui ont fait la guerre de gaieté de coeur, assurément sans aucun intérêt.
Il en a coûté sans doute pour établir la liberté en Angleterre ; c'est dans des mers de sang qu'on a noyé l'idole du pouvoir despotique ; mais les Anglais ne croient point avoir acheté trop cher de bonnes lois. Les autres nations n'ont pas eu moins de troubles, n'ont pas versé moins de sang qu'eux ; mais ce sang ont répandu pour la cause de leur liberté n'a fait que cimenter leur servitude.
Ce qui devient une révolution en Angleterre n'est qu'une sédition dans les autres pays. Une ville prend les armes pour défendre ses privilèges, soit en Espagne, soit en Barbarie, soit en Turquie : aussitôt des soldats mercenaires la subjuguent, des bourreaux la punissent, et le reste de la nation baise ses chaînes. Les Français pensent que le gouvernement de cette île est plus orageux que la mer qui l'environne, et cela est vrai ; mais c'est quand le Roi commence la tempête, c'est quand il veut se rendre le maître du vaisseau dont il n'est que le premier pilote. Les guerres civiles de France ont été plus longues, plus cruelles, plus fécondes en crimes que celles d'Angleterre ; mais, de toutes ces guerres civiles, aucune n'a eu une liberté sage pour objet.
Dans les temps détestables de Charles IX et d'Henri III, il s'agissait seulement de savoir si on serait l'esclave des Guises. Pour la dernière guerre de Paris, elle ne mérite que des sifflets ; il me semble que je vois des écoliers qui se mutinent contre le préfet d'un collège, et qui finissent par être fouettés ; le cardinal de Retz, avec beaucoup d'esprit et de courage mal employés, rebelle sans aucun sujet, factieux sans dessein, chef de parti sans armée, cabalait pour cabaler, et semblait faire la guerre civile pour son Le Parlement ne savait ce qu'il voulait, ni ce qu'il ne voulait pas ; il levait des troupes par arrêt, il les cassait ; il menaçait, il demandait pardon ; il mettait à prix la tête du cardinal Mazarin, et ensuite venait le complimenter en cérémonie. Nos guerres civiles sous Charles VI avaient été cruelles, celles de la Ligue furent abominables, celle de la Fronde fut ridicule.
Ce qu'on reproche le plus en France aux Anglais, c'est le supplice de Charles ler, qui fut traité par ses vainqueurs comme il les eût traités s'il eût été heureux.
Après tout, regardez d'un côté Charles ler vaincu en bataille rangée, prisonnier, jugé, condamné dans Westminster, et de l'autre l'empereur Henri VII empoisonné par son chapelain en communiant, Henri III assassiné par un moine ministre de la rage de tout un Parti, trente assassinats médités contre Henri plusieurs exécutés, et le dernier privant enfin la France de ce grand roi. Pesez ces attentats, et jugez.
Ce mélange heureux dans le gouvernement d'Angleterre, ce concert entre les Communes, les Lords et le Roi n'a pas toujours subsisté. L'Angleterre a été longtemps esclave ; elle l'a été des Romains, des Saxons, des Danois, des Français. Guillaume le Conquérant surtout la gouverna avec un sceptre de fer ; il disposait des biens et de la vie de ses nouveaux sujets comme un monarque de l'Orient ; il défendit, sous peine de mort, qu'aucun Anglais osât avoir du feu et de la lumière chez lui, passé huit heures du soir, soit qu'il prétendît par là prévenir leurs assemblées nocturnes, soit qu'il voulût essayer, par une défense si bizarre, jusqu'où peut aller le pouvoir d'un homme sur d'autres hommes.
Il est vrai qu'avant et après Guillaume le Conquérant les Anglais ont eu des parlements ; ils s'en vantent, comme si ces assemblées, appelées alors parlements, composées de tyrans ecclésiastiques et de pillards nommés barons, avaient été les gardiens de la liberté et de la félicité publique.
Les Barbares, qui des bords de la mer Baltique fondaient dans le reste de l'Europe, apportèrent avec eux l'usage de ces états ou parlements, dont on a fait tant de bruit et qu'on connaît si peu. Les rois alors n'étaient point despotiques, cela est vrai ; mais les peuples n'en gémissaient que plus dans une servitude misérable. Les chefs de ces sauvages qui avaient ravagé la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre se firent monarques ; leurs capitaines partagèrent entre eux les terres des vaincus. De là ces margraves, ces lairds, ces barons, ces sous-tyrans qui disputaient souvent avec leur roi les dépouilles des peuples. C'étaient des oiseaux de proie combattant contre un aigle pour sucer le sang des colombes ; chaque peuple avait cent tyrans au lieu d'un maître. Les prêtres se mirent bientôt de la partie. De tout temps, le sort des Gaulois, des Germains, des insulaires d'Angleterre avait été d'être gouvernés par leurs druides et par les chefs de leurs villages, ancienne espèce de barons, mais moins tyrans que leurs successeurs. Ces druides se disaient médiateurs entre la divinité et les hommes ; ils faisaient des lois, ils excommuniaient, ils condamnaient à la mort. Les évêques succédèrent peu à peu à leur autorité temporelle dans le gouvernement goth et vandale. Les papes se mirent à leur tête, et, avec des brefs, des bulles, et des moines, firent trembler les rois, les déposèrent, les firent assassiner, et tirèrent à eux tout l'argent qu'ils purent de l'Europe. L'imbécile Inas, l'un des tyrans de l'heptarchie d'Angleterre, fut le premier qui, dans un pèlerinage à Rome, se soumit à payer le denier de Saint-Pierre (ce qui était environ un écu de notre monnaie) pour chaque maison de son territoire. Toute 1'Úle suivit bientôt cet exemple. L'Angleterre devint petit à petit une province du pape ; le Saint-Père y envoyait de temps en temps ses légats, pour y lever des impôts exorbitants. Jean sans Terre fit enfin une cession en bonne forme de son royaume à Sa Sainteté, qui l'avait excommunié ; et les barons, qui n'y trouvèrent pas leur compte, chassèrent ce misérable roi ; ils mirent à sa place Louis VIII, père de saint Louis, roi de France ; mais ils se dégoûtèrent bientôt de ce nouveau venu, et lui firent repasser la mer.
Tandis que les barons, les évêques, les papes déchiraient ainsi l'Angleterre, où tous voulaient commander le peuple, la plus nombreuse, la plus vertueuse même et par conséquent la plus respectable partie des hommes, composée de ceux qui étudient les lois et les sciences, des négociants, des artisans, en un mot de tout ce qui n'était point tyran, le peuple, dis-je, était regardé par eux comme des animaux au-dessous de l'homme. Il s'en fallait bien que les communes eussent alors part au gouvernement ; c'étaient des vilains : leur travail, leur sang appartenaient à leurs maîtres, qui s'appelaient nobles. Le plus grand des hommes étaient en Europe ce qu'ils sont encore en plusieurs endroits du Nord, serfs d'un seigneur, espèce de bétail qu'on vend et qu'on achète avec la terre. Il a fallu des siècles pour rendre justice à l'humanité, pour sentir qu'il était horrible que le grand nombre semât et que le petit nombre ; et n'est-ce pas un bonheur pour le genre humain que l'autorité de ces petits brigands ait été éteinte en France par la puissance légitime de nos rois, et en Angleterre par la puissance légitime des rois et du peuple ?
Heureusement, dans les secousses que les querelles des rois et des grands donnaient aux empires, les fers des nations se sont plus ou moins relâchés ; la liberté est née en Angleterre des querelles des tyrans. Les barons forcèrent Jean sans Terre et Henri III à accorder cette fameuse charte, dont le principal but était, à la vérité, de mettre les rois dans la dépendance des lords, mais dans laquelle le reste de la nation fut un peu favorisé, afin que, dans l'occasion, elle se rangeât du parti de ses prétendus protecteurs. Cette Grande Charte, qui est regardée comme l'origine sacrée des libertés anglaises, fait bien voir elle-même combien peu la liberté était connue. Le titre seul prouve que le roi se croyait absolu de droit, et que les barons et le clergé même ne le forçaient à se relâcher de ce droit prétendu que parce qu'ils étaient les forts.
Voici comme commence la Grande Charte : « Nous accordons de notre libre volonté les privilèges suivants aux archevêques, évêques, abbés, prieurs et barons de notre royaume, etc.
Dans les articles de cette charte il n'est pas dit un mot de la Chambre des Communes, preuve qu'elle n'existait pas encore, ou qu'elle existait sans pouvoir. On y spécifie les hommes libres d'Angleterre : triste démonstration qu'il y en avait qui ne l'étaient pas. On voit, par l'article 32, que ces hommes prétendus libres devaient des services à leur seigneur. Une telle liberté tenait encore beaucoup de l'esclavage.
Par l'article 21, le roi ordonne que ses officiers ne pourront dorénavant prendre de force les chevaux et les charrettes des hommes libres qu'en payant, et ce règlement parut au peuple une vraie liberté, parce qu'il ôtait une plus grande tyrannie.
Henri VII, usurpateur heureux et grand politique, qui faisait semblant d'aimer les barons, mais qui les haïssait et les craignait, s'avisa de procurer l'aliénation de leurs terres. Par là, les vilains, qui, dans la suite, acquirent du bien par leurs travaux, achetèrent les châteaux des illustres pairs qui s'étaient ruinés par leurs folies. Peu à peu toutes les terres changèrent de maîtres.
La Chambre des Communes devint de jour en jour plus puissante. Les familles des anciens pairs s'éteignirent avec le temps ; et, comme il n'y a proprement que les pairs qui soient nobles en Angleterre dans la rigueur de la Loi, il n'y aurait plus du tout de noblesse en ce pays-là, si les rois n'avaient pas créé de nouveaux barons de temps en temps, et conservé l'ordre des pairs, qu'ils avaient tant craint autrefois, pour l'opposer à celui des Communes, devenu trop redoutable.
Tous ces nouveaux pairs, qui composent la Chambre haute, reçoivent du roi leur titre et rien de plus ; presque aucun d'eux n'a la terre dont il porte le nom. L'un est duc de Dorset, et n'a pas un pouce de terre en Dorsetshire ; l'autre est comte d'un village, qui sait à peine où ce village est situé. Ils ont du dans le Parlement, non ailleurs.
Vous n'entendez point ici parler de haute, moyenne et basse justice, ni du droit de chasser sur les terres d'un citoyen, lequel n'a pas la liberté de tirer un coup de fusil sur son propre champ.
Un homme, parce qu'il est noble ou parce qu'il est prêtre, n'est point ici exempt de payer certaines taxes ; tous les impôts sont réglés par la Chambre des Communes, qui, n'étant que la seconde par son rang, est la première par son crédit.
Les seigneurs et les évêques peuvent bien rejeter le bill des Communes pour les taxes ; mais il ne leur est pas permis d'y rien changer ; il faut ou qu'ils le reçoivent ou qu'ils le rejettent sans restriction. Quand le bill est confirmé par les lords et approuvé par le roi, alors tout le monde paie. Chacun donne, non selon sa qualité (ce qui est absurde), mais selon son revenu ; il n'y a point de taille ni de capitation arbitraire, mais une taxe réelle sur les terres. Elles ont toutes été évaluées sous le fameux roi Guillaume III, et au-dessous de leur prix.
La taxe subsiste toujours la même, quoique les revenus des terres aient augmenté ; ainsi personne n'est foulé, et personne ne se plaint. Le paysan n'a point les pieds meurtris par des sabots, il mange du pain blanc, il est bien vêtu, il ne craint point d'augmenter le nombre de ses bestiaux ni de couvrir son toit de tuiles, de peur que l'on ne hausse ses impôts l'année d'après. Il y a ici beaucoup de paysans qui ont environ deux cent mille francs de bien, et qui ne dédaignent pas de continuer à cultiver la terre qui les a enrichis, et dans laquelle ils vivent libres.
Le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour ; de la s'est formée la grandeur de l'État. C'est le commerce qui a établi peu à peu les forces navales par qui les Anglais sont les maîtres des mers. Ils ont à présent près de deux cents vaisseaux de guerre. La postérité apprendra peut-être avec surprise qu'une petite île, qui n'a de soi-même qu'un peu de plomb, de l'étain, de la terre à foulon et de la laine grossière, est devenue par son commerce assez puissante pour envoyer, en 1723, trois flottes à la fois en trois extrémités du monde, l'une devant Gibraltar, conquise et conservée par ses armes, l'autre à Porto-Bello, pour ôter au roi d'Espagne la jouissance des trésors des Indes, et la troisième dans la mer Baltique, pour empêcher les du Nord de se battre.
Quand Louis XIV faisait trembler l'Italie, et que ses armées déjà maîtresses de la Savoie et du Piémont, étaient prêtes de prendre Turin, il fallut que le prince Eugène marchât du fond de l'Allemagne au secours du duc de Savoie ; il n'avait point d'argent, sans quoi on ne prend ni ne défend les villes ; il eut à des marchands anglais ; en une demi-heure de temps, on lui prêta cinquante millions. Avec cela il délivra Turin, battit les Français, et écrivit à ceux qui avaient prêté cette somme ce petit billet : "Messieurs, j'ai reçu votre argent, et je me flatte de l'avoir employé à votre satisfaction."
Tout cela donne un juste orgueil à un marchand anglais, et fait qu'il ose se comparer, non sans quelque raison, à un citoyen romain. Aussi le cadet d'un pair du royaume ne dédaigne point le négoce. Milord Townshend, ministre d'État, a un frère qui se contente d'être marchand dans la Cité. Dans le temps que Oxford gouvernait l'Angleterre, son cadet était facteur à Alep, d'où il ne voulut pas revenir, et où il est mort.
Cette coutume, qui pourtant commence trop à se passer, paraît monstrueuse à des Allemands entêtés de leurs quartiers ; ils ne sauraient concevoir que le fils d'un pair d'Angleterre ne soit qu'un riche et puissant bourgeois, au lieu qu'en Allemagne tout est prince ; on a vu jusqu'à trente altesses du même nom n'ayant pour tout bien que des armoiries et de l'orgueil.
En France est marquis qui veut ; et quiconque arrive à Paris du fond d'une province avec de l'argent à dépenser et un nom en ac ou en ille, peut dire « un homme comme moi, un homme de ma qualité, et mépriser souverainement un négociant ; le négociant entend lui-même parler si souvent avec mépris de sa profession, qu'il est assez sot pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le Roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire, et contribue au bonheur du monde.
On dit doucement, dans l'Europe chrétienne, que les Anglais sont des fous et des enragés : des fous, parce qu'ils donnent la petite vérole à leurs enfants, pour les empêcher de l'avoir, des enragés, parce qu'ils communiquent de gaieté de coeur à ces enfants une maladie certaine et affreuse, dans la vue de un mal incertain. Les Anglais, de leur côté, disent : « Les autres Européens sont des lâches et des dénaturés : ils sont lâches, en ce qu'ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants ; dénaturés, en ce qu'ils les exposent à mourir un jour de la petite vérole. » Pour juger qui a raison dans cette dispute, voici l'histoire de cette fameuse insertion, dont on parle hors d'Angleterre avec tant d'effroi.
Les femmes de Circassie sont, de temps immémorial, dans l'usage de donner la petite vérole à leurs enfants, même à l'âge de six mois, en leur faisant une incision au bras, et en insérant dans cette incision une pustule qu'elles ont soigneusement enlevée du corps d'un autre enfant. Cette pustule fait, dans le où elle est insinuée, l'effet du levain dans un morceau de pâte ; elle y fermente, et répand dans la masse du sang les qualités dont elle est empreinte. Les boutons de l'enfant à qui l'on a donné cette petite vérole artificielle servent à porter la même maladie à d'autres. C'est une circulation presque continuelle en Circassie ; et quand malheureusement il n'y a point de petite vérole dans le pays, on est aussi embarrassé qu'on l'est ailleurs dans une mauvaise année.
Ce qui a introduit en Circassie cette coutume, qui paraît si étrange à d'autres peuples, est pourtant une cause commune à toute la terre : c'est la tendresse maternelle et l'intérêt.
Les Circassiens sont pauvres et leurs filles sont belles ; aussi ce sont elles dont ils font le plus de trafic. Ils fournissent de beautés les harems du Grand Seigneur, du Sophi de Perse, et de ceux qui sont assez riches pour acheter et pour entretenir cette marchandise précieuse. Ils élèvent ces filles en tout bien et en tout honneur à former des danses pleines de lascivité et de mollesse, à rallumer par tous les artifices les plus voluptueux le goût des maîtres dédaigneux à qui elles sont destinées : ces pauvres créatures répètent tous les jours leur leçon avec leur mère, comme nos petites filles répètent leur catéchisme, sans y rien comprendre.
Or, il arrivait souvent qu'un père et une mère, après avoir bien pris des peines pour donner une bonne éducation à leurs enfants, se voyaient tout d'un coup frustrés de leur espérance. La petite vérole se mettait dans la famille ; une fille en mourait, une autre perdait un oeil, une troisième relevait avec un gros nez ; et les pauvres gens étaient ruinés sans ressource. Souvent même, quand la petite vérole devenait épidémique, le commerce était interrompu pour plusieurs années, ce qui causait une notable diminution dans les sérails de Perse et de Turquie.
Une nation commerçante est toujours fort alerte sur ses intérêts, et ne néglige rien des connaissances qui peuvent être utiles à son négoce. Les Circassiens s'aperçurent que, sur mille personnes, il s'en trouvait à peine une seule qui fût attaquée deux fois d'une petite vérole bien complète ; qu'à la vérité on essuie quelquefois trois ou quatre petites véroles légères, mais jamais deux qui soient décidées et dangereuses ; qu'en un mot jamais on n'a véritablement cette maladie deux fois en sa vie. Ils remarquèrent encore que, quand les petites véroles sont très bénignes et que leur éruption ne trouve à percer qu'une peau délicate et fine, elles ne laissent aucune impression sur le visage. De ces observations naturelles ils conclurent que si un enfant de six mois ou d'un an avait une petite vérole bénigne, il n'en mourrait pas, il n'en serait pas marqué, et serait quitte de cette maladie pour le reste de ses jours.
Il restait donc, pour conserver la vie et la beauté de leurs enfants, de leur donner la petite vérole de bonne heure ; c'est ce que l'on fit, en insérant dans le corps d'un enfant un bouton que l'on prit de la petite vérole la plus complète et en même temps la plus favorable qu'on pût trouver. L'expérience ne pas manquer de réussir. Les Turcs, qui sont gens sensés, adoptèrent bientôt après cette coutume, et aujourd'hui il n'y a point de Bacha, dans Constantinoble, qui ne donne la petite vérole à son fils et à sa fille en les faisant sevrer.
Il y a quelques gens qui prétendent que les Circassiens prirent autrefois cette coutume des Arabes ; mais nous laissons ce point d'histoire à éclaircir par quelque savant bénédictin, qui ne manquera pas de composer là-dessus plusieurs volumes in-folio avec les preuves. Tout ce que j'ai à dire sur cette matière, que, dans le commencement du règne de Georges premier, Madame de Wortley-Montaigu, une des femmes d'Angleterre qui a le plus d'esprit et le plus de force dans l'esprit, étant avec son mari en ambassade à Constantinople, s'avisa de donner sans scrupule la petite vérole à un enfant dont elle était accouchée en ce pays. Son chapelain eut beau lui dire que cette expérience n'était pas chrétienne, et ne pouvait réussir que chez des infidèles, le fils de Mme Wortley s'en trouva à merveille. Cette dame, de retour à Londres, fit part de son expérience à la princesse de Galles, qui est aujourd'hui reine. Il faut que, titres et couronnes à part, cette princesse est née pour encourager tous les arts et pour faire du bien aux hommes ; c'est un philosophe aimable sur le trône ; elle n'a jamais perdu ni une occasion de s'instruire, ni une occasion d'exercer sa générosité ; c'est elle qui, ayant entendu dire qu'une fille de Milton vivait encore, et vivait dans la misère, lui envoya sur-le-champ un présent considérable ; c'est elle qui protège ce pauvre père Courayer; c'est elle qui daigna être la médiatrice entre le docteur Clarke et Monsieur Leibnitz. Dès qu'elle eut entendu parler de l'inoculation ou insertion de la petite vérole, elle en fit faire l'épreuve sur quatre criminels condamnés à mort, à qui elle sauva doublement la vie ; car non seulement elle les tira de la potence, mais, à la faveur de cette petite vérole artificielle, elle prévint la naturelle, qu'ils auraient probablement eue, et dont ils seraient morts peut-être dans un âge plus avancé.
La princesse, assurée de l'utilité de cette épreuve, fit inoculer ses enfants : l'Angleterre suivit son exemple, et, depuis ce temps, dix mille enfants de famille au moins doivent ainsi la vie à la reine et à Mme Wortley-Montaigu, et autant de filles leur doivent leur beauté.
Sur cent personnes dans le monde, soixante au moins ont la petite vérole ; de ces soixante, vingt en meurent dans les années les plus favorables et vingt en conservent pour toujours de fâcheux restes : voilà donc la cinquième partie des hommes que cette maladie tue ou enlaidit sûrement. De tous ceux qui sont en Turquie ou en Angleterre, aucun ne meurt, s'il n'est infirme et condamné à mort d'ailleurs ; personne n'est marqué; aucun n'a la petite vérole une seconde fois, supposé que l'inoculation ait été parfaite. Il est donc certain que si quelque ambassadrice française avait rapporté ce secret de Constantinople à Paris, elle aurait rendu un service éternel à la nation ; le duc de Villequier, père du duc d'Aumont d'aujourd'hui, l'homme de France le mieux constitué et le plus sain, ne serait pas mort à la fleur de son âge.
Le prince de Soubise, qui avait la santé la plus brillante, n'aurait pas été emporté à l'âge de vingt-cinq ans ; Monseigneur, grand-père de Louis XV, n'aurait pas été enterré dans sa cinquantième année ; vingt mille personnes, mortes à Paris de la petite vérole en 1723, vivraient encore. Quoi donc ! Est-ce que les Français n'aiment point la vie ? Est-ce que leurs femmes ne se soucient point de leur beauté ? En vérité, nous sommes d'étranges gens ! Peut-être dans dix ans prendra-t-on cette méthode anglaise, si les curés et les médecins le permettent ; ou bien les Français, dans trois mois, se serviront de l'inoculation par fantaisie, si les Anglais s'en dégoûtent par inconstance.
J'apprends que depuis cent ans les Chinois sont dans cet usage ; c'est un grand préjugé que l'exemple d'une nation qui passe pour être la plus sage et la mieux policée de l'univers. Il est vrai que les Chinois s'y prennent d'une façon différente ; ils ne font point d'incision; ils font prendre la petite vérole par le nez, comme du tabac en poudre; cette façon est plus agréable, mais elle revient au même, et sert également à confirmer que, si on avait pratiqué l'inoculation en France, on aurait sauvé la vie à des milliers d'hommes.
Il n'y a pas longtemps que l'on agitait, dans une compagnie célèbre, cette question usée et frivole, quel était le plus grand homme, de César, d'Alexandre, de Tamerlan, de Cromwell, etc.
Quelqu'un répondit que c'était sans contredit Isaac Newton. Cet homme avait raison ; car si la vraie grandeur consiste à avoir reçu du Ciel un puissant génie, et à s'en être servi pour s'éclairer soi-même et les autres, un homme comme monsieur Newton, tel qu'il s'en trouve à peine en dix siècles, est véritablement le grand homme ; et ces politiques et ces conquérants, dont aucun siècle n'a manqué, ne sont d'ordinaire que d'illustres méchants. C'est à celui qui domine sur les esprits par la force de la vérité, non à ceux qui font des esclaves par la violence, c'est à celui qui connaît l'univers, non à ceux qui le défigurent, que nous devons nos respects.
Puis donc que vous exigez que je vous parle des hommes célèbres qu'a portés l'Angleterre, je commencerai par les Bacon, les Locke, les Newton, etc. Les généraux et les ministres viendront à leur tour.
Il faut commencer par le fameux comte de Verulam, connu en Europe sous le nom de Bacon, qui était son nom de famille. Il était fils d'un garde des Sceaux, et fut longtemps chancelier sous le roi Jacques premier. Cependant, au milieu des intrigues de la cour et des occupations de sa charge, qui demandaient un homme tout entier, il trouva le temps d'être grand philosophe, bon historien et écrivain élégant; et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il vivait dans un siècle où l'on ne connaissait guère l'art de bien écrire, encore moins la bonne philosophie. Il a été, comme c'est l'usage parmi les hommes, plus estimé après sa mort que de son vivant : ses ennemis étaient à la cour de Londres ; ses admirateurs étaient dans toute l'Europe.
Lorsque le marquis d'Effiat amena en Angleterre la princesse Marie, fille de Henri le Grand, qui devait épouser le prince de Galles, ce ministre alla visiter Bacon, qui, alors étant malade au lit, le reçut les rideaux fermés. « Vous ressemblez aux anges, lui dit d'Effiat ; on entend toujours parler d'eux, on les croit bien supérieurs aux hommes, et on n'a jamais la consolation de les voir.
Vous savez, Monsieur, comment Bacon fut accusé d'un crime qui n'est guère d'un philosophe, de s'être laissé corrompre par argent ; vous savez comment il fut condamné par la Chambre des Pairs à une amende d'environ quatre cent mille livres de notre monnaie, à perdre sa dignité de chancelier et de pair.
Aujourd'hui, les Anglais révèrent sa mémoire au point qu'ils ne veulent point avouer qu'il ait été coupable. Si vous me demandez ce que j'en pense, je me servirai, pour vous répondre, d'un mot que j'ai ouï dire à milord Bolingbroke. On parlait, en sa présence, de l'avarice dont le duc de Marlborough avait été accusé, et on en citait des traits sur lesquels on appelait au témoignage de milord Bolingbroke, qui, ayant été son ennemi déclaré, pouvait peut-être avec bienséance dire ce qui en était. « C'était un si grand homme, répondit-il, que j'ai oublié ses vices. Je me bornerai donc à vous parler de ce qui a mérité au chancelier Bacon l'estime de l'Europe.
Le plus singulier et le meilleur de ses ouvrages est celui qui est aujourd'hui le moins lu et le plus inutile : je veux parler de son Novum scientiarum organum. C'est l'échafaud avec lequel on a bâti la nouvelle philosophie ; et, quand cet édifice a été élevé au moins en partie, l'échafaud n'a plus été d'aucun usage.
Le chancelier Bacon ne connaissait pas encore la nature ; mais il savait et indiquait tous les chemins qui mènent à elle. Il avait méprisé de bonne heure ce que les universités appelaient la philosophie ; et il faisait tout ce qui dépendait de lui, afin que ces compagnies, instituées pour la perfection de la raison humaine, ne continuassent pas de la gâter par leurs quiddités, leur horreur du vide, leurs formes substantielles et tous les mots impertinents que non seulement l'ignorance rendait respectables, mais qu'un mélange ridicule avec la religion avait rendus presque sacrés.
Il est le père de la philosophie expérimentale. Il est bien vrai qu'avant lui on avait découvert des secrets étonnants. On avait inventé la boussole, l'imprimerie, la gravure des estampes, la peinture à l'huile, les glaces, l'art de rendre en quelque façon la vue aux vieillards par les lunettes qu'on appelle bésicles, la poudre à canon, etc. On avait cherché, trouvé et conquis un nouveau monde. Qui ne croirait que ces sublimes découvertes eussent été faites par les plus grands philosophes, et dans des temps bien plus éclairés que le nôtre ? Point du tout : c'est dans le temps de la plus stupide barbarie que ces grands changements ont été faits sur la terre : le hasard seul a produit presque toutes ces inventions, et il y a même bien de l'apparence que ce qu'on appelle hasard a eu grande part dans la découverte de l'Amérique ; du moins a-t-on toujours cru que Christophe Colomb n'entreprit son voyage que sur la foi d'un capitaine de vaisseau qu'une tempête avait jeté jusqu'à la hauteur des îles Caraïbes.
Quoi qu'il en soit, les hommes savaient aller au bout du monde, ils savaient détruire des villes avec un tonnerre artificiel plus terrible que le tonnerre véritable ; mais ils ne connaissaient pas la circulation du sang, la pesanteur de l'air, les lois du mouvement, la lumière, le nombre de nos planètes, etc., et un homme qui soutenait une thèse sur les catégories d'Aristote, sur l'universel a parte rei ou telle autre sottise, était regardé comme un prodige.
Les inventions les plus étonnantes et les plus utiles ne sont pas celles qui font le plus d'honneur à l'esprit humain.
C'est à un instinct mécanique, qui est chez la plupart des hommes, que nous devons tous les arts, et nullement à la saine philosophie.
La découverte du feu, l'art de faire du pain, de fondre et de préparer les métaux, de bâtir des maisons, l'invention de la navette, sont d'une tout autre nécessité que l'imprimerie et la boussole ; cependant ces arts furent inventés par des hommes encore sauvages.
Quel prodigieux usage les Grecs et les Romains ne firent-ils pas depuis des mécaniques ? Cependant on croyait de leur temps qu'il y avait des cieux de cristal, et que les étoiles étaient de petites lampes qui tombaient quelquefois dans la mer ; et un de leurs grands philosophes, après bien des recherches, avait trouvé que les astres étaient des cailloux qui s'étaient détachés de la terre.
En un mot, personne avant le chancelier Bacon n'avait connu la philosophie expérimentale ; et de toutes les épreuves physiques qu'on a faites depuis lui, il n'y en a presque pas une qui ne soit indiquée dans son livre. Il en avait fait lui-même plusieurs ; il fit des espèces de machines pneumatiques, par les- quelles il devina l'élasticité de l'air ; il a tourné tout autour de la découverte de sa pesanteur ; il y touchait ; cette vérité fut saisie par Torricelli. Peu de temps après, la physique expérimentale commença tout d'un coup à être cultivée à la fois dans presque toutes les parties de l'Europe. C'était un trésor caché dont Bacon s'était douté, et que tous les philosophes, encouragés par sa promesse, s'efforcèrent de déterrer.
Mais ce qui m'a le plus surpris, ç'a été de voir dans son livre, en termes exprès, cette attraction nouvelle dont monsieur Newton passe pour l'inventeur.
« Il faut chercher, dit Bacon, s'il n'y aurait point une espèce de force magnétique qui opère entre la terre et les choses pesantes, entre la Lune et l'Océan, entre les Planètes, etc.
En un autre endroit, il dit : « Il faut ou que les corps graves soient portés vers le centre de la terre ou qu'ils en soient mutuellement attirés, et, en ce dernier cas, il est évident que plus les corps, en tombant, s'approcheront de la terre, plus fortement ils s'attireront. Il faut, poursuit-il, expérimenter si la même horloge à poids ira plus vite sur le haut d'une montagne ou au fond d'une mine ; si la force des poids diminue sur la montagne et augmente dans la mine, il y a apparence que la terre a une vraie attraction.
Ce précurseur de la philosophie a été aussi un écrivain élégant, un historien, un bel esprit.
Ses Essais de morale sont très estimés ; mais ils sont faits pour instruire plutôt que pour plaire ; et, n'étant ni la satire de la nature humaine comme les Maximes de M. de La Rochefoucauld, ni l'école du scepticisme comme Montaigne, ils sont moins lus que ces deux livres ingénieux.
Son Histoire de Henri VII a passé pour un chef d'oeuvre ; mais je serais fort trompé si elle pouvait être comparée à l'ouvrage de notre illustre de Thou.
En parlant de ce fameux imposteur Parkins, juif de naissance, qui prit si hardiment le nom de Richard IV, roi d'Angleterre, encouragé par la duchesse de Bourgogne, et qui disputa la couronne à Henri VII, voici comme le chancelier Bacon s'exprime :
« Environ ce temps, le roi Henri fut obsédé d'esprits malins par la magie de la duchesse de Bourgogne, qui évoqua des enfers l'ombre d'Édouard IV pour venir tourmenter le roi Henri. Quand la duchesse de Bourgogne eut instruit Parkins, elle commença à délibérer par quelle région du Ciel elle ferait paraître cette comète, et elle résolut qu'elle éclaterait d'abord sur l'horizon de l'Irlande.
Il me semble que notre sage de Thou ne donne guère dans ce phébus, qu'on prenait autrefois pour du sublime, mais qu'à présent on nomme avec raison galimatias.
Jamais il ne fut peut-être un esprit plus sage, plus méthodique, un logicien plus exact que M. Locke ; cependant il n'était pas grand mathématicien. Il n'avait jamais pu se soumettre à la fatigue des calculs ni à la sécheresse des vérités mathématiques, qui ne présente d'abord rien de sensible à l'esprit ; et personne n'a mieux prouvé que lui qu'on pouvait avoir l'esprit géomètre sans le secours de la géométrie. Avant lui, de grands philosophes avaient décidé positivement ce que c'est que l'âme de l'homme ; mais, puisqu'ils n'en savaient rien du tout, il est bien juste qu'ils aient tous été d'avis différents.
Dans la Grèce, berceau des arts et des erreurs, et où l'on poussa si loin la grandeur et la sottise de l'esprit humain, on raisonnait comme chez nous sur l'âme.
Le divin Anaxagoras, à qui on dressa un autel pour avoir appris aux hommes que le Soleil était plus grand que le Péloponnèse, que la neige était noire et que les cieux étaient de pierre, affirma que l'âme était un esprit aérien, mais cependant immortel.
Diogène, un autre que celui qui devint cynique après avoir été faux-monnayeur, assurait que l'âme était une portion de la substance même de Dieu ; et cette idée au moins était brillante.
Épicure la composait de parties comme le corps. Aristote, qu'on a expliqué de mille façons, parce qu'il était inintelligible, croyait, si l'on s'en rapporte à quelques-uns de ses disciples, que l'entendement de tous les hommes était une seule et même substance.
Le divin Platon, maître du divin Aristote, et le divin Socrate, maître du divin Platon, disaient l'âme corporelle et éternelle ; le démon de Socrate lui avait appris sans doute ce qui en était. Il y a des gens, à la vérité, qui prétendent qu'un homme qui se vantait d'avoir un génie familier était indubitablement un ou un fripon ; mais ces gens-là sont trop difficiles.
Quant à nos Pères de l'Église, plusieurs dans les premiers siècles ont cru l'âme humaine, les Anges et Dieu corporels.
Le monde se raffine toujours. Saint Bernard, selon l'aveu du père Mabillon, enseigna, à propos de l'âme, qu'après la mort elle ne voyait point Dieu dans le Ciel, mais qu'elle conversait seulement avec l'humanité de Jésus-Christ ; on ne le crut pas cette fois sur sa parole. L'aventure de la Croisade avait un peu décrédité ses oracles. Mille scolastiques sont venus ensuite, comme le docteur irréfragable, le docteur subtil, le docteur angélique, le docteur séraphique, le docteur chérubique, qui tous ont été bien sûrs de connaître l'âme très clairement, mais qui n'ont pas laissé d'en parler comme s'ils avaient voulu que personne n'y entendît rien.
Notre Descartes, né pour découvrir les erreurs de l'antiquité, mais pour y substituer les siennes, et entraîné par cet esprit systématique qui aveugle les plus grands hommes, s'imagina avoir démontré que l'âme était la même chose que la pensée, comme la matière, selon lui, est la même chose que l'étendue ; il assura que l'on pense toujours, et que l'âme arrive dans le corps pourvue de toutes les notions métaphysiques, connaissant Dieu, l'espace, l'infini, ayant toutes les idées abstraites, remplie enfin de belles connaissances, qu'elle oublie malheureusement en sortant du ventre de sa mère.
M. Malebranche, de l'Oratoire, dans ses illusions sublimes, non seulement admit les idées innées, mais il ne doutait pas que nous ne vissions tout en Dieu, et que Dieu, pour ainsi dire, ne fût notre âme.
Tant de raisonneurs ayant fait le roman de l'âme, un sage est venu, qui en a fait modestement l'histoire. Locke a développé à l'homme la raison humaine, comme un excellent anatomiste explique les ressorts du corps humain. Il s'aide partout du flambeau de la physique ; il ose quelquefois parler affirmativement, mais il ose aussi douter ; au lieu de définir tout d'un coup ce que nous ne connaissons pas, il examine par degrés ce que nous voulons connaître. Il prend un enfant au moment de sa naissance ; il suit pas à pas les progrès de son entendement ; il voit ce qu'il a de commun avec les bêtes et ce qu'il a au-dessus d'elles ; il consulte surtout son propre témoignage, la conscience de sa pensée.
« Je laisse, dit-il, à discuter à ceux qui en savent plus que moi, si notre âme existe avant ou après l'organisation de notre corps ; mais j'avoue qu'il m'est tombé en partage une de ces âmes grossières qui ne pensent pas toujours, et j'ai même le malheur de ne pas concevoir qu'il soit plus nécessaire à l'âme de penser toujours qu'au corps d'être toujours en mouvement.
Pour moi, je me vante de l'honneur d'être en ce point aussi stupide que Locke. Personne ne me fera jamais croire que je pense toujours ; et je ne me sens pas plus disposé que lui à imaginer que, quelques semaines après ma conception, j'étais une fort savante âme, sachant alors mille choses que j'ai oubliées en naissant, et ayant fort inutilement possédé dans l'utérus des connaissances qui m'ont échappé dès que j'ai pu en avoir besoin, et que je n'ai jamais bien pu rapprendre depuis.
Locke, après avoir ruiné les idées innées, après avoir bien renoncé à la vanité de croire qu'on pense toujours, établit que toutes nos idées nous viennent par les sens, examine nos idées simples et celles qui sont composées, suit l'esprit de l'homme dans toutes ses opérations, fait voir combien les langues que les parlent sont imparfaites, et quel abus nous faisons des termes à tous moments.
Il vient enfin à considérer l'étendue ou plutôt le néant des connaissances humaines. C'est dans ce chapitre qu'il ose avancer modestement ces paroles : Nous ne serons peut-être jamais capables de connaître si un être purement matériel pense ou non.
Ce discours sage parut à plus d'un théologien une déclaration scandaleuse que l'âme est matérielle et mortelle.
Quelques Anglais, dévots à leur manière, sonnèrent l'alarme. Les superstitieux sont dans la société ce que les poltrons sont dans une armée : ils ont, et donnent des terreurs paniques. On cria que Locke voulait renverser la religion : il ne s'agissait pourtant point de religion dans cette affaire ; c'était une question purement philosophique, très indépendante de la foi et de la révélation ; il ne fallait qu'examiner sans aigreur s'il y a de la contradiction à dire : la matière peut penser, et si Dieu peut communiquer la pensée à la matière. Mais les théologiens commencent trop souvent par dire que Dieu est outragé quand on n'est pas de leur avis. C'est trop ressembler aux mauvais poètes, qui criaient que Despréaux parlait mal du roi, parce qu'il se moquait d'eux.
Le docteur Stillingfleet s'est fait une réputation de théologien modéré, pour n'avoir pas dit positivement des injures à Locke. Il entra en lice contre lui, mais il fut battu, car il raisonnait en docteur, et Locke en philosophe instruit de la force et de la faiblesse de l'esprit humain, et qui se battait avec des armes dont il connaissait la trempe.
Si j'osais parler après M. Locke sur un sujet si délicat, je dirais : Les hommes disputent depuis longtemps sur la nature et sur l'immortalité de l'âme. À l'égard de son immortalité, il est impossible de la démontrer, puisqu'on dispute encore sur sa nature, et qu'assurément il faut connaître à fond un être créé pour décider s'il est immortel ou non. La raison humaine est si peu capable de démontrer par elle-même l'immortalité de l'âme que la religion a été obligée de nous la révéler. Le bien commun de tous les hommes demande qu'on croie l'âme immortelle ; la foi nous l'ordonne ; il n'en faut pas davantage, et la chose est décidée. Il n'en est pas de même de sa nature ; il importe peu à la religion de quelle substance soit l'âme, pourvu qu'elle soit vertueuse ; c'est une horloge qu'on nous a donnée à gouverner ; mais l'ouvrier ne nous a pas dit de quoi le ressort de cette horloge est composé.
Je suis corps et je pense : je n'en sais pas davantage. Irai-je attribuer à une cause inconnue ce que je puis si aisément attribuer à la seule cause seconde que je connais ? Ici, tous les philosophes de l'école m'arrêtent en argumentant, et disent : « Il n'y a dans le corps que de l'étendue et de la solidité, et il ne peut avoir que du mouvement et de la figure. Or, du mouvement et de la figure, de l'étendue et de la solidité ne peuvent faire une pensée ; donc l'âme ne peut pas être matière. Tout ce grand raisonnement tant de fois répété se réduit uniquement à ceci : « Je ne connais point du tout la matière ; j'en devine imparfaitement quelques propriétés ; or, je ne sais point du tout si ces propriétés peuvent être jointes à la pensée ; donc parce que je ne sais rien du tout, j'assure positivement que la matière ne saurait penser. Voilà nettement la manière de raisonner de l'école. Locke dirait avec simplicité à ces messieurs : « Confessez du moins que vous êtes aussi ignorants que moi ; votre imagination ni la mienne ne peuvent concevoir comment un corps a des idées ; et comprenez-vous mieux comment une substance, telle qu'elle soit, a des idées ? Vous ne concevez ni la matière ni l'esprit ; comment osez-vous assurer quelque chose ?
Le superstitieux vient à son tour, et dit qu'il faut brûler, pour le bien de leurs âmes, ceux qui soupçonnent qu'on peut penser avec la seule aide du corps. Mais que diraient-ils si c'étaient eux-mêmes qui fussent coupables d'irréligion ? En effet, quel est l'homme qui osera assurer, sans une impiété absurde, qu'il est impossible au Créateur de donner à la matière la pensée et le sentiment ? Voyez, je vous prie, à quel embarras vous êtes réduits, vous qui bornez ainsi la Puissance du Créateur ! Les bêtes ont les mêmes organes que nous, les mêmes sentiments, les mêmes perceptions ; elles ont de la mémoire, elles combinent quelques idées. Si Dieu n'a pas pu animer la matière et lui donner le sentiment, il faut de deux choses l'une, ou que les bêtes soient de pures machines ou qu'elles aient une âme spirituelle.
Il me paraît presque démontré que les bêtes ne peuvent être de simples machines. Voici ma preuve : Dieu leur a fait précisément les mêmes organes de sentiment que les nôtres ; donc, s'ils ne sentent point, Dieu a fait un ouvrage inutile. Or Dieu, de votre aveu même, ne fait rien en vain ; donc il n'a point tant d'organes de sentiment pour qu'il n'y eût point de sentiment ; donc les bêtes ne sont point de pures machines.
Les bêtes, selon vous, ne peuvent pas avoir une âme spirituelle ; donc, malgré vous, il ne reste autre chose à dire, sinon que Dieu a donné aux organes des bêtes, qui sont matière, la faculté de sentir et d'apercevoir, laquelle vous appelez instinct dans elles.
Eh! qui peut empêcher Dieu de communiquer à nos organes plus déliés cette faculté de sentir, d'apercevoir et de penser, que nous appelons raison humaine ? De quelque côté que vous vous tourniez, vous êtes obligés d'avouer votre ignorance et la puissance immense du Créateur. Ne vous révoltez donc plus contre la sage et modeste philosophie de Locke ; loin d'être contraire à la religion, elle lui servirait de preuve, si la religion en avait besoin ; car, quelle philosophie plus religieuse que celle qui, n'affirmant que ce qu'elle conçoit clairement et sachant avouer sa faiblesse, vous dit qu'il faut recourir à Dieu dès qu'on examine les premiers principes ?
D'ailleurs, il ne faut jamais craindre qu'aucun sentiment philosophique puisse nuire à la religion d'un pays. Nos mystères ont beau être contraires à nos démonstrations, ils n'en sont pas moins révérés par les philosophes chrétiens, qui savent que les objets de la raison et de la foi sont de différente nature. Jamais les philosophes ne feront une secte de religion. Pourquoi ? C'est qu'ils n'écrivent point pour le peuple, et qu'ils sont sans enthousiasme.
Divisez le genre humain en vingt parts : il y en a dix-neuf composées de ceux qui travaillent de leurs mains, et qui ne sauront jamais s'il y a un Locke au monde ; dans la vingtième partie qui reste, combien trouve-t-on peu d'hommes qui lisent ! Et parmi ceux qui lisent, il y en a vingt qui lisent des romans, un qui étudie la philosophie. Le nombre de ceux qui pensent est excessivement petit, et ceux-là ne s'avisent pas de troubler le monde.
Ce n'est ni Montaigne, ni Locke, ni Bayle, ni Spinosa, ni Hobbes, ni milord Shaftesbury, ni M. Collins, ni M. Toland, etc., qui ont porté le flambeau de la discorde dans leur patrie ; ce sont, pour la plupart, des théologiens, qui, ayant eu d'abord l'ambition d'être chefs de secte, ont eu bientôt celle d'être chefs de parti. Que dis-je! tous les livres des philosophes modernes mis ensemble ne feront jamais dans le monde autant de bruit seulement qu'en a fait autrefois la dispute des cordeliers sur la forme de leur manche et de leur capuchon.
Un Français qui arrive à Londres trouve les choses bien changées en philosophie comme dans tout le reste. Il a laissé le monde plein ; il le trouve vide. À Paris, on voit l'univers composé de tourbillons de matière subtile ; à Londres, on ne voit rien de cela. Chez nous, c'est la pression de la lune qui cause le de la mer ; chez les Anglais, c'est la mer qui gravite vers la lune, de façon que, quand vous croyez que la lune devrait nous donner marée haute, ces Messieurs croient qu'on doit avoir marée basse ; ce qui malheureusement ne peut se vérifier, car il aurait fallu, pour s'en éclaircir, examiner la lune et les au premier instant de la création.
Vous remarquerez encore que le soleil, qui en France n'entre pour rien dans cette affaire, y contribue ici environ pour son quart. Chez vos cartésiens, tout se fait par une impulsion qu'on ne comprend guère ; chez M. Newton, c'est par une attraction dont on ne connaît pas mieux la cause. À Paris, vous vous la terre faite comme un melon ; à Londres, elle est aplatie des deux côtés. La lumière, pour un cartésien, existe dans l'air ; pour un newtonien, elle vient du soleil en six minutes et demie. Votre chimie fait toutes ses opérations avec des acides, des alcalis et de la matière subtile ; l'attraction domine jusque la chimie anglaise.
L'essence même des choses a totalement changé. Vous ne vous accordez ni sur la définition de l'âme ni sur celle de la matière. Descartes assure que l'âme est la même chose que la pensée, et Locke lui prouve assez bien le contraire.
Descartes assure encore que l'étendue seule fait la matière ; Newton y ajoute la solidité. Voilà de furieuses contrariétés.
Non nostrum inter vos tantas componere lites.
Ce fameux Newton, ce destructeur du système cartésien, mourut au mois de mars de l'an passé 1727. Il a vécu honoré de ses compatriotes, et a été enterré comme un roi qui aurait fait du bien à ses sujets.
On a lu ici avec avidité et l'on a traduit en anglais l'éloge que M. de Fontenelle a prononcé de M. Newton dans l'Académie des Sciences. On attendait en Angleterre le jugement de M. de Fontenelle comme une déclaration solennelle de la supériorité de la philosophie anglaise ; mais, quand on a vu qu'il Descartes à Newton, toute la société royale de Londres s'est soulevée. Loin d'acquiescer au jugement, on a critiqué ce discours. Plusieurs même (et ceux-là ne sont pas les plus philosophes) ont été choqués de cette comparaison seulement parce que Descartes était Français.
Il faut avouer que ces deux grands hommes ont été bien différents l'un de l'autre dans leur conduite, dans leur fortune et dans leur philosophie.
Descartes était né avec une imagination vive et forte, qui en fit un homme singulier dans sa vie privée comme dans sa manière de raisonner. Cette imagination ne put se cacher même dans ses ouvrages philosophiques, où l'on voit à tout moment des comparaisons ingénieuses et brillantes. La nature en presque fait un poète, et en effet il composa pour la reine de Suède un divertissement en vers que pour l'honneur de sa mémoire on n'a pas fait imprimer.
Il essaya quelque temps du métier de la guerre, et depuis étant devenu tout à fait philosophe, il ne crut pas indigne de lui de faire l'amour. Il eut de sa maîtresse une fille nommée Francine, qui mourut jeune et dont il regretta beaucoup la perte. Ainsi il éprouva tout ce qui appartient à l'humanité.
Il crut longtemps qu'il était nécessaire de fuir les hommes, et surtout sa patrie, pour philosopher en liberté. Il avait raison ; les hommes de son temps n'en savaient pas assez pour l'éclaircir, et n'étaient guère capables que de lui nuire.
Il quitta la France parce qu'il cherchait la vérité, qui y était persécutée alors par la misérable philosophie de l'École ; mais il ne trouva pas plus de raison dans les universités de la Hollande, où il se retira. Car dans le temps qu'on condamnait en France les seules propositions de sa philosophie qui vraies, il fut aussi persécuté par les prétendus philosophes de Hollande qui ne l'entendaient pas mieux, et qui, voyant de plus près sa gloire, haïssaient davantage sa personne. Il fut obligé de sortir d'Utrecht ; il essuya l'accusation d'athéisme, dernière ressource des calomniateurs ; et lui qui avait employé toute la sagacité de son esprit à chercher de nouvelles preuves de l'existence d'un Dieu, fut soupçonné de n'en point reconnaître.
Tant de persécutions supposaient un très grand mérite et une réputation éclatante : aussi avait-il l'un et l'autre. La raison perça même un peu dans le monde à travers les ténèbres de l'École et les préjugés de la superstition populaire. Son nom fit enfin tant de bruit qu'on voulut l'attirer en France par des récompenses. On lui proposa une pension de mille écus ; il vint sur cette espérance, paya les frais de la patente, qui se vendait alors, n'eut point la pension, et s'en retourna philosopher dans sa solitude de Nord-Hollande, dans le temps que le grand Galilée, à l'âge de quatre-vingts ans, gémissait dans les prisons de l'Inquisition, pour avoir démontré le mouvement de la terre. Enfin il mourut à Stockholm d'une mort prématurée et causée par un mauvais régime, au milieu de quelques savants, ses ennemis, et entre les mains d'un médecin qui le haïssait.
La carrière du chevalier Newton a été toute différente. Il a vécu quatre-vingt-cinq ans, toujours tranquille, heureux et honoré dans sa patrie.
Son grand bonheur a été non seulement d'être né dans un pays libre, mais dans un temps où les impertinences scolastiques étant bannies, la raison seule était cultivée ; et le monde ne pouvait être que son écolier, et non son ennemi.
Une opposition singulière dans laquelle il se trouve avec Descartes, c'est que, dans le cours d'une si longue vie, il n'a eu ni passion ni faiblesse ; il n'a jamais approché d'aucune femme : c'est ce qui m'a été confirmé par le médecin et le chirurgien entre les bras de qui il est mort. On peut admirer en cela mais il ne faut pas blâmer Descartes.
L'opinion publique en Angleterre sur ces deux philosophes est que le premier était un rêveur, et que l'autre était un sage.
Très peu de personnes à Londres lisent Descartes, dont effectivement les ouvrages sont devenus inutiles ; très peu lisent aussi Newton, parce qu'il faut être fort savant pour le comprendre ; cependant, tout le monde parle d'eux ; on n'accorde rien au Français et on donne tout à l'Anglais. Quelques gens croient si on ne s'en tient plus à l'horreur du vide, si on sait que l'air est pesant, si on se sert de lunettes d'approche, on en a l'obligation à Newton. Il est ici l'Hercule de la fable, à qui les ignorants attribuaient tous les faits des autres héros.
Dans une critique qu'on a faite à Londres du discours de M. de Fontenelle, on a osé avancer que Descartes n'était pas un grand géomètre. Ceux qui parlent ainsi peuvent se reprocher de battre leur nourrice ; Descartes a fait un aussi grand chemin, du point où il a trouvé la géométrie jusqu'au point où il l'a poussée, que Newton en a fait après lui : il est le premier qui ait trouvé la manière de donner les équations algébriques des courbes. Sa géométrie, grâce à lui devenue aujourd'hui commune, était de son temps si profonde qu'aucun professeur n'osa entreprendre du l'expliquer, et qu'il n'y avait en Hollande Schooten et en France que Fermat qui l'entendissent.
Il porta cet esprit de géométrie et d'invention dans la dioptrique, qui devint entre ses mains un art tout nouveau ; et s'il s'y trompa en quelque chose, c'est qu'un homme qui découvre de nouvelles terres ne peut tout d'un coup en connaître toutes les propriétés : ceux qui viennent après lui et qui rendent ces terres fertiles lui ont au moins l'obligation de la découverte. Je ne nierai pas que tous les autres ouvrages de M. Descartes fourmillent d'erreurs.
La géométrie était un guide que lui-même avait en quelque façon formé, et qui l'aurait conduit sûrement dans sa physique ; cependant il abandonna à la fin ce guide et se livra à l'esprit de système. Alors sa philosophie ne fut plus qu'un roman ingénieux, et tout au plus vraisemblable pour les ignorants. Il se trompa sur la nature de l'âme, sur les preuves de l'existence de Dieu, sur la matière, sur les lois du mouvement, sur la nature de la lumière ; il admit les idées innées, il inventa de nouveaux éléments, il créa un monde, il fit l'homme à sa mode, et on dit avec raison que l'homme de Descartes n'est en effet que celui de Descartes, fort éloigné de l'homme véritable.
Il poussa ses erreurs métaphysiques jusqu'à prétendre que deux et deux ne font quatre que parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais ce n'est point trop dire qu'il était estimable même dans ses égarements. Il se trompa, mais ce fut au moins avec méthode, et avec un esprit conséquent ; il détruisit les chimères absurdes dont on infatuait la jeunesse depuis deux mille ans ; il apprit aux hommes de son temps à raisonner et à se servir contre lui-même de ses armes. S'il n'a pas payé en bonne monnaie, c'est beaucoup d'avoir décrié la fausse.
Je ne crois pas qu'on ose, à la vérité, comparer en rien sa philosophie avec celle de Newton : la première est un essai, la seconde est un chef-d'oeuvre. Mais celui qui nous a mis sur la voie de la vérité vaut peut-être celui qui a été depuis au bout de cette carrière.
Descartes donna la vue aux aveugles ; ils virent les fautes de l'Antiquité et les siennes. La route qu'il ouvrit est, depuis lui, devenue immense. Le petit livre de Rohaut a fait pendant quelque temps une physique complète ; aujourd'hui, tous les recueils des académies de l'Europe ne font pas même un de système : en approfondissant cet abîme, il s'est trouvé infini. Il s'agit maintenant de voir ce que M. Newton a creusé dans ce précipice.
Les découvertes du chevalier Newton, qui lui ont fait une réputation si universelle, regardent le système du monde, la lumière, l'infini en géométrie, et enfin la chronologie, à laquelle il s'est amusé pour se délasser.
Je vais vous dire (si je puis, sans verbiage) le peu que j'ai pu attraper de toutes ces sublimes idées.
À l'égard du système de notre monde, on disputait depuis longtemps sur la cause qui fait tourner et qui retient dans leurs orbites toutes les planètes, et sur celle qui fait descendre ici-bas tous les corps vers la surface de la terre.
Le système de Descartes, expliqué et fort changé depuis lui, semblait rendre une raison plausible de ces phénomènes, et cette raison paraissait d'autant plus vraie qu'elle est simple et intelligible à tout le monde. Mais, en philosophie, il faut se défier de ce qu'on croit entendre trop aisément, aussi bien que des choses qu'on n'entend pas.
La pesanteur, la chute accélérée des corps tombant sur la terre, la révolution des planètes dans leurs orbites, leurs rotations autour de leur axe, tout cela n'est que du mouvement ; or, le mouvement ne peut être conçu que par impulsion ; donc tous ces corps sont poussés. Mais par quoi le sont-ils ? Tout l'espace plein ; donc il est rempli d'une matière très subtile, puisque nous ne l'apercevons pas ; donc cette matière va d'Occident en Orient, puisque c'est d'Occident en Orient que toutes les planètes sont entraînées. Aussi, de supposition en supposition et de vraisemblance en vraisemblance, on a imaginé un vaste tourbillon de matière subtile, dans lequel les planètes sont entraînées autour du soleil ; on crée encore un autre tourbillon particulier, qui nage dans le grand, et qui tourne journellement autour de la planète. Quand tout cela est fait, on prétend que la pesanteur dépend de ce mouvement journalier ; car, dit-on, la matière subtile qui tourne autour de notre petit tourbillon doit aller dix-sept fois plus vite que la terre ; or, si elle va dix-sept fois plus vite que la terre, elle doit avoir incomparablement plus de force centrifuge, et repousser par conséquent tous les corps vers la terre. Voilà la cause de la pesanteur, dans le système cartésien.
Mais avant que de calculer la force centrifuge et la vitesse de cette matière subtile, il fallait s'assurer qu'elle existât, et supposé qu'elle existe, il est encore démontré faux qu'elle puisse être la cause de la pesanteur.
M. Newton semble anéantir sans ressource tous ces tourbillons, grands et petits, et celui qui emporte les planètes autour du soleil, et celui qui fait tourner chaque planète sur elle-même.
Premièrement, à l'égard du prétendu petit tourbillon de la terre, il est prouvé qu'il doit perdre petit à petit son mouvement ; il est prouvé que si la terre nage dans un fluide, ce fluide doit être de la même densité que la terre, et si ce fluide est de la même densité, tous les corps que nous remuons doivent une résistance extrême, c'est-à-dire qu'il faudrait un levier de la longueur de la terre pour soulever le poids d'une livre.
À l'égard des grands tourbillons, ils sont encore plus chimériques. Il est impossible de les accorder avec les règles de Kepler, dont la vérité est démontrée. M. Newton fait voir que la révolution du fluide dans lequel Jupiter est supposé entraîné, n'est pas avec la révolution du fluide de la terre comme la révolution de Jupiter est avec celle de la terre.
Il prouve que, toutes les planètes faisant leurs révolutions dans des ellipses, et par conséquent étant bien plus éloignées les unes des autres dans leurs aphélies et bien plus proches dans leurs périhélies, la terre, par exemple, devrait aller plus vite quand elle est plus près de Vénus et de Mars, puisque le fluide qui l'emporte, étant alors plus pressé, doit avoir plus de mouvement ; et cependant c'est alors même que le mouvement de la terre est plus ralenti.
Il prouve qu'il n'y a point de matière céleste qui aille d'Occident en Orient, puisque les comètes traversent ces espaces tantôt de l'Orient à l'Occident, tantôt du Septentrion au Midi.
Enfin pour mieux trancher encore, s'il est possible, toute difficulté, il prouve ou du moins rend fort probable, et même par des expériences, que le plein est impossible, et il nous ramène le vide, qu'Aristote et Descartes avaient banni du monde.
Ayant, par toutes ces raisons et par beaucoup d'autres encore, renversé les tourbillons du cartésianisme, il désespérait de pouvoir connaître jamais s'il y a un principe secret dans la nature, qui cause à la fois le mouvement de tous les corps célestes et qui fait la pesanteur sur la terre. S'étant retiré en 1666 à la campagne, près de Cambridge, un jour qu'il se promenait dans son jardin et qu'il voyait des fruits tomber d'un arbre, il se laissa aller à une méditation profonde sur cette pesanteur dont tous les philosophes ont cherché si longtemps la cause en vain, et dans laquelle le vulgaire ne soupçonne pas de mystère. Il se dit à lui-même : « De quelque hauteur dans notre hémisphère que tombassent ces corps, leur chute serait certainement dans la progression découverte par Galilée ; et les espaces parcourus par eux seraient comme les carrés des temps. Ce pouvoir qui fait descendre les corps graves est le même, sans aucune diminution sensible, à quelque profondeur qu'on soit dans la terre et sur la plus haute montagne. Pourquoi ce pouvoir ne s'étendrait-il pas jusqu'à la lune? Et, s'il est vrai qu'il pénètre jusque-là, n'y a-t-il pas grande apparence que ce pouvoir la retient dans son orbite et détermine son mouvement ? Mais, si la lune obéit à ce principe, quel qu'il soit, n'est-il pas encore très raisonnable de croire que les autres planètes y sont également soumises ?
« Si ce pouvoir existe, il doit (ce qui est prouvé d'ailleurs) augmenter en raison renversée des carrés des distances. Il n'y a donc plus qu'à examiner le chemin que ferait un corps grave en tombant sur la terre d'une hauteur médiocre, et le chemin que ferait dans le même temps un corps qui tomberait de l'orbite de la lune. Pour en être instruit, il ne s'agit plus que d'avoir la mesure de la terre et la distance de la lune à la terre.
Voilà comment M. Newton raisonna. Mais on n'avait alors en Angleterre que de très fausses mesures de notre globe ; on s'en rapportait à l'estime incertaine des pilotes, qui comptaient soixante milles d'Angleterre pour un degré, au lieu qu'il en fallait compter près de soixante et dix. Ce faux calcul ne pas avec les conclusions que M. Newton voulait tirer, il les abandonna. Un philosophe médiocre et qui n'aurait eu que de la vanité, eût fait cadrer comme il eût pu la mesure de la terre avec son système. M. Newton aima mieux abandonner alors son projet. Mais depuis que M. Picart eut mesuré la terre exactement, en traçant cette méridienne qui fait tant d'honneur à la France, M. Newton reprit ses premières idées, et il trouva son compte avec le calcul de M. Picart. C'est une chose qui me paraît toujours admirable, qu'on ait découvert de si sublimes vérités avec l'aide d'un quart de cercle et d'un peu d'arithmétique.
La circonférence de la terre est de cent vingt-trois millions deux cent quarante-neuf mille six cents pieds de Paris. De cela seul peut suivre tout le système de l'attraction.
On connaît la circonférence de la terre, on connaît celle de l'orbite de la lune, et le diamètre de cet orbite. La révolution de la lune dans cet orbite se fait en vingt-sept jours, sept heures, quarante-trois minutes ; donc il est démontré que la lune, dans son mouvement moyen, parcourt cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante pieds de Paris par minute ; et, par un théorème connu, il est démontré que la force centrale qui ferait tomber un corps de la hauteur de la lune, ne le ferait tomber que de quinze pieds de Paris dans la première minute.
Maintenant, si la règle par laquelle les corps pèsent, gravitent, s'attirent en raison inverse des carrés des distances est vraie, si c'est le même pouvoir qui agit suivant cette règle dans toute la nature, il est évident que, la terre étant éloignée de la lune de soixante demi-diamètres, un corps grave doit tomber sur la terre de quinze pieds dans la première seconde, et cinquante-quatre mille pieds dans la première minute.
Or est-il qu'un corps grave tombe, en effet, de quinze pieds dans la première seconde, et parcourt dans la première minute cinquante-quatre mille pieds, lequel nombre est le carré de soixante multiplié par quinze ; donc les corps pèsent en raison inverse des carrés des distances ; donc le même pouvoir fait la pesanteur sur la terre et retient la lune dans son orbite.
Étant donc démontré que la lune pèse sur la terre, qui est le centre de son mouvement particulier, il est démontré que la terre et la lune pèsent sur le soleil, qui est le centre de leur mouvement annuel.
Les autres planètes doivent être soumises à cette loi générale, et, si cette loi existe, ces planètes doivent suivre les règles trouvées par Kepler. Toutes ces règles, tous ces rapports sont en effet gardés par les planètes avec la dernière exactitude ; donc le pouvoir de la gravitation fait peser toutes les planètes vers le soleil, de même que notre globe. Enfin, la réaction de tout corps étant proportionnelle à l'action, il demeure certain que la terre pèse à son tour sur la lune, et que le soleil pèse sur l'une et sur l'autre, que des satellites de Saturne pèse sur les quatre, et les quatre sur lui tous cinq sur Saturne, Saturne sur tous ; qu'il en est ainsi de Jupiter, et que tous ces globes sont attirés par le soleil, réciproquement attiré par eux.
Ce pouvoir de gravitation agit à proportion de la matière que renferment les corps ; c'est une vérité que M. Newton a démontrée par des expériences. Cette nouvelle découverte a servi à faire voir que le soleil, centre de toutes les planètes, les attire toutes en raison directe de leurs masses, combinées avec leur éloignement. De là, s'élevant par degrés jusqu'à des connaissances qui semblaient n'être pas faites pour l'esprit humain, il ose calculer combien de matière contient le soleil, et combien il s'en trouve dans chaque planète ; et ainsi il fait voir que, par les simples lois de la mécanique, chaque globe céleste doit être nécessairement à la place où il est. Son seul principe des lois de la gravitation rend raison de toutes les inégalités apparentes dans le cours des globes célestes. Les variations de la lune deviennent une suite de ces lois. De plus, on voit évidemment pourquoi les noeuds de la lune font leur révolution en dix-neuf ans, et ceux de la terre dans l'espace d'environ vingt-six mille années. Le flux et le reflux de la mer est encore un effet très simple de cette attraction. La proximité de la lune dans son plein et quand elle est nouvelle, et son éloignement dans ses quartiers, combinés avec l'action du soleil, rendent une raison sensible de l'élévation et de l'abaissement de l'Océan.
Après avoir rendu compte, par sa sublime théorie, du cours et des inégalités des planètes, il assujettit les comètes au frein de la même loi. Ces feux si longtemps inconnus, qui étaient la terreur du monde et l'écueil de la philosophie, placés par Aristote au-dessous de la lune, et renvoyés par Descartes au-dessus de Saturne, sont mis enfin à leur véritable place par Newton.
Il prouve que ce sont des corps solides, qui se meuvent dans la sphère de l'action du soleil, et décrivent une ellipse si excentrique et si approchante de la parabole que certaines comètes doivent mettre plus de cinq cents ans dans leur révolution.
M. Halley croit que la comète de 1680 est la même qui parut du temps de Jules César : celle-là surtout sert plus qu'une autre à faire voir que les comètes sont des corps durs et opaques ; car elle descendit si près du soleil qu'elle n'en était éloignée que d'une sixième partie de son disque ; elle dut, par acquérir un degré de chaleur deux mille fois plus violent que celui du fer le plus enflammé. Elle aurait été dissoute et consommée en peu de temps, si elle n'avait pas été un corps opaque. La mode commençait alors de deviner le cours des comètes. Le célèbre mathématicien Jacques Bernoulli conclut par son système que cette fameuse comète de 1680 reparaîtrait le 17 mai 1719. Aucun astronome de l'Europe ne se coucha cette nuit du 17 mai, mais la fameuse comète ne parut point. Il y a au moins plus d'adresse, s'il n'y a plus de sûreté, à lui donner cinq cent soixante-quinze ans pour revenir. Un géomètre anglais nommé Wilston, non moins chimérique que géomètre, a sérieusement affirmé que du temps du Déluge il y avait eu une comète qui avait inondé notre globe, et il a eu l'injustice de s'étonner qu'on se soit moqué de lui. L'Antiquité pensait à peu près dans le goût de Wilston ; elle croyait que les comètes étaient toujours les avant-courrières de quelque grand malheur sur la terre. Newton au contraire soupçonne qu'elles sont très bienfaisantes, et que les fumées qui en sortent ne servent qu'à secourir et vivifier les planètes qui s'imbibent, dans leur cours, de toutes ces particules que le soleil a détachées des comètes. Ce sentiment est du moins plus probable que l'autre.
Ce n'est pas tout. Si cette force de gravitation, d'attraction, agit dans tous les globes célestes, elle agit sans doute sur toutes les parties de ces globes ; car, si les corps s'attirent en raison de leurs masses, ce ne peut être qu'en raison de la quantité de leurs parties ; et si ce pouvoir est logé dans le tout, il l'est sans doute dans la moitié, il l'est dans le quart, dans la huitième partie, ainsi jusqu'à l'infini. De plus, si ce pouvoir n'était pas également dans chaque partie, il y aurait toujours quelques côtés du globe qui plus que les autres, ce qui n'arrive pas. Donc ce pouvoir existe réellement dans toute la matière, et dans les plus petites particules de la matière.
Ainsi, voilà l'attraction qui est le grand ressort qui fait mouvoir toute la nature.
Newton avait bien prévu, après avoir démontré l'existence de ce principe, qu'on se révolterait contre ce seul nom. Dans plus d'un endroit de son livre il précautionne son lecteur contre l'attraction même, il l'avertit de ne la pas confondre avec les qualités occultes des anciens, et de se contenter de connaître qu'il y a dans tous les corps une force centrale qui agit d'un bout de l'univers à l'autre sur les corps les plus proches et sur les plus éloignés, suivant les lois immuables de la mécanique.
Il est étonnant qu'après les protestations solennelles de ce grand philosophe, M. Saurin et M. de Fontenelle, qui eux-mêmes méritent ce nom, lui aient reproché nettement les chimères du péripatétisme : M. Saurin, dans les Mémoires de l'Académie de 1709, et M. de Fontenelle, dans l'Éloge même de M. Newton.
Presque tous les Français, savants et autres, ont répété ce reproche. On entend dire partout : « Pourquoi Newton ne s'est-il pas servi du mot d'impulsion, que l'on comprend si bien, plutôt que du terme d'attraction, que l'on ne comprend pas ?
Newton aurait pu répondre à ces critiques : « Premièrement, vous n'entendez pas plus le mot d'impulsion que celui d'attraction, et, si vous ne concevez pas pourquoi un corps tend vers le centre d'un autre corps, vous n'imaginez pas plus par quelle vertu un corps en peut pousser un autre.
« Secondement, je n'ai pas pu admettre l'impulsion ; car il faudrait, pour cela, que j'eusse connu qu'une matière céleste pousse en effet les planètes ; or, non seulement je ne connais point cette matière, mais j'ai prouvé qu'elle n'existe pas.
« Troisièmement, je ne me sers du mot d'attraction que pour exprimer un effet que j'ai découvert dans la nature, effet certain et indiscutable d'un principe inconnu, qualité inhérente dans la matière, dont de plus habiles que moi trouveront, s'ils peuvent, la cause.
-- Que nous avez-vous donc appris, insiste-t-on encore, et pourquoi tant de calculs pour nous dire ce que vous-même ne comprenez pas ?
-- Je vous ai appris, pourrait continuer Newton, que la mécanique des forces centrales fait peser tous les corps à proportion de leur matière, que ces forces centrales font seules mouvoir les planètes et les comètes dans des proportions marquées. Je vous démontre qu'il est impossible qu'il y ait une autre cause de la pesanteur et du mouvement de tous les corps célestes ; car, les corps graves tombant sur la terre selon la proportion démontrée des forces centrales, et les planètes achevant leurs cours suivant ces mêmes proportions, s'il y avait encore un autre pouvoir qui agît sur tous ces corps, il augmenterait leurs vitesses ou changerait leurs directions. Or jamais aucun de ces corps n'a un seul degré de mouvement, de vitesse, de détermination qui ne soit démontré être l'effet des forces centrales ; donc il est impossible qu'il y ait un autre principe.
Qu'il me soit permis de faire encore parler un moment Newton. Ne sera-t-il pas bien reçu à dire : « Je suis dans un cas bien différent des Anciens. Ils voyaient, par exemple, l'eau monter dans les pompes, et ils disaient : « L'eau monte parce qu'elle a horreur du vide. Mais moi je suis dans le cas de celui qui aurait remarqué le premier que l'eau monte dans les pompes, et qui laisserait à d'autres le soin d'expliquer la cause de cet effet. L'anatomiste qui a dit le premier que le bras se remue parce que les muscles se contractent, enseigna aux hommes une vérité incontestable ; lui en aura-t-on moins parce qu'il n'a pas su pourquoi les muscles se contractent ? La cause du ressort de l'air est inconnue, mais celui qui a découvert ce ressort a rendu un grand service à la physique. Le ressort que j'ai découvert était plus caché, plus universel ; ainsi, on doit m'en savoir plus de gré. J'ai découvert une propriété de la matière, un des secrets du Créateur ; j'en ai calculé, j'en ai démontré les effets ; peut-on me chicaner sur le nom que je lui donne ?
« Ce sont les tourbillons qu'on peut appeler une qualité occulte, puisqu'on n'a jamais prouvé leur existence. L'attraction au contraire est une chose réelle, puisqu'on en démontre les effets et qu'on en calcule les proportions. La cause de cette cause est dans le sein de Dieu.
Procedes huc, et non ibis amplius.
Un nouvel univers a été découvert par les philosophes du dernier siècle, et ce monde nouveau était d'autant plus difficile à connaître qu'on ne se doutait pas même qu'il existât. Il semblait aux plus sages que c'était une témérité d'oser seulement songer qu'on pût deviner par quelles lois les corps célestes se et comment la lumière agit.
Galilée, par ses découvertes astronomiques, Kepler, par ses calculs, Descartes, au moins dans sa dioptrique, et Newton, dans tous ses ouvrages, ont vu la mécanique des ressorts du monde. Dans la géométrie, on a assujetti l'infini au calcul. La circulation du sang dans les animaux et de la sève dans les végétales a changé pour nous la nature. Une nouvelle manière d'exister a été donnée aux corps dans la machine pneumatique. Les objets se sont rapprochés de nos yeux à l'aide des télescopes. Enfin, ce que Newton a découvert sur la lumière est digne de tout ce que la curiosité des hommes pouvait attendre de plus hardi, après tant de nouveautés.
Jusqu'à Antonio de Dominis, l'arc-en-ciel avait paru un miracle inexplicable ; ce philosophe devina que c'était un effet nécessaire de la pluie et du soleil. Descartes rendit son nom immortel par l'explication mathématique de ce phénomène si naturel ; il calcula les réflexions de la lumière dans les gouttes de pluie, et cette sagacité eut alors quelque chose de divin.
Mais qu'aurait-il dit si on lui avait fait connaître qu'il se trompait sur la nature de la lumière ; qu'il n'avait aucune raison d'assurer que c'était un corps globuleux ; qu'il est faux que cette matière, s'étendant par tout l'univers, n'attende, pour être mise en action, que d'être poussée par le soleil, ainsi qu'un long bâton qui agit à un bout quand il est pressé par l'autre ; qu'il est très vrai qu'elle est dardée par le soleil, et qu'enfin la lumière est transmise du soleil à la terre en près de sept minutes, quoique un de canon, conservant toujours sa vitesse, ne puisse faire ce chemin qu'en vingt-cinq années ?
Quel eût été son étonnement si on lui avait dit : « Il est faux que la lumière se réfléchisse directement en rebondissant sur les parties solides du corps ; il est faux que les corps soient transparents quand ils ont des pores larges ; et il viendra un homme qui démontrera ces paradoxes, et qui anatomisera un seul rayon de lumière avec plus de dextérité que le plus habile artiste ne dissèque le corps humainl !
Cet homme est venu. Newton, avec le seul secours du prisme, a démontré aux yeux que la lumière est un amas de rayons colorés qui, tous ensemble, donnent la couleur blanche. Un seul rayon est divisé par lui en sept rayons, qui viennent tous se placer sur un linge ou sur un papier blanc dans leur ordre, l'un au- de l'autre et à d'inégales distances. Le premier est couleur de feu; le second, citron ; le troisième, jaune ; le quatrième, vert ; le cinquième, bleu ; le sixième, indigo ; le septième, violet. Chacun de ces rayons, tamisé ensuite par cent autres prismes, ne changera jamais la couleur qu'il porte, de même qu'un or épuré ne change plus dans les creusets. Et, pour surabondance de preuve que chacun de ces rayons élémentaires porte en soi ce qui fait sa couleur à nos yeux, prenez un petit morceau de bois jaune, par exemple, et exposez-le au rayon couleur de feu : ce bois se teint à l'instant en couleur de feu ; au rayon vert il prend la couleur verte ; et ainsi du reste.
Quelle est donc la cause des couleurs dans la nature ? Rien autre chose que la disposition des corps à réfléchir les rayons d'un certain ordre et à absorber tous les autres. Quelle est cette secrète disposition ? Il démontre que c'est uniquement l'épaisseur des petites parties constituantes dont un corps est composé. Et comment se fait cette réflexion ? On pensait que c'était parce que les rayons rebondissaient, comme une balle, sur la surface d'un corps solide. Point du tout ; Newton enseigne aux philosophes étonnés que les corps ne sont opaques que parce que leurs pores sont larges, que la lumière se réfléchit à nos yeux du sein de ces pores mêmes, que, plus les pores d'un corps sont petits, plus le corps est transparent : ainsi le papier, qui réfléchit la lumière quand il est sec, la transmet quand il est huilé, parce que l'huile, ses pores, les rend beaucoup plus petits.
C'est là qu'examinant l'extrême porosité des corps, chaque partie ayant ses pores, et chaque partie de ses parties ayant les siens, il fait voir qu'on n'est point assuré qu'il y ait un pouce cubique de matière solide dans l'univers ; tant notre esprit est éloigné de concevoir ce que c'est que la matière !
Ayant ainsi décomposé la lumière, et ayant porté la sagacité de ses découvertes jusqu'à démontrer le moyen de connaître la couleur composée par les couleurs primitives, il fait voir que ces rayons élémentaires, séparés par le moyen du prisme, ne sont arrangés dans leur ordre que parce qu'elles sont réfractées en cet ordre même ; et c'est cette propriété, inconnue jusqu'à lui, de se rompre dans cette proportion, c'est cette réfraction inégale des rayons, ce pouvoir de réfracter le rouge moins que la couleur orangée, etc., qu'il nomme réfrangibilité.
Les rayons les plus réflexibles sont les plus réfrangibles ; de là il fait voir que le même pouvoir cause la réflexion et la réfraction de la lumière.
Tant de merveilles ne sont que le commencement de ses découvertes ; il a trouvé le secret de voir les vibrations et les secousses de la lumière, qui vont et viennent sans fin, et qui transmettent la lumière ou la réfléchissent selon l'épaisseur des parties qu'elles rencontrent ; il a osé calculer l'épaisseur des particules d'air nécessaire entre deux verres posés l'un sur l'autre, l'un plat, l'autre convexe d'un côté, pour opérer telle transmission ou réflexion, et pour faire telle ou telle couleur.
De toutes ces combinaisons il trouve en quelle proportion la lumière agit sur les corps et les corps agissent sur elle.
Il a si bien vu la lumière qu'il a déterminé à quel point l'art de l'augmenter et d'aider nos yeux par des télescopes doit se borner.
Descartes, par une noble confiance bien pardonnable à l'ardeur que lui donnaient les commencements d'un art presque découvert par lui, Descartes espérait voir dans les astres, avec des lunettes d'approche, des objets aussi petits que ceux qu'on discerne sur la terre.
Newton a montré qu'on ne peut plus perfectionner les lunettes, à cause de cette réfraction et de cette réfrangibilité même qui, en nous rapprochant les objets, écartent trop les rayons élémentaires ; il a calculé, dans ces verres, la proportion de l'écartement des rayons rouges et des rayons bleus ; et, portant démonstration dans des choses dont on ne soupçonnait pas même l'existence, il examine les inégalités que produit la figure du verre, et celle que fait la réfrangibilité. Il trouve que le verre objectif de la lunette étant convexe d'un côté et plat de l'autre, si le côté plat est tourné vers l'objet, le défaut qui vient de la construction et de la position du verre est cinq mille fois moindre que le défaut qui vient par la réfrangibilité ; et qu'ainsi ce n'est pas la figure des verres qui fait qu'on ne peut perfectionner les d'approche, mais qu'il faut s'en prendre à la matière même de la lumière.
Voilà pourquoi il inventa un télescope qui montre les objets par réflexion, et non point par réfraction. Cette nouvelle sorte de lunette est très difficile à faire, et n'est pas d'un usage bien aisé ; mais on dit en Angleterre qu'un télescope de réflexion de cinq pieds fait le même effet qu'une lunette d'approche de cent pieds.
Le labyrinthe et l'abîme de l'infini est aussi une carrière nouvelle parcourue par Newton, et on tient de lui le fil avec lequel on s'y peut conduire.
Descartes se trouve encore son précurseur dans cette étonnante nouveauté ; il allait à grands pas dans sa géométrie jusque vers l'infini, mais il s'arrêta sur le bord. M. Wallis, vers le milieu du dernier siècle, fut le premier qui réduisit une fraction, par une division perpétuelle, à une suite infinie.
Milord Brouncker se servit de cette suite pour carrer l'hyperbole.
Mercator publia une démonstration de cette quadrature. Ce fut à peu près dans ce temps que Newton, à l'âge de vingt-trois ans, avait inventé une méthode générale pour faire sur toutes les courbes ce qu'on venait d'essayer sur l'hyperbole.
C'est cette méthode de soumettre partout l'infini au calcul algébrique, que l'on appelle calcul différentiel ou des fluxions et calcul intégral. C'est l'art de nombrer et de mesurer avec exactitude ce dont on ne peut pas même concevoir l'existence.
En effet, ne croiriez-vous pas qu'on veut se moquer de vous, quand on vous dit qu'il y a des lignes infiniment grandes qui forment un angle infiniment petit ?
Qu'une droite qui est droite tant qu'elle est finie, changeant infiniment peu de direction, devient courbe infinie : qu'une courbe peut devenir infiniment moins courbe ?
Qu'il y a des carrés d'infini, des cubes d'infini, et des infinis d'infini, dont le pénultième n'est rien par rapport au dernier ?
Tout cela, qui paraît d'abord l'excès de la déraison, est, en effet, l'effort de la finesse et de l'étendue de l'esprit humain, et la méthode de trouver des vérités qui étaient jusqu'alors inconnues.
Cet édifice si hardi est même fondé sur des idées simples. Il s'agit de mesurer la diagonale d'un carré, d'avoir l'aire d'une courbe, de trouver une racine carrée à un nombre qui n'en a point dans l'arithmétique ordinaire.
Et, après tout, tant d'ordres d'infinis ne doivent pas plus révolter l'imagination que cette proposition si connue, qu'entre un cercle et une tangente on peut toujours faire passer des courbes ; ou cette autre, que la matière est toujours divisible. Ces deux vérités sont depuis longtemps démontrées, et ne sont pas plus compréhensibles que le reste.
On a disputé longtemps à Newton l'invention de ce fameux calcul. M. Leibnitz a passé en Allemagne pour l'inventeur des différences que Newton appelle fluxions, et Bernoulli a revendiqué le calcul intégral ; mais l'honneur de la première découverte a demeuré à Newton, et il est resté aux autres la gloire d'avoir pu faire douter entre eux et lui.
C'est ainsi que l'on contesta à Harvey la découverte de la circulation du sang ; à M. Perrault, celle de la circulation de la sève. Hartsoeker et Leuvenhoeck se sont contesté l'honneur d'avoir vu le premier les petits vermisseaux dont nous sommes faits. Ce même Hartsoeker a disputé à M. Huyghens l'invention d'une nouvelle manière de calculer l'éloignement d'une étoile fixe. On ne sait encore quel philosophe trouva le problème de la roulette.
Quoi qu'il en soit, c'est par cette géométrie de l'infini que Newton est parvenu aux plus sublimes connaissances.
Il me reste à vous parler d'un autre ouvrage plus à la portée du genre humain, mais qui se sent toujours de cet esprit créateur que Newton portait dans toutes ses recherches ; c'est une chronologie toute nouvelle, car, dans tout ce qu'il entreprenait, il fallait qu'il changeât les idées reçues par les autres hommes.
Accoutumé à débrouiller des chaos, il a voulu porter au moins quelque lumière dans celui de ces fables anciennes confondues avec l'histoire, et fixer une chronologie incertaine. Il est vrai qu'il n'y a point de famille, de ville, de nation qui ne cherche à reculer son origine ; de plus, les premiers historiens sont les plus négligents à marquer les dates ; les livres étaient moins communs mille fois qu'aujourd'hui ; par conséquent, étant moins exposé à la critique, on trompait le monde plus impunément ; et, puisqu'on a évidemment supposé des faits, il est assez probable qu'on a aussi supposé des dates.
En général, il parut à Newton que le monde était de cinq cents ans plus jeune que les chronologistes ne le disent ; il fonde son idée sur le cours ordinaire de la nature et sur les observations astronomiques.
On entend ici par le cours de la nature le temps de chaque génération des hommes. Les Égyptiens s'étaient servis les premiers de cette manière incertaine de compter. Quand ils voulurent écrire les commencements de leur histoire, ils comptaient trois cent quarante et une générations depuis Ménès jusqu'à Séthon ; et, n'ayant pas de dates fixes, ils évaluèrent trois générations à cent ans. Ainsi, ils comptaient du règne de Ménès au règne de Séthon onze mille trois cent quarante années.
Les Grecs, avant de compter par olympiades, suivirent la méthode des Égyptiens, et étendirent même un peu la durée des générations, poussant chaque génération jusqu'à quarante années.
Or, en cela, les Égyptiens et les Grecs se trompèrent dans leur calcul. Il est bien vrai que, selon le cours ordinaire de la nature, trois générations font environ cent à six-vingts ans ; mais il s'en faut bien que trois règnes tiennent ce nombre d'années. Il est très évident qu'en général les hommes vivent plus longtemps que les rois ne règnent. Ainsi, un homme qui voudra écrire l'histoire sans avoir de dates précises, et qui saura qu'il y a eu neuf rois chez une nation, aura grand tort s'il compte trois cents ans pour ces neuf rois. Chaque génération est d'environ trente-six ans ; chaque règne est environ de vingt, l'un portant l'autre. Prenez les trente rois d'Angleterre, depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à Georges premier ; ils ont régné six cent quarante-huit ans, ce qui, réparti sur les trente rois, donne à chacun vingt et un ans et demi de règne. Soixante-trois rois de France ont régné, l'un portant l'autre, chacun à peu près vingt ans. Voilà le cours ordinaire de la nature. Donc les anciens se sont trompés quand ils ont égalé, en général, la durée des règnes à la durée des générations ; donc ils ont trop compté ; donc il est à de retrancher un peu de leur calcul.
Les observations astronomiques semblent prêter encore un plus grand secours à notre philosophe ; il en paraît plus fort en combattant sur son terrain.
Vous savez, Monsieur, que la terre, outre son mouvement annuel qui l'emporte autour du soleil d'Occident en Orient dans l'espace d'une année, a encore une révolution singulière, tout à fait inconnue jusqu'à ces derniers temps. Ses pôles ont un mouvement très lent de rétrogradation d'Orient en Occident, qui fait que chaque jour leur position ne répond pas précisément aux mêmes points du ciel. Cette différence, insensible en une année, devient assez forte avec le temps, et, au bout de soixante et douze ans, on trouve que la différence est d'un degré, c'est-à-dire de la trois cent soixantième partie de tout le ciel. Ainsi, après soixante et douze années, le colure de l'équinoxe du printemps, qui passait par une fixe, répond à une autre fixe. De là vient que le soleil, au lieu d'être dans la partie du ciel où était le Bélier du temps d'Hipparque, se trouve répondre à cette partie du ciel où était le Taureau, et les Gémeaux sont à la place où le Taureau était alors. Tous les signes ont changé de place ; cependant, nous retenons toujours la manière de parler des anciens ; nous disons que le soleil est dans le Bélier au printemps, par la même condescendance que nous disons que le soleil tourne.
Hipparque fut le premier chez les Grecs qui s'aperçut de quelques changements dans les constellations par rapport aux équinoxes, ou plutôt qui l'apprit des Égyptiens. Les philosophes attribuèrent ce mouvement aux étoiles ; car alors on était bien loin d'imaginer une telle révolution dans la terre : on la croyait en tous sens immobile. Ils créèrent donc un ciel où ils attachèrent toutes les étoiles, et donnèrent à ce ciel un mouvement particulier qui le faisait avancer vers l'Orient, pendant que toutes les étoiles semblaient faire leur route journalière d'Orient en Occident. À cette erreur ils en ajoutèrent une seconde bien plus essentielle ; ils crurent que le ciel prétendu des étoiles fixes avançait vers l'Orient d'un degré en cent années. Ainsi, ils se trompèrent dans leur calcul astronomique aussi bien que dans leur système physique. Par exemple, un astronome aurait dit alors : « L'équinoxe du printemps a été, du temps d'un tel observateur, dans un tel signe, à une telle étoile ; il a fait deux degrés de chemin depuis cet observateur jusqu'à nous ; or, deux degrés valent deux cents ans ; donc cet observateur vivait deux cents ans avant moi. Il est certain qu'un astronome qui eût raisonné ainsi se serait trompé justement de cinquante-quatre ans. Voilà pourquoi les anciens, doublement trompés, composèrent leur grande année du monde, c'est-à-dire de la révolution de tout le ciel, d'environ trente-six mille ans. Mais les modernes que cette révolution imaginaire du ciel des étoiles n'est autre chose que la. révolution des pôles de la terre, qui se fait en vingt-cinq mille neuf cents années. Il est bon de remarquer ici, en passant, que Newton, en déterminant la figure de la terre, a très heureusement expliqué la raison de cette révolution.
Tout ceci posé, il reste, pour fixer la chronologie, de voir par quelle étoile le colure de l'équinoxe coupe aujourd'hui l'écliptique au printemps, et de savoir s'il ne se trouve point quelque ancien qui nous ait dit en quel point l'écliptique était coupé de son temps par le même colure des équinoxes.
Clément Alexandrin rapporte que Chiron, qui était de l'expédition des Argonautes, observa les constellations au temps de cette fameuse expédition, et fixa l'équinoxe du printemps au milieu du Bélier, l'équinoxe de l'automne au milieu de la Balance, le solstice de notre été au milieu du Cancer, et le d'hiver au milieu du Capricorne.
Longtemps après l'expédition des Argonautes et un an avant la guerre du Péloponnèse, Méton observa que le point du solstice d'été passait par le huitième degré du Cancer.
Or, chaque signe du Zodiaque est de trente degrés. Du temps de Chiron, le solstice était à la moitié du signe, c'est-à-dire au quinzième degré ; un an avant la guerre du Péloponnèse, il était au huitième : donc il avait retardé de sept degrés. Un degré vaut soixante et douze ans : donc, du commencement de la du Péloponnèse à l'entreprise des Argonautes, il n'y a que sept fois soixante et douze ans, qui font cinq cent quatre ans, et non pas sept cents années, comme le disaient les Grecs. Ainsi, en comparant l'état du ciel d'aujourd'hui à l'état où il était alors, nous voyons que l'expédition des Argonautes doit être placée environ neuf cents ans avant Jésus-Christ, et non pas environ quatorze cents ans ; et, par conséquent, le monde est moins vieux d'environ cinq cents ans qu'on ne pensait. Par là, toutes les époques sont rapprochées, et tout s'est fait plus tard qu'on ne le dit. Je ne sais si ce système ingénieux fera une grande fortune, et si on voudra se résoudre, sur ces idées, à réformer la chronologie du monde ; peut-être les savants trouveraient-ils que c'en serait trop d'accorder à un même homme l'honneur d'avoir perfectionné à la fois la physique, la géométrie et l'histoire : ce serait une espèce de monarchie dont l'amour-propre s'accommode malaisément. Aussi, dans le temps que de très grands philosophes l'attaquaient sur l'attraction, d'autres combattaient son système chronologique. Le temps, qui devrait faire voir à qui la victoire est due, ne fera peut-être que laisser la dispute plus indécise.
Les Anglais avaient déjà un théâtre, aussi bien que les Espagnols, quand les Français n'avaient que des tréteaux. Shakespeare, qui passait pour le Corneille des Anglais, fleurissait à peu près dans le temps de Lope de Véga. Il créa le théâtre. Il avait un génie plein de force et de fécondité, de naturel et de sublime sans la moindre étincelle de bon goût et sans la moindre connaissance des règles. Je vais vous dire une chose hasardée, mais vraie : c'est que le mérite de cet auteur a perdu le théâtre anglais ; il y a de si belles scènes, des morceaux si grands et si terribles répandus dans ses farces monstrueuses qu'on tragédies, que ces pièces ont toujours été jouées avec un grand succès. Le temps, qui seul fait la réputation des hommes, rend à la fin leurs défauts respectables. La plupart des idées bizarres et gigantesques de cet auteur ont acquis au bout de deux cents ans le droit de passer pour sublimes ; les auteurs modernes l'ont presque tous copié ; mais ce qui réussissait chez Shakespeare est sifflé chez eux, et vous croyez bien que la vénération qu'on a pour cet ancien augmente à mesure que l'on méprise les modernes. On ne fait pas réflexion qu'il ne faudrait pas l'imiter, et le mauvais succès de ses copistes fait seulement qu'on le croit inimitable.
Vous savez que dans la tragédie du More de Venise, pièce très touchante, un mari étrangle sa femme sur le théâtre, et quand la pauvre femme est étranglée, elle s'écrie qu'elle meurt très injustement. Vous n'ignorez pas que dans Hamlet des fossoyeurs creusent une fosse en buvant, en chantant des et en faisant sur les têtes des morts qu'ils rencontrent des plaisanteries convenables à gens de leur métier. Mais ce qui vous surprendra, c'est qu'on a imité ces sottises sous le règne de Charles second, qui était celui de la politesse et l'âge d'or des beaux-arts.
Otway, dans sa Venise sauvée, introduit le sénateur Antonio et la courtisane Naki au milieu des horreurs de la conspiration du marquis de Bedmar. Le vieux sénateur Antonio fait auprès de sa courtisane toutes les singeries d'un vieux débauché impuissant et hors du bon sens ; il contrefait le taureau et le chien, il mord les jambes de sa maîtresse, qui lui donne des coups de pied et des coups de fouet. On a retranché de la pièce d'Otway ces bouffonneries, faites pour la plus vile canaille ; mais on a laissé dans le Jules César de Shakespeare les plaisanteries des cordonniers et des savetiers romains sur la scène avec Brutus et Cassius. C'est que la sottise d'Otway est moderne, et que celle de Shakespeare est ancienne.
Vous vous plaindrez sans doute que ceux qui jusqu'à présent, vous ont parlé du théâtre anglais, et surtout de ce fameux Shakespeare, ne vous aient encore fait voir que ses erreurs, et que personne n'ait traduit aucun de ces endroits frappants qui demandent grâce pour toutes ses fautes. Je vous répondrai qu'il est bien aisé de rapporter en prose les erreurs d'un poète, mais très difficile de traduire ses beaux vers. Tous les grimauds qui s'érigent en critiques des écrivains célèbres compilent des volumes ; j'aimerais mieux deux pages qui nous fissent connaître quelques beautés ; car je maintiendrai toujours, avec les gens de bon goût, qu'il y a plus à profiter dans douze vers d'Homère et de Virgile que dans toutes les critiques qu'on a faites de ces deux grands hommes.
J'ai hasardé de traduire quelques morceaux des meilleurs poètes anglais : en voici un de Shakespeare. Faites grâce à la copie en faveur de l'original ; et souvenez-vous toujours, quand vous voyez une traduction, que vous ne voyez qu'une faible estampe d'un beau tableau.
J'ai choisi le monologue de la tragédie d'Hamlet, qui est su de tout le monde et qui commence par ce vers : To be or not to be, that is the question. C'est Hamlet, prince de Danemark, qui parle :
Demeure ; il faut choisir, et passer à l'instant De la vie à la mort, ou de l'être au néant. Dieux cruels ! s'il en est, éclairez mon courage. Faut-il vieillir courbé sous la main qui m'outrage, Supporter ou finir mon malheur et mon sort ? Qui suis-je ? qui m'arrête ? et qu'est-ce que la mort ? C'est la fin de nos maux, c'est mon unique asile ; Après de longs transports, c'est un sommeil tranquille ; On s'endort, et tout meurt. Mais un affreux réveil Doit succéder peut-être aux douceurs du sommeil. On nous menace, on dit que cette courte vie De tourments éternels est aussitôt suivie. O mort ! moment fatal ! affreuse éternité ! Tout coeur à ton seul nom se glace, épouvanté. Eh ! qui pourrait sans toi supporter cette vie, De nos Prêtres menteurs bénir l'hypocrisie, D'une indigne maîtresse encenser les erreurs, Ramper sous un Ministre, adorer ses hauteurs, Et montrer les langueurs de son âme abattue À des amis ingrats qui détournent la vue ? La mort serait trop douce en ces extrémités ; Mais le scrupule parle, et nous crie : « Arrêtez. Il défend à nos mains cet heureux homicide, Et d'un Héros guerrier fait un chrétien timide, etc.
Ne croyez pas que j'aie rendu ici l'anglais mot pour mot ; malheur aux faiseurs de traductions littérales, qui en traduisant chaque parole énervent le sens ! C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue, et que l'esprit vivifie.
Voici encore un passage d'un fameux tragique anglais, Dryden, poète du temps de Charles second, auteur plus fécond que judicieux, qui aurait une réputation sans mélange s'il n'avait fait que la dixième partie de ses ouvrages et dont le grand défaut est d'avoir voulu être universel.
Ce morceau commence ainsi :
When I consider life, t'is all a cheat. Yet fool'd by hope men favour the deceit.
De desseins en regrets et d'erreurs en désirs Les mortels insensés promènent leur folie. Dans des malheurs présents, dans l'espoir des plaisirs, Nous ne vivons jamais, nous attendons la vie. Demain, demain, dit-on, va combler tous nos voeux ; Demain vient, et nous laisse encor plus malheureux. Quelle est l'erreur, hélas ! du soin qui nous dévore ? Nul de nous ne voudrait recommencer son cours : De nos premiers moments nous maudissons l'aurore, Et de la nuit qui vient nous attendons encore Ce qu'ont en vain promis les plus beaux de nos jours, etc.
C'est dans ces morceaux détachés que les tragiques anglais ont jusqu'ici excellé ; leurs pièces, presque toutes barbares, dépourvues de bienséance, d'ordre, de vraisemblance, ont des lueurs étonnantes au milieu de cette nuit. Le style est trop ampoulé, trop hors de la nature, trop copié des écrivains hébreux si remplis de l'enflure asiatique ; mais aussi il faut avouer que les échasses du style figuré, sur lesquelles la langue anglaise est guindée, élèvent aussi l'esprit bien haut, quoique par une marche irrégulière.
Le premier Anglais qui ait fait une pièce raisonnable et écrite d'un bout à l'autre avec élégance est l'illustre M. Addison. Son Caton d'Utique est un chef-d'ouvre pour la diction et pour la beauté des vers. Le rôle de Caton est à mon gré fort au-dessus de celui de Cornélie dans le Pompée de Corneille ; car Caton est grand sans enflure, et Cornélie, qui d'ailleurs n'est pas un personnage nécessaire, vise quelquefois au galimatias. Le Caton de M. Addison me paraît le plus beau personnage qui soit sur aucun théâtre, mais les autres rôles de la pièce n'y répondent pas, et cet ouvrage si bien écrit est défiguré par une intrigue froide d'amour, qui répand sur la pièce une langueur qui la tue.
La coutume d'introduire de l'amour à tort et à travers dans les ouvrages dramatiques passa de Paris à Londres vers l'an 1660 avec nos rubans et nos perruques. Les femmes, qui parent les spectacles, comme ici, ne veulent plus souffrir qu'on leur parle d'autre chose que d'amour. Le sage Addison eut la molle complaisance de plier la sévérité de son caractère aux moeurs de son temps, et gâta un chef-d'oeuvre pour avoir voulu plaire.
Depuis lui, les pièces sont devenues plus régulières, le peuple plus difficile, les auteurs plus corrects et moins hardis. J'ai vu des pièces nouvelles fort sages, mais froides. Il semble que les Anglais n'aient été faits jusqu'ici que pour produire des beautés irrégulières. Les monstres brillants de Shakespeare plaisent mille fois plus que la sagesse moderne. Le génie poétique des Anglais ressemble jusqu'à présent à un arbre touffu planté par la nature, jetant au hasard mille rameaux, et croissant inégalement et avec force ; il meurt, si vous voulez forcer sa nature et le tailler en arbre des jardins de Marly.
Je ne sais comment le sage et ingénieux M. de Muralt, dont nous avons les lettres sur les Anglais et sur les Français, s'est borné, en parlant de la comédie, à critiquer un comique nommé Shadwell. Cet auteur était assez méprisé de son temps ; il n'était point le poète des honnêtes gens ; ses pièces, goûtées pendant quelques représentations par le peuple, étaient dédaignées par tous les gens de bon goût, et ressemblaient à tant de pièces que j'ai vues, en France, attirer la foule et révolter les lecteurs, et dont on a pu dire
Tout Paris les condamne, et tout Paris les court.
M. de Muralt aurait dû, ce semble, nous parler d'un auteur excellent qui vivait alors : c'était M. Wicherley, qui fut longtemps l'amant déclaré de la maîtresse la plus illustre de Charles second. Cet homme, qui passait sa vie dans le plus grand monde, en connaissait parfaitement les vices et les ridicules, et les peignait du pinceau le plus ferme et des couleurs les plus vraies.
Il a fait un misanthrope, qu'il a imité de Molière. Tous les traits de Wicherley y sont plus forts et plus hardis que ceux de notre misanthrope ; mais aussi ils ont moins de finesse et de bienséance. L'auteur anglais a corrigé le seul défaut qui soit dans la pièce de Molière ; ce défaut est le manque d'intrigue et d'intérêt. La pièce anglaise est intéressante, et l'intrigue en est ingénieuse, elle est trop hardie sans doute pour nos moeurs. C'est un capitaine de vaisseau plein de valeur, de franchise, et de mépris pour le genre humain ; il a un ami sage et sincère dont il se défie, et une maîtresse dont il est tendrement aimé, sur laquelle il ne daigne pas jeter les yeux ; au contraire, il a mis toute sa confiance dans un faux ami qui est le plus indigne homme qui respire, et il a donné son coeur à la plus coquette et à la plus perfide de toutes les femmes ; il est bien assuré que cette femme est une Pénélope, et ce faux ami un Caton. Il part pour s'aller battre contre les Hollandais, et laisse tout son argent, ses pierreries et tout ce qu'il a au à cette femme de bien, et recommande cette femme elle-même à cet ami fidèle, sur lequel il compte si fort. Cependant, le véritable honnête homme dont il se défie tant s'embarque avec lui ; et la maîtresse qu'il n'a pas seulement daigné regarder se déguise en page et fait le voyage sans que le capitaine s'aperçoive de son sexe de toute la campagne.
Le capitaine, ayant fait sauter son vaisseau dans un combat, revient à Londres, sans secours, sans vaisseau et sans argent, avec son page et son ami, ne connaissant ni l'amitié de l'un, ni l'amour de l'autre. Il va droit chez la perle des femmes, qu'il compte retrouver avec sa cassette et sa fidélité : il la retrouve mariée avec l'honnête fripon à qui il s'était confié, et on ne lui a pas plus gardé son dépôt que le reste. Mon homme a toutes les peines du monde à croire qu'une femme de bien puisse faire de pareils tours ; mais, pour l'en convaincre mieux, cette honnête dame devient amoureuse du petit page, et veut le prendre à force. Mais, comme il faut que justice se fasse et que, dans une pièce de théâtre, le vice soit puni et la vertu récompensée, il se trouve, à fin de compte, que le capitaine se met à la place du page, couche avec son infidèle, fait cocu son traître ami, lui donne un bon coup d'épée au travers du corps, reprend sa cassette et épouse son page. Vous remarquerez qu'on a encore tardé cette pièce d'une comtesse de Pimbesche, vieille plaideuse, parente du capitaine, laquelle est bien la plus plaisante créature et le meilleur caractère qui soit au théâtre.
Wicherley a encore tiré de Molière une pièce non moins singulière et non moins hardie : c'est une espèce d'École des Femmes.
Le principal personnage de la pièce est un drôle à bonnes fortunes, la terreur des maris de Londres, qui, pour être plus sûr de son fait, s'avise de faire courir le bruit que dans sa dernière maladie les chirurgiens ont trouvé à propos de le faire eunuque. Avec cette belle réputation, tous les maris lui leurs femmes, et le pauvre homme n'est plus embarrassé que du choix ; il donne surtout la préférence à une petite campagnarde qui a beaucoup d'innocence et de tempérament, et qui fait son mari cocu avec une bonne foi qui vaut mieux que la malice des dames les plus expertes. Cette pièce n'est pas, si vous voulez, l'école des bonnes moeurs, mais en vérité c'est l'école de l'esprit et du bon comique.
Un chevalier Vanbrugh a fait des comédies encore plus plaisantes, mais moins ingénieuses. Ce chevalier était un homme de plaisir ; par-dessus cela, poète et architecte : on prétend qu'il écrivait comme il bâtissait, un peu grossièrement. C'est lui qui a bâti le fameux château de Blenheim, pesant et durable monument de notre malheureuse bataille d'Hochstedt. Si les appartements étaient seulement aussi larges que les murailles sont épaisses, ce château serait assez commode.
On a mis dans l'épitaphe de Vanbrugh qu'on souhaitait que la terre ne lui fût point légère, attendu que de son vivant il l'avait si inhumainement chargée.
Ce chevalier, ayant fait un tour en France avant la guerre de 1701, fut mis à la Bastille, et y resta quelque temps, sans avoir jamais pu savoir ce qui lui avait attiré cette distinction de la part de notre ministère. Il fit une comédie à la Bastille ; et ce qui est à mon sens fort étrange, c'est qu'il n'y a dans cette pièce aucun trait contre le pays dans lequel il essuya cette violence.
Celui de tous les Anglais qui a porté le plus loin la gloire du théâtre comique est feu M. Congreve. Il n'a fait que peu de pièces, mais toutes sont excellentes dans leur genre. Les règles du théâtre y sont rigoureusement observées ; elles sont pleines de caractères nuancés avec une extrême finesse ; on n'y essuie pas la moindre mauvaise plaisanterie ; vous y voyez partout le langage des honnêtes gens avec des actions de fripon : ce qui prouve qu'il connaissait bien son monde, et qu'il vivait dans ce qu'on appelle la bonne compagnie. Il était infirme et presque mourant quand je l'ai connu ; il avait un défaut, c'était de ne pas assez estimer son premier métier d'auteur, qui avait fait sa réputation et sa fortune. Il me parlait de ses ouvrages comme de bagatelles au-dessous de lui, et me dit, à la première conversation, de ne le voir que sur le pied d'un gentilhomme qui vivait très uniment ; je lui répondis que, s'il avait eu le malheur de n'être qu'un gentilhomme comme un autre, je ne le serais jamais venu voir, et je fus très choqué de cette vanité si mal placée.
Ses pièces sont les plus spirituelles et les plus exactes ; celles de Vanbrugh, les plus gaies, et celles de Wicherley, les plus fortes.
Il est à remarquer qu'aucun de ces beaux esprits n'a mal parlé de Molière. Il n'y a que les mauvais auteurs anglais qui aient dit du mal de ce grand homme. Ce sont les mauvais musiciens d'Italie qui méprisent Lulli, mais un Buononcini l'estime et lui rend justice, de même qu'un Mead fait cas d'un Helvétius et d'un Silva.
L'Angleterre a encore de bons poètes comiques, tels que le chevalier Steele et M. Cibber, excellent comédien et d'ailleurs poète du Roi, titre qui paraît ridicule, mais qui ne laisse pas de donner mille écus de rente et de beaux privilèges. Notre grand Corneille n'en a pas eu tant.
Au reste ne me demandez pas que j'entre ici dans le moindre détail de ces pièces anglaises dont je suis si grand partisan, ni que je vous rapporte un bon mot ou une plaisanterie des Wicherley et des Congreve ; on ne rit point dans une traduction. Si vous voulez connaître la comédie anglaise, il n'y a d'autre moyen pour cela que d'aller à Londres, d'y rester trois ans, d'apprendre bien l'anglais et de voir la comédie tous les jours. Je n'ai pas grand plaisir en lisant Plaute et Aristophane : pourquoi ? c'est que je ne suis ni Grec ni Romain. La finesse des bons mots, l'allusion, l'à-propos, tout cela est perdu pour un étranger.
Il n'en est pas de même dans la tragédie ; il n'est question chez elle que de grandes passions et de sottises héroïques consacrées par de vieilles erreurs de fable ou d'histoire. Oedipe, Électre appartiennent aux Espagnols, aux Anglais, et à nous, comme aux Grecs. Mais la bonne comédie est la peinture parlante des ridicules d'une nation, et si vous ne connaissez pas la nation à fond, vous ne pouvez guère juger de la peinture.
Il a été un temps en France où les Beaux-Arts étaient cultivés par les premiers de l'État. Les courtisans surtout s'en mêlaient, malgré la dissipation, le goût des riens, la passion pour l'intrigue, toutes divinités du pays.
Il me paraît qu'on est actuellement à la cour dans tout un autre goût que celui des lettres. Peut-être dans peu de temps la mode de penser reviendra-t-elle : un roi n'a qu'à vouloir ; on fait de cette nation-ci tout ce qu'on veut. En Angleterre communément on pense, et les lettres y sont plus en honneur qu'en France. Cet avantage est une suite nécessaire de la forme de leur gouvernement. Il y a à Londres environ huit cents personnes qui ont le droit de parler en public et de soutenir les intérêts de la nation ; environ cinq ou six mille prétendent au même honneur à leur tour ; tout le reste s'érige en juge de ceux-ci, et chacun peut faire imprimer ce qu'il pense sur les affaires publiques. Ainsi, toute la nation est dans la nécessité de s'instruire. On n'entend parler que des gouvernements d'Athènes et de Rome ; il faut bien, malgré qu'on en ait, lire les auteurs qui en ont traité ; cette étude conduit naturellement aux Belles-Lettres. En général, les hommes ont l'esprit de leur état. Pourquoi d'ordinaire nos magistrats, nos avocats, nos médecins et beaucoup d'ecclésiastiques ont-ils plus de lettres, de goût et d'esprit que l'on n'en trouve dans toutes les autres professions ? C'est que réellement leur état est d'avoir l'esprit cultivé, comme celui d'un marchand est de connaître son négoce. Il n'y a pas longtemps qu'un seigneur anglais fort jeune me vint voir à Paris en revenant d'Italie ; il avait fait en vers une description de ce pays-là, aussi poliment écrite que tout ce qu'ont fait le comte de Rochester et nos Chaulieu, nos Sarrasin et nos Chapelle.
La traduction que j'en ai faite est si loin d'atteindre à la force et à la bonne plaisanterie de l'original que je suis obligé d'en demander sérieusement pardon à l'auteur et à ceux qui entendent l'anglais ; cependant, comme je n'ai pas d'autre moyen de faire connaître les vers de milord..., les voici dans ma :
Qu'ai-je donc vu dans l'Italie ? Orgueil, astuce et pauvreté, Grands compliments, peu de bonté, Et beaucoup de cérémonie, L'extravagante comédie Que souvent l'Inquisition [Il entend sans doute les farces que certains prédicateurs jouent dans les places publiques.] Veut qu'on nomme religion, Mais qu'ici nous nommons folie. La nature, en vain bienfaisante, Veut enrichir ces lieux charmants ; Des Prêtres la main désolante Étouffe ses plus beaux présents. Les Monsignors, soi-disant grands, Seuls dans leurs palais magnifiques, Y sont d'illustres fainéants, Sans argent et sans domestiques. les petits, sans liberté, Martyrs du joug qui les domine, Ils ont fait voeu de pauvreté, Priant Dieu par oisiveté, Et toujours jeûnant par famine. Ces beaux lieux, du Pape bénis, Semblent habités par les diables, Et les habitants misérables Sont damnés dans le paradis.
Peut-être dira-t-on que ces vers sont d'un hérétique ; mais on traduit tous les jours, et même assez mal, ceux d'Horace et de Juvénal, qui avaient le malheur d'être païens. Vous savez bien qu'un traducteur ne doit pas répondre des sentiments de son auteur ; tout ce qu'il peut faire, c'est de prier Dieu pour sa conversion, et c'est ce que je ne manque pas de faire pour celle du milord.
Tout le monde connaît de réputation le comte de Rochester. M. de Saint-Évremond en a beaucoup parlé ; mais il ne nous a fait connaître du fameux Rochester que l'homme de plaisir, l'homme à bonnes fortunes ; je voudrais faire connaître en lui l'homme de génie et le grand poète. Entre autres ouvrages qui brillaient de cette imagination ardente qui n'appartenait qu'à lui, il a fait quelques satires sur les mêmes sujets que notre célèbre Despréaux avait choisis. Je ne sais rien de plus utile, pour se perfectionner le goût, que la comparaison des grands génies qui se sont exercés sur les mêmes matières.
Voici comme M. Despréaux parle contre la raison humaine, dans sa satire sur l'homme :
Cependant, à le voir, plein de vapeurs légères, Soi-même se bercer de ses propres chimères, Lui seul de la nature est la base et l'appui, Et le dixième Ciel ne tourne que pour lui. De tous les animaux il est ici le maître ; Qui pourrait le nier, poursuis-tu ? Moi, peut-être : Ce maître prétendu qui leur donne des lois, Ce Roi des animaux, combien a-t-il de Rois ?
Voici à peu près comme s'exprime le comte de Rochester, dans sa satire sur l'homme ; mais il faut que le lecteur se ressouvienne toujours que ce sont ici des traductions libres de poètes anglais, et que la gêne de notre versification et les bienséances délicates de notre langue ne peuvent donner l'équivalent de la licence impétueuse du style anglais.
Cet esprit que je hais, cet esprit plein d'erreur, Ce n'est pas ma raison, c'est la tienne, Docteur ; C'est ta raison frivole, inquiète, orgueilleuse, Des sages animaux rivale dédaigneuse Qui croit entre eux et l'Ange occuper le milieu, Et pense être ici-bas l'image de son Dieu, Vil atome importun, qui croit, doute, dispute, Rampe, s'élève, tombe, et nie encor sa chute ; Qui nous dit : « Je suis libre , en nous montrant ses fers, Et dont l'oeil trouble et faux croit percer l'Univers. Allez, révérends fous, bienheureux fanatiques ! bien l'amas de vos riens scolastiques ! Pères de visions et d'énigmes sacrés, du labyrinthe où vous vous égarez, Allez obscurément éclaircir vos mystères, Et courez dans l'école adorer vos chimères ! Il est d'autres erreurs : il est de ces dévots, Condamnés par eux-même à l'ennui du repos. Ce mystique encloîtré, fier de son indolence, Tranquille au sein de Dieu, qu'y peut-il faire ? Il pense. Non, tu ne penses point, misérable, tu dors, Inutile à la terre et mis au rang des morts ; Ton esprit énervé croupit dans la mollesse ; Réveille-toi, sois homme, et sors de ton ivresse. L'homme est né pour agir, et tu prétends penser !
Que ces idées soient vraies ou fausses, il est toujours certain qu'elles sont exprimées avec une énergie qui fait le poète.
Je me garderai bien d'examiner la chose en philosophe, et de quitter ici le pinceau pour le compas. Mon unique but, dans cette lettre, est de faire connaître le génie des poètes anglais, et je vais continuer sur ce ton.
On a beaucoup entendu parler du célèbre Waller en France. MM. de La Fontaine, Saint-Évremond et Bayle ont fait son éloge ; mais on ne connaît de lui que son nom. Il eut à peu près à Londres la même réputation que Voiture eut à Paris, et je crois qu'il la méritait mieux. Voiture vint dans un temps où l'on sortait de la barbarie, et où l'on était encore dans l'ignorance. On voulait avoir de l'esprit, et on n'en avait pas encore. On cherchait des tours au lieu de pensées : les faux brillants se trouvent plus aisément que les pierres précieuses. Voiture, né avec un génie frivole et facile, fut le premier qui brilla dans cette aurore de la littérature française ; s'il était venu après les grands hommes qui ont illustré le siècle de Louis XIV, ou il aurait été inconnu, ou l'on n'aurait parlé de lui que pour le mépriser, ou il aurait son style. M. Despréaux le loue, mais c'est dans ses premières satires ; c'est dans le temps où le goût de Despréaux n'était pas encore formé : il était jeune, et dans l'âge où l'on juge des hommes par la réputation, et non pas par eux-mêmes. D'ailleurs, Despréaux était souvent bien injuste dans ses louanges dans ses censures. Il louait Segrais, que personne ne lit ; il insultait Quinault, que tout le monde sait par cour ; et il ne dit rien de La Fontaine. Waller, meilleur que Voiture, n'était pas encore parfait ; ses ouvrages galants respirent la grâce ; mais la négligence les fait languir, et souvent les pensées fausses les défigurent. Les Anglais n'étaient pas encore parvenus de son temps à écrire avec correction. Ses ouvrages sérieux sont pleins d'une vigueur qu'on n'attendrait pas de la mollesse de ses autres pièces. Il a fait un éloge funèbre de Cromwell, qui, avec ses défauts, passe pour un chef-d'oeuvre. Pour entendre cet ouvrage, il faut savoir que Cromwell mourut le jour d'une tempête extraordinaire.
La pièce commence ainsi :
Il n'est plus ; c'en est fait ; soumettons-nous au sort : Le ciel a signalé ce jour par des tempêtes, Et la voix du tonnerre, éclatant sur nos têtes, Vient d'annoncer sa mort. Par ses derniers soupirs il ébranle cette île, Cette île que son bras fit trembler tant de fois, Quand, dans le cours de ses exploits, Il brisait la tête des rois Et soumettait un peuple à son joug seul docile. tu t'en es troublée. O mer ! tes flots émus Semblent dire en grondant aux plus lointains rivages Que l'effroi de la terre, et ton maître, n'est plus. Tel au Ciel autrefois s'envola Romulus, Tel il quitta la terre au milieu des orages, d'un peuple guerrier il reçut les hommages : Obéi dans sa vie, à sa mort adoré, Son palais fut un temple, etc.
C'est à propos de cet éloge de Cromwell que Waller fit au roi Charles second cette réponse, qu'on trouve dans le dictionnaire de Bayle. Le Roi, pour qui Waller venait, selon l'usage des rois et des poètes, de présenter une pièce farcie de louanges, lui reprocha qu'il avait fait mieux pour Cromwell. Waller : « Sire, nous autres poètes, nous réussissons mieux dans les fictions que dans les vérités. Cette réponse n'était pas si sincère que celle de l'ambassadeur hollandais, qui, lorsque le même roi se plaignait que l'on avait moins d'égards pour lui que pour Cromwell, répondit: « Ah! Sire, ce Cromwell était tout autre chose.
Mon but n'est pas de faire un commentaire sur le caractère de Waller ni de personne ; je ne considère les gens après leur mort que par leurs ouvrages ; tout le reste est pour moi anéanti ; je remarque seulement que Waller, né à la cour, avec soixante mille livres de rente, n'eut jamais ni le sot orgueil ni la nonchalance d'abandonner son talent. Les comtes de Dorset et de Roscommon, les deux ducs de Buckingham, milord Halifax et tant d'autres n'ont pas cru déroger en devenant de très grands poètes et d'illustres écrivains. Leurs ouvrages leur font plus d'honneur que leur nom. Ils ont cultivé les lettres comme s'ils en eussent attendu leur fortune ; ils ont, de plus, rendu les arts respectables aux yeux du peuple, qui, en tout, a besoin d'être mené par les grands, et qui pourtant se règle moins sur eux en Angleterre qu'en aucun lieu du monde.
Je voulais vous parler de M. Prior, un des plus aimables poètes d'Angleterre, que vous avez vu à Paris plénipotentiaire et envoyé extraordinaire en 1712. Je comptais vous donner aussi quelque idée des poésies de milord Roscommon, de milord Dorset, etc. ; mais je sens qu'il me faudrait faire un gros livre, et qu'après bien de la peine, je ne vous donnerais qu'une idée fort imparfaite de tous ces ouvrages. La poésie est une espèce de musique : il faut l'entendre pour en juger. Quand je vous traduis quelques morceaux de ces poésies étrangères, je vous note imparfaitement leur musique, mais je ne puis exprimer goût de leur chant.
Il y a surtout un poème anglais que je désespérerais de vous faire connaître ; il s'appelle Hudibras. Le sujet est la guerre civile et la secte des puritains tournée en ridicule. C'est Don Quichotte, c'est notre Satire Ménippée fondus ensemble ; c'est, de tous les livres que j'aie jamais lus, celui où j'ai trouvé le plus d'esprit ; mais c'est aussi le plus intraduisible. Qui croirait qu'un livre qui saisit tous les ridicules du genre humain, et qui a plus de pensées que de mots, ne peut souffrir la traduction ? C'est que presque tout y fait allusion à des aventures particulières : le plus grand ridicule tombe principalement sur les théologiens, que peu de gens du monde entendent ; il faudrait à tous moments un commentaire, et la plaisanterie expliquée cesse d'être plaisanterie : tout commentateur de bons mots est un sot.
Voilà pourquoi on n'entendra jamais bien en France les livres de l'ingénieux docteur Swift, qu'on appelle le Rabelais d'Angleterre. Il a l'honneur d'être prêtre, comme Rabelais, et de se moquer de tout, comme lui ; mais on lui fait grand tort, selon mon petit sens, de l'appeler de ce nom. Rabelais, dans son et inintelligible livre, a répandu une extrême gaieté et une plus grande impertinence ; il a prodigué l'érudition, les ordures et l'ennui ; un bon conte de deux pages est acheté par des volumes de sottises. Il n'y a que quelques personnes d'un goût bizarre qui se piquent d'entendre et d'estimer tout cet ; le reste de la nation rit des plaisanteries de Rabelais et méprise le livre. On le regarde comme le premier des bouffons ; on est fâché qu'un homme qui avait tant d'esprit en ait fait un si misérable usage ; c'est un philosophe ivre, qui n'a écrit que dans le temps de son ivresse.
M. Swift est Rabelais dans son bon sens, et vivant en bonne compagnie ; il n'a pas, à la vérité, la gaieté du premier, mais il a toute la finesse, la raison, le choix, le bon goût qui manquent à notre curé de Meudon. Ses vers sont d'un goût singulier et presque inimitable ; la bonne plaisanterie est son partage en vers et en prose ; mais, pour le bien entendre, il faut faire un petit voyage dans son pays.
Vous pouvez plus aisément vous former quelque idée de M. Pope ; c'est, je crois, le poète le plus élégant, le plus correct et, ce qui est encore beaucoup, le plus harmonieux qu'ait eu l'Angleterre. Il a réduit les aigres de la trompette anglaise aux sons doux de la flûte ; on peut le traduire, parce qu'il est extrêmement clair, et que ses sujets pour la plupart sont généraux et du ressort de toutes les nations.
On connaîtra bientôt en France son Essai sur la Critique, par la traduction en vers qu'en fait M. l'abbé du Resnel.
Voici un morceau de son poème de la Boucle de cheveux, que je viens de traduire avec ma liberté ordinaire ; car, encore une fois, je ne sais rien de pis que de traduire un poète mot pour mot.
Umbriel à l'instant, vieux Gnome rechigné, Va, d'une aile pesante et d'un air renfrogné, Chercher, en murmurant, la caverne profonde Où, loin des doux rayons que répand l'oeil du monde, La Déesse aux vapeurs a choisi son séjour. Les tristes Aquilons y sifflent à l'entour, Et le souffle malsain de leur aride haleine Y porte aux environs la fièvre et la migraine. Sur un riche sofa, derrière un paravent, Loin des flambeaux, du bruit, des parleurs et du vent, La quinteuse Déesse incessamment repose, Le coeur gros de chagrins, sans en savoir la cause, N'ayant pensé jamais, l'esprit toujours troublé, L'oeil chargé, le teint pâle et l'hypocondre enflé. La médisante envie est assise auprès d'elle, spectre féminin, décrépite pucelle, Avec un air dévot déchirant son prochain, chansonnant les gens l'Évangile à la main. Sur un lit plein de fleurs négligemment penchée, Une jeune beauté non loin d'elle est couchée : C'est l'Affectation, qui grasseye en parlant, Écoute sans entendre, et lorgne en regardant, Qui rougit sans pudeur, et rit de tout sans joie, De cent maux différents prétend qu'elle est la proie, Et, pleine de santé sous le rouge et le fard, Se plaint avec mollesse, et se pâme avec art.
Si vous lisiez ce morceau dans l'original, au lieu de le lire dans cette faible traduction, vous le compareriez à la description de la mollesse dans le Lutrin.
En voilà bien honnêtement pour les poètes anglais. Je vous ai touché un petit mot de leurs philosophes. Pour de bons historiens, je ne leur en connais pas encore ; il a fallu qu'un Français ait écrit leur histoire. Peut-être le génie anglais, qui est ou froid ou impétueux, n'a pas encore saisi cette éloquence et cet air noble et simple de l'histoire ; peut-être aussi l'esprit de parti, qui fait voir trouble, a décrédité tous leurs historiens : la moitié de la nation est toujours l'ennemie de l'autre. J'ai trouvé des gens qui m'ont assuré que milord Marlborough était un poltron, et que M. Pope était un sot, comme, en France, quelques jésuites trouvent Pascal un petit esprit, et quelques jansénistes disent que le père Bourdaloue n'était qu'un bavard. Marie Stuart est une sainte héroïne pour les jacobites ; pour les autres, c'est une débauchée, une adultère, une homicide : ainsi en Angleterre on a des factums et point d'histoire. Il est vrai qu'il y a à présent un M. Gordon, excellent traducteur de Tacite, très capable d'écrire l'histoire de son pays, mais M. Rapin de Thoyras l'a prévenu. Enfin il me paraît que les Anglais n'ont point de si bons historiens que nous, qu'ils n'ont point de véritables tragédies, qu'ils ont des comédies charmantes, des morceaux de poésie admirables et des philosophes qui devraient être les précepteurs du genre humain.
Les Anglais ont beaucoup profité des ouvrages de notre langue ; nous devrions à notre tour emprunter d'eux, après leur avoir prêté ; nous ne sommes venus, les Anglais et nous, qu'après les Italiens, qui en tout ont été nos maîtres, et que nous avons surpassés en quelque chose. Je ne sais à laquelle des trois nations il faudra donner la préférence ; mais heureux celui qui sait sentir leurs différents mérites !
Ni en Angleterre ni en aucun pays du monde on ne trouve des établissements en faveur des beaux-arts comme en France. Il y a presque partout des universités ; mais c'est en France seulement qu'on trouve ces utiles encouragements pour l'astronomie, pour toutes les parties des mathématiques, pour celle de la pour les recherches de l'Antiquité, pour la peinture, la sculpture et l'architecture. Louis XIV s'est immortalisé par toutes ces fondations, et cette immortalité ne lui a pas coûté deux cent mille francs par an.
J'avoue que c'est un de mes étonnements que le parlement d'Angleterre, qui s'est avisé de promettre vingt mille guinées à celui qui ferait l'impossible découverte des longitudes, n'ait jamais pensé à imiter Louis XIV dans sa magnificence envers les arts.
Le mérite trouve à la vérité en Angleterre d'autres récompenses plus honorables pour la nation. Tel est le respect que ce peuple a pour les talents, qu'un homme de mérite y fait toujours fortune. M. Addison, en France, eût été de quelque académie, et aurait pu obtenir, par le crédit de quelque femme, une de douze cents livres, ou plutôt on lui aurait fait des affaires, sous prétexte qu'on aurait aperçu, dans sa tragédie de Caton, quelques traits contre le portier d'un homme en place ; en Angleterre, il a été secrétaire d'État. M. Newton était intendant des monnaies du royaume ; M. Congreve avait une charge importante ; M. Prior a été plénipotentiaire. Le docteur Swift est doyen d'Irlande, et y est beaucoup plus considéré que le primat. Si la religion de M. Pope ne lui permet pas d'avoir une place, elle n'empêche pas au moins que sa traduction d'Homère ne lui ait valu deux cent mille francs. J'ai vu longtemps en France l'auteur de Rhadamiste près de mourir de faim ; et le fils d'un des plus grands hommes que la France ait eus, et qui commençait à marcher sur les traces de son père, était réduit à la misère sans M. Fagon. Ce qui encourage le plus les arts en Angleterre, c'est la considération où ils sont : le portrait du premier ministre se trouve sur la cheminée de son cabinet ; mais j'ai vu celui de M. Pope dans vingt maisons.
M. Newton était honoré de son vivant, et l'a été après sa mort comme il devait l'être. Les principaux de la nation se sont disputé l'honneur de porter le poêle à son convoi. Entrez à Westminster. Ce ne sont pas les tombeaux des rois qu'on y admire ; ce sont les monuments que la reconnaissance de la nation a aux plus grands hommes qui ont contribué à sa gloire ; vous y voyez leurs statues, comme on voyait dans Athènes celles des Sophocle et des Platon ; et je suis persuadé que la seule vue de ces glorieux monuments a excité plus d'un esprit et a formé plus d'un grand homme.
On a même reproché aux Anglais d'avoir été trop loin dans les honneurs qu'ils rendent au simple mérite ; on a trouvé à redire qu'ils aient enterré dans Westminster la célèbre comédienne Mlle Oldfield à peu près avec les mêmes honneurs qu'on a rendus à M. Newton. Quelques-uns ont prétendu qu'ils avaient d'honorer à ce point la mémoire de cette actrice, afin de nous faire sentir davantage la barbare et lâche injustice qu'ils nous reprochent, d'avoir jeté à la voirie le corps de Mlle Lecouvreur.
Mais je puis vous assurer que les Anglais, dans la pompe funèbre de Mlle Oldfield, enterrée dans leur Saint-Denis, n'ont rien consulté que leur goût ; ils sont bien loin d'attacher l'infamie à l'art des Sophocle et des Euripide, et de retrancher du corps de leurs citoyens ceux qui se dévouent à réciter devant eux des ouvrages dont leur nation se glorifie.
Du temps de Charles premier, et dans le commencement de ces guerres civiles commencées par des rigoristes fanatiques, qui eux-mêmes en furent enfin les victimes, on écrivait beaucoup contre les spectacles, d'autant plus que Charles premier et sa femme, fille de notre Henri le Grand, les aimaient extrêmement.
Un docteur, nommé Prynne, scrupuleux à toute outrance, qui se serait cru damné s'il avait porté une soutane au lieu d'un manteau court, et qui aurait voulu que la moitié des hommes eût massacré l'autre pour la gloire de Dieu et la propaganda fide, s'avisa d'écrire un fort mauvais livre contre d'assez bonnes comédies qu'on jouait tous les jours très innocemment devant le Roi et la Reine. Il cita l'autorité des rabbins et quelques passages de saint Bonaventure, pour prouver que l'Oedipe de Sophocle était l'ouvrage du Malin, que Térence était excommunié ipso facto ; et il ajouta que sans doute Brutus, qui était un janséniste très sévère, n'avait assassiné César que parce que César, qui était grand-prêtre, avait composé une tragédie d'Oedipe ; enfin, il dit que tous ceux qui assistaient à un spectacle étaient des excommuniés qui reniaient leur chrême et leur baptême. C'était outrager le roi et toute la famille royale. Les Anglais respectaient alors Charles premier ; ils ne voulurent pas souffrir qu'on parlât d'excommunier ce même prince à qui ils firent depuis couper la tête. M. Prynne fut cité devant la Chambre étoilée, condamné à voir son beau livre brûlé par la main du bourreau, et lui, à avoir les oreilles coupées. Son procès se voit dans les actes publics.
On se garde bien, en Italie, de flétrir l'opéra et d'excommunier le signor Senesino ou la signora Cuzzoni. Pour moi, j'oserais souhaiter qu'on pût supprimer en France je ne sais quels mauvais livres qu'on a imprimés contre nos spectacles ; car, lorsque les Italiens et les Anglais apprennent que nous flétrissons de la plus grande infamie un art dans lequel nous excellons, que l'on condamne comme impie un spectacle représenté chez les religieux et dans les couvents, qu'on déshonore des jeux où Louis XIV et Louis XV ont été acteurs, qu'on déclare oeuvre du démon des pièces revues par les magistrats les plus sévères et représentées devant une reine vertueuse ; quand, dis-je, des étrangers apprennent cette insolence, ce manque de respect à l'autorité royale, cette barbarie gothique qu'on ose nommer sévérité chrétienne, que voulez-vous qu'ils pensent de notre nation ? Et comment peuvent-ils concevoir, ou que nos lois autorisent un art déclaré si infâme, ou qu'on ose marquer de tant d'infamie un art autorisé par les lois, récompensé par les souverains, cultivé par les grands hommes et admiré des nations ; et qu'on trouve chez le même libraire la déclamation du père Le Brun contre nos spectacles, à côté des ouvrages immortels des Racine, des Corneille, des Molière, etc. ?
Les Anglais ont eu, longtemps avant nous, une académie des sciences ; mais elle n'est pas si bien réglée que la nôtre, et cela par la seule raison peut-être qu'elle est plus ancienne ; car, si elle avait été formée après l'Académie de Paris, elle en aurait adopté quelques sages lois et eût perfectionné les autres.
La Société Royale de Londres manque des deux choses les plus nécessaires aux hommes, de récompenses et de règles. C'est une petite fortune sûre à Paris pour un géomètre, pour un chimiste, qu'une place à l'Académie ; au contraire, il en coûte à Londres pour être de la Société Royale. Quiconque dit en Angleterre : « J'aime les arts et veut être de la Société, en est dans l'instant. Mais en France, pour être membre et pensionnaire de l'Académie, ce n'est pas assez d'être amateur ; il faut être savant, et disputer la place contre des concurrents d'autant plus redoutables qu'ils sont animés par la gloire, par l'intérêt, par la difficulté même, et par cette inflexibilité d'esprit que donne d'ordinaire l'étude opiniâtre des sciences de calcul.
L'Académie des sciences est sagement bornée à l'étude de la nature, et en vérité c'est un champ assez vaste pour occuper cinquante ou soixante personnes. Celle de Londres mêle indifféremment la littérature à la physique. Il me semble qu'il est mieux d'avoir une académie particulière pour les belles-lettres, afin que rien ne soit confondu, et qu'on ne voie point une dissertation sur les coiffures des Romaines à côté d'une centaine de courbes nouvelles.
Puisque la Société de Londres a peu d'ordre et nul encouragement, et que celle de Paris est sur un pied tout opposé, il n'est pas étonnant que les Mémoires de notre Académie soient supérieurs aux leurs : des soldats bien disciplinés et bien payés doivent à la longue l'emporter sur des volontaires. Il est vrai que la Société Royale a eu un Newton, mais elle ne l'a pas produit ; il y avait même peu de ses confrères qui l'entendissent ; un génie comme M. Newton appartenait à toutes les académies de l'Europe, parce que toutes avaient beaucoup à apprendre de lui.
Le fameux docteur Swift forma le dessein, dans les dernières années du règne de la reine Anne, d'établir une académie pour la langue, à l'exemple de l'Académie Française. Ce projet était appuyé par le comte d'Oxford, grand trésorier, et encore plus par le vicomte Bolingbroke, secrétaire d'État, qui avait le don de parler sur-le-champ dans le Parlement avec autant de pureté que Swift écrivait dans son cabinet, et qui aurait été le protecteur et l'ornement de cette académie. Les membres qui la devaient composer étaient des hommes dont les ouvrages dureront autant que la langue anglaise : c'étaient le docteur Swift, Prior, que nous avons vu ici ministre public et qui en Angleterre a la même réputation que La Fontaine a parmi nous ; c'étaient M. Pope, le Boileau d'Angleterre, M. Congreve, qu'on peut en appeler le Molière ; plusieurs autres, dont les noms m'échappent ici, auraient tous fait fleurir cette compagnie dans sa naissance. Mais la reine mourut subitement ; les Whigs se mirent dans la tête de faire pendre les protecteurs de l'académie, ce qui, comme vous croyez bien, fut mortel aux belles-lettres. Les membres de ce corps auraient eu un grand avantage sur les premiers qui composèrent l'Académie Française ; car Prior, Congreve, Dryden, Pope, Addison, etc., avaient fixé la langue anglaise par leurs écrits, au lieu que Chapelain, Colletet, Cassaigne, Faret, Perrin, Cotin, vos premiers académiciens, étaient l'opprobre de votre nation, et que leurs noms sont devenus si ridicules que, si quelque auteur passable avait le malheur de s'appeler Chapelain ou Cotin, il serait obligé de changer de nom. Il aurait fallu surtout que l'académie anglaise se proposât des occupations toutes différentes de la nôtre. Un jour, un bel esprit de ce pays-là me demanda les Mémoires de l'Académie Française. « Elle n'écrit point de Mémoires, lui répondis-je ; mais elle a fait imprimer soixante ou quatre-vingts volumes de compliments. Il en parcourut un ou deux ; il ne put jamais entendre ce style, quoiqu'il entendît fort bien tous nos bons auteurs. « Tout ce que j'entrevois, me dit-il, dans ces beaux discours, c'est que le récipiendaire, ayant assuré que son prédécesseur était un grand homme, que le cardinal de Richelieu était un très grand homme, le chancelier Séguier un assez grand homme, Louis XIV un plus que grand homme, le directeur lui répond la même chose, et ajoute que le récipiendaire pourrait bien aussi être une espèce de grand homme, et que, pour lui, directeur, il n'en quitte pas sa part.
Il est aisé de voir par quelle fatalité presque tous ces discours ont fait si peu d'honneur à ce corps : vitium est temporis potius quam homminis. L'usage s'est insensiblement établi que tout académicien répéterait ces éloges à sa réception : ç'a été une espèce de loi d'ennuyer le public. Si on cherche ensuite pourquoi les plus grands génies qui sont entrés dans ce corps ont fait quelquefois les plus mauvaises harangues, la raison en est encore bien aisée ; c'est qu'ils ont voulu briller, c'est qu'ils ont voulu traiter nouvellement une matière toute usée : la nécessité de parler, l'embarras de n'avoir rien à dire et l'envie d'avoir de l'esprit sont trois choses capables de rendre ridicule même le plus grand homme ; ne pouvant trouver des pensées nouvelles, ils ont cherché des tours nouveaux, et ont parlé sans penser, comme des gens qui mâcheraient à vide, et feraient semblant de manger en périssant d'inanition.
Au lieu que c'est une loi dans l'Académie Française de faire imprimer tous ces discours, par lesquels seuls elle est connue, ce devrait être une loi de ne les imprimer pas.
L'Académie des Belles-Lettres s'est proposé un but plus sage et plus utile, c'est de présenter au public un recueil de Mémoires remplis de recherches et de critiques curieuses. Ces Mémoires sont déjà estimés chez les étrangers ; on souhaiterait seulement que quelques matières y fussent plus approfondies, et qu'on n'en eût point traité d'autres. On se serait, par exemple, fort bien passé de je ne sais quelle dissertation sur les prérogatives de la main droite sur la main gauche, et quelques autres recherches qui, sous un titre moins ridicule, n'en sont guère moins frivoles.
L'Académie des Sciences, dans ses recherches plus difficiles et d'une utilité plus sensible, embrasse la connaissance de la nature et la perfection des arts. Il est à croire que des études si profondes et si suivies, des calculs si exacts, des découvertes si fines, des vues si grandes, produiront enfin quelque chose qui servira au bien de l'univers.
Jusqu'à présent, comme nous l'avons déjà observé ensemble, c'est dans les siècles les plus barbares que se sont faites les plus utiles découvertes ; il semble que le partage des temps les plus éclairés et des compagnies les plus savantes soit de raisonner sur ce que des ignorants ont inventé. On sait aujourd'hui, après les longues disputes de M. Huyghens et de M. Renaud, la détermination de l'angle le plus avantageux d'un gouvernail de vaisseau avec la quille ; mais Christophe Colomb avait découvert l'Amérique sans rien soupçonner de cet angle.
Je suis bien loin d'inférer de là qu'il faille s'en tenir seulement à une pratique aveugle ; mais il serait heureux que les physiciens et les géomètres joignissent, autant qu'il est possible, la pratique à la spéculation. Faut-il que ce qui fait le plus d'honneur à l'esprit humain soit souvent ce qui est le moins utile ? Un homme, avec les quatre règles d'arithmétique et du bon sens, devient un grand négociant, un Jacques Coeur, un Delmet, un Bernard, tandis qu'un pauvre algébriste passe sa vie à chercher dans les nombres des rapports et des propriétés étonnantes, mais sans usage, et qui ne lui apprendront pas ce que c'est que le change. Tous les arts sont à peu près dans ce cas ; il y a un point, passé lequel les recherches ne sont plus que pour la curiosité : ces vérités ingénieuses et inutiles ressemblent à des étoiles qui, placées trop loin de nous, ne nous donnent point de clarté.
Pour l'Académie Française, quel service ne rendrait-elle pas aux lettres, à la langue et à la nation, si, au lieu de faire imprimer tous les ans des compliments, elle faisait imprimer les bons ouvrages du siècle de Louis XIV, épurés de toutes les fautes de langage qui s'y sont glissées ? Corneille et Molière en sont pleins ; La Fontaine en fourmille ; celles qu'on ne pourrait pas corriger seraient au moins marquées. L'Europe, qui lit ces auteurs, apprendrait par eux notre langue avec sûreté ; sa pureté serait à jamais fixée ; les bons livres français, imprimés avec ce soin aux dépens du Roi, seraient un des plus glorieux monuments de la nation. J'ai ouï dire que M. Despréaux avait fait autrefois cette proposition, et qu'elle a été renouvelée par un homme dont l'esprit, la sagesse et la saine critique sont connus ; mais cette idée a eu le sort de beaucoup d'autres projets utiles, d'être approuvée et d'être négligée.
Je vous envoie les remarques critiques que j'ai faites depuis longtemps sur les Pensées de M. Pascal. Ne me comparez point ici, je vous prie, à Ézéchias, qui voulut faire brûler tous les livres de Salomon. Je respecte le génie et l'éloquence de Pascal ; mais plus je les respecte, plus je suis persuadé qu'il aurait lui-même corrigé beaucoup de ces Pensées, qu'il avait jetées au hasard sur le papier, pour les examiner ensuite : et c'est en admirant son génie que je combats quelques-unes de ses idées.
Il me paraît qu'en général l'esprit dans lequel M. Pascal écrivit ces Pensées était de montrer l'homme dans un jour odieux. Il s'acharne à nous peindre tous méchants et malheureux. Il écrit contre la nature humaine à peu près comme il écrivait contre les jésuites. Il impute à l'essence de notre nature ce qui qu'à certains hommes. Il dit éloquemment des injures au genre humain. J'ose prendre le parti de l'humanité contre ce misanthropes sublime ; j'ose assurer que nous ne sommes ni si méchants ni si malheureux qu'il le dit ; je suis, de plus, très persuadé que, s'il avait suivi, dans le livre qu'il méditait, le dessein qui paraît dans ses Pensées, il aurait fait un livre plein de paralogismes éloquents et de faussetés admirablement déduites. Je crois même que tous ces livres qu'on a faits depuis peu pour prouver la religion chrétienne, sont plus capables de scandaliser que d'édifier. Ces auteurs prétendent-ils en savoir plus que Jésus-Christ et les Apôtres ? C'est vouloir soutenir un chêne en 1'entourant de roseaux ; on peut écarter ces roseaux inutiles sans craindre de faire tort à l'arbre.
J'ai choisi avec discrétion quelques pensées de Pascal ; je mets les réponses au bas. C'est à vous à juger si j'ai tort ou raison.
I. « Les grandeurs et les misères de l'homme sont tellement visibles qu'il faut nécessairement que la vraie religion nous enseigne qu'il y a en lui quelque grand principe de grandeur, et en même temps quelque grand principe de misère. Car il faut que la véritable religion connaisse à fond notre nature, qu'elle connaisse tout ce qu'elle a de grand et tout ce qu'elle a de misérable, et la raison de l'un et de l'autre. Il faut encore qu'elle nous rende raison des étonnantes contrariétés qui s'y rencontrent.
Cette manière de raisonner paraît fausse et dangereuse : car la fable de Prométhée et de Pandore, les androgynes de Platon et les dogmes des Siamois rendraient aussi bien raison de ces contrariétés apparentes. La religion chrétienne n'en demeurera pas moins vraie, quand même on n'en tirerait pas ces ingénieuses, qui ne peuvent servir qu'à faire briller l'esprit.
Le christianisme n'enseigne que la simplicité, l'humanité, la charité ; vouloir le réduire à la métaphysique, c'est en faire une source d'erreurs.
II. « Qu'on examine sur cela toutes les religions du monde, et qu'on voie s'il y en a une autre que la chrétienne qui y satisfasse. Sera-ce celle qu'enseignaient les philosophes qui nous proposent pour tout bien un bien qui est en nous ? Est-ce le vrai bien ? Ont-ils trouvé le remède à nos maux ? Est-ce avoir guéri la présomption de l'homme que de l'avoir égalé à Dieu ? Et ceux qui nous ont égalés aux bêtes et qui nous ont donné des plaisirs de la terre pour tout bien, ont-ils apporté le remède à nos concupiscences ?
Les philosophes n'ont point enseigné de religion ; ce n'est pas leur philosophie qu'il s'agit de combattre. Jamais philosophe ne s'est dit inspiré de Dieu, car dès lors il eût cessé d'être philosophe, et il eût fait le Il ne s'agit pas de savoir si Jésus-Christ doit l'emporter sur Aristote ; il s'agit de prouver que la religion de Jésus-Christ est la véritable, et que celles de Mahomet, des païens et toutes les autres sont fausses.
III. « Et cependant sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le noeud de notre condition prend ses retours et ses plis dans l'abîme du péché originel, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme.
Est-ce raisonner que de dire : L'homme est inconcevable sans ce mystère inconcevable. Pourquoi vouloir aller plus loin que l'Écriture ? N'y a-t-il pas de la témérité à croire qu'elle a besoin d'appui, et que ces idées philosophiques peuvent lui en donner ?
Qu'aurait répondu M. Pascal à un homme qui lui aurait dit : « Je sais que le mystère du péché originel est l'objet de ma foi et non de ma raison. Je conçois fort bien sans mystère ce que c'est que l'homme ; je vois qu'il vient au monde comme les autres animaux ; que l'accouchement des mères est plus douloureux à mesure qu'elles sont plus délicates ; que quelquefois des femmes et des animaux femelles meurent dans l'enfantement ; qu'il y a quelquefois des enfants mal organisés qui vivent privés d'un ou deux sens et de la faculté du raisonnement ; que ceux qui sont le mieux organisés sont ceux qui ont les passions les plus vives ; que l'amour de soi-même est égal chez tous les hommes, et qu'il leur est aussi nécessaire que les cinq sens ; que cet amour-propre nous est donné de Dieu pour la conservation de notre être, et qu'il nous a donné la religion pour régler cet amour-propre ; que nos idées sont justes ou inconséquentes, obscures ou lumineuses, selon que nos organes sont plus ou moins solides, plus ou moins et selon que nous sommes plus ou moins passionnés ; que nous dépendons en tout de l'air qui nous environne, des aliments que nous prenons, et que, dans tout cela, il n'y a rien de contradictoire. L'homme n'est point une énigme, comme vous vous le figurez, pour avoir le plaisir de la deviner. L'homme paraît être à sa place dans la nature, supérieur aux animaux, auxquels il est semblable par les organes, inférieur à d'autres êtres, auxquels il ressemble probablement par la pensée. Il est, comme tout ce que nous voyons, mêlé de mal et de bien, de plaisir et de peine. Il est pourvu de passions pour agir, et de raison pour gouverner ses actions. Si l'homme était parfait, il serait Dieu, et ces prétendues contrariétés, que vous appelez contradictions, sont les ingrédients nécessaires qui entrent dans le composé de l'homme, qui est ce qu'il doit être.
IV. « Suivons nos mouvements, observons-nous nous-mêmes, et voyons si nous n'y trouverons pas les caractères vivants de ces deux natures.
« Tant de contradictions se trouveraient-elles dans un sujet simple?
« Cette duplicité de l'homme est si visible qu'il y en a qui ont pensé que nous avions deux âmes, un sujet simple leur paraissant incapable de telles et si soudaines variétés, d'une présomption démesurée à un horrible abattement de cour.
Nos diverses volontés ne sont point des contradictions dans la nature, et l'homme n'est point un sujet simple. Il est composé d'un nombre innombrable d'organes : si un seul de ces organes est un peu altéré, il est nécessaire qu'il change toutes les impressions du cerveau, et que l'animal ait de nouvelles pensées et de nouvelles volontés. Il est très vrai que nous sommes tantôt abattus de tristesse, tantôt enflés de présomption : et cela doit être quand nous nous trouvons dans des situations opposées. Un animal que son maître caresse et nourrit, et un autre qu'on égorge lentement et avec adresse pour en faire une dissection, éprouvent des sentiments bien contraires : aussi faisons-nous ; et les différences qui sont en nous sont si peu contradictoires qu'il serait contradictoire qu'elles n'existassent pas.
Les fous qui ont dit que nous avions deux âmes pouvaient par la même raison nous en donner trente ou quarante ; car un homme, dans une grande passion, a souvent trente ou quarante idées différentes de la même chose, et doit nécessairement les avoir, selon que cet objet lui paraît sous différentes faces.
Cette prétendue duplicité de l'homme est une idée aussi absurde que métaphysique. J'aimerais autant dire que le chien qui mord et qui caresse est double ; que la poule, qui a tant soin de ses petits, et qui ensuite les abandonne jusqu'à les méconnaître, est double ; que la glace, qui représente à la fois des objets différents, est double ; que l'arbre, qui est tantôt chargé, tantôt dépouillé de feuilles, est double. J'avoue que l'homme est inconcevable ; mais tout le reste de la nature l'est aussi, et il n'y a pas plus de apparentes dans l'homme que dans tout le reste.
V. « Ne parier point que Dieu est, c'est parier qu'il n'est pas. Lequel prendrez-vous donc ? Pesons le gain et la perte, en prenant le parti de croire que Dieu est. Si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu'il est, sans hésiter. -- Oui, il faut gager ; mais je gage peut-être trop. -- Voyons, puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, quand vous n'auriez que deux vies à gagner pour une, vous pourriez encore gager.
Il est évidemment faux de dire : « Ne point parier que Dieu est, c'est parier qu'il n'est pas ; car celui qui doute et demande à s'éclairer ne parie assurément ni pour ni contre.
D'ailleurs cet article paraît un peu indécent et puéril ; cette idée de jeu, de perte et de gain, ne convient point à la gravité du sujet.
De plus, l'intérêt que j'ai à croire une chose n'est pas une preuve de l'existence de cette chose. Je vous donnerai, me dites-vous, l'empire du monde, si je crois que vous avez raison. Je souhaite alors de tout mon coeur que vous ayez raison ; mais, jusqu'à ce que vous me l'ayez prouvé, je ne puis vous croire.
Commencez, pourrait-on dire à M. Pascal, par convaincre ma raison. J'ai intérêt, sans doute, qu'il y ait un Dieu ; mais si, dans votre système, Dieu n'est venu que pour si peu de personnes ; si le petit nombre des élus est si effrayant ; si je ne puis rien du tout par moi-même, dites-moi, je vous prie, quel intérêt j'ai à vous croire ? N'ai-je pas un intérêt visible à être persuadé du contraire ? De quel front osez-vous me montrer un bonheur infini, auquel, d'un million d'hommes, à peine un seul a droit d'aspirer ? Si vous me convaincre, prenez-vous-y d'une autre façon, et n'allez pas tantôt me parler de jeu de hasard, de pari, de croix et de pile, et tantôt m'effrayer par les épines que vous semez sur le chemin que je veux et que je dois suivre. Votre raisonnement ne servirait qu'à faire des athées, si la voix de toute la nature nous criait qu'il y a un Dieu, avec autant de force que ces subtilités ont de faiblesse.
VI. « En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, et ces contrariétés étonnantes qui se découvrent dans sa nature, et regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il y en mourant, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait emporté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans avoir aucun moyen d'en sortir ; et sur cela j'admire comment on n'entre pas en désespoir d'un si misérable état.
En lisant cette réflexion, je reçois une lettre d'un de mes amis, qui demeure dans un pays fort éloigné. Voici ses paroles :
« Je suis ici comme vous m'y avez laissé, ni plus gai, ni plus triste, ni plus riche, ni plus pauvre, jouissant d'une santé parfaite, ayant tout ce qui rend la vie agréable, sans amour, sans avarice, sans ambition et sans envie ; et tant que tout cela durera, je m'appellerai hardiment un homme très heureux.
Il y a beaucoup d'hommes aussi heureux que lui. Il en est des hommes comme des animaux ; tel chien couche et mange avec sa maîtresse ; tel autre tourne la broche et est tout aussi content ; tel autre devient enragé, et on le tue. Pour moi, quand je regarde Paris ou Londres, je ne vois aucune raison pour entrer ce désespoir dont parle M. Pascal ; je vois une ville qui ne ressemble en rien à une île déserte, mais peuplée, opulente, policée, et où les hommes sont heureux autant que la nature humaine le comporte. Quel est l'homme sage qui sera prêt à se pendre parce qu'il ne sait pas comme on voit Dieu face à face, que sa raison ne peut débrouiller le mystère de la Trinité ? Il faudrait autant se désespérer de n'avoir pas quatre pieds et deux ailes.
Pourquoi nous faire horreur de notre être ? Notre existence n'est point si malheureuse qu'on veut nous le faire accroire. Regarder l'univers comme un cachot, et tous les hommes comme des criminels qu'on va exécuter, est l'idée d'un fanatique. Croire que le monde est un lieu de délices où l'on ne doit avoir que du plaisir, c'est la rêverie d'un sybarite. Penser que la terre, les hommes et les animaux sont ce qu'ils doivent être dans l'ordre de la Providence, est, je crois, d'un homme sage.
VII. « (Les juifs pensent) que Dieu ne laissera pas éternellement les autres peuples dans ces ténèbres ; qu'il viendra un libérateur pour tous ; qu'ils sont au monde pour l'annoncer ; qu'ils sont formés exprès pour être les hérauts de ce grand événement, et pour appeler tous les peuples à s'unir à eux dans de ce libérateur.
Les juifs ont toujours attendu un libérateur ; mais leur libérateur est pour eux et non pour nous. Ils attendent un messie qui rendra les juifs maîtres des chrétiens ; et nous espérons que le Messie réunira un jour les juifs aux chrétiens : ils pensent précisément sur cela le contraire de ce que nous pensons.
VIII. « La loi par laquelle ce peuple est gouverné est tout ensemble la plus ancienne loi du monde, la plus parfaite, et la seule qui ait toujours été gardée sans interruption dans un état. C'est ce que Philon, juif, montre en divers lieux, et Josèphe admirablement contre Appion, où il fait voir qu'elle est si ancienne que le nom même de loi n'a été connu des plus anciens que plus de mille ans après, en sorte qu'Homère, qui a parlé de tant de peuples, ne s'en est jamais servi. Et il est aisé de juger de la perfection de cette loi par sa simple lecture, où l'on voit qu'on y a pourvu à toutes choses avec tant de sagesse, tant d'équité, tant de jugement, que les plus anciens législateurs grecs et romains en ayant quelque lumière en ont emprunté leurs principales lois : ce qui paraît par celles qu'ils appellent des douze Tables, et par les autres preuves que Josèphe en donne.
Il est très faux que la loi des juifs soit la plus ancienne, puisque avant Moïse, leur législateur, ils demeuraient en Égypte, le pays de la terre le plus renommé pour ses sages lois.
Il est très faux que le nom de loi n'ait été connu qu'après Homère ; il parle des lois de Minos ; le mot de loi est dans Hésiode. Et quand le nom de loi ne se trouverait ni dans Hésiode ni dans Homère, cela ne prouverait rien. Il y avait des rois et des juges ; donc il y avait des lois.
Il est encore très faux que les Grecs et les Romains aient pris des lois des juifs. Ce ne peut être dans les commencements de leurs républiques, car alors ils ne pouvaient connaître les juifs ; ce ne peut être dans le temps de leur grandeur, car alors ils avaient pour ces barbares un mépris connu de toute la terre.
IX. « Ce peuple est encore admirable en sincérité. Ils gardent avec amour et fidélité le livre où Moïse déclare qu'ils ont toujours été ingrats envers Dieu, et qu'il sait qu'ils le seront encore plus après sa mort ; mais qu'il appelle le ciel et la terre à témoin contre eux, qu'il le leur a assez dit ; qu'enfin Dieu, s'irritant contre eux, les dispersera par tous les peuples de la terre ; que, comme ils l'ont irrité en adorant des dieux qui n'étaient point leurs dieux, il les irritera en appelant un peuple qui n'était point son peuple. ce livre, qui les déshonore en tant de façons, ils le conservent aux dépens de leur vie. C'est une sincérité qui n'a point d'exemple dans le monde, ni sa racine dans la nature.
Cette sincérité a partout des exemples, et n'a sa racine que dans la nature. L'orgueil de chaque juif est intéressé à croire que ce n'est point sa détestable politique, son ignorance des arts, sa grossièreté qui l'a perdu, mais que c'est la colère de Dieu qui le punit. Il pense avec satisfaction qu'il a fallu des miracles pour l'abattre, et que sa nation est toujours la bien-aimée du Dieu qui la châtie.
Qu'un prédicateur monte en chaire, et dise aux Français : « Vous êtes des misérables, qui n'avez ni coeur ni conduite ; vous avez été battus à Hochstedt et à Ramillies parce que vous n'avez pas su vous défendre ; il se fera lapider. Mais s'il dit : « Vous êtes des catholiques chéris de Dieu ; vos péchés infâmes avaient irrité l'Éternel, qui vous livra aux hérétiques à Hochstedt et à Ramillies ; mais, quand vous êtes revenus au Seigneur, alors il a béni votre courage à Denain ; ces paroles le feront aimer de l'auditoire.
X. « S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures.
Il faut aimer, et très tendrement, les créatures ; il faut aimer sa patrie, sa femme, son père, ses enfants ; et il faut si bien les aimer que Dieu nous les fait aimer malgré nous. Les principes contraires ne sont propres qu'à faire de barbares raisonneurs.
XI. « Nous naissons injustes ; car chacun tend à soi. Cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général ; et la pente vers soi est le commencement de tout désordre en guerre, en police, en économie, etc.
Cela est selon tout ordre. Il est aussi impossible qu'une société puisse se former et subsister sans amour-propre, qu'il serait impossible de faire des enfants sans concupiscence, de songer à se nourrir sans appétit, etc. C'est l'amour de nous-même qui assiste l'amour des autres ; c'est par nos besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain ; c'est le fondement de tout commerce ; c'est l'éternel lien des hommes. Sans lui il n'y aurait pas eu un art inventé, ni une société de dix personnes formée. C'est cet amour-propre, que chaque animal a reçu de la nature, qui nous avertit de respecter celui des autres. La loi dirige cet amour-propre, et la religion le perfectionne. Il est bien vrai que Dieu aurait pu faire des créatures uniquement attentives au bien d'autrui. Dans ce cas, les marchands auraient été aux Indes par charité et le maçon eût scié de la pierre pour faire plaisir à son prochain. Mais Dieu a établi les choses autrement. N'accusons point l'instinct qu'il nous donne, et faisons-en l'usage qu'il commande.
XII. « (Le sens caché des prophéties) ne pouvait induire en erreur, et il n'y avait qu'un peuple aussi charnel que celui-là qui s'y pût méprendre. Car quand les biens sont promis en abondance, qui les empêchait d'entendre les véritables biens, sinon leur cupidité, qui déterminait ce sens aux biens de la terre ?
En bonne foi, le peuple le plus spirituel de la terre l'aurait-il entendu autrement ? Ils étaient esclaves des Romains ; ils attendaient un libérateur qui les rendrait victorieux et qui ferait respecter Jérusalem dans tout le monde. Comment, avec les lumières de leur raison, pouvaient-ils voir ce vainqueur, ce monarque dans Jésus pauvre et mis en croix ? Comment pouvaient-ils entendre, par le nom de leur capitale, une Jérusalem céleste, eux à qui le Décalogue n'avait pas seulement parlé de l'immortalité de l'âme ? un peuple si attaché à sa loi pouvait-il, sans une lumière supérieure, reconnaître dans les prophéties, qui n'étaient pas leur loi, un Dieu caché sous la figure d'un juif circoncis, qui par sa religion nouvelle a détruit et rendu abominables la Circoncision et le Sabbat, fondements sacrés de la loi judaïque ? Encore une fois, adorons Dieu sans vouloir percer dans l'obscurité de ses mystères.
XIII. « Le temps du premier avènement de Jésus-Christ est prédit. Le temps du second ne l'est point, parce que le premier devait être caché, au lieu que le second doit être éclatant et tellement manifeste que ses ennemis mêmes le reconnaîtront.
Le temps du second avènement de Jésus-Christ a été prédit encore plus clairement que le premier. M. Pascal avait apparemment oublié que Jésus-Christ, dans le chapitre XXI de saint Luc, dit expressément : « Lorsque vous verrez une armée environner Jérusalem, sachez que la désolation est proche... Jérusalem foulée aux pieds, et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles ; les flots de la mer feront un très grand bruit... Les vertus des cieux seront ébranlées ; et alors ils verront le fils de l'homme, qui viendra sur une nuée avec une grande puissance et une grande majesté.
Ne voilà-t-il pas le second avènement prédit distinctement ? Mais, si cela n'est point arrivé encore, ce n'est point à nous d'oser interroger la Providence.
XIV. « Le Messie, selon les juifs charnels, doit être un grand prince temporel. Selon les chrétiens charnels, il est venu nous dispenser d'aimer Dieu, et nous donner des sacrements qui opèrent tout sans nous. Ni l'un ni l'autre n'est la religion chrétienne ni juive.
Cet article est bien plutôt un trait de satire qu'une réflexion chrétienne. On voit que c'est aux jésuites qu'on en veut ici. Mais en vérité aucun jésuite a-t-il jamais dit que Jésus-Christ est venu nous dispenser d'aimer Dieu ? La dispute sur l'amour de Dieu est une pure dispute de mots, comme la plupart des querelles scientifiques qui ont causé des haines si vives et des malheurs si affreux.
Il parait encore un autre défaut dans cet article. C'est qu'on y suppose que l'attente d'un messie était un point de religion chez les juifs. C'était seulement une idée consolante répandue parmi cette nation. Les juifs espéraient un libérateur. Mais il ne leur était pas ordonné d'y croire comme article de foi. Toute leur religion était renfermée dans les livres de la loi. Les prophètes n'ont jamais été regardés par les juifs comme législateurs.
XV. « Pour examiner les prophéties, il faut les entendre. Car si l'on croit qu'elles n'ont qu'un sens, il est sûr que le Messie ne sera point venu ; mais, si elles ont deux sens, il est sûr qu'il sera venu en Jésus-Christ.
La religion chrétienne est si véritable qu'elle n'a pas besoin de preuves douteuses. Or, si quelque chose pouvait ébranler les fondements de cette sainte et raisonnable religion, c'est ce sentiment de M. Pascal. Il veut que tout ait deux sens dans l'Écriture ; mais un homme qui aurait le malheur d'être incrédule pourrait lui dire : Celui qui donne deux sens à ses paroles veut tromper les hommes, et cette duplicité est toujours punie par les lois ; comment donc pouvez-vous, sans rougir, admettre dans Dieu ce qu'on punit et ce qu'on déteste dans les hommes ? Que dis-je ? avec quel mépris et avec quelle indignation ne traitez-vous pas les oracles des païens, parce qu'ils avaient deux sens ! Ne pourrait-on pas dire plutôt que les prophéties qui regardent directement Jésus-Christ n'ont qu'un sens, comme celles de Daniel, de Michée et autres ? Ne pourrait-on pas même dire que, quand nous n'aurions aucune intelligence des prophéties, la religion n'en serait pas moins prouvée ?
XVI. « La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité ; car elle est surnaturelle.
Il est à croire que M. Pascal n'aurait pas employé ce galimatias dans son ouvrage, s'il avait eu le temps de le faire.
XVII. « Les faiblesses les plus apparentes sont des forces à ceux qui prennent bien les choses. Par exemple, les deux généalogies de saint Mathieu et de saint Luc. Il est visible que cela n'a pas été fait de concert.
Les éditeurs des Pensées de Pascal auraient-ils dû imprimer cette pensée, dont l'exposition seule est peut-être capable de faire tort à la religion ? À quoi bon dire que ces généalogies, ces points fondamentaux de la religion chrétienne se contrarient, sans dire en quoi elles peuvent s'accorder ? Il fallait présenter l'antidote avec le poison. Que penserait-on d'un avocat qui dirait : « Ma partie se contredit, mais cette faiblesse est une force, pour ceux qui savent bien prendre les choses ?
XVIII. « Qu'on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en faisons profession ; mais que l'on reconnaisse la vérité de la religion dans l'obscurité même de la religion, dans le peu de lumière que nous en avons, et dans l'indifférence que nous avons de la connaître.
Voilà d'étranges marques de vérité qu'apporte Pascal ! Quelles autres marques a donc le mensonge ? Quoi ! il suffirait, pour être cru, de dire : Je suis obscur, je suis inintelligible ! Il serait bien plus sensé de ne présenter aux yeux que les lumières de la foi, au lieu de ces ténèbres d'érudition.
XIX. « S'il n'y avait qu'une religion, Dieu serait trop manifeste.
Quoi ! vous dites que, s'il n'y avait qu'une religion, Dieu serait trop manifeste ! Eh ! oubliez-vous que vous dites, à chaque page, qu'un jour il n'y aura qu'une religion ? Selon vous, Dieu sera donc alors trop manifeste.
XX. « Je dis que la religion juive ne consistait en aucune de ces choses, mais seulement en l'amour de Dieu, et que Dieu réprouvait toutes les autres choses.
Quoi ! Dieu réprouvait tout ce qu'il ordonnait lui-même avec tant de soin aux juifs, et dans un détail si prodigieux ! N'est-il pas plus vrai de dire que la loi de Moïse consistait et dans l'amour et dans le culte ? Ramener tout à l'amour de Dieu sent peut-être moins l'amour de Dieu que la haine que tout janséniste a pour son prochain moliniste.
XXI. « La chose la plus importante à la vie, c'est le choix d'un métier ; le hasard en dispose. La coutume fait les maçons, les soldats, les couvreurs.
Qui peut donc déterminer les soldats, les maçons et tous les ouvriers mécaniques, sinon ce qu'on appelle hasard et la coutume ? Il n'y a que les arts de génie auxquels on se détermine de soi-même. Mais, pour les métiers que tout le monde peut faire, il est très naturel et très raisonnable que la coutume en dispose.
XXII. « Que chacun examine sa pensée ; il la trouvera toujours occupée au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent ; et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer l'avenir. Le présent n'est jamais notre but ; le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre objet.
Il faut, bien loin de se plaindre, remercier l'auteur de la nature de ce qu'il nous donne cet instinct qui nous emporte sans cesse vers l'avenir. Le trésor le plus précieux de l'homme est cette espérance qui nous adoucit nos chagrins, et qui nous peint des plaisirs futurs dans la possession des plaisirs présents. Si les hommes étaient assez malheureux pour ne s'occuper que du présent, on ne sèmerait point, on ne bâtirait point, on ne planterait point, on ne pourvoirait à rien : on manquerait de tout au milieu de cette fausse jouissance. Un esprit comme M. Pascal pouvait-il donner dans un lieu commun aussi faux que celui-là ? La nature a établi que chaque homme jouirait du présent en se nourrissant, en faisant des enfants, en écoutant des sons agréables, en occupant sa faculté de penser et de sentir, et qu'en sortant de ces états, souvent au milieu de ces états même, il penserait au lendemain, sans quoi il périrait de misère
XXIII. « Mais quand j'y ai regardé de plus près, j'ai trouvé que cet éloignement que les hommes ont du repos, et de demeurer avec eux-mêmes, vient d'une cause bien effective, c'est-à-dire du malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne nous peut consoler, lorsque rien ne nous empêche d'y penser, et que nous ne voyons que nous.
Ce mot ne voir que nous ne forme aucun sens.
Qu'est-ce qu'un homme qui n'agirait point, et qui est supposé se contempler ? Non seulement je dis que cet homme serait un imbécile, inutile à la société, mais je dis que cet homme ne peut exister : car que contemplerait-il ? son corps, ses pieds, ses mains, ses cinq sens ? Ou il serait un idiot, ou bien il ferait usage de tout cela. Resterait-il à contempler sa faculté de penser ? Mais il ne peut contempler cette faculté qu'en l'exerçant. Ou il ne pensera à rien, ou bien il pensera aux idées qui lui sont déjà venues, ou il en composera de nouvelles : or il ne peut avoir d'idées que du dehors. Le voilà donc occupé ou de ses sens ou de ses idées ; le voilà donc hors de soi, ou imbécile.
Encore une fois, il est impossible à la nature humaine de rester dans cet engourdissement imaginaire ; il est absurde de le penser ; il est insensé d'y prétendre. L'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. N'être point occupé et n'exister pas est la même chose pour l'homme. Toute la différence consiste dans les occupations douces ou tumultueuses, dangereuses ou utiles.
XXIV. « Les hommes ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et l'occupation au dehors, qui vient du ressentiment de leur misère continuelle ; et ils ont un autre instinct secret qui reste de la grandeur de leur première nature, qui leur fait connaître que le bonheur n'est en effet que dans le repos.
Cet instinct secret étant le premier principe et le fondement nécessaire de la société, il vient plutôt de la bonté de Dieu, et il est plutôt l'instrument de notre bonheur qu'il n'est l'instrument de notre misère. Je ne sais pas ce que nos premiers pères faisaient dans le paradis terrestre ; mais, si chacun d'eux n'avait pensé qu'à soi, l'existence du genre humain était bien hasardée. N'est-il pas absurde de penser qu'ils avaient des sens parfaits, c'est-à-dire des instruments d'action parfaits, uniquement pour la contemplation ? Et n'est-il pas plaisant que des têtes pensantes puissent imaginer que la paresse est un titre de grandeur, et l'action, un rabaissement de notre nature ?
XXV. « C'est pourquoi, lorsque Cinéas disait à Pyrrhus, qui se proposait de jouir du repos avec ses amis après avoir conquis une grande partie du monde, qu'il ferait mieux d'avancer lui-même son bonheur en jouissant dès lors de ce repos, sans l'aller chercher par tant de fatigues, il lui donnait un conseil qui recevait de grandes difficultés, et qui n'était guère plus raisonnable que le dessein de ce jeune ambitieux. L'un et l'autre supposait que l'homme se pût contenter de soi-même et de ses biens présents, sans remplir le vide de son coeur d'espérances imaginaires, ce qui est faux. Pyrrhus ne pouvait être ni devant ni après avoir conquis le monde.
L'exemple de Cinéas est bon dans les satires de Despréaux, mais non dans un livre philosophique. Un roi sage peut être heureux chez lui ; et de ce qu'on nous donne Pyrrhus pour un fou, cela ne conclut rien pour le reste des hommes.
XXVI. « On doit reconnaître que l'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans aucune cause étrangère d'ennui, par le propre état de sa condition.
Au contraire l'homme est si heureux en ce point, et nous avons tant d'obligation à l'auteur de la nature qu'il a attaché l'ennui à l'inaction, afin de nous forcer par là à être utiles au prochain et à nous-même.
XXVII. « D'où vient que cet homme qui a perdu depuis peu son fils unique et qui, accablé de procès et de querelles, était ce matin si troublé, n'y pense plus maintenant ? Ne vous en étonnez pas, il est tout occupé à voir par où passera un cerf que ses chiens poursuivent avec ardeur depuis six heures. Il n'en faut pas davantage pour l'homme, quelque plein de tristesse qu'il soit. Si l'on peut gagner sur lui de refaire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-là.
Cet homme fait à merveille : la dissipation est un remède plus sûr contre la douleur que le quinquina contre la fièvre ; ne blâmons point en cela la nature, qui est toujours prête à nous secourir.
XXVIII. « Qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes, et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs semblables, et, se regardant les uns les autres avec douleur et sans espérance, attendent leur tour. C'est l'image de la condition des hommes.
Cette comparaison assurément n'est pas juste : des malheureux enchaînés qu'on égorge l'un après l'autre, sont malheureux, non seulement parce qu'ils souffrent, mais encore parce qu'ils éprouvent ce que les autres hommes ne souffrent pas. Le sort naturel d'un homme n'est ni d'être enchaîné ni d'être ; mais tous les hommes sont faits, comme les animaux et les plantes, pour croître, pour vivre un certain temps, pour produire leur semblable et pour mourir. On peut dans une satire montrer l'homme tant qu'on voudra du mauvais côté ; mais, pour peu qu'on se serve de sa raison, on avouera que de tous les animaux l'homme est le plus parfait, le plus heureux, et celui qui vit le plus longtemps. Au lieu donc de nous étonner et de nous plaindre du malheur et de la brièveté de la vie, nous devons nous étonner et nous féliciter de notre bonheur et de sa durée. À ne raisonner qu'en philosophe, j'ose dire qu'il y a bien de l'orgueil et de la témérité à prétendre que par notre nature nous devons être mieux que nous ne sommes.
XXIX. « Les sages parmi les païens, qui ont dit qu'il n'y a qu'un Dieu, ont été persécutés, les juifs haïs, les chrétiens encore plus.
Ils ont été quelquefois persécutés, de même que le serait aujourd'hui un homme qui viendrait enseigner l'adoration d'un Dieu, indépendante du culte reçu. Socrate n'a pas été condamné pour avoir dit : Il n'y a qu'un Dieu, mais pour s'être élevé contre le culte extérieur du pays, et pour s'être fait des ennemis puissants fort mal à propos. À l'égard des juifs, ils étaient haïs, non parce qu'ils ne croyaient qu'un Dieu, mais parce qu'ils haïssaient ridiculement les autres nations, parce que c'étaient des barbares qui massacraient sans pitié leurs ennemis vaincus, parce que ce vil peuple, superstitieux, ignorant, privé des arts, privé du commerce, méprisait les peuples les plus policés. Quant aux chrétiens, ils étaient haïs des païens parce qu'ils tendaient à abattre la religion et l'empire, dont ils vinrent enfin à bout, comme les protestants se sont rendus les maîtres dans les mêmes pays, où ils furent longtemps haïs, et massacrés.
XXX. « Les défauts de Montaigne sont grands. Il est plein de mots sales et déshonnêtes. Cela ne vaut rien. Ses sentiments sur l'homicide volontaire et sur la mort sont horribles.
Montaigne parle en philosophe, non en chrétien : il dit le pour et le contre de l'homicide volontaire. Philosophiquement parlant, quel mal fait à la société un homme qui la quitte quand il ne peut plus la servir ? Un vieillard a la pierre et souffre des douleurs insupportables ; on lui dit : « Si vous ne vous faites tailler, vous allez mourir ; si l'on vous taille, vous pourrez encore radoter, baver et traîner pendant un an, à charge à vous-même et aux autres. Je suppose que le bonhomme prenne alors le parti de n'être plus à charge à personne : voilà à peu près le cas que Montaigne expose.
XXXI. « Combien les lunettes nous ont-elles découvert d'astres qui n'étaient point pour nos philosophes d'auparavant ? On attaquait hardiment l'Écriture sur ce qu'on y trouve en tant d'endroits du grand nombre des étoiles. Il n'y en a que mille vingt-deux, disait-on ; nous le savons.
Il est certain que la Sainte Écriture, en matière de physique, s'est toujours proportionnée aux idées reçues ; ainsi, elle suppose que la terre est immobile, que le soleil marche, etc. Ce n'est point du tout par un raffinement d'astronomie qu'elle dit que les étoiles sont innombrables, mais pour s'accorder aux idées vulgaires. En effet, quoique nos yeux ne découvrent qu'environ mille vingt-deux étoiles, cependant quand on regarde le ciel fixement, la vue éblouie croit alors en voir une infinité. L'Écriture parle donc selon ce préjugé vulgaire, car elle ne nous a pas été donnée pour faire de nous des physiciens ; et il y a grande apparence que Dieu ne révéla ni à Habacuc ni à Baruch, ni à Michée qu'un jour un Anglais nommé Flamstead mettrait dans son catalogue plus de sept mille étoiles aperçues avec le télescope.
XXXII. « Est-ce courage à un homme mourant d'aller, dans la faiblesse et dans l'agonie, affronter un Dieu tout-puissant et éternel ?
Cela n'est jamais arrivé ; et ce ne peut être que dans un violent transport au cerveau qu'un homme dise « Je crois un Dieu, et je le brave.
XXXIII. « Je crois volontiers les histoires dont les témoins se font égorger.
La difficulté n'est pas seulement de savoir si on croira des témoins qui meurent pour soutenir leur déposition, comme ont fait tant de fanatiques, mais encore si ces témoins sont effectivement morts pour cela, si on a conservé leurs dépositions, s'ils ont habité les pays où l'on dit qu'ils sont morts. Pourquoi Josèphe, né dans les temps de la mort du Christ, Josèphe ennemi d'Hérode, Josèphe peu attaché au judaïsme, n'a-t-il pas dit un mot de tout cela ? Voilà ce que M. Pascal eût débrouillé avec succès, comme ont fait depuis tant d'écrivains éloquents.
XXXIV. « Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes en naissant ; l'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes, qui ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent dans cette ignorance d'où ils étaient partis.
Cette pensée est un pur sophisme ; et la fausseté consiste dans ce mot d'ignorance qu'on prend en deux sens différents. Celui qui ne sait ni lire ni écrire est un ignorant ; mais un mathématicien, pour ignorer les principes cachés de la nature, n'est pas au point d'ignorance dont il était parti quand il commença à apprendre à lire. M. Newton ne savait pas pourquoi l'homme remue son bras quand il le veut ; mais il n'en était pas moins savant sur le reste. Celui qui ne sait pas l'hébreu, et qui sait le latin, est savant par comparaison avec celui qui ne sait que le français.
XXXV. « Ce n'est pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement ; car il vient d'ailleurs et de dehors ; et ainsi il est dépendant, et par conséquent sujet à être troublé par mille accidents qui font les afflictions inévitables.
Celui-là est actuellement heureux qui a du plaisir, et ce plaisir ne peut venir que de dehors. Nous ne pouvons avoir de sensations ni d'idées que par les objets extérieurs, comme nous ne pouvons nourrir notre corps qu'en y faisant entrer des substances étrangères qui se changent en la nôtre.
XXXVI. « L'extrême esprit est accusé de folie, comme l'extrême défaut. Rien ne passe pour bon que la médiocrité.
Ce n'est point l'extrême esprit, c'est l'extrême vivacité et volubilité de l'esprit qu'on accuse de folie. L'extrême esprit est l'extrême justesse, l'extrême finesse, l'extrême étendue, opposée diamétralement à la folie.
L'extrême défaut d'esprit est un manque de conception, un vide d'idées ; ce n'est point la folie, c'est la stupidité. La folie est un dérangement dans les organes, qui fait voir plusieurs objets trop vite, ou qui arrête l'imagination sur un seul avec trop d'application et de violence. Ce n'est point non plus la qui passe pour bonne, c'est l'éloignement des deux vices opposés, c'est ce qu'on appelle juste milieu, et non médiocrité.
XXXVII. « Si notre condition était véritablement heureuse, il ne faudrait pas nous divertir d'y penser.
Notre condition est précisément de penser aux objets extérieurs, avec lesquels nous avons un rapport nécessaire. Il est faux qu'on puisse divertir un homme de penser à la condition humaine ; car, à quelque chose qu'il applique son esprit, il l'applique à quelque chose de lié nécessairement à la condition humaine ; et encore une fois, penser à soi avec abstraction des choses naturelles, c'est ne à rien du tout, qu'on y prenne bien garde.
Loin d'empêcher un homme de penser à sa condition, on ne l'entretient jamais que des agréments de sa condition. On parle à un savant de réputation et de science ; à un prince, de ce qui a rapport à sa grandeur ; à tout homme on parle de plaisir.
XXXVIII. « Les grands et les petits ont mêmes accidents, mêmes fâcheries et mêmes passions. Mais les uns sont au haut de la roue, et les autres près du centre, et ainsi moins agités par les mêmes mouvements.
Il est faux que les petits soient moins agités que les grands ; au contraire, leurs désespoirs sont plus vifs parce qu'ils ont moins de ressources. De cent personnes qui se tuent à Londres, il y en a quatre-vingt-dix-neuf du bas peuple, et à peine une d'une condition relevée. La comparaison de la roue est ingénieuse et fausse.
XXXIX. « On n'apprend pas aux hommes à être honnêtes gens, et on leur apprend tout le reste ; et cependant ils ne se piquent de rien tant que de cela. Ainsi ils ne se piquent de savoir que la seule chose qu'ils n'apprennent point.
On apprend aux hommes à être honnêtes gens, et, sans cela, peu parviendraient à l'être. Laissez votre fils prendre dans son enfance tout ce qu'il trouvera sous sa main, à quinze ans il volera sur le grand chemin ; louez-le d'avoir dit un mensonge, il deviendra faux témoin ; flattez sa concupiscence, il sera sûrement débauché. On apprend tout aux hommes, la vertu, la religion.
XL. « Le sot projet que Montaigne a eu de se peindre ! Et cela, non pas en passant et contre ses maximes, comme il arrive à tout le monde de faillir, mais par ses propres maximes et par un dessein premier et principal ; car de dire des sottises par hasard et par faiblesse, c'est un mal ordinaire ; mais d'en dire à dessein, c'est ce qui n'est pas supportable, et d'en dire de telles que celle-là.
Le charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement comme il a fait ! Car il a peint la nature humaine ; et le pauvre projet de Nicole, de Malebranche, de Pascal, de décrier Montaigne !
XLI. « Lorsque j'ai considéré d'où vient qu'on ajoute tant de foi à tant d'imposteurs qui disent qu'ils ont des remèdes, jusqu'à mettre souvent sa vie entre leurs mains, il m'a paru que la véritable cause est qu'il y a de vrais remèdes ; car il ne serait pas possible qu'il y en eût tant de faux, et qu'on y donnât tant de créance, s'il n'y en avait de véritables. Si jamais il n'y en avait eu, et que tous les maux eussent été incurables, il est impossible que les hommes se fussent imaginé qu'ils en pourraient donner, et encore plus, que tant d'autres eussent donné créance à ceux qui se fussent vantés d'en avoir. De même que si un homme se vantait d'empêcher de mourir, personne ne le croirait, parce qu'il n'y a aucun exemple de cela. Mais, comme il y a eu quantité de remèdes qui se sont trouvés véritables par la connaissance même des plus grands hommes, la créance des hommes s'est pliée Par là, parce que la chose ne pouvant être niée en général (puisqu'il y a des effets particuliers qui sont véritables), le peuple, qui ne peut pas discerner lesquels d'entre ces effets particuliers sont les véritables, les croit tous. De même, ce qui fait qu'on croit tant de faux effets de la lune, c'est qu'il y en a de vrais, comme le flux de la mer.
« Ainsi, il me paraît aussi évidemment qu'il n'y a tant de faux miracles, de fausses révélations, de sortilèges, que parce qu'il y en a de vrais.
Il me semble que la nature humaine n'a pas besoin du vrai pour tomber dans le faux. On a imputé mille fausses influences à la lune avant qu'on imaginât le moindre rapport véritable avec le flux de la mer. Le premier homme qui a été malade a cru sans peine le premier charlatan. Personne n'a vu de loups-garous ni de sorciers, et beaucoup y ont cru. Personne n'a vu de transmutation de métaux, et plusieurs ont été ruinés par la créance de la pierre philosophale. Les Romains, les Grecs, tous les païens ne croyaient-ils donc aux faux miracles dont ils étaient inondés que parce qu'ils en avaient vu de véritables ?
XLII. « Le port règle ceux qui sont dans un vaisseau ; mais où trouverons-nous ce point dans la morale ?
Dans cette seule maxime reçue de toutes les nations :
« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît.
XLIII. « Ferox gens nullam esse vitam sine armis putat. Ils aiment mieux la mort que la paix ; les autres aiment mieux la mort que la guerre. Toute opinion peut être préférée à la vie, dont l'amour paraît si fort et si naturel .
C'est des Catalans que Tacite a dit cela ; mais il n'y en a point dont on ait dit et dont on puisse dire : « Elle aime mieux la mort que la guerre.
XLIV. « À mesure qu'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux. Les gens du commun ne trouvent pas de différence entre les hommes.
Il y a très peu d'hommes vraiment originaux ; presque tous se gouvernent, pensent et sentent par l'influence de la coutume et de l'éducation : rien n'est si rare qu'un esprit qui marche dans une route nouvelle ; mais parmi cette foule d'hommes qui vont de compagnie, chacun a de petites différences dans la démarche, que les vues fines aperçoivent.
XLV. « Il y a donc deux sortes d'esprit, l'un de pénétrer vivement et profondément les conséquences des principes, et c'est là l'esprit de justesse ; l'autre de comprendre un grand nombre de principes sans les confondre, et c'est là l'esprit de géométrie.
L'usage veut, je crois, aujourd'hui qu'on appelle esprit géométrique l'esprit méthodique et conséquent.
XLVI. « La mort est plus aisée à supporter sans y penser, que la pensée de la mort sans péril.
On ne peut pas dire qu'un homme supporte la mort aisément ou malaisément, quand il n'y pense point du tout. Qui ne sent rien ne supporte rien.
XLVII. « Nous supposons que tous les hommes conçoivent et sentent de la même sorte les objets qui se présentent à eux ; mais nous le supposons bien gratuitement, car nous n'en avons aucune preuve. Je vois bien qu'on applique les mêmes mots dans les mêmes occasions, et que toutes les fois que deux hommes voient, par exemple, de la neige, ils expriment tous deux la vue de ce même objet par les mêmes mots, en disant l'un et l'autre qu'elle est blanche ; et de cette conformité d'application on tire une puissante conjecture d'une conformité d'idée ; mais cela n'est pas absolument convaincant, quoiqu'il y ait lieu à parier pour l'affirmative.
Ce n'était pas la couleur blanche qu'il fallait apporter en preuve. Le blanc, qui est un assemblage de tous les rayons, paraît éclatant à tout le monde, éblouit un peu à la longue, fait à tous les yeux le même effet, mais on pourrait dire que peut-être les autres couleurs ne sont pas aperçues de tous les yeux de la même manière.
XLVIII. « Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment.
Notre raisonnement se réduit à céder au sentiment en fait de goût, non en fait de science.
XLIX. « Ceux qui jugent d'un ouvrage par règle sont à l'égard des autres comme ceux qui ont une montre à l'égard de ceux qui n'en ont point. L'un dit : « Il y a deux heures que nous sommes ici ; l'autre dit : « Il n'y a que trois quarts d'heure. Je regarde ma montre ; je dis à l'un : « Vous vous ennuyez ; et à l'autre « Le temps ne vous dure guère.
En ouvrages de goût, en musique, en poésie, en peinture, c'est le goût qui tient lieu de montre ; et celui qui n'en juge que par règles en juge mal.
L. « César était trop vieux, ce me semble, pour s'aller amuser à conquérir le monde. Cet amusement était bon à Alexandre ; c'était un jeune homme qu'il était difficile d'arrêter ; mais César devait être plus mûr.
L'on s'imagine d'ordinaire qu'Alexandre et César sont sortis de chez eux dans le dessein de conquérir la terre ; ce n'est point cela : Alexandre succéda à Philippe dans le généralat de la Grèce, et fut chargé de la juste entreprise de venger les Grecs des injures du roi de Perse : il battit l'ennemi commun, et ses conquêtes jusqu'à l'Inde, parce que le royaume de Darius s'étendait jusqu'à l'Inde ; de même que le duc de Marlborough serait venu jusqu'à Lyon sans le maréchal de Villars.
À l'égard de César, il était un des premiers de la République. Il se brouilla avec Pompée, comme les jansénistes avec les molinistes ; et alors, ce fut à qui s'exterminerait. Une seule bataille, où il n'y eut pas dix mille hommes de tués, décida de tout.
Au reste la pensée de M. Pascal est peut-être fausse en tout sens. Il fallait la maturité de César pour se démêler de tant d'intrigues ; et il est étonnant qu'Alexandre, à son âge, ait renoncé au plaisir pour faire une guerre si pénible.
LI. « C'est une plaisante chose à considérer, de ce qu'il y a des gens dans le monde qui, ayant renoncé à toutes les lois de Dieu et de la nature, s'en sont fait eux-mêmes auxquelles ils obéissent exactement, comme par exemple, les voleurs, etc.
Cela est encore plus utile que plaisant à considérer ; car cela prouve que nulle société d'hommes ne peut subsister un seul jour sans règles.
LII. « L'homme n'est ni ange ni bête : et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête.
Qui veut détruire les passions, au lieu de les régler, veut faire l'ange.
LIII. « Un cheval ne cherche point à se faire admirer de son compagnon : on voit bien entre eux quelque sorte d'émulation à la course, mais c'est sans conséquence ; car, étant à l'étable, le plus pesant et le plus mai taillé ne cède pas pour cela son avoine à l'autre. Il n'en est pas de même parmi les : leur vertu ne se satisfait pas d'elle-même ; et ils ne sont point contents s'ils n'en tirent avantage contre les autres.
L'homme le plus mal taillé ne cède pas non plus son pain à l'autre, mais le plus fort l'enlève au plus faible ; et chez les animaux et chez les hommes, les gros mangent les petits.
LIV. « Si l'homme commençait par s'étudier lui-même, il verrait combien il est incapable de passer outre. Comment se pourrait-il faire qu'une partie connût le tout ? Il aspirera peut-être à connaître au moins les parties avec lesquelles il a de la proportion. Mais les parties du monde ont toutes un tel rapport et un tel enchaînement l'une avec l'autre que je crois impossible de connaître l'une sans l'autre et sans le tout.
Il ne faudrait point détourner l'homme de chercher ce qui lui est utile, par cette considération qu'il ne peut tout connaître.
Non possis oculo quantum contendere Lynceus, Non tamen idcirco contemnas lippus inungi.
Nous connaissons beaucoup de vérités ; nous avons trouvé beaucoup d'inventions utiles. Consolons-nous de ne pas savoir les rapports qui peuvent être entre une araignée et l'anneau de Saturne, et continuons à examiner ce qui est à notre portée.
LV. « Si la foudre tombait sur les lieux bas, les poètes et ceux qui ne savent raisonner que sur les choses de cette nature manqueraient de preuves.
Une comparaison n'est preuve ni en poésie ni en prose : elle sert en poésie d'embellissement, et en prose elle sert à éclaircir et à rendre les choses plus sensibles. Les poètes qui ont comparé les malheurs des grands à la foudre qui frappe les montagnes feraient des comparaisons contraires, si le contraire
LVI. « C'est cette composition d'esprit et de corps qui a fait que presque tous les philosophes ont confondu les idées des choses, et attribué aux corps ce qui n'appartient qu'aux esprits, et aux esprits ce qui ne peut convenir qu'aux corps.
Si nous savions ce que c'est qu'esprit, nous pourrions nous plaindre de ce que les philosophes lui ont attribué ce qui ne lui appartient pas ; mais nous ne connaissons ni l'esprit ni le corps ; nous n'avons aucune idée de l'un, et nous n'avons que des idées très imparfaites de l'autre. Donc nous ne pouvons quelles sont leurs limites.
LVII. « Comme on dit beauté poétique, on devrait dire aussi beauté géométrique et beauté médicinale. Cependant on ne le dit point ; et la raison en est qu'on sait bien quel est l'objet de la géométrie, et quel est l'objet de la médecine, mais on ne sait pas en quoi consiste l'agrément qui est l'objet de la poésie. On ne sait ce que c'est que ce modèle naturel qu'il faut imiter ; et, à faute de cette connaissance, on a inventé de certains termes bizarres : siècle d'or, merveille de nos jours, fatal laurier, bel astre, etc. ; et on appelle ce jargon beauté poétique. Mais qui s'imaginera une femme vêtue sur ce modèle, verra une jolie demoiselle toute couverte de miroirs et de chaînes de laiton.
Cela est très faux : on ne doit pas dire beauté géométrique ni beauté médicinale, parce qu'un théorème et une purgation n'affectent point les sens agréablement, et qu'on ne donne le nom de beauté qu'aux choses qui charment les sens, comme la musique, la peinture, l'éloquence, la poésie, l'architecture régulière, etc.
La raison qu'apporte M. Pascal est tout aussi fausse. On sait très bien en quoi consiste l'objet de la poésie ; il consiste à peindre avec force, netteté, délicatesse et harmonie ; la poésie est l'éloquence harmonieuse. Il fallait que M. Pascal eût bien peu de goût pour dire que fatal laurier, bel astre et sottises sont des beautés poétiques ; et il fallait que les éditeurs de ces Pensées fussent des personnes bien peu versées dans les belles-lettres pour imprimer une réflexion si indigne de son illustre auteur.
Je ne vous envoie point mes autres remarques sur les Pensées de Monsieur Pascal, qui entraîneraient des discussions trop longues. C'est assez d'avoir cru apercevoir quelques erreurs d'inattention dans ce grand génie ; c'est une consolation pour un esprit aussi borné que le mien d'être bien persuadé que les plus grands hommes se trompent comme le vulgaire.
FEMME, SOYER SOUMISE A VOS MARIS
L’abbé de Châteauneuf me contait un jour que Mme la maréchale de Grancey était fort impérieuse ; elle avait d’ailleurs de très grandes qualités. Sa plus grande fierté consistait à se respecter soi-même, à ne rien faire dont elle pût rougir en secret ; elle ne s’abaissa jamais à dire un mensonge : elle aimait mieux avouer une vérité dangereuse que d’user d’une dissimulation utile ; elle disait que la dissimulation marque toujours de la timidité. Mille actions généreuses signalèrent sa vie ; mais quand on l’en louait, elle se croyait méprisée ; elle disait : « Vous pensez donc que ces actions m’ont coûté des efforts ? » Ses amants l’adoraient, ses amis la chérissaient, et son mari la respectait.
Elle passa quarante années dans cette dissipation, et dans ce cercle d’amusements qui occupent sérieusement les femmes ; n’ayant jamais rien lu que les lettres qu’on lui écrivait, n’ayant jamais mis dans sa tête que les nouvelles du jour, les ridicules de son prochain, et les intérêts de son cœur. Enfin, quand elle se vit à cet âge où l’on dit que les belles femmes qui ont de l’esprit passent d’un trône à l’autre, elle voulut lire. Elle commença par les tragédies de Racine, et fut étonnée de sentir en les lisant encore plus de plaisir qu’elle n’en avait éprouvé à la représentation : le bon goût qui se déployait en elle lui faisait discerner que cet homme ne disait jamais que des choses vraies et intéressantes, qu’elles étaient toutes à leur place ; qu’il était simple et noble, sans déclamation, sans rien de forcé, sans courir après l’esprit ; que ses intrigues, ainsi que ses pensées, étaient toutes fondées sur la nature : elle retrouvait dans cette lecture l’histoire de ses sentiments, et le tableau de sa vie.
On lui fit lire Montaigne : elle fut charmée d’un homme qui faisait conversation avec elle, et qui doutait de tout. On lui donna ensuite les grands hommes de Plutarque : elle demanda pourquoi il n’avait pas écrit l’histoire des grandes femmes.
L’abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de colère. « Qu’avez-vous donc, madame ? » lui dit-il.
— J’ai ouvert par hasard, répondit-elle, un livre qui traînait dans mon cabinet ; c’est, je crois, quelque recueil de lettres ; j’y ai vu ces paroles : Femmes, soyez soumises à vos maris ; j’ai jeté le livre.
— Comment, madame! Savez-vous bien que ce sont les Épîtres de saint Paul ?
— Il ne m’importe de qui elles sont ; l’auteur est très impoli. Jamais Monsieur le maréchal ne m’a écrit dans ce style ; je suis persuadée que votre saint Paul était un homme très difficile à vivre. Était-il marié ?
— Oui, madame.
— Il fallait que sa femme fût une bien bonne créature : si j’avais été la femme d’un pareil homme, je lui aurais fait voir du pays. Soyez soumises à vos maris ! Encore s’il s’était contenté de dire: Soyez douces, complaisantes, attentives, économes, je dirais : voilà un homme qui sait vivre ; et pourquoi soumises, s’il vous plaît ? Quand j’épousai M. de Grancey, nous nous promîmes d’être fidèles : je n’ai pas trop gardé ma parole, ni lui la sienne ; mais ni lui ni moi ne promîmes d’obéir. Sommes-nous donc des esclaves ? N’est-ce pas assez qu’un homme, après m’avoir épousée, ait le droit de me donner une maladie de neuf mois, qui quelquefois est mortelle ? N’est-ce pas assez que je mette au jour avec de très grandes douleurs un enfant qui pourra me plaider quand il sera majeur ? Ne suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des incommodités très désagréables pour une femme de qualité, et que, pour comble, la suppression d’une de ces douze maladies par an soit capable de me donner la mort sans qu’on vienne me dire encore : Obéissez ?
« Certainement la nature ne l’a pas dit ; elle nous a fait des organes différents de ceux des hommes ; mais en nous rendant nécessaires les uns aux autres, elle n’a pas prétendu que l’union formât un esclavage. Je me souviens bien que Molière a dit :
Du côté de la barbe est la toute-puissance.
Mais voilà une plaisante raison pour que j’aie un maître ! Quoi ! Parce qu’un homme a le menton couvert d’un vilain poil rude, qu’il est obligé de tondre de fort près, et que mon menton est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement ? Je sais bien qu’en général les hommes ont les muscles plus forts que les nôtres, et qu’ils peuvent donner un coup de poing mieux appliqué : j’ai peur que ce ne soit là l’origine de leur supériorité.
Ils prétendent avoir aussi la tête mieux organisée, et, en conséquence, ils se vantent d’être plus capables de gouverner ; mais je leur montrerai des reines qui valent bien des rois. On me parlait ces jours passés d’une princesse allemande qui se lève à cinq heures du matin pour travailler à rendre ses sujets heureux, qui dirige toutes les affaires, répond à toutes les lettres, encourage tous les arts, et qui répand autant de bienfaits qu’elle a de lumières. Son courage égale ses connaissances ; aussi n’a-t-elle pas été élevée dans un couvent par des imbéciles qui nous apprennent ce qu’il faut ignorer, et qui nous laissent ignorer ce qu’il faut apprendre. Pour moi, si j’avais un État à gouverner, je me sens capable d’oser suivre ce modèle. »
L’abbé de Châteauneuf, qui était fort poli, n’eut garde de contredire Mme la maréchale.
« À propos, dit-elle, est-il vrai que Mahomet avait pour nous tant de mépris qu’il prétendait que nous n’étions pas dignes d’entrer en paradis, et que nous ne serions admises qu’à l’entrée ?
— En ce cas, dit l’abbé, les hommes se tiendront toujours à la porte ; mais consolez-vous, il n’y a pas un mot de vrai dans tout ce qu’on dit ici de la religion mahométane. Nos moines ignorants et méchants nous ont bien trompés comme le dit mon frère, qui a été douze ans ambassadeur à la Porte.
— Quoi ! il n’est pas vrai, monsieur, que Mahomet ait inventé la pluralité des femmes pour mieux s’attacher les hommes ? Il n’est pas vrai que nous soyons esclaves en Turquie, et qu’il nous soit défendu de prier Dieu dans une mosquée ?
— Pas un mot de tout cela, madame ; Mahomet, loin d’avoir imaginé la polygamie, l’a réprimée et restreinte. Le sage Salomon possédait sept cents épouses. Mahomet a réduit ce nombre à quatre seulement. Mesdames iront en paradis tout comme messieurs, et sans doute on y fera l’amour, mais d’une autre manière qu’on ne le fait ici : car vous sentez bien que nous ne connaissons l’amour dans ce monde que très imparfaitement.
— Hélas! vous avez raison, dit la maréchale : l’homme est bien peu de chose. Mais, dites-moi ; votre Mahomet a-t-il ordonné que les femmes fussent soumises à leurs maris ?
— Non, madame, cela ne se trouve point dans l’Alcoran.
— Pourquoi donc sont-elles esclaves en Turquie ?
— Elles ne sont point esclaves, elles ont leurs biens, elles peuvent tester, elles peuvent demander un divorce dans l’occasion ; elles vont à la mosquée à leurs heures, et à leurs rendez-vous à d’autres heures : on les voit dans les rues avec leurs voiles sur le nez, comme vous aviez votre masque il y a quelques années. Il est vrai qu’elles ne paraissent ni à l’opéra ni à la comédie ; mais c’est parce qu’il n’y en a point. Doutez-vous que si jamais dans Constantinople, qui est la patrie d’Orphée, il y avait un Opéra, les dames turques ne remplissent les premières loges ?
— Femmes, soyez soumises à vos maris ! disait toujours la maréchale entre ses dents. Ce Paul était bien brutal.
— Il était un peu dur, repartit l’abbé, et il aimait fort à être le maître : il traita du haut en bas saint Pierre, qui était un assez bon homme. D’ailleurs, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu’il dit. On lui reproche d’avoir eu beaucoup de penchant pour le jansénisme.
— Je me doutais bien que c’était un hérétique, dit la maréchale » ; et elle se remit à sa toilette.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Un vieillard, qui toujours plaint le
présent et vante le passé, me disait : " Mon ami, la France n'est pas aussi
riche qu'elle l'a été sous Henri IV. Pourquoi? C'est que les terres ne sont pas
si bien cultivées; c'est que les hommes manquent à la terre, et que le
journalier ayant enchéri son travail, plusieurs colons laissent leurs héritages en friche.
- D'où vient cette disette de manœuvres?
- De ce que quiconque s'est senti un peu d'industrie a embrassé les métiers de
brodeur, de ciseleur, d'horloger, d'ouvrier en soie, de procureur, ou de
théologien. C'est que la révocation de l'édit de Nantes a laissé un très grand
vide dans le royaume; que les religieuses et les mendiants se sont multipliés,
et qu'enfin chacun a fui, autant qu'il a pu, le travail pénible de la culture,
pour laquelle Dieu nous a fait naître, et que nous avons rendue ignominieuse,
tant nous sommes sensés!
Une autre cause de notre pauvreté est dans nos besoins nouveaux. Il faut payer à
nos voisins quatre millions d'un article, et cinq ou six d'un autre, pour mettre
dans notre nez une poudre puante venue de l'Amérique; le café, le thé, le
chocolat, la cochenille, l'indigo, les épiceries, nous coûtent plus de soixante
millions par an. Tout cela était inconnu du temps de Henri IV, aux épiceries
près, dont la consommation était bien moins grande. Nous brûlons cent fois plus
de bougie, et nous tirons plus de la moitié de notre cire de l'étranger, parce
que nous négligeons les ruches. Nous voyons cent fois plus de diamants aux
oreilles, au cou, aux mains de nos citoyennes de Paris (1)
et de nos grandes villes qu'il n'y en avait chez toutes les dames de la cour de
Henri IV, en comptant la reine. Il a fallu payer presque toutes ces superfluités argent comptant .
Observez surtout que nous payons plus de quinze millions de rentes sur l'Hôtel
de Ville aux étrangers, et que Henri IV, à son avènement, en ayant trouvé pour
deux millions en tout sur cet hôtel imaginaire, en remboursa sagement une partie
pour délivrer l'Etat de ce fardeau (2).
Considérez que nos guerres civiles avaient fait verser en France les trésors du
Mexique, lorsque don Phelippo el discreto voulait acheter la France, et que
depuis ce temps-là les guerres étrangères nous ont débarrassés de la moitié de
notre argent.
Voilà en partie les causes de notre pauvreté. Nous la cachons sous des lambris
vernis, et par l'artifice des marchandes de modes : nous sommes pauvres avec
goût. Il y a des financiers, des entrepreneurs, des négociants très riches;
leurs enfants, leurs gendres, sont très riches; en général la nation ne l'est
pas. "
Le raisonnement de ce vieillard, bon ou mauvais, fit sur moi une impression
profonde car le curé de ma paroisse, qui a toujours eu de l'amitié pour moi, m'a
enseigné un peu de géométrie et d'histoire, et je commence à réfléchir, ce qui
est très rare dans ma province. Je ne sais s'il avait raison en tout; mais,
étant fort pauvre, je n'eus pas grand peine à croire que j'avais beaucoup de
compagnons.
(1)
Madame de Maintenon, qui en tout genre était une femme fort
entendue, excepté dans celui sur lequel elle consultait le Trigaud et processif
abbé Gobelin, son confesseur; Madame de Maintenon, dis-je, dans une de ses
lettres, fait le compte du ménage de son frère et de sa femme, en 1680. Le mari
et la femme avaient à payer le loyer d'une maison agréable; leurs domestiques
étaient au nombre de dix; ils avaient quatre chevaux et deux cochers, un bon
dîner tous les jours. Madame de Maintenon évalue le tout à neuf mille francs par
an, et met trois mille livres pour le jeu, les spectacles, les fantaisies, et
les magnificences de monsieur et de madame.
(2) Il faudrait à présent environ quarante mille livres pour
mener une telle vie dans Paris; il n'en eût fallu que six mille du temps de
Henri IV. Cet exemple prouve assez que le vieux bonhomme ne radote pas absolument
DÉSASTRE DE L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Je suis bien aise d'apprendre à
l'univers que j'ai une terre qui me vaudrait net quarante écus de rente, n'était
la taxe à laquelle elle est imposée.
Il parut plusieurs édits de quelques personnes qui, se trouvant de loisir,
gouvernent l'Etat au coin de leur feu. Le préambule de ces édits était que la
puissance législatrice et exécutrice est née de droit divin copropriétaire de ma
terre, et que je lui dois au moins la moitié de ce que je mange. L'énormité de
l'estomac de la puissance législatrice et exécutrice me fit faire un grand signe
de croix. Que serait-ce si cette puissance, qui préside à l'ordre essentiel des
sociétés, avait ma terre en entier! L'un est encore plus divin que l'autre.
Monsieur le contrôleur général sait que je ne payais en tout que douze livres;
que c'était un fardeau très pesant pour moi, et que j'y aurais succombé si Dieu
ne m'avait donné le génie de faire des paniers d'osier, qui m'aidaient à
supporter ma misère. Comment donc pourrai-je tout d'un coup donner au roi vingt
écus?
Les nouveaux ministres disaient encore dans leur préambule qu'on ne doit taxer
que les terres, parce que tout vient de la terre, jusqu'à la pluie, et que par
conséquent il n'y a que les fruits de la terre qui doivent l'impôt.
Un de leurs huissiers vint chez moi dans la dernière guerre; il me demanda pour
ma quote-part trois setiers de blé et un sac de fèves, le tout valant vingt
écus, pour soutenir la guerre qu'on faisait, et dont je n'ai jamais su la
raison, ayant seulement entendu dire que, dans cette guerre, il n'y avait rien à
gagner du tout pour mon pays, et beaucoup à perdre. Comme je n'avais alors ni
blé, ni fèves, ni argent, la puissance législatrice et exécutrice me fit traîner
en prison, et on fit la guerre comme on put.
En sortant de mon cachot, n'ayant que la peau sur les os, je rencontrai un homme
joufflu et vermeil dans un carrosse à six chevaux; il avait six laquais, et
donnait à chacun d'eux pour gages le double de mon revenu. Son maître d'hôtel,
aussi vermeil que lui, avait deux mille francs d'appointements, et lui en volait
par an vingt mille. Sa maîtresse lui coûtait quarante mille écus en six mois; je
l'avais connu autrefois dans le temps qu'il était moins riche que moi: il
m'avoua, pour me consoler, qu'il jouissait de quatre cent mille livres de rente.
"Vous en payez donc deux cent mille à l'Etat, lui dis-je, pour soutenir la
guerre avantageuse que nous avons; car moi, qui n'ai juste que mes cent vingt
livres, il faut que j'en paye la moitié.
- Moi, dit-il, que je contribue aux besoins de l'Etat! Vous voulez rire, mon
ami; j'ai hérité d'un oncle qui avait gagné huit millions à Cadix et à Surate;
je n'ai pas un pouce de terre, tout mon bien est en contrats, en billets sur la
place: je ne dois rien à l'Etat; c'est à vous de donner la moitié de votre
subsistance, vous qui êtes un seigneur terrien. Ne voyez-vous pas que, si le
ministre des finances exigeait de moi quelques secours pour la patrie, il serait
un imbécile qui ne saurait pas calculer? Car tout vient de la terre; l'argent et
les billets ne sont que des gages d'échange: au lieu de mettre sur une carte au
pharaon cent setiers de blé, cent bœufs, mille moutons, et deux cents sacs
d'avoine, je joue des rouleaux d'or qui représentent ces denrées dégoûtantes.
Si, après avoir mis l'impôt unique sur ces denrées, on venait encore me demander
de l'argent, ne voyez-vous pas que ce serait un double emploi? que ce serait
demander deux fois la même chose? Mon onde vendit à Cadis pour deux millions de
votre blé, et pour deux millions d'étoffes fabriquées avec votre laine il gagna
plus de cent pour cent dans ces deux affaires. Vous concevez bien que ce profit
fut fait sur des terres déjà taxées : ce que mon oncle achetait dix sous de
vous, il le revendait plus de cinquante francs au Mexique; et, tous frais faits,
il est revenu avec huit millions.
" Vous sentez bien qu'il serait d'une horrible injustice de lui redemander
quelques oboles sur les dix sous qu'il vous donna. Si vingt neveux comme moi,
dont les oncles auraient gagné dans le bon temps chacun huit millions au
Mexique, à Buenos-Ayres, à Lima, à Surate ou à Pondichéry, prêtaient seulement à
l'Etat chacun deux cent mille francs dans les besoins urgents de la patrie cela
produirait quatre millions : quelle horreur! Payez mon ami, vous qui jouissez en
paix d'un revenu clair et net de quarante écus; servez bien la patrie, et venez
quelquefois dîner avec ma livrée.>>
Ce discours plausible me fit beaucoup réfléchir, et ne me consola guère.
ENTRETIEN AVEC UN GÉOMÈTRE
Il arrive quelquefois qu'on ne peut
rien répondre, et qu'on n'est pas persuadé. On est atterré sans pouvoir être
convaincu. On sent dans le fond de son âme un scrupule, une répugnance qui nous
empêche de croire ce qu'on nous a prouvé. Un géomètre vous démontre qu'entre un
cercle et une tangente vous pouvez faire passer une infinité de lignes courbes,
et que vous n'en pouvez faire passer une droite: vos yeux, votre raison, vous
disent le contraire. Le géomètre vous répond gravement que c'est là un infini du
second ordre. Vous vous taisez, et vous vous en retournez tout stupéfait, sans
avoir aucune idée nette, sans rien comprendre, et sans rien répliquer.
Vous consultez un géomètre de meilleure foi, qui vous explique le mystère. "
Nous supposons, dit-il, ce qui ne peut être dans la nature, des lignes qui ont
de la longueur sans largeur : il est impossible, physiquement parlant, qu'une
ligne réelle en pénètre une autre. Nulle courbe, ni nulle droite réelle ne peut
passer entre deux lignes réelles qui se touchent: ce ne sont là que des jeux de
l'entendement, des chimères idéales; et la véritable géométrie est l'art de
mesurer les choses existantes."
Je fus très content de l'aveu de ce sage mathématicien, et je me mis à rire dans
mon malheur, d'apprendre qu'il y avait de la charlatanerie jusque dans la
science qu'on appelle la haute science.
Mon géomètre était un citoyen philosophe qui avait daigné quelquefois causer
avec moi dans ma chaumière. Je lui dis : " Monsieur, vous avez tâché d'éclairer
les badauds de Paris sur le plus grand intérêt des hommes, la durée de la vie
humaine. Le ministère a connu par vous seul ce qu'il doit donner aux rentiers
viagers, selon leurs différents âges. Vous avez proposé de donner aux maisons de
la ville l'eau qui leur manque, et de nous sauver enfin de l'opprobre et du
ridicule d'entendre toujours crier à l'eau, et de voir des femmes enfermées dans
un cerceau oblong porter deux seaux d'eau, pesant ensemble trente livres, à un
quatrième étage auprès d'un privé. Faites-moi, je vous prie, l'amitié de me dire
combien il y a d'animaux à deux mains et à deux pieds en France.
LE GEOMÈTRE
On prétend qu'il y en a environ vingt millions, et je veux bien adopter ce
calcul très probable b, en attendant qu'on le vérifie; ce qui serait très aisé,
et qu'on n'a pas encore fait, parce qu'on ne s'avise jamais de tout.
b. Cela est prouvé par les mémoires des intendants, faits à la fin du
dix-septième siècle, combinés avec le dénombrement par feux, composé en 1753 par
ordre de Monsieur le comte d'Argenson, et surtout avec l'ouvrage très exact de
Monsieur de Mezence, fait sous les yeux de Monsieur l'intendant de la
Mi chaudière, l'un des hommes les plus éclairés.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Combien croyez-vous que le territoire de France contienne d'arpents?
LE GÉOMÈTRE
Cent trente millions, dont presque la moitié est en chemins, en villes,
villages, landes, bruyères, marais, sables, terres stériles, couvents inutiles,
jardins de plaisance plus agréables qu'utiles, terrains incultes, mauvais
terrains mal cultivés. On pourrait réduire les terres d'un bon rapport à
soixante et quinze millions d'arpents carrés; mais comptons-en quatre-vingts
millions: on ne saurait trop faire pour sa patrie.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Combien croyez-vous que chaque arpent rapporte l'un dans l'autre, année commune,
en blés, en semence de toute espèce, vins, étangs, bois, métaux, bestiaux,
fruits, laines, soies, lait, huiles, tous frais faits, sans compter l'impôt?
LE GÉOMÈTRE
Mais, s'ils produisent chacun vingt-cinq livres, c'est beaucoup; cependant
mettons trente livres, pour ne pas décourager nos concitoyens. Il y a des,
arpents qui produisent des valeurs renaissantes estimées trois cents livres; il
y en a qui produisent trois livres. La moyenne proportionnelle entre trois et
trois cents est trente: car vous voyez bien que trois est à trente comme trente
est à trois cents. Il est vrai que, s'il y avait beaucoup d'arpents à trente
livres, et très peu à trois cents livres, notre compte ne s'y trouverait pas;
mais, encore une fois, je ne veux point chicaner.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Eh bien! monsieur, combien les quatre-vingts millions d'arpents donneront-ils de
revenu, estimé en argent?
LE GÉOMÈTRE
Le compte est tout fait: cela produit par an deux milliards quatre cents
millions de livres numéraires au cours de ce jour.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
J'ai lu que Salomon possédait lui seul vingt-cinq milliards d'argent comptant;
et certainement il n'y a pas deux milliards quatre cents millions d'espèces
circulantes dans la France, qu'on m'a dit être beaucoup plus grande et plus
riche que le pays de Salomon.
LE GÉOMÈTRE
C'est là le mystère : il y a peut-être à présent environ neuf cents millions
d'argent circulant dans le royaume, et cet argent, passant de main en main,
suffit pour payer toutes les denrées et tous les travaux; le même écu peut
passer mille fois de la poche du cultivateur dans celle du cabaretier et du
commis des aides.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
J'entends. Mais vous m'avez dit que nous sommes vingt millions d'habitants,
hommes et femmes, vieillards et enfants: combien pour chacun, s'il vous plaît.
LE GÉOMÈTRE
Cent vingt livres, ou quarante écus.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Vous avez deviné tout juste mon revenu : j'ai quatre arpents qui, en comptant
les années de repos mêlées avec les années de produit, me valent cent vingt
livres; c'est peu de chose.
Quoi! Si chacun avait une portion égale, comme dans l'âge d'or, chacun n'aurait
que cinq louis d'or par an?
LE GÉOMÈTRE
Pas davantage, suivant notre calcul, que j'ai un peu enflé. Tel est l'état de la
nature humaine. La vie et la fortune sont bien bornées : on ne vit à Paris, l'un
portant l'autre, que vingt-deux à vingt-trois ans; l'un portant l'autre, on n'a
tout au plus que cent vingt livres par an à dépenser: c'est-à-dire que votre
nourriture, votre vêtement, votre logement, vos meubles, sont représentés par la
somme de cent vingt livres.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Hélas! que vous ai-je fait pour m'ôter ainsi la fortune et la vie? Est-il vrai
que je n'aie que vingt-trois ans à vivre, à moins que je ne vole la part de mes
camarades.
LE GÉOMÈTRE
Cela est incontestable dans la bonne ville de Paris; mais de ces vingt-trois ans
il en faut retrancher au moins dix de votre enfance car l'enfance n'est pas une
jouissance de la vie, c'est une préparation, c'est le vestibule de l'édifice,
c'est l'arbre qui n'a pas encore donné de fruits, c'est le crépuscule d'un jour.
Retranchez des treize années qui vous restent le temps du sommeil et celui de
l'ennui, c'est au moins la moitié reste six ans et demi que vous passez dans le
chagrin, les douleurs, quelques plaisirs, et l'espérance.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Miséricorde! votre compte ne va pas à trois ans d'une existence supportable.
LE GÉOMÈTRE
Ce n'est pas ma faute. La nature se soucie fort peu des individus. Il y a
d'autres insectes qui ne vivent qu'un jour, mais dont l'espèce dure à jamais. La
nature est comme ces grands princes qui comptent pour rien la perte de quatre
cent mille hommes, pourvu qu'ils viennent à bout de leurs augustes desseins.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Quarante écus, et trois ans à vivre! quelle ressource imagineriez-vous contre
ces deux malédictions?
LE GÉOMÈTRE
Pour la vie, il faudrait rendre dans Paris l'air plus pur, que les hommes
mangeassent moins, qu'ils fissent plus d'exercice, que les mères allaitassent
leurs enfants, qu'on ne fût plus assez malavisé pour craindre l'inoculation:
c'est ce que j'ai déjà dit, et pour la fortune, il n'y a qu'à se marier, et
faire des garçons et des filles.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Quoi! le moyen de vivre commodément est d'associer ma misère à celle d'un autre?
LE GÉOMÈTRE
Cinq ou six misères ensemble font un établissement très tolérable. Ayez une
brave femme, deux garçons et deux filles seulement, cela fait sept cent vingt
livres pour votre petit ménage, supposé que justice soit faite, et que chaque
individu ait cent vingt livres de rente. Vos enfants en bas âge ne vous coûtent
presque rien; devenus grands, ils vous soulagent; leurs secours mutuels vous
sauvent presque toutes les dépenses, et vous vivez très heureusement en
philosophe, pourvu que ces messieurs qui gouvernent l'Etat n'aient pas la
barbarie de vous extorquer à chacun vingt écus par an; mais le malheur est que
nous ne sommes plus dans l'âge d'or, où les hommes, nés tous égaux, avaient
également part aux productions succulentes d'une terre non cultivée. Il s'en
faut beaucoup aujourd'hui que chaque être à deux mains et à deux pieds possède
un fonds de cent vingt livres de revenu.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Ah! vous nous ruinez. Vous nous disiez tout à l'heure que dans un pays où il y a
quatre-vingts millions d'arpents de terre assez bonne, et vingt millions
d'habitants, chacun doit jouir de cent vingt livres de rente, et vous nous les
ôtez.
LE GÉOMÈTRE
Je comptais suivant les registres du siècle d'or, et il faut compter suivant le
siècle de fer. Il y a beaucoup d'habitants qui n'ont que la valeur de dix écus
de rente, d'autres qui n'en ont que quatre ou cinq, et plus de six millions
d'hommes qui n'ont absolument rien.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Mais ils mourraient de faim au bout de trois jours.
LE GÉOMÈTRE
Point du tout: les autres qui possèdent leurs portions les font travailler, et
partagent avec eux; c'est ce qui paye le théologien, le confiturier,
l'apothicaire, le prédicateur, le comédien, le procureur et le fiacre. Vous vous
êtes cru à plaindre de n'avoir que cent vingt livres à dépenser par an, réduites
à cent huit livres à cause de votre taxe de douze francs; mais regardez les
soldats qui donnent leur sang pour la patrie : ils ne disposent, à quatre sous
par jour, que de soixante et treize livres, et ils vivent gaiement en
s'associant par chambrées.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Ainsi donc un ex-jésuite a plus de cinq fois la paye du soldat. Cependant les
soldats ont rendu plus de services à 1'Etat sous les yeux du roi à Fontenoy, à
Laufelt, au siège de Fribourg, que n'en a jamais rendu le révérend père La
Valette.
LE GÉOMÈTRE
Rien n'est plus vrai; et même chaque jésuite devenu libre a plus à dépenser
qu'il ne coûtait à son couvent: il y en a même qui ont gagné beaucoup d'argent à
faire des brochures contre les parlements, comme le révérend père Patouillet et
le révérend père Nonotte. Chacun s'ingénie dans ce monde : l'un est à. la tête
d'une manufacture d'étoffes; l'autre de porcelaine; un autre entreprend l'opéra;
celui-ci fait la gazette ecclésiastique; cet autre, une tragédie bourgeoise, ou
un roman dans le goût anglais; il entretient le papetier, le marchand d'encre,
le libraire, le colporteur, qui sans 1ui demanderaient l'aumône. Ce n'est enfin
que la restitution de cent vingt livres à ceux qui n'ont rien qui fait fleurir
l'Etat.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Parfaite manière de fleurir!
LE GÉOMÈTRE
Il n'y en a point d'autre: par tout pays le riche fait vivre le pauvre. Voilà
l'unique source de l'industrie du commerce. Plus la nation est industrieuse,
plus elle gagne sur l'étranger. Si nous attrapions de 1'étranger dix millions
par an pour la balance du commerce, il y aurait dans vingt ans deux cents
millions de plus dans l'Etat: ce serait dix francs de plus à répartir loyalement
sur chaque tête, c'est-à-dire que les négociants feraient gagner à chaque pauvre
dix francs de plus, dans l'espérance de faire des gains encore plus
considérables; mais le commerce a ses bornes, comme la fertilité de la terre:
autrement la progression irait à l'infini; et puis il n'est pas sûr que la
balance de notre commerce nous soit toujours favorable : il y a des temps où
nous perdons.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
J'ai entendu parler beaucoup de population. Si nous nous avisions de faire le
double d'enfants de ce que nous en faisons, Si notre patrie était peuplée du
double, Si nous avions quarante millions d'habitants au lieu de vingt,
qu'arriverait-il?
LE GÉOMÈTRE
Il arriverait que chacun n'aurait à dépenser que vingt écus, l'un portant
l'autre, ou qu'il faudrait que la terre rendît le double de ce qu'elle rend, ou
qu'il y aurait le double de pauvres, ou qu'il faudrait avoir le double
d'industrie, et gagner le double sur l'étranger, ou envoyer la moitié de la
nation en Amérique; ou que la moitié de la nation mangeât l'autre.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Contentons-nous donc de nos vingt millions d'hommes, et de nos cent vingt livres
par tête, réparties comme il plaît à Dieu; mais cette situation est triste, et
votre siècle de fer est bien dur.
LE GÉOMÈTRE
Il n'y a aucune nation qui soit mieux, et il en est beaucoup qui sont plus mal.
Croyez-vous qu'il y ait dans le Nord de quoi donner la valeur de cent vingt
livres à chaque habitant? S'ils avaient eu l'équivalent, les Huns, les Goths,
les Vandales et les Francs n'auraient pas déserté leur patrie pour aller
s'établir ailleurs, le fer et la flamme à la main.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Si je vous laissais dire, vous me persuaderiez bientôt que je suis heureux avec
mes cent vingt francs.
LE GÉOMÈTRE
Si vous pensiez être heureux, en ce cas vous le seriez.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
On ne peut s'imaginer être ce qu'on n'est pas, à moins qu'on ne soit fou.
LE GÉOMÈTRE
Je vous ai déjà dit que, pour être plus à votre aise et plus heureux que vous
n'êtes, il faut que vous preniez une femme; mais j'ajouterai qu'elle doit avoir
comme vous cent vingt livres de rente, c'est-à-dire quatre arpents à dix écus
l'arpent. Les anciens Romains n'en avaient chacun que trois. Si vos enfants sont
industrieux, ils pourront en gagner chacun autant en travaillant pour les
autres.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Ainsi ils ne pourront avoir de l'argent sans que d'autres en perdent.
LE GÉOMÈTRE
C'est la loi de toutes les nations; on ne respire qu'à ce prix.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Et il faudra que ma femme et moi nous donnions chacun la moitié de notre récolte
à la puissance législatrice et exécutrice, et que les nouveaux ministres d'Etat
nous enlèvent la moitié du prix de nos sueurs et de la substance de nos pauvres
enfants avant qu'ils puissent gagner leur vie! Dites-moi, je vous prie, combien
nos nouveaux ministres font entrer d'argent de droit divin dans les coffres du
roi.
LE GÉOMÈTRE
Vous payez vingt écus pour quatre arpents qui vous en rapportent quarante.
L'homme riche qui possède quatre cents arpents payera deux mille écus par ce
nouveau tarif, et les quatre-vingts millions d'arpents rendront au roi douze
cents millions de livres par année, ou quatre cents millions d'écus.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Cela me parait impraticable et impossible.
LE GÉOMÈTRE
Vous avez très grande raison, et cette impossibilité est une démonstration
géométrique qu'il y a un vice fondamental de raisonnement dans nos nouveaux
ministres.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
N'y a-t-il pas aussi une prodigieuse injustice démontrée à me prendre la moitié
de mon blé, de mon chanvre, de la laine de mes moutons, etc., et de n'exiger
aucun secours de ceux qui auront gagné dix ou vingt, ou trente mille livres de
rente avec mon chanvre, dont ils ont tissu de la toile; avec ma laine, dont ils
ont fabriqué des draps; avec mon blé, qu'ils auront vendu plus cher qu'ils ne
l'ont acheté?
LE GÉOMÈTRE
L'injustice de cette administration est aussi évidente que son calcul est
erroné. Il faut que l'industrie soit favorisée; mais il faut que l'industrie
opulente secoure l'Etat. Cette industrie vous a certainement ôté une partie de
vos cent vingt livres, et se les est appropriées en vous vendant vos chemises et
votre habit vingt fois plus cher qu'ils ne vous auraient coûté si vous les aviez
faits vous-même. Le manufacturier, qui s'est enrichi à vos dépens, a, je
l'avoue, donné un salaire à ses ouvriers, qui n'avaient rien par eux-mêmes; mais
il a retenu pour lui, chaque année, une somme qui lui a valu enfin trente mille
livres de rente : il a donc acquis cette fortune à vos dépens; vous ne pourrez
jamais lui vendre vos denrées assez cher pour vous rembourser de ce qu'il a
gagné sur vous: car, si vous tentiez ce surhaussement, il en ferait venir de
l'étranger à meilleur prix. Une preuve que cela est ainsi, c'est qu'il reste
toujours possesseur de ses trente mille livres de rente, et vous restez avec vos
cent vingt livres, qui diminuent souvent, bien loin d'augmenter.
Il est donc nécessaire et équitable que l'industrie raffinée du négociant paye
plus que l'industrie grossière du laboureur. Il en est de même des receveurs des
deniers publics. Votre taxe avait été jusqu'ici de douze francs avant que nos
grands ministres vous eussent pris vingt écus. Sur ces douze francs, le
publicain retenait dix sols pour lui. Si dans votre province il y a cinq cent
mille âmes, il aura gagné deux cent cinquante mille francs par an. Qu'il en
dépense cinquante, il est clair qu'au bout de dix ans il aura deux millions de
bien. Il est très juste qu'il contribue à proportion, sans quoi tout serait
perverti et bouleversé.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Je vous remercie d'avoir taxé ce financier, cela soulage mon imagination; mais
puisqu'il a si bien augmenté son superflu, comment puis-je faire pour accroître
aussi ma petite fortune?
LE GÉOMÈTRE
Je vous l'ai déjà dit, en vous mariant, en travaillant, en tâchant de tirer de
votre terre quelques gerbes de plus que ce qu'elle vous produisait.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Je suppose que j'ai bien travaillé; que toute la nation en ait fait autant; que
la puissance législatrice et exécutrice en ait reçu un plus gros tribut: combien
la nation a-t-elle gagné au bout de l'année?
LE GÉOMÈTRE
Rien du tout; à moins qu'elle n'ait fait un commerce étranger utile; mais elle
aura vécu plus commodément chacun aura eu à proportion plus d'habits, de
chemises, de meubles, qu'il n'en avait auparavant Il y aura eu dans l'Etat une
circulation plus abondante; les salaires auront été augmentés avec le temps à
peu près en proportion du nombre de gerbes de blé, de toisons de moutons, de
cuirs de bœufs, de cerfs et de chèvres, qui auront été employés, de grappes de
raisin qu'on aura foulées dans le pressoir. On aura payé au roi plus de valeurs
de denrées en argent, et le roi aura rendu plus de valeurs à tous ceux qu'il
aura fait travailler sous ses ordres; mais il n'y aura pas un écu de plus dans
le royaume.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Que restera-t-il donc à la puissance au bout de l'année?
LE GÉOMÈTRE
Rien, encore une fois; c'est ce qui arrive à toute puissance elle ne thésaurise
pas; elle a été nourrie, vêtue, logée, meublée; tout le monde l'a été aussi,
chacun suivant son état; et, si elle thésaurise, elle a arraché à la circulation
autant d'argent qu'elle en a entassé; elle a fait autant de malheureux qu'elle a
mis de fois quarante écus dans ses coffres.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Mais ce grand Henri IV n'était donc qu'un vilain, un ladre, un pillard : car on
m'a conté qu'il avait encaqué dans la Bastille plus de cinquante millions de
notre monnaie d'aujourd'hui?
LE GÉOMÈTRE
C'était un homme aussi bon, aussi prudent que valeureux. Il allait faire une
juste guerre, et en amassant dans ses coffres vingt-deux millions de son temps,
en ayant encore à recevoir plus de vingt autres qu'il laissait circuler, il
épargnait à son peuple plus de cent millions qu'il en aurait coûté s'il n'avait
pas pris ces utiles mesures. Il se rendait moralement sûr du succès contre un
ennemi qui n'avait pas les mêmes précautions. Le calcul des probabilités était
prodigieusement en sa faveur. Ces vingt-deux millions encaissés prouvaient qu'il
y avait alors dans le royaume la valeur de vingt-deux millions d'excédent dans
les biens de la terre: ainsi personne ne souffrait.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Mon vieillard me l'avait bien dit qu'on était à proportion plus riche sous
l'administration du duc de Sully que sous celle des nouveaux ministres, qui ont
mis l'impôt unique, et qui m'ont pris vingt écus sur quarante. Dites-moi, je
vous prie, y a-t-il une nation au monde qui jouisse de ce beau bénéfice de
l'impôt unique?
LE GÉOMÈTRE
Pas une nation opulente. Les Anglais, qui ne rient guère, se sont mis à rire
quand ils ont appris que des gens d'esprit avaient proposé parmi nous cette
administration. Les Chinois exigent une taxe de tous les vaisseaux marchands qui
abordent à Kanton; les Hollandais payent à Nangasaqui, quand ils sont reçus au
Japon, sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens; les Lapons et les Samoyèdes,
à la vérité, sont soumis à un impôt unique en peaux de martres; la république de
Saint-Marin ne paye que des dîmes pour entretenir l'Etat dans sa splendeur.
Il y a dans notre Europe une nation célèbre par son équité et par sa valeur qui
ne paye aucune taxe : c'est le peuple helvétien. Mais voici ce qui est arrivé :
ce peuple s'est mis à la place des ducs d'Autriche et de Zeringue; les petits
cantons sont démocratiques et très pauvres; chaque habitant y paye une somme
très modique pour les besoins de la petite république. Dans les cantons riches,
on est chargé envers l'Etat des redevances que les archiducs d'Autriche et les
seigneurs fonciers exigeaient : les cantons protestants sont à proportion du
double plus riches que les catholiques, parce que l1Etat y possède les biens des
moines. Ceux qui étaient sujets des archiducs d'Autriche, des ducs de Zeringue,
et des moines, le sont aujourd'hui de la patrie; ils payent à cette patrie les
mêmes dîmes, les mêmes droits, les mêmes lods et ventes qu'ils payaient à leurs
anciens maîtres; et, comme les sujets en général ont très peu de commerce, le
négoce n'est assujetti à aucune charge, excepté de petits droits d'entrepôt :
les hommes trafiquent de leur valeur avec les puissances étrangères, et se
vendent pour quelques années, ce qui fait entrer quelque argent dans leur pays à
nos dépens; et c'est un exemple aussi unique dans le monde policé que l'est
l'impôt établi par vos nouveaux législateurs.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Ainsi, monsieur, les Suisses ne sont pas de droit divin dépouillés de la moitié
de leurs biens; et celui qui possède quatre vaches n'en donne pas deux à l'Etat?
LE GÉOMÈTRE
Non, sans doute. Dans un canton, sur treize tonneaux de vin on en donne un et on
en boit douze. Dans un autre canton, on paye la douzième partie et on en boit
onze.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Ah! qu'on me fasse Suisse! Le maudit impôt que l'impôt unique et inique qui m'a
réduit à demander l'aumône! Mais trois ou quatre cents impôts, dont les noms
même me sont impossibles à retenir et à prononcer, sont-ils plus justes et plus
honnêtes? Y a-t-il jamais eu un législateur qui, en fondant un Etat, ait imaginé
de créer des conseillers du roi mesureurs de charbons, jaugeurs de vin, mouleurs
de bois, langueyeurs de porcs, contrôleurs de beurre salé? d'entretenir une
armée de faquins deux fois plus nombreuse que celle d'Alexandre, commandée par
soixante généraux qui mettent le pays à contribution, qui remportent des
victoires signalées tous les jours, qui font des prisonniers, et qui quelquefois
les sacrifient en l'air ou sur un petit théâtre de planches, comme faisaient les
anciens Scythes, à ce que m'a dit mon curé?
Une telle législation, contre laquelle tant de cris s'élevaient, et qui faisait
verser tant de larmes, valait-elle mieux que celle qui m'ôte tout d'un coup
nettement et paisiblement la moitié de mon existence? J'ai peur qu'à bien
compter on ne m'en prît en détail les trois quarts sous l'ancienne finance.
LE GÉOMÈTRE
Iliacos fritta muros peccatur et extra.
Est modus in rebus. Caveas ne quid nimis.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
J'ai appris un peu d'histoire et de géométrie, mais je ne sais pas le latin.
LE GÉOMÈTRE
Cela signifie à peu près " On a tort des deux côtés. Gardez le milieu en tout.
Rien de trop.>>
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Oui, rien de trop, c'est ma situation; mais je n'ai pas assez.
LE GÉOMÈTRE
Je conviens que vous périrez de faim, et moi aussi, et l'Etat aussi, supposé que
la nouvelle administration dure seulement deux ans; mais il faut espérer que
Dieu aura pitié de nous.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
On passe sa vie à espérer, et on meurt en espérant. Adieu, monsieur; vous m'avez
instruit, mais j'ai le cœur navré.
LE GÉOMÈTRE
C'est souvent le fruit de la science.
AVENTURE AVEC UN CARME
Quand j'eus bien remercié l'académicien
de l'Académie des sciences de m'avoir mis au fait, je m'en allai tout pantois,
louant la Providence, mais grommelant entre mes dents ces tristes paroles:
"vingt écus de rente seulement pour vivre, et n'avoir que vingt-deux ans à vivre!
hélas! puisse notre vie être encore plus courte, puisqu'elle est si malheureuse!"
Je me trouvai bientôt vis-à-vis d'une maison superbe. Je sentais déjà la faim;
je n'avais pas seulement la cent vingtième partie de la somme lui appartient de
droit à chaque individu; mais, dès qu'on m'eut appris que ce palais était le
couvent des révérends pères carmes déchaussés, je conçus de grandes espérances,
et je dis: "Puisque ces saints sont assez humbles pour marcher pieds nus, ils
seront assez charitables pour me donner à dîner."
Je sonnai; un carme vint : "Que voulez-vous, mon fils ?
- Du pain, mon révérend père; les nouveaux édits m'ont tout ôté.
- Mon fils, nous demandons nous-mêmes l'aumône; nous ne la faisons pas.
- Quoi! votre saint institut vous ordonne de n'avoir pas de souliers, et vous avez une maison de prince, et vous me refusez à manger!
- Mon fils, il est vrai que nous sommes sans souliers et sans bas : c'est une dépense de moins; mais nous n'avons pas plus froid aux pieds qu'aux mains; et si notre saint institut nous avait ordonné d'aller cul nu, nous n'aurions point froid au derrière. A l'égard de notre belle maison, nous l'avons aisément bâtie, parce que nous avons cent mille livres de rente en maisons dans la même rue.
- Ah! ah! vous me laissez mourir de faim, et vous avez cent mille livres de rente! Vous en rendez donc cinquante mille au nouveau gouvernement?
- Dieu nous préserve de payer une obole! Le seul produit de la terre cultivée par des mains laborieuses, endurcies de calus et mouillées de larmes, doit des tributs à la puissance législatrice et exécutrice. Les aumônes qu'on nous a données nous ont mis en état de faire bâtir ces maisons, dont nous tirons cent mille livres par an; mais ces aumônes venant des fruits de la terre, ayant déjà payé le tribut, elles ne doivent pas payer deux fois : elles ont sanctifié les fidèles qui se sont appauvris en nous enrichissant, et nous continuons à demander l'aumône et à mettre à contribution le faubourg St-Germain pour sanctifier encore les fidèles."
Ayant dit Ces mots, le carme me ferma la
porte au nez.
Je passai par-devant l'hôtel des mousquetaires gris; je contai la chose à un de
ces messieurs: ils me donnèrent un bon dîner et un écu. L'un d'eux proposa
d'aller brûler le couvent; mais un mousquetaire plus sage lui montra que le
temps n'était pas encore venu, et le pria d'attendre encore deux ou trois ans.
AUDIENCE DE MONSIEUR LE CONTROLEUR GÉNÉRAL
J'allai, avec mon écu, présenter un placet à monsieur le contrôleur général, qui donnait audience ce jour-là.
Son antichambre était remplie de gens de toute espèce. Il y avait surtout des
visages encore plus pleins, des ventres plus rebondis, des mines plus fières que
mon homme aux huit millions. Je n'osais m'approcher; je les voyais, et ils ne me
voyaient pas.
Un moine, gros décimateur, avait intenté un procès à des citoyens qu'il appelait
ses paysans. Il avait déjà plus de revenu que la moitié de ses paroissiens
ensemble, et de plus il était seigneur de fief. Il prétendait que ses vassaux,
ayant converti avec des peines extrêmes leurs bruyères en vignes, ils lui
devaient la dixième partie de leur vin, ce qui faisait, en comptant le prix du
travail et des échalas, et des futailles, et du cellier, plus du quart de la
récolte. " Mais comme les dîmes, disait-il, sont de droit divin, je demande le
quart de la substance de mes paysans au nom de Dieu. Le ministre lui dit: "Je
vois combien vous êtes charitable!"
Un fermier général, fort intelligent dans les aides, lui dit alors :
"Monseigneur, ce village ne peut rien donner à ce moine : car, ayant fait payer
aux paroissiens l'année passée trente-deux impôts pour leur vin, et les ayant
fait condamner ensuite à payer le trop bu, ils sont entièrement ruinés. J'ai
fait vendre leurs bestiaux et leurs meubles, ils sont encore mes redevables. Je
m'oppose aux prétentions du révérend père.
- Vous avez raison d'être son rival, repartit le ministre; vous aimez l'un et
l'autre également votre prochain, et vous m'édifiez tous deux."
Un troisième, moine et seigneur, dont les paysans sont mainmortables, attendait
aussi un arrêt du conseil qui le mît en possession de tout le bien d'un badaud
de Paris, qui, ayant par inadvertance demeuré un an et un jour dans une maison
sujette à cette servitude et enclavée dans les Etats de ce prêtre, y était mort
au bout de l'année. Le moine réclamait tout le bien du badaud, et cela de droit
divin.
Le ministre trouva le cœur du moine aussi juste et aussi tendre que les deux
premiers.
Un quatrième, qui était contrôleur du domaine, présenta un beau mémoire par
lequel il se justifiait d'avoir réduit vingt familles à l'aumône. Elles avaient
hérité de leurs oncles ou tantes, ou frères, ou cousins; il avait fallu payer
les droits. Le domanier leur avait prouvé généreusement qu'elles n'avaient pas
assez estimé leurs héritages, qu'elles étaient beaucoup plus riches qu'elles ne
croyaient, et, en conséquence, les ayant condamnées à l'amende du triple, les
ayant ruinées en frais, et fait mettre en prison les pères de famille, il avait
acheté leurs meilleures possessions sans bourse délier.
Le contrôleur général lui dit (d'un ton un peu amer à la vérité) "Euge!
contrôleur bone et fidelis; quia supra pauca fuisti fidelis, fermier général te
constituam (1).".
Cependant il dit tout bas à un maître des requêtes qui était à côté de lui:
"il faudra bien faire rendre gorge à ces sangsues sacrées et profanes : il est temps de soulager le peuple, qui,
sans nos soins notre équité, n'aurait jamais quoi vivre que dans l'autre monde."(2)
"Des hommes d'un génie profond lui présentèrent des projets. L'un avait imaginé de mettre des impôts sur l'esprit. Tout le monde, disait-il,
s'empressera de payer, personne ne voulant passer pour un sot. Le ministre lui dit : "Je vous déclare exempt de la taxe."
Un autre proposa d'établir l'impôt unique sur les chansons et sur le rire,
attendu que la nation était la plus gaie du monde, et qu'une chanson la
consolait de tout; mais le ministre observa que depuis quelque temps on ne
faisait plus guère de chansons plaisantes, et il craignit que, pour échapper à
la taxe, on ne devînt trop sérieux.
Vint un sage et brave citoyen qui offrit de donner au roi trois fois plus, en
faisant payer par la nation trois fois moins. Le ministre lui conseilla
d'apprendre l'arithmétique.
Un cinquième prouvait au roi, par amitié, qu'il ne pouvait recueillir que
soixante et quinze millions; mais qu'il allait lui en donner deux cent
vingt-cinq. "Vous me ferez plaisir, dit le ministre, quand nous aurons payé les
dettes de l'Etat."
Enfin arriva un commis de l'auteur nouveau qui fait la puissance législatrice
copropriétaire de toutes nos terres par le droit divin, et qui donnait au roi
douze cents millions de rente. Je reconnus l'homme qui m'avait mis en prison
pour n'avoir pas payé mes vingt écus. Je me jetai aux pieds de monsieur le
contrôleur général, et je lui demandai justice; il fit
un grand éclat de rire, et me dit que c'était un tour qu'on m'avait joué. Il
ordonna à ces mauvais plaisants de me donner cent écus de dédommagement, et
m'exempta de taille pour le reste de ma vie. Je lui dis "Monseigneur, Dieu vous
bénisse! "
(1) Je me fis expliquer Ces paroles par un savant à quarante écus
elle me réjouirent.
(2) Le cas à peu prés semblable est arrivé dans la province que
j'habite, et le contrôleur du domaine a été forcé à faire restitution; mais il
n'a pas été puni.
LETTRE A L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Quoique je sois trois fois aussi riche que vous, c'est-à-dire quoique je possède
trois cent soixante livres ou francs de revenu, je vous écris cependant comme
d'égal à égal, sans affecter l'orgueil des grandes fortunes.
J'ai lu l'histoire de votre désastre et de la justice que monsieur le contrôleur
général vous a rendue; je vous en fais mon compliment; mais par malheur je viens
de lire le Financier citoyen, malgré la répugnance que m'avait inspirée le
titre, qui paraît contradictoire à bien des gens. Ce citoyen vous ôte vingt
francs de vos rentes, et à moi soixante: il n'accorde que cent francs à chaque
individu sur la totalité des habitants; mais, en récompense, un homme non moins
illustre enfle nos rentes jusqu'à cent cinquante livres; je vois que votre
géomètre a pris un juste milieu. Il n'est point de ces magnifiques seigneurs qui
d'un trait de plume peuplent Paris d'un million d'habitants, et vous font rouler
quinze cents millions d'espèces sonnantes dans le royaume, après tout ce que
nous en avons perdu dans nos guerres dernières.
Comme vous êtes grand lecteur, je vous prêterai le Financier citoyen; mais
n'allez pas le croire en tout : il cite le testament du grand ministre Colbert,
et il ne sait pas que c'est une rapsodie ridicule faite par un Gatien de
Courtilz; il cite la Dîme du maréchal de Vauban, et il ne sait pas qu'elle est
d'un Boisguilbert; il cite le testament du cardinal de Richelieu, et il ne sait
pas qu'il est de l'abbé de Bourzeis. Il suppose que ce cardinal assure que quand
la viande enchérit, on donne une paye plus forte au soldat. Cependant la viande
enchérit beaucoup sous son ministère, et la paye du soldat n'augmenta point: ce
qui prouve, indépendamment de cent autres preuves, que ce livre reconnu pour
supposé dès qu'il parut, et ensuite attribué au cardinal même, ne lui appartient
pas plus que les testaments du cardinal Alberoni et du maréchal de Belle-Isle ne
leur appartiennent.
Défiez-vous toute votre vie des testaments et des systèmes: j'en ai été la
victime comme vous. Si les Solons et les Lycurgues modernes se sont moqués de
vous, les nouveaux Triptolèmes se sont encore plus moqués de moi, et, sans une
petite succession qui m'a ranimé, j'étais mort de misère.
J'ai cent vingt arpents labourables dans le plus beau pays de la nature, et le
sol le plus ingrat. Chaque arpent ne rend, tous frais faits, dans mon pays,
qu'un écu de trois livres. Dès que j'eus lu dans les journaux qu'un célèbre
agriculteur avait inventé un nouveau semoir, et qu'il labourait sa terre par
planches, afin qu'en semant moins il recueillît davantage, j'empruntai vite de
l'argent, j'achetai un semoir, je labourai par planches; je perdis ma peine et
mon argent, aussi bien que l'illustre agriculteur qui ne sème plus par planches.
Mon malheur voulut que je lusse le Journal économique, qui se vend à Paris chez
Boudot. Je tombai sur l'expérience d'un Parisien ingénieux qui, pour se réjouir,
avait fait labourer son parterre quinze fois, et y avait semé du froment, au
lieu d'y planter des tulipes; il eut une récolte très abondante. J'empruntai
encore de l'argent. "Je n'ai qu'à donner trente labours, me disais-je, j'aurai
le double de la récolte de ce digne Parisien, qui s'est formé des principes
d'agriculture à l'Opéra et à la Comédie; et me voilà enrichi par ses leçons et
par son exemple.
Labourer seulement quatre fois dans mon pays est une chose impossible; la
rigueur et les changements soudains des saisons ne le permettent pas; et
d'ailleurs le malheur que j'avais eu de semer par planches, comme l'illustre
agriculteur dont j'ai parlé, m'avait forcé à vendre mon attelage. Je fais
labourer trente fois mes cent vingt arpents par toutes les charrues qui sont à
quatre lieues à la ronde. Trois labours pour chaque arpent coûtent douze livres,
c'est un prix fait; il fallut donner trente façons par arpent; le labour de
chaque arpent me coûta cent vingt livres : la façon de mes cent vingt arpents me
revint à quatorze mille quatre cents livres. Ma récolte, qui se monte, année
commune, dans mon maudit pays, à trois cents setiers, monta, il est vrai, à
trois cent trente, qui, à vingt livres le setier, me produisirent six mille six
cents livres: je perdis sept mille huit cents livres; il est vrai que j'eus la
paille.
J'étais ruiné, abîmé, sans une vieille tante qu'un grand médecin dépêcha dans
l'autre monde, en raisonnant aussi bien en médecine que moi en agriculture.
Qui croirait que j'eus encore la faiblesse de me laisser séduire par le Journal
de Boudot? Cet homme-là, après tout, n'avait pas juré ma perte. Je lis dans son
recueil qu'il n'y a qu'à faire une avance de quatre mille francs pour avoir
quatre mille livres de rente en artichauts : certainement Boudot me rendra en
artichauts ce qu'il m'a fait perdre en blé. Voilà mes quatre mille francs
dépensés, et mes artichauts mangés par des rats de campagne. Je fus hué dans mon
canton comme le diable de Papefiguière.
J'écrivais une lettre de reproche fulminante à Boudot Pour toute réponse le
traître s'égaya dans son Journal à mes dépens. Il me nia impudemment que les
Caraïbes fussent nés rouges; je fus obligé de lui envoyer une attestation d'un
ancien procureur du roi de la Guadeloupe, comme quoi Dieu a fait les Caraïbes
rouges ainsi que les Nègres noirs. Mais cette petite victoire ne m'empêcha pas
de perdre jusqu'au dernier sou toute la succession de ma tante, pour avoir trop
cru les nouveaux systèmes. Mon cher monsieur, encore une fois, gardez-vous des charlatans.
NOUVELLES DOULEURS OCCASIONNÉES
PAR LES NOUVEAUX SYSTÈMES
(Ce petit morceau est tiré des manuscrits d'un vieux solitaire)
Je vois que si de bons citoyens se sont amusés à gouverner les Etats, et à se
mettre à la place des rois; si d'autres se sont crus des Triptolèmes et des
Cérès, il y en a de plus fiers qui se sont mis sans façon à la place de Dieu, et
qui ont créé l'univers avec leur plume, comme Dieu le créa autrefois par la parole.
Un des premiers qui se présenta à mes adorations fut un descendant de Thalès,
nommé Telliamed, qui m'apprit que les montagnes et les hommes sont produits par
les eaux de la mer. Il y eut d'abord de beaux hommes marins qui ensuite
devinrent amphibies. Leur belle queue fourchue se changea en cuisses et en
jambes. J'étais encore tout plein des Métamorphoses d'Ovide, et d'un livre où il
était démontré que la race des hommes était bâtarde d'une race de babouins:
j'aimais autant descendre d'un poisson que d'un singe.
Avec le temps j'eus quelques doutes sur cette généalogie, et même sur la
formation des montagnes. " Quoi! me dit-il, vous ne savez pas que les courants
de la mer, qui jettent toujours du sable à droite et à gauche à dix ou douze
pieds de hauteur, tout au plus, ont produit, dans une suite infinie de siècles,
des montagnes de vingt mille pieds de haut, lesquelles ne sont pas de sable?
Apprenez que la mer a nécessairement couvert tout le globe. La preuve en est
qu'on a vu des ancres de vaisseau sur le mont Saint-Bernard, qui étaient là
plusieurs siècles avant que les hommes eussent des vaisseaux. Figurez-vous que
la terre est un globe de verre qui a été longtemps tout couvert d'eau."
Plus il m'endoctrinait, plus je devenais incrédule.
" Quoi donc! me dit-il, n'avez-vous pas vu le falun de Touraine à trente-six
lieues de la mer? C'est un amas de coquilles avec lesquelles on engraisse la
terre comme avec du fumier. Or, si la mer a déposé dans la succession des temps
une mine entière de coquilles à trente-six lieues de l'Océan, pourquoi
n'aura-t-elle pas été jusqu'à trois mille lieues pendant plusieurs siècles sur
notre globe de verre?"
Je lui répondis "Monsieur Telliamed, il y a des gens qui font quinze lieues par
jour à pied; mais ils ne peuvent en faire cinquante. Je ne crois pas que mon
jardin soit de verre; et quant à votre falun, je doute encore qu'il soit un lit
de coquilles de mer. Il se pourrait bien que ce ne fût qu'une mine de petites
pierres calcaires qui prennent aisément la forme des fragments de coquilles,
comme il y a des pierres qui sont figurées en langues, et qui ne sont point des
langues; en étoiles, et qui ne sont point des astres; en serpents roulés sur
eux-mêmes, et qui ne sont point des serpents; en parties naturelles du beau
sexe, et qui ne sont point pourtant les dépouilles des dames. On voit des
dendrites, des pierres figurées, qui représentent des arbres et des maisons,
sans que jamais ces petites pierres aient été des maisons et des chênes.
si la mer avait déposé tant de lits coquilles en Touraine, pourquoi aurait-elle négligé
Bretagne, Normandie, Picardie,
et toutes les autres côtes? j'ai bien peur que ce falun vanté ne vienne pas plus hommes. quand se serait répandue à trente-six lieues,
n'est dire qu'elle ait été jusqu'à trois mille, même cents, montagnes aient produites par eaux. j'aimerais autant le
Caucase a formé mer, prétendre fait Caucase.
- Mais, monsieur l'incrédule, que répondrez-vous aux huîtres pétrifiées qu'on a trouvées sur le sommet des Alpes?
- Je répondrai, monsieur le créateur, que je n'ai pas vu plus d'huîtres
pétrifiées que d'ancres de vaisseau sur le haut du mont Cenis. Je répondrai ce
qu'on a déjà dit, qu'on a trouvé des écailles d'huîtres (qui se pétrifient
aisément) à de très grandes distances de la mer, comme on a déterré des
médailles romaines à cent lieues de Rome; et j'aime mieux croire que des
pèlerins de Saint-Jacques ont laissé quelques coquilles vers Saint-Maurice que
d'imaginer que la mer a formé le mont Saint-bernard.
"Il y a des coquillages partout; mais est-il bien sûr qu'ils ne soient pas les
dépouilles des testacés et des crustacés de nos lacs et de nos rivières, aussi
bien que des petits poissons marins?
- Monsieur l'incrédule, je vous tournerai en ridicule dans le monde que je me
propose de créer.
- Monsieur le créateur, à vous permis; chacun est le maître dans son monde; mais
vous ne me ferez jamais croire que celui où nous sommes soit de verre, ni que
quelques coquilles soient des démonstrations que la mer a produit les Alpes et
le mont Taurus. Vous savez qu'il n'y a aucune coquille dans les montagnes
d'Amérique. Il faut que ce ne soit pas vous qui ayez créé cet hémisphère, et que
vous vous soyez contenté de former l'ancien monde: c'est bien assez.
- Monsieur, monsieur, si on n'a pas découvert de coquilles sur les montagnes
d'Amérique, on en découvrira.
- Monsieur, c'est parler en créateur qui sait son secret, et qui est sûr de son
fait. Je vous abandonne, si vous voulez, votre falun, pourvu que vous me
laissiez mes montagnes. Je suis d'ailleurs le très humble et très obéissant
serviteur de votre providence."
Dans le temps que je m'instruisais ainsi avec Teillamed, un jésuite irlandais
déguisé en homme, d'ailleurs grand observateur, et ayant de bons microscopes,
fit des anguilles avec de la farine de blé ergoté. On ne douta pas alors qu'on
ne fit des hommes avec de la farine de bon froment. Aussitôt on créa des
particules organiques qui composèrent des hommes. Pourquoi non? Le grand
géomètre Fatio avait bien ressuscité des morts à Londres on pouvait tout aussi
aisément faire à Paris des vivants avec des particules organiques; mais,
malheureusement les nouvelles anguilles de Needham ayant disparu, les nouveaux
hommes disparurent aussi, et s'enfuirent chez les monades, qu'ils rencontrèrent
dans le plein au milieu de la matière subtile, globuleuse, et cannelée.
Ce n'est pas que ces créateurs de systèmes n'aient rendu de grands services à la
physique; à Dieu ne plaise que je méprise leurs travaux! On les a comparés à des
alchimistes qui, en faisant de l'or (qu'on ne fait point,), ont trouvé de bons
remèdes, ou du moins des choses très curieuses. On peut être un homme d'un rare
mérite, et se tromper sur la formation des animaux et sur la structure du globe.
Les poissons changés en hommes, et les eaux changées en montagnes, ne m'avaient
pas fait autant de mal que M. Boudot. Je me bornais tranquillement à douter,
lorsqu'un Lapon me prit sous sa protection. C'était un profond philosophe, mais
qui ne pardonnait jamais aux gens qui n'étaient pas de son avis. Il me fit
d'abord connaître clairement l'avenir en exaltant mon âme. Je fis de si
prodigieux efforts d'exaltation que j'en tombai malade; mais il me guérit en
m'enduisant de poix-résine de la tête aux pieds. A peine fus-je en état de
marcher qu'il me proposa un voyage aux terres australes pour y disséquer des
têtes de géants, ce qui nous ferait connaître clairement la nature de l'âme. Je
ne pouvais supporter la mer; il eut la bonté de me mener par terre. Il fit
creuser un grand trou dans le globe terraqué : ce trou allait droit chez les
Patagons. Nous partîmes; je me cassai une jambe à l'entrée du trou; on eut
beaucoup de peine à me redresser la jambe il s'y forma un calus qui m'a beaucoup
soulagé.
J'ai déjà parlé de tout cela dans une de mes diatribes pour instruire l'univers
très attentif à ces grandes choses. Je suis bien vieux; j'aime quelquefois à
répéter mes contes, afin de les inculquer mieux dans la tête des petits garçons
pour lesquels je travaille depuis si longtemps.
MARIAGE DE L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
L'homme aux quarante écus s'étant beaucoup formé, et ayant fait une petite
fortune, épousa une jolie fille qui possédait cent écus de rente. Sa femme
devint bientôt grosse. Il alla trouver son géomètre, et lui demanda si elle lui
donnerait un garçon ou une fille. Le géomètre lui répondit que les sages-femmes,
les femmes de chambre, le savaient pour l'ordinaire; mais que les physiciens,
qui prédisent les éclipses, n'étaient pas si éclairés qu'elles.
Il voulut savoir ensuite si son fils ou sa fille avait déjà une âme. Le géomètre
dit que ce n'était pas son affaire, et qu'il en fallait parler au théologien du
coin.
L'homme aux quarante écus, qui était déjà l'homme aux deux cents écus pour le
moins, demanda en quel endroit était son enfant. "Dans une petite poche, lui dit
son ami, entre la vessie et l'intestin rectum. - O Dieu paternel! s'écria-t-il,
l'âme immortelle de mon fils née et logée entre de l'urine et quelque chose de
pis! - Oui, mon cher voisin, l'âme d'un cardinal n'a point eu d'autre berceau;
et avec cela on fait le fier, on se donne des airs.
- Ah! monsieur le savant, ne pourriez-vous point me dire comment les enfants se
font.
- Non, mon ami; mais, si vous voulez, je vous dirai ce que les philosophes ont
imaginé, c'est-à-dire comment les enfants ne se font point.
"Premièrement, le révérend père Sanchez, dans son excellent livre de Matrimonio,
est entièrement de l'avis d'Hippocrate; il croit comme un article de foi que les
deux véhicules fluides de l'homme et de la femme s'élancent et s'unissent
ensemble, et que dans le moment l'enfant est conçu par cette union; et il est si
persuadé de ce système physique, devenu théologique, qu'il examine, chapitre XXI
du livre second, utrum virgo Maria semen emiserit in copulatione cum Spiritu
Sancto.
- Eh! monsieur, je vous ai déjà dit que je n'entends pas le latin; expliquez-moi
en français l'oracle du père Sanchez. Le géomètre lui traduisit le texte, et
tous deux frémirent d'horreur. Le nouveau marié, en trouvant Sanchez
prodigieusement ridicule, fut pourtant assez content d'Hippocrate; et il se
flattait que sa femme avait rempli toutes les conditions imposées par ce médecin
pour faire un enfant.
"Malheureusement, lui dit le voisin, il y a beaucoup de femmes qui ne répandent
aucune liqueur, qui ne reçoivent qu'avec aversion les embrassements de leurs
maris, et qui cependant en ont des enfants. Cela seul décide contre Hippocrate
et Sanchez.
"De plus, il y a très grande apparence que la nature agit toujours dans les
mêmes cas par les mêmes principes or il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui
engendrent sans copulation, comme les poissons écaillés, les huîtres, les
pucerons. Il a donc fallu que les physiciens cherchassent une mécanique de
génération qui convînt à tous les animaux. Le célèbre Harvey, qui le premier
démontra la circulation, et qui était digne de découvrir le secret de la nature,
crut l'avoir trouvé dans les poules : elles pondent des œufs; il jugea que les
femmes pondaient aussi. Les mauvais plaisants dirent que c'est pour cela que les
bourgeois, et même quelques gens de cour, appellent leur femme ou leur maîtresse
ma poule, et qu'on dit que toutes les femmes sont coquettes, parce qu'elles
voudraient que les coqs les trouvassent belles. Malgré ces railleries, Harvey ne
changea point d'avis, et il fut établi dans toute l'Europe que nous venons d'un
œuf.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Mais, monsieur, vous m'avez dit que la nature est toujours semblable à
elle-même, qu'elle agit toujours par le même principe dans le même cas : les
femmes, les juments, les ânesses, les anguilles, ne pondent point; vous vous
moquez de moi.
LE GÉOMÈTRE
Elles ne pondent point en dehors, mais elles pondent en dedans; elles ont des
ovaires comme tous les oiseaux; les juments, les anguilles, en ont aussi. Un œuf
se détache de l'ovaire; il est couvé dans la matrice. Voyez tous les poissons
écaillés, les grenouilles : ils jettent des œufs, que le mâle féconde. Les
baleines et les autres animaux marins de cette espèce font éclore leurs œufs
dans leur matrice. Les mites, les teignes, les plus vils insectes, sont
visiblement formés d'un œuf: tout vient d'un œuf; et notre globe est un grand
œuf qui contient tous les autres.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Mais vraiment ce système porte tous les caractères de la vérité; il est simple,
il est uniforme, il est démontré aux yeux dans plus de la moitié des animaux;
j'en suis fort content, je n'en veux point d'autre : les œufs de ma femme me
sont fort chers.
LE GÉOMÈTRE
On s'est lassé à la longue de ce système: on a fait les enfants d'une autre
façon.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Et pourquoi, puisque celle-là est si naturelle?
LE GÉOMÈTRE
C'est qu'on a prétendu que nos femmes n'ont point d'ovaire, mais seulement de
petites glandes.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Je soupçonne que des gens qui avaient un autre système à débiter ont voulu
décréditer les œufs.
LE GÉOMÈTRE
Cela pourrait bien être. Deux Hollandais s'avisèrent d'examiner la liqueur
séminale au microscope, celle de l'homme, celle de plusieurs animaux, et ils
crurent y apercevoir des animaux déjà tout formés qui couraient avec une vitesse
inconcevable. Ils en virent même dans le fluide séminal du coq. Alors on jugea
que les mâles faisaient tout, et les femelles rien; elles ne servirent plus qu'à
porter le trésor que le mâle leur avait confié.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Voilà qui est bien étrange. J'ai quelques doutes sur tous ces petits animaux qui
frétillent si prodigieusement dans une liqueur, pour être ensuite immobiles dans
les œufs des oiseaux, et pour être non moins immobiles neuf mois, à quelques
culbutes près, dans le ventre de la femme; cela ne me paraît pas conséquent. Ce
n'est pas, autant que j'en puis juger, la marche de la nature. Comment sont
faits, s'il vous plaît, ces petits hommes qui sont si bons nageurs dans la
liqueur dont vous me parlez?
LE GÉOMÈTRE
Comme des vermisseaux. Il y avait surtout un médecin nommé Andry, qui voyait des
vers partout, et qui voulait absolument détruire le système d'Harvey. Il aurait,
s'il l'avait pu, anéanti la circulation du sang, parce qu'un autre l'avait
découverte. Enfin deux Hollandais et monsieur Andry, à force de tomber dans le
péché d'Onan et de voir les choses au microscope, réduisirent l'homme à être
chenille. Nous sommes d'abord un ver comme elle; de là, dans notre enveloppe,
nous devenons comme elle, pendant neuf mois, une vraie chrysalide, que les
paysans appellent fève. Ensuite, Si la chenille devient papillon, nous devenons
hommes : voilà nos métamorphoses.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Eh bien! s'en est-on tenu là ? N'y a-t-il point eu depuis de nouvelle mode?
LE GÉOMÈTRE
On s'est dégoûté d'être chenille. Un philosophe extrêmement plaisant a découvert
dans une Vénus physique que l'attraction faisait les enfants; et voici comment
la chose s'opère. Le germe étant tombé dans la matrice, l'œil droit attire l'œil
gauche, qui arrive pour s'unir à lui en qualité d'œil; mais il en est empêché
par le nez, qu'il rencontre en chemin, et qui l'oblige de se placer à gauche. Il
en est de même des bras, des cuisses et des jambes, qui tiennent aux cuisses. Il
est difficile d'expliquer, dans cette hypothèse, la situation des mamelles et
des fesses. Ce grand philosophe n'admet aucun dessein de l'Etre créateur dans la
formation des animaux; il est bien loin de croire que le cœur soit fait pour
recevoir le sang et pour le chasser, l'estomac pour digérer, les yeux pour voir,
les oreilles pour entendre: cela lui paraît trop vulgaire; tout se fait par
attraction.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Voilà un maître fou. Je me flatte que personne n'a pu adopter une idée aussi
extravagante,
LE GÉOMÈTRE
On en rit beaucoup; mais ce qu'il y eut de triste, c'est que cet insensé
ressemblait aux théologiens, qui persécutent autant qu'ils le peuvent ceux
qu'ils font rire.
D'autres philosophes ont imaginé d'autres manières qui n'ont pas fait une plus
grande fortune : ce n'est plus le bras qui va chercher le bras; ce n'est plus la
cuisse qui court après la cuisse; ce sont de petites molécules, de petites
particules de bras et de cuisse qui se placent les unes sur les autres. On sera
peut-être enfin obligé d'en revenir aux œufs, après avoir perdu bien du temps.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
J'en suis ravi; mais quel a été le résultat de toutes ces disputes?
LE GÉOMÈTRE
Le doute. Si la question avait été débattue entre des théologaux, il y aurait eu
des excommunications et du sang répandu; mais entre des physiciens la paix est
bientôt faite: chacun a couché avec sa femme, sans penser le moins du monde à
son ovaire, ni à ses trompes de Fallope. Les femmes sont devenues grosses ou
enceintes, sans demander seulement comment ce mystère s'opère. C'est amsi que
vous semez du blé, et que vous ignorez comment le blé germe en terre.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Oh! je le sais bien; on me l'a dit il y a longtemps: c'est par pourriture.
Cependant il me prend quelquefois des envies de rire de tout ce qu'on m'a dit.
LE GÉOMÈTRE
C'est une fort bonne envie. Je vous conseille de douter de tout, excepté que les
trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits, et que les triangles qui
ont même base et même hauteur sont égaux entre eux, ou autres propositions
pareilles, comme, par exemple, que deux et deux font quatre.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Oui, je crois qu'il est fort sage de douter; mais je sens que je suis curieux
depuis que j'ai fait fortune et que j'ai du loisir. Je voudrais, quand ma
volonté remue mon bras ou ma jambe, découvrir le ressort par lequel ma volonté
les remue : car sûrement il y en a un. Je suis quelquefois tout étonné de
pouvoir lever et abaisser mes yeux, et de ne pouvoir dresser mes oreilles. Je
pense, et je voudrais connaître un peu... là... toucher au doigt ma pensée. Cela
doit être fort curieux. Je cherche si je pense par moi-même, si Dieu me donne
mes idées, si mon âme est venue dans mon corps à six semaines ou à un jour,
comment elle s'est logée dans mon cerveau; si. je pense beaucoup quand je dors
profondément, et quand je suis en léthargie. Je me creuse la cervelle pour
savoir comment un corps en pousse un autre. Mes sensations ne m'étonnent pas
moins : j'y trouve du divin, et surtout dans le plaisir.
J'ai fait quelquefois mes efforts pour imaginer un nouveau sens, et je n'ai
jamais pu y parvenir. Les géomètres savent toutes ces choses; ayez la bonté de
m'instruire.
LE GÉOMÈTRE
Hélas! nous sommes aussi ignorants que vous; adressez-vous à la Sorbonne."
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS, DEVENU PÈRE,
RAISONNE SUR LES MOINES
Quand l'homme aux quarante écus se vit père d'un garçon, il commença à se croire
un homme de quelque poids dans l'Etat; il espéra donner au moins dix sujets au
roi, qui seraient tous utiles. C'était l'homme du monde qui faisait le mieux des
paniers; et sa femme était une excellente couturière. Elle était née dans le
voisinage d'une grosse abbaye de cent mille livres de rente. Son mari me demanda
un jour pourquoi ces messieurs, qui étaient en petit nombre, avaient englouti
tant de parts de quarante écus. " Sont-ils plus utiles que moi à la patrie? -
Non, mon cher voisin. - Servent-ils comme moi à la population du pays ? - Non,
au moins en apparence. - Cultivent-ils la terre? défendent-ils l'Etat quand il
est attaqué ? - Non, ils prient Dieu pour vous.
- Eh bien! je prierai Dieu pour eux, et partageons.
" Combien croyez-vous que les couvents renferment de ces gens utiles, soit en
hommes, soit en filles, dans le royaume?
- Par les mémoires des intendants, faits sur la fin du dernier siècle, il y en
avait environ quatre-vingt-dix mille.
- Par notre ancien compte, ils ne devraient, à quarante écus par tête, posséder
que dix millions huit cent mille livres : combien en ont-ils?
- Cela va à cinquante millions, en comptant les messes et les quêtes des moines
mendiants, qui mettent réellement un impôt considérable sur le peuple. Un frère
quêteur d'un couvent de Paris s'est vanté publiquement que sa besace valait
quatre-vingt mille livres de rente.
- Voyons combien cinquante millions répartis entre quatre-vingt-dix mille têtes
tondues donnent à chacune.
- Cinq cent cinquante-cinq livres.
- C'est une somme considérable dans une société nombreuse, où les dépenses
diminuent par la quantité même des consommateurs car il en coûte bien moins à
dix personnes pour vivre ensemble que si chacun avait séparément son logis et sa
table.
" Les ex-jésuites, à qui on donne aujourd'hui quatre cents livres de pension,
ont donc réellement perdu à ce marché? (1)
- Je ne le crois pas car ils sont presque tous retirés chez des parents qui les
aident; plusieurs disent la messe pour de l'argent, ce qu'ils ne faisaient pas
auparavant; d'autres se sont faits précepteurs; d'autres ont été soutenus par
des dévotes; chacun s'est tiré d'affaire, et peut-être y en a-t-il peu
aujourd'hui qui, ayant goûté du monde et de la liberté, voulussent reprendre
leurs anciennes chaînes. La vie monacale, quoi qu'on en dise, n'est point du
tout à envier. C'est une maxime assez connue que les moines sont des gens qui
s'assemblent sans se connaître, vivent sans s'aimer, et meurent sans se
regretter.
- Vous pensez donc qu'on leur rendrait un très grand service de les défroquer
tous?
- Ils y gagneraient beaucoup sans doute, et l'Etat encore davantage; on rendrait
à la patrie des citoyens et des citoyennes qui ont sacrifié témérairement leur
liberté dans un âge où les lois ne permettent pas qu'on dispose d'un fonds de
dix sous de rente; on tirerait ces cadavres de leurs tombeaux : ce serait une
vraie résurrection. Leurs maisons deviendraient des hôtels de ville, des
hôpitaux, des écoles publiques, ou seraient affectées à des manufactures; la
population deviendrait plus grande, tous les arts seraient mieux cultivés. On
pourrait du moins diminuer le nombre de ces victimes volontaires en fixant le
nombre des novices: la patrie aurait plus d'hommes utiles et moins de
malheureux. C'est le sentiment de tous les magistrats, c'est le vœu unanime du
public, depuis que les esprits sont éclairés. L'exemple de l'Angleterre et de
tant d'autres Etats est une preuve évidente de la nécessité de cette réforme.
Que ferait aujourd'hui l'Angleterre, Si au lieu de quarante mille hommes de mer,
elle avait quarante mille moines? Plus les arts se sont multipliés, plus le
nombre des sujets laborieux est devenu nécessaire. Il y a certainement dans les
cloîtres beaucoup de talents ensevelis qui sont perdus pour l'Etat. Il faut,
pour faire fleurir un royaume, le moins de prêtres possible, et le plus
d'artisans possible. L'ignorance et la barbarie de nos pères, loin d'être une
règle pour nous, n'est qu'un avertissement de faire ce qu'ils feraient s'ils
étaient en notre place avec nos lumières.
-Ce n'est donc point par haine contre les moines que vous voulez les abolir?
C'est par pitié pour eux; c'est par amour pour la patrie. Je pense comme vous.
Je ne voudrais point que mon fils fût moine; et si je croyais que je dusse avoir
des enfants pour le cloître, je ne coucherais plus avec ma femme.
- Quel est en effet le bon père de famille qui ne gémisse de voir son fils et sa
fille perdus pour la société? Cela s'appelle se sauver; mais un soldat qui se
sauve quand il faut combattre est puni. Nous sommes tous des soldats de l'Etat;
nous sommes à la solde de la société, nous devenons des déserteurs quand nous la
quittons. Que dis-je? les moines sont des parricides qui étouffent une postérité
tout entière. Quatre-vingt-dix mille cloîtrés, qui braillent ou qui nasillent du
latin, pourraient donner à l'Etat chacun deux sujets : cela fait cent soixante
mille hommes qu'ils font périr dans leur germe. Au bout de cent ans la perte est
immense : cela est démontré.
"Pourquoi donc le monachisme a-t-il prévalu? parce que le gouvernement fut
presque partout détestable et absurde depuis Constantin; parce que l'empire
romain eut plus de moines que de soldats; parce qu'il y en avait cent mille dans
la seule Egypte; parce qu'ils étaient exempts de travail et de taxe; parce que
les chefs des nations barbares qui détruisirent l'empire, s'étant faits
chrétiens pour gouverner des chrétiens, exercèrent la plus horrible tyrannie;
parce qu'on se jetait en foule dans les cloîtres pour échapper aux fureurs de
ces tyrans, et qu'on se plongeait dans un esclavage pour en éviter un autre;
parce que les papes, en instituant tant d'ordres différents de fainéants sacrés,
se firent autant de sujets dans les autres Etats; parce qu'un paysan aime mieux
être appelé mon révérend père, et donner des bénédictions, que de conduire la
charrue; parce qu'il ne sait pas que la charrue est plus noble que le froc;
parce qu'il aime mieux vivre aux dépens des sots que par un travail honnête;
enfin parce qu'il ne sait pas qu'en se faisant moine il se prépare des jours
malheureux, tissus d'ennui et de repentir.
- Allons, monsieur, plus de moines, pour leur bonheur et pour le nôtre. Mais je
suis fâché d'entendre dire au seigneur de mon village, père de quatre garçons et
de trois filles, qu'il ne saura où les placer s'il ne fait pas ses filles
religieuses.
- Cette allégation trop souvent répétée est inhumaine, antipatriotique,
destructive de la société.
"Toutes les fois qu'on peut dire d'un état de vie, quel qu'il puisse être: si
tout le monde embrassait cet état le genre humain serait perdu, il est démontré
que cet état ne vaut rien, et que celui qui le prend nuit au genre humain autant
qu'il est en lui.
"Or il est clair que si tous les garçons et toutes les filles s'encloîtraient le
monde périrait: donc la moinerie est par cela seul l'ennemie de la nature
humaine, indépendamment des maux affreux qu'elle a causés quelquefois.
- Ne pourrait-on pas en dire autant des soldats?
- Non assurément : car si chaque citoyen porte les armes à son tour, comme
autrefois dans toutes les républiques, et surtout dans celle de Rome, le soldat
n'en est que meilleur cultivateur; le soldat citoyen se marie, il combat pour sa
femme et pour ses enfants. Plût à Dieu que tous les laboureurs fussent soldats
et mariés! ils seraient d'excellents citoyens. Mais un moine, en tant que moine,
n'est bon qu'à dévorer la substance de ses Compatriotes. Il n'y a point de
vérité plus reconnue.
- Mais les filles, monsieur, les filles des pauvres gentilshommes, qu'on ne peut
marier, que feront-elles?
Elles feront, on l'a dit mille fois, comme les filles d'Angleterre, d'Ecosse,
d'Irlande, de Suisse, de Hollande, de la moitié de l'Allemagne, de Suède, de
Norvège, du Danemark, de Tartine, de Turquie, d'Afrique, et de presque tout le
reste de la terre; elles seront bien meilleures épouses, bien meilleures mères,
quand on se sera accoutumé, ainsi qu'en Allemagne, à prendre des femmes sans
dot. Une femme ménagère et laborieuse fera plus de bien dans une maison que la
fille d'un financier, qui dépense plus en superfluités qu'elle n'a porté de
revenu chez son mari.
"Il faut qu'il y ait des maisons de retraite pour la vieillesse, pour
l'infirmité, pour la difformité. Mais, par le plus détestable des abus, les
fondations ne sont que pour la jeunesse et pour les personnes bien conformées.
On commence, dans le cloître, par faire étaler aux novices des deux sexes leur
nudité, malgré toutes les lois de la pudeur; on les examine attentivement devant
et derrière. Qu'une vieille bossue aille se présenter pour entrer dans un
cloître, on la chassera avec mépris, à moins qu'elle ne donne une dot immense.
Que dis-je? toute religieuse doit être dotée, sans quoi elle est le rebut du
couvent. Il n'y eut jamais d'abus plus intolérable.
- Allez, allez, monsieur, je vous jure que mes filles ne seront jamais
religieuses. Elles apprendront à filer, à coudre, à faire de la dentelle, à
broder, à se rendre utiles. Je regarde les vœux comme un attentat contre la
patrie et contre soi-même. Expliquez-moi, je vous prie, comment il se peut faire
qu'un de mes amis, pour contredire le genre humain, prétende que les moines sont
très utiles à la population d'un Etat, parce que leurs bâtiments sont mieux
entretenus que ceux des Seigneurs, et leurs terres mieux cultivées?
- Eh! quel est donc votre ami qui avance une proposition si étrange?
- C'est l'Ami des hommes, ou plutôt celui des moines.
- Il a voulu rire; il sait trop bien que dix familles qui ont chacune cinq mille
livres de rente en terre sont cent fois, mille fois plus utiles qu'un couvent
qui jouit d'un revenu de cinquante mille livres, et qui a toujours un trésor
secret. Il vante les belles maisons bâties par les moines, et c'est précisément
ce qui irrite les citoyens c'est le sujet des plaintes de l'Europe; Le vœu de
pauvreté condamne les palais, comme le vœu d'humilité contredit l'orgueil, et
comme le vœu d'anéantir sa race contredit la nature.
- Je commence à croire qu'il faut beaucoup se défier des livres.
- Il faut en user avec eux comme avec les hommes choisir les plus raisonnables,
les examiner, et ne se rendre jamais qu'à l'évidence."
(1). Le jésuite Sanadon a mis adsunt pour adflent. Un amateur
d'Horace prétend que c'est pour cela qu'on a chassé les jésuites.
DES IMPOTS PAYÉS A L'ÉTRANGER
Il y a un mois que l'homme aux quarante écus vint me trouver en se tenant les
côtés de rire, et il riait de si grand cœur que je me mis à rire aussi sans
savoir de quoi il était question : tant l'homme est né imitateur! tant
l'instinct nous maîtrise! tant les grands mouvements de l'âme sont contagieux!
Ut ridentibus arrident, ita flentibus adflent e Humani vuitus.
Quand il eut bien ri, il me dit qu'il venait de rencontrer un homme qui se
disait protonotaire du Saint Siège, et que cet homme envoyait une grosse somme
d'argent à trois cents lieues d'ici, à un Italien, au nom d'un Français à qui le
roi avait donné un petit fief, et que ce Français ne pourrait jamais jouir des
bienfaits du roi s'il ne donnait à cet Italien la première année de son revenu.
" La chose est très vraie, lui dis-je; mais elle n'est pas si plaisante. Il en
coûte à la France environ quatre cent mille livres par an en menus droits de
cette espèce; et, depuis environ deux siècles et demi que cet usage dure, nous
avons déjà porté en Italie quatre-vingts millions.
- Dieu paternel! s'écria-t-il, que de fois quarante écus! Cet Italien-là nous
subjugua donc, il y a deux siècles et demi? Il nous imposa ce tribut?
- Vraiment, répondis-je, il nous en imposait autrefois d'une façon bien plus
onéreuse. Ce n'est là qu'une bagatelle en comparaison de ce qu'il leva longtemps
sur notre pauvre nation et sur les autres pauvres nations de l'Europe. " Alors
je lui racontai comment ces saintes usurpations s'étaient établies. Il sait un
peu d'histoire; il a du bon sens : il comprit aisément que nous avions été des
esclaves auxquels il restait encore un petit bout de chaîne. Il parla longtemps
avec énergie contre cet abus; mais avec quel respect pour la religion en
général! Comme il révérait les évêques! comme il leur souhaitait beaucoup de
quarante écus, afin qu'ils les dépensassent dans leurs diocèses en bonnes
œuvres!
Il voulait aussi que tous les curés de campagne eussent un nombre de quarante
écus suffisant pour les faire vivre avec décence. " Il est triste, disait-il
qu'un curé soit obligé de disputer trois gerbes de blé à son ouaille, et qu'il
ne soit pas largement payé par la province. Il est honteux que ces messieurs
soient toujours en procès avec leurs seigneurs. Ces contestations éternelles
pour des droits imaginaires, pour des dîmes, détruisent la considération qu'on
leur doit. Le malheureux cultivateur, qui a déjà payé aux préposés son dixième,
et les deux sous pour livre, et la taille, et la capitation, et le rachat du
logement des gens de guerre, après qu'il a logé des gens de guerre, etc., etc.,
etc.; cet infortuné, dis-je, qui se voit encore enlever le dixième de sa récolte
par son curé, ne le regarde plus comme son pasteur, mais comme son écorcheur,
qui lui arrache le peu de peau qui lui reste. Il sent bien qu'en lui enlevant la
dixième gerbe de droit divin, on a la cruauté diabolique de ne pas lui tenir
compte de ce qu'il lui en a coûté pour faire croître cette gerbe. Que lui
reste-t-il, pour lui et pour sa famille? Les pleurs, la disette, le
découragement, le désespoir; et il meurt de fatigue et de misère. Si le curé
était payé par la province, il serait la consolation de ses paroissiens, au lieu
d'être regardé par eux comme leur ennemi."
Ce digne homme s'attendrissait en prononçant ces paroles; il aimait sa patrie,
et était idolâtre du bien public. Il s'écriait quelquefois : " Quelle nation que
la française, si on voulait!
Nous allâmes voir son fils, à qui sa mère, bien propre et bien lavée, donnait un
gros téton blanc. L'enfant était fort joli. "Hélas! dit le père, te voilà donc,
et tu n'as que vingt-trois ans de vie, et quarante écus à prétendre!"
DES PROPORTIONS
Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens; mais deux sacs de blé
volés ne sont pas à ceux qui les ont pris comme la perte de leur vie l'est à
l'intérêt de la personne volée.
Le prieur de***, à qui deux de ses domestiques de campagne avaient dérobé deux
setiers de blé, vient de faire pendre les deux délinquants. Cette exécution lui
a plus coûté que toute sa récolte ne lui a valu, et, depuis ce temps, il ne
trouve plus de valets.
Si les lois avaient ordonné que ceux qui voleraient le blé de leur maître
laboureraient son champ toute leur vie, les fers aux pieds et une sonnette au
cou, attachée à un carcan, ce prieur aurait beaucoup gagné.
Il faut effrayer le crime: oui, sans doute; mais le travail forcé et la honte
durable l'intimident plus que la potence.
Il y a quelques mois qu'à Londres un malfaiteur fut condamné à être transporté
en Amérique pour y travailler aux sucreries avec les nègres. Tous les criminels
en Angleterre, comme en bien d'autres pays, sont reçus à présenter requête au
roi, soit pour obtenir grâce entière, soit pour diminution de peine. Celui-ci
présenta requête pour être pendu il alléguait qu'il haïssait mortellement le
travail, et qu'il aimait mieux être étranglé une minute que de faire du sucre
toute sa vie.
D'autres peuvent penser autrement, chacun a son goût; mais on a déjà dit, et il
faut répéter, qu'un pendu n'est bon à rien, et que les supplices doivent être
utiles.
Il y a quelques années que l'on condamna dans la Tartarie deux jeunes gens à
être empalés, pour avoir regardé, leur bonnet sur la tête, passer une procession
de lamas. L'empereur de la Chine, qui est un homme de beaucoup d'esprit, dit
qu'il les aurait condamnés à marcher nu-tête à la procession pendant trois mois.
Proportionnez les peines aux délits, a dit le marquis Beccaria; ceux qui ont
fait les lois n'étaient pas géomètres.
Si l'abbé Guyon, ou Cogé, ou l'ex-jésuite Nonone, ou l'ex-jésuite Patouillet, ou
le prédicant La Beaumelle, font de misérables libelles où il n'y a ni vérité, ni
raison, ni esprit, irez-vous les faire pendre, comme le prieur de *** a fait
pendre ses deux domestiques; et cela, sous prétexte que les calomniateurs sont
plus coupables que les voleurs?
Condamnerez-vous Fréron même aux galères, pour avoir insulté le bon goût, et
pour avoir menti toute sa vie dans l'espérance de payer son cabaretier?
Ferez-vous mettre au pilori le sieur Larcher, parce qu'il a été très pesant,
parce qu'il a entassé erreur sur erreur, parce qu'il n'a jamais su distinguer
aucun degré de probabilité, parce qu'il veut que, dans une antique et immense
cité renommée par sa police et par la jalousie des maris, dans Babylone enfin,
où les femmes étaient gardées par des eunuques, toutes les princesses allassent
par dévotion donner publiquement leurs faveurs dans la cathédrale aux étrangers
pour de l'argent? Contentons-nous de l'envoyer sur les lieux courir les bonnes
fortunes; soyons modérés en tout; mettons de la proportion entre les délits et
les peines.
Pardonnons à ce pauvre Jean-Jacques, lorsqu'il n'écrit que pour se contredire,
lorsqu'après avoir donné une comédie sifflée sur le théâtre de Paris, il injurie
ceux qui en font jouer à cent lieues de là; lorsqu'il cherche des protecteurs,
et qu'il les outrage; lorsqu'il déclame contre les romans, et qu'il fait des
romans dont le héros est un sot précepteur qui reçoit l'aumône d'une Suissesse à
laquelle il a fait un enfant, et qui va dépenser son argent dans un bordel de
Paris; laissons le croire qu'il a surpassé Fénelon et Xénophon, en élevant un
jeune homme de qualité dans le métier de menuisier: ces extravagantes platitudes
ne méritent pas un décret de prise de corps; les petites maisons suffisent avec
de bons bouillons, de la saignée, et du régime.
Je hais les lois de Dracon, qui punissaient également les crimes et les fautes,
la méchanceté et la folie. Ne traitons point le jésuite Nonone, qui n'est
coupable que d'avoir écrit des bêtises et des injures, comme on a traité les
jésuites Malagrida, Oldcorn, Garnet, Guignard, Gueret, et comme on devait
traiter le jésuite Le Teiller, qui trompa son roi, et qui troubla la France.
Distinguons principalement dans tout procès, dans toute contention, dans toute
querelle, l'agresseur de l'outragé, l'oppresseur de l'opprimé. La guerre
offensive est d'un tyran; celui qui se défend est un homme juste.
Comme j'étais plongé dans ces réflexions, l'homme aux quarante écus me vint voir
tout en larmes. Je lui demandai avec émotion si son fils, qui devait vivre
vingt-trois ans, était mort. " Non, dit-il, le petit se porte bien, et ma femme
aussi; mais j'ai été appelé en témoignage contre un meunier à qui on a fait
subir la question ordinaire et extraordinaire, et qui s'est trouvé innocent; je
l'ai vu s'évanouir dans les tortures redoublées; j'ai entendu craquer ses os;
j'entends encore ses cris et ses hurlements, ils me poursuivent; je pleure de
pitié, et je tremble d'horreur. " Je me mis à pleurer et à frémir aussi, car je
suis extrêmement sensible.
Ma mémoire alors me représenta l'aventure épouvantable des Calas : une mère
vertueuse dans les fers, ses filles éplorées et fugitives, sa maison au pillage;
un père de famille respectable brisé par la torture, agonisant sur la roue, et
expirant dans les flammes; un fils chargé de chaînes, traîné devant les juges,
dont un lui dit: "Nous venons de rouer votre père, nous allons vous rouer
aussi."
Je me souvins de la famille des Sirven, qu'un de mes amis rencontra dans des
montagnes couvertes de glaces, lorsqu'elle fuyait la persécution d'un juge aussi
inique qu'ignorant. " Ce juge, me dit-il, a condamné toute cette famille
innocente au supplice, en supposant, sans la moindre apparence de preuve, que le
père et la mère, aidés de deux de leurs filles, avaient égorgé et noyé la
troisième, de peur qu'elle n'allât à la messe. " Je voyais à la fois, dans des
jugements de cette espèce, l'excès de la bêtise, de l'injustice et de la
barbarie.
Nous plaignions la nature humaine, l'homme aux quarante écus et moi. J'avais
dans ma poche le discours d'un avocat général de Dauphiné, qui roulait en partie
sur ces matières intéressantes; je lui en lus les endroits suivants:
" Certes, ce furent des hommes véritablement grands qui osèrent les premiers se
charger de gouverner leurs semblables, et s'imposer le fardeau de la félicité
publique; qui, pour le bien qu'ils voulaient faire aux hommes, s'exposèrent à
leur ingratitude, et, pour le repos d'un peuple, renoncèrent au leur; qui se
mirent, pour ainsi dire, entre les hommes et la Providence, pour leur composer,
par artifice, un bonheur qu'elle semblait leur avoir refusé.
Quel magistrat, un peu sensible à ses devoirs, à la seule humanité, pourrait
soutenir ces idées? Dans la solitude d'un cabinet pourra-t-il, sans frémir
d'horreur et de pitié, jeter les yeux sur ces papiers, monuments infortunés du
crime ou de l'innocence? Ne lui semble-t-il pas entendre des voix gémissantes
sortir de ces fatales écritures, et le presser de décider du sort d'un citoyen,
d'un époux, d'un père, d'une famille? Quel juge impitoyable (s'il est chargé
d'un seul procès criminel) pourra passer de sang-froid devant une prison? C'est
donc moi, dira-t-il, qui retiens dans ce détestable séjour mon semblable,
peut-être mon égal, mon concitoyen, un homme enfin! c'est moi qui le lie tous
les jours, qui ferme sur lui ces odieuses portes! Peut-être le désespoir s'est
emparé de son âme; il pousse vers le ciel mon nom avec des malédictions, et sans
doute il atteste contre moi le grand Juge qui nous observe et doit nous juger
tous les deux.
" Ici un spectacle effrayant se présente tout à coup à mes yeux; le juge se
lasse d'interroger par la parole; il veut interroger par les supplices :
impatient dans ses recherches, et peut-être irrité de leur inutilité, on apporte
des torches, des chaînes, des leviers, et tous ces instruments inventés pour la
douleur. Un bourreau vient se mêler aux fonctions de la magistrature, et
terminer par la violence un interrogatoire commencé par la liberté.
Douce philosophie! toi qui ne cherches la vérité qu'avec l'attention et la
patience, t'attendais-tu que, dans ton siècle, on employât de tels instruments
pour la découvrir?
" Est-il bien vrai que nos lois approuvent cette méthode inconcevable, et que
l'usage la consacre?
" Leurs lois imitent leurs préjugés; les punitions publiques sont aussi cruelles
que les vengeances particulières, et les actes de leur raison ne sont guère
moins impitoyables que ceux de leurs passions. Quelle est donc la cause de cette
bizarre opposition ? C'est que nos préjugés sont anciens, et que notre morale
est nouvelle; c'est que nous sommes aussi pénétrés de nos sentiments
qu'inattentifs à nos idées; c'est que l'avidité des plaisirs nous empêche de
réfléchir sur nos besoins, et que nous sommes plus empressés de vivre que de
nous diriger; c'est, en un mot, que nos mœurs sont douces, et qu'elles ne sont
pas bonnes; c'est que nous sommes polis, et nous ne sommes seulement pas
humains."
Ces fragments, que l'éloquence avait dictés à l'humanité, remplirent le cœur de
mon ami d'une douce consolation. Il admirait avec tendresse. "Quoi! disait-il
dans son transport, on fait des chefs-d'œuvre en province! on m'avait dit qu'il
n'y a que Paris dans le monde.
- Il n'y a que Paris, lui dis-je, où l'on fasse des opéras-comiques; mais il y a
aujourd'hui dans les provinces beaucoup de magistrats qui pensent avec la même
vertu, et qui s'expriment avec la même force. Autrefois les oracles de la
justice, ainsi que ceux de la morale, n'étaient que ridicules. Le docteur
Balouard déclamait au barreau, et Arlequin dans la chaire. La philosophie est
enfin venue, elle a dit: "Ne parlez en public que pour dire des vérités neuves
et utiles, avec l'éloquence du sentiment et de la raison.
- Mais si nous n'avons rien de neuf à dire ? se sont écriés les parleurs. -
Taisez-vous alors, a répondu la philosophie; tous ces vains discours d'appareil,
qui ne contiennent que des phrases, sont comme le feu de la St. Jean, allumé le
jour de l'année où l'on a le moins besoin de se chauffer il ne cause aucun
plaisir, et il n'en reste pas même la cendre.
"Que toute la France lise les bons livres. Mais, malgré les progrès de l'esprit
humain, on lit très peu; et, parmi ceux qui veulent quelquefois s'instruire, la
plupart lisent très mal. Mes voisins et mes voisines jouent, après dîner, un jeu
anglais, que j'ai beaucoup de peine à prononcer, car on l'appelle wisk.
Plusieurs bons bourgeois, plusieurs grosses têtes, qui se croient de bonnes
têtes, vous disent avec un air d'importance que les livres ne sont bons à rien.
Mais, messieurs les Velches, savez-vous que vous n'êtes gouvernés que par des
livres? Savez-vous que l'ordonnance civile, le code militaire, et l'Evangile,
sont des livres dont vous dépendez continuellement? Lisez, éclairez-vous; ce
n'est que par la lecture qu'on fortifie son âme; la conversation la dissipe, le
jeu la resserre.
- J'ai bien peu d'argent, me répondit l'homme aux quarante écus; mais, si jamais
je fais une petite fortune, j'achèterai des livres chez Marc-Michel Rey.
DE LA VÉROLE
L'homme aux quarante écus demeurait dans un petit canton où l'on n'avait jamais
mis de soldats en garnison depuis cent cinquante années. Les mœurs, dans ce coin
de terre inconnu, étaient pures comme l'air qui l'environne. On ne savait pas
qu'ailleurs l'amour pût être infecté d'un poison destructeur, que les
générations fussent attaquées dans leur germe, et que la nature, se contredisant
elle-même, pût rendre la tendresse horrible et le plaisir affreux; on se livrait
à l'amour avec la sécurité de l'innocence. Des troupes vinrent, et tout changea.
Deux lieutenants, l'aumônier du régiment, un caporal, et un soldat de recrue qui
sortait du séminaire, suffirent pour empoisonner douze villages en moins de
trois mois. Deux cousines de l'homme aux quarante écus se virent couvertes de
pustules calleuses; leurs beaux cheveux tombèrent; leur voix devint rauque; les
paupières de leurs yeux, fixes et éteints, se chargèrent d'une couleur livide,
et ne se fermèrent plus pour laisser entrer le repos dans des membres disloqués,
qu'une carie secrète commençait à ronger comme ceux de l'Arabe Job, quoique Job
n'eût jamais eu cette maladie.
Le chirurgien-major du régiment, homme d'une grande expérience, fut obligé de
demander des aides à la cour pour guérir toutes les filles du pays. Le ministre
de la guerre, toujours porté d'inclination à soulager le beau sexe, envoya une
recrue de fraters, qui gâtèrent d'une main ce qu'ils rétablirent de l'autre.
L'homme aux quarante écus lisait alors l'histoire philosophique de Candide,
traduite de l'allemand du docteur Ralph, qui prouve évidemment que tout est
bien, et qu'il était absolument impossible, dans le meilleur des mondes
possibles, que la vérole, la peste, la pierre, la gravelle, les écrouelles, la
chambre de Valence, et 1' Inquisition, n'entrassent dans la composition de
l'univers, de cet univers uniquement fait pour l'homme, roi des animaux et image
de Dieu, auquel on voit bien qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau. Il
lisait, dans l'histoire véritable de Candide, que le fameux docteur Pangloss
avait perdu dans le traitement un œil et une oreille. "Hélas! dit-il, mes deux
cousines, mes deux pauvres cousines, seront-elles borgnes ou borgnesses et
essorillées?
- Non, lui dit le major consolateur; les Allemands ont la main
lourde; mais, nous autres, nous guérissons les filles promptement, sûrement, et
agréablement."
En effet les deux jolies cousines en furent quittes pour avoir la tête enflée
comme un ballon pendant six semaines, pour perdre la moitié de leurs dents, en
tirant la langue d'un demi-pied, et pour mourir de la poitrine au bout de six
mois.
Pendant l'opération, le cousin et le chirurgien-major raisonnèrent ainsi.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Est-il possible, monsieur, que la nature ait attaché de si épouvantables
tourments à un plaisir si nécessaire, tant de honte à tant de gloire, et qu'il y
ait plus de risque à faire un enfant qu'à tuer un homme ? Serait-il vrai au
moins, pour notre consolation, que ce fléau diminue un peu sur la terre, et
qu'il devienne moins dangereux de jour en jour?
LE CHIRURGIEN-MAJOR
Au contraire, il se répand de plus en plus dans toute l'Europe chrétienne; il
s'est étendu jusqu'en Sibérie; j'en ai vu mourir plus de cinquante personnes, et
surtout un grand général d'armée et un ministre d'Etat fort sage. Peu de
poitrines faibles résistent à la maladie et au remède. Les deux sœurs, la petite
et la grosse, se sont liguées encore plus que les moines pour détruire le genre
humain.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Nouvelle raison pour abolir les moines, afin que, remis au rang des hommes, ils
réparent un peu le mal que font les deux sœurs. Dites-moi, je vous prie, Si les
bêtes ont la vérole.
LE CHIRURGIEN
Ni la petite, ni la grosse, ni les moines, ne sont connus chez elles.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Il faut donc avouer qu'elles sont plus heureuses et plus prudentes que nous dans
ce meilleur des mondes.
LE CHIRURGIEN
Je n'en ai jamais douté; elles éprouvent bien moins de maladies que nous : leur
instinct est bien plus sûr que notre raison; jamais ni le passé ni l'avenir ne
les tourmentent
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Vous avez été chirurgien d'un ambassadeur de France en Turquie : y a-t-il
beaucoup de vérole à Constantinople?
LE CHIRURGIEN
Les Francs l'ont apportée dans le faubourg de Péra, où ils demeurent. J'y ai
connu un capucin qui en était mangé comme Pangloss; mais elle n'est point
parvenue dans la ville: les Francs n'y couchent presque jamais. Il n'y a presque
point de filles publiques dans cette ville immense. Chaque homme riche a des
femmes esclaves de Circassie, toujours gardées, toujours surveillées, dont la
beauté ne peut être dangereuse. Les Turcs appellent la vérole le mal chrétien,
et cela redouble le profond mépris qu'ils ont pour notre théologie; mais, en
récompense, ils ont la peste, maladie d'Egypte, dont ils font peu de cas, et
qu'ils ne se donnent jamais la peine de prévenir.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
En quel temps croyez-vous que ce fléau commença dans l'Europe?
LE CHIRURGIEN
Au retour du premier voyage de Christophe Colomb chez des peuples innocents qui
ne connaissaient ni l'avarice ni la guerre, vers l'an 1494. Ces nations, simples
et justes, étaient attaquées de ce mal de temps immémorial, comme la lèpre
régnait chez les Arabes et chez les Juifs, et la peste chez les Egyptiens. Le
premier fruit que les Espagnols recueillirent de cette conquête du nouveau monde
fut la vérole; elle se répandit plus promptement que l'argent du Mexique, qui ne
circula que longtemps après en Europe. La raison en est que, dans toutes les
villes, il y avait alors de belles maisons publiques appelées bordels, établies
par l'autorité des souverains pour conserver l'honneur des dames. Les Espagnols
portèrent le venin dans ces maisons privilégiées dont les princes et les évêques
tiraient les filles qui leur étaient nécessaires. On a remarqué qu'à Constance
il y avait eu sept cent dix-huit filles pour le service du concile qui fit
brûler si dévotement Jean Hus et Jérôme de Prague.
On peut juger par ce seul trait avec quelle rapidité le mal parcourut tous les
pays. Le premier seigneur qui en mourut fut l'illustrissime et révérendissime
évêque et vice-roi de Hongrie, en 1499, que Bartholomeo Montanagua, grand
médecin de Padoue, ne put guérir. Gualtien assure que l'archevêque de Mayence
Berthold de Henneberg, "attaqué de la grosse vérole, rendit son âme à Dieu en
1504." On sait que notre roi François 1er en mourut. Henri III la prit à Venise;
mais le jacobin Jacques Clément prévint l'effet de la maladie.
Le parlement de Paris, toujours zélé pour le bien public, fut le premier qui
donna un arrêt contre la vérole, en 1497. Il défendit à tous les vérolés de
rester dans Paris sous peine de la hart; mais, comme il n'était pas facile de
prouver juridiquement aux bourgeois et bourgeoises qu'ils étaient en délit, cet
arrêt n'eut pas plus d'effet que ceux qui furent rendus depuis contre
l'émétique; et, malgré le parlement, le nombre des coupables augmenta toujours.
Il est certain que, si on les avait exorcisés, au lieu de les faire pendre, il
n'y en aurait plus aujourd'hui sur la terre; mais c'est à quoi malheureusement
on ne pensa jamais.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
Est-il bien vrai ce que j'ai lu dans Candide, que, parmi nous, quand deux armées
de trente mille hommes chacune marchent ensemble en front de bandière, on peut
parier qu'il y a vingt mille vérolés de chaque côté?
LE CHIRURGIEN
Il n'est que trop vrai. Il en est de même dans les licences de Sorbonne. Que
voulez-vous que fassent de jeunes bacheliers à qui la nature parle plus haut et
plus ferme que la théologie? Je puis vous jurer que, proportion gardée, mes
confrères et moi nous avons traité plus de jeunes prêtres que de jeunes
officiers.
L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS
N'y aurait-il point quelque manière d'extirper cette contagion qui désole
l'Europe? On a déjà tâché d'affaiblir le poison d'une vérole, ne pourra-t-on
rien tenter sur l'autre?
LE CHIRURGIEN
Il n'y aurait qu'un seul moyen, c'est que tous les princes de l'Europe se
liguassent ensemble, comme dans les temps de Godefroy de Bouillon. Certainement
une croisade contre la vérole serait beaucoup plus raisonnable que ne l'ont été
celles qu'on entreprit autrefois si malheureusement contre Saladin, Melecsala,
et les Albigeois. Il vaudrait bien mieux s'entendre pour repousser l'ennemi
commun du genre humain que d'être continuellement occupé à guetter le moment
favorable de dévaster la terre et de couvrir les champs de morts, pour arracher
à son voisin deux ou trois villes et quelques villages. Je parle contre mes
intérêts car la guerre et la vérole font ma fortune; mais il faut être homme
avant d'être chirurgien-major.
C'est ainsi que l'homme aux quarante écus se formait, comme on dit, l'esprit et
le cœur. Non seulement il hérita de ses deux cousines, qui moururent en six
mois; mais il eut encore la succession d'un parent fort éloigné, qui avait été
sous-fermier des hôpitaux des armées, et qui s'était fort engraissé en mettant
les soldats blessés à la diète. Cet homme n'avait jamais voulu se marier; il
avait un assez joli sérail. Il ne reconnut aucun de ses parents, vécut dans la
crapule, et mourut à Paris d'indigestion. C'était un homme, comme on voit, fort
utile à l'Etat.
Notre nouveau philosophe fut obligé d'aller à Paris pour recueillir l'héritage
de son parent. D'abord les fermiers du domaine le lui disputèrent. Il eut le
bonheur de gagner son procès, et la générosité de donner aux pauvres de son
canton, qui n'avaient pas leur contingent de quarante écus de rente, une partie
des dépouilles du richard. Après quoi il se mit à satisfaire sa grande passion
d'avoir une bibliothèque.
Il lisait tous les matins, faisait des extraits, et le soir il consultait les
savants pour savoir en quelle langue le serpent avait parlé à notre bonne mère;
si l'âme est dans le corps calleux ou dans la glande pinéale; si St. Pierre
avait demeuré vingt-cinq ans à Rome; quelle différence spécifique est entre un
trône et une domination, et pourquoi les nègres ont le nez épaté. D'ailleurs il
se proposa de ne jamais gouverner l'Etat, et de ne faire aucune brochure contre
les pièces nouvelles. On l'appelait monsieur André; c'était son nom de baptême.
Ceux qui l'ont connu rendent justice à sa modestie et à ses qualités, tant
acquises que naturelles. Il a bâti une maison commode dans son ancien domaine de
quatre arpents. Son fils sera bientôt en âge d'aller au collège; mais il veut
qu'il aille au collège d'Harcourt, et non à celui de Mazarin, à cause du
professeur Cogé, qui fait des libelles, et parce qu'il ne faut pas qu'un
professeur de collège fasse des libelles.
Madame André lui a donné une fille fort jolie, qu'il espère marier à un
conseiller de la cour des aides, pourvu que ce magistrat n'ait pas la maladie
que le chirurgien-major veut extirper dans l'Europe chrétienne.
GRANDE QUERELLE
Pendant le séjour de monsieur André à Paris, il y eut une querelle importante.
Il s'agissait de savoir si Marc-Antonin était un honnête homme, et s'il était en
enfer ou en purgatoire, ou dans les limbes, en attendant qu'il ressuscitât. Tous
les honnêtes gens prirent le parti de Marc-Antonin. Ils disaient : Antonin a
toujours été juste, sobre, chaste, bienfaisant. Il est vrai qu'il n'a pas en
paradis une place aussi belle que St. Antoine; car il faut des proportions,
comme nous l'avons vu; mais certainement l'âme de l'empereur Antonin n'est point
à la broche dans l'enfer. Si elle est en purgatoire, il faut l'en tirer; il n'y
a qu'à dire des messes pour lui. Les jésuites n'ont plus rien à faire; qu'ils
disent trois mille messes pour le repos de l'âme de Marc-Antonin; ils y
gagneront, à quinze sous la pièce, deux mille deux cent cinquante livres.
D'ailleurs, on doit du respect à une tête couronnée; il ne faut pas la damner
légèrement.
Les adversaires de ces bonnes gens prétendaient au contraire qu'il ne fallait
accorder aucune composition à Marc-Antonin; qu'il était un hérétique; que les
carpocratiens et les aloges n'étaient pas si méchants que lui; qu'il était mort
sans confession; qu'il fallait faire un exemple; qu'il était bon de le damner
pour apprendre à vivre aux empereurs de la Chine et du Japon, à ceux de Perse,
de Turquie et de Maroc, aux rois d'Angleterre, de Suède, de Danemark, de Prusse,
au stathouder de Hollande, et aux avoyés du canton de Berne, qui n'allaient pas
plus à confesse que l'empereur Marc-Antonin; et qu'enfin c'est un plaisir
indicible de donner des décrets contre des souverains morts, quand on ne peut en
lancer contre eux de leur vivant, de peur de perdre ses oreilles.
La querelle devint aussi sérieuse que le fut autrefois celle des Ursulines et
des Annonciades, qui disputèrent à qui porterait plus longtemps des œufs à la
coque entre les fesses sans les casser. On craignit un schisme, comme du temps
des cent et un contes de ma mère l'oie, et de certains billets payables au
porteur dans l'autre monde. C'est une chose bien épouvantable qu'un schisme:
cela signifie division dans les opinions, et, jusqu'à ce moment fatal, tous les
hommes avaient pensé de même.
Monsieur André, qui est un excellent citoyen, pria les chefs des deux partis à
souper. C'est un des bons convives que nous ayons; son humeur est douce et vive,
sa gaieté n'est point bruyante; il est facile et ouvert; il n'a point cette
sorte d'esprit qui semble vouloir étouffer celui des autres; l'autorité qu'il se
concilie n'est due qu'à ses grâces, à sa modération, et à une physionomie ronde
qui est tout à fait persuasive. Il aurait fait souper gaiement ensemble un Corse
et un Génois, un représentant de Genève et un négatif, le muphti et un
archevêque. Il fit tomber habilement les premiers coups que les disputants se
portaient, en détournant la conversation, et en faisant un conte très agréable
qui réjouit également les damnants et les damnés. Enfin, quand ils furent un peu
en pointe de vin, il leur fit signer que l'âme de l'empereur Marc-Antonin
resterait in statu quo, c'est-à-dire je ne sais où, en attendant un jugement définitif.
Les âmes des docteurs s'en retournèrent dans leurs limbes paisiblement après le
souper : tout fut tranquille. Cet accommodement fit un très grand honneur à
l'homme aux quarante écus; et toutes les fois qu'il s'élevait une dispute bien
acariâtre, bien virulente entre des gens lettrés ou non lettrés, on disait aux
deux partis: "Messieurs, allez souper chez monsieur André."
Je connais deux factions acharnées qui, faute d'avoir été souper chez monsieur
André, se sont attiré de grands malheurs.
SCÉLÉRAT CHASSÉ
La réputation qu'avait acquise monsieur André d'apaiser les querelles en donnant
de bons soupers lui attira, la semaine passée, une singulière visite. Un homme
noir, assez mal mis, le dos voûté, la tête penchée sur une épaule, l'œil hagard,
les mains fort sales, vint le conjurer de lui donner à souper avec ses ennemis.
Quels sont vos ennemis, lui dit monsieur André, et qui êtes-vous ? - Hélas!
dit-il, j'avoue, monsieur, qu'on me prend pour un de ces maroufles qui font des
libelles pour gagner du pain, et qui crient: Dieu, Dieu, Dieu, religion,
religion, pour attraper quelque petit bénéfice. On m'accuse d'avoir calomnié les
citoyens les plus véritablement religieux, les plus sincères adorateurs de la
Divinité, les plus honnêtes gens du royaume. Il est vrai, monsieur, que, dans la
chaleur de la composition, il échappe souvent aux gens de mon métier de petites
inadvertances qu'on prend pour des erreurs grossières, des écarts que l'on
qualifie de mensonges impudents. Notre zèle est regardé comme un mélange affreux
de friponnerie et de fanatisme. On assure que tandis que nous surprenons la
bonne foi de quelques vieilles imbéciles, nous sommes le mépris et l'exécration
de tous les honnêtes gens qui savent lire.
" Mes ennemis sont les principaux membres des plus illustres académies de
l'Europe, des écrivains honorés, des citoyens bienfaisants. Je viens de mettre
en lumière un ouvrage que j'ai intitulé Antiphilosophique. Je n'avais que de
bonnes intentions mais personne n'a voulu acheter mon livre. Ceux à qui je l'ai
présenté l'ont jeté dans le feu, en me disant qu'il n'était pas seulement
antiraisonnable, mais antichrétien et très anti honnête.
- Eh bien! lui dit monsieur André, imitez ceux à qui vous avez présenté votre
libelle; jetez-le dans le feu, et qu'il n'en soit plus parlé. Je loue fort votre
repentir; mais il n'est pas possible que je vous fasse souper avec des gens
d'esprit qui ne peuvent être vos ennemis, attendu qu'ils ne vous liront jamais.
- Ne pourriez-vous pas du moins, monsieur, dit le cafard, me réconcilier avec
les parents de feu monsieur de Montesquieu, dont j'ai outragé la mémoire pour
glorifier le révérend père Routh, qui vint assiéger ses derniers moments, et qui
fut chassé de sa chambre?
- Morbleu lui dit monsieur André, il y a longtemps que le révérend père Routh
est mort allez-vous-en souper avec lui."
C'est un rude homme que monsieur André, quand il a affaire à cette espèce
méchante et sotte. Il sentit que le cafard ne voulait souper chez lui avec des
gens de mérite que pour engager une dispute, pour les aller ensuite calomnier,
pour écrire contre eux, pour imprimer de nouveaux mensonges. Il le chassa de sa
maison comme on avait chassé Routh de l'appartement du président de Montesquieu.
On ne peut guère tromper monsieur André. Plus il était simple et naïf quand il
était l'homme aux quarante écus, plus il est devenu avisé quand il a connu les
hommes.
LE BON SENS DE MONSIEUR ANDRÉ
Comme le bon sens de monsieur André s'est fortifié depuis qu'il a une
bibliothèque! Il vit avec les livres comme avec les hommes; il choisit; et il
n'est jamais la dupe des noms. Quel plaisir de s 'instruire et d'agrandir son
âme pour un écu, sans sortir de chez soi!
Il se félicite d'être né dans un temps où la raison humaine commence à se
perfectionner.
" Que je serais malheureux, dit-il, Si l'âge où je vis était celui du jésuite
Garasse, du jésuite Guignard, ou du docteur Boucher, du docteur Aubry, du
docteur Guincestre, ou du temps que l'on condamnait aux galères ceux qui
écrivaient contre les catégories d'Aristote."
La misère avait affaibli les ressorts de l'âme de monsieur André, le bien-être
leur a rendu leur élasticité. Il y a mille Andrés dans le monde auxquels il n'a
manqué qu'un tour de roue de la fortune pour en faire des hommes d'un vrai
mérite.
Il est aujourd'hui au fait de toutes les affaires de l'Europe, et surtout des
progrès de l'esprit humain.
" Il me semble, me disait-il mardi dernier, que la Raison voyage à petites
journées, du nord au midi, avec ses deux intimes amies, l'Expérience et la
Tolérance. L'Agriculture et le Commerce l'accompagnent. Elle s'est présentée en
Italie; mais la Congrégation de l'Indice l'a repoussée. Tout ce qu'elle a pu
faire a été d'envoyer secrètement quelques-uns de ses facteurs, qui ne laissent
pas de faire du bien. Encore quelques années, et le pays des Scipion ne sera
plus celui des Arlequins enfroqués.
" Elle a de temps en temps de cruels ennemis en France; mais elle y a tant
d'amis qu'il faudra bien à la fin qu'elle y soit premier ministre.
" Quand elle s'est présentée en Bavière et en Autriche, elle a trouvé deux ou
trois grosses têtes à perruque qui l'ont regardée avec des yeux stupides et
étonnés. Ils lui ont dit: " Madame, nous n'avons jamais entendu parler de vous;
nous ne vous connaissons pas. - Messieurs, leur a-t-elle répondu, avec le temps
vous me connaîtrez et vous m'aimerez. Je suis três bien reçue à Berlin, à
Moscou, à Copenhague, à Stockholm. Il y a longtemps que, par le crédit de Locke,
de Gordon, de Trenchard, de milord Shaftesbury, et de tant d'autres, j'ai reçu
mes lettres de naturalité en Angleterre. Vous m'en accorderez un jour. Je suis
la fille du Temps, et j'attends tout de mon père."
" Quand elle a passé sur les frontières de l'Espagne et du Portugal, elle a béni
Dieu de voir que les bûchers de I' Inquisition n'étaient plus si souvent
allumés; elle a espéré beaucoup en voyant chasser les jésuites, mais elle a
craint qu'en purgeant le pays de renards on ne le laissât exposé aux loups.
" Si elle fait encore des tentatives pour entrer en Italie, on croit qu'elle
commencera par s'établir à Venise, et qu'elle séjournera dans le royaume de
Naples, malgré toutes les liquéfactions de ce pays-là, qui lui donnent des
vapeurs. On prétend qu'elle a un secret infaillible pour détacher les cordons
d'une couronne qui sont embarrassés, je ne sais comment, dans ceux d'une tiare,
et pour empêcher les haquenées d'aller faire la révérence aux mules. "
Enfin la conversation de monsieur André me réjouit beaucoup; et plus je le vois, plus je l'aime.
D'UN BON SOUPER CHEZ MONSIEUR ANDRÉ
Nous soupâmes hier ensemble avec un docteur de Sorbonne, monsieur Pinto, célèbre
juif, le chapelain de la chapelle réformée de l'ambassadeur batave, le
secrétaire de monsieur le prince Gallitzin, du rite grec, un capitaine suisse
calviniste, deux philosophes, et trois dames d'esprit. Le souper fut fort long,
et cependant on ne disputa pas plus sur la religion que si aucun des convives
n'en avait jamais eu : tant il faut avouer que nous sommes devenus polis; tant
on craint à souper de contrister ses frères! Il n'en est pas ainsi du régent
Cogé, et de l'ex-jésuite Nonotte, et de l'ex-jésuite Patouillet, et de
l'ex-jésuite Rotalier, et de tous les animaux de cette espèce. Ces croquants-là
vous disent plus de sottises dans une brochure de deux pages que la meilleure
compagnie de Paris ne peut dire de choses agréables et instructives dans un
souper de quatre heures. Et, ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'ils n'oseraient
dire en face à personne ce qu'ils ont l'impudence d'imprimer.
La conversation roula d'abord sur une plaisanterie des Lettres persanes, dans
laquelle on répète, d'après plusieurs graves personnages, que le monde va non
seulement en empirant, mais en se dépeuplant tous les jours; de sorte que si le
proverbe plus on est de fous, plus on rit a quelque vérité, le rire sera
incessamment banni de la terre.
Le docteur de Sorbonne assura qu'en effet le monde était réduit presque à rien,
Il cita le père Petau, qui démontre qu'en moins de trois cents ans un seul des
fils de Noé (je ne sais si c'est Sem ou Japhet) avait procréé de son corps une
série d'enfants qui se montait à six cent vingt-trois milliards six cent douze
millions trois cent cinquante-huit mille fidèles, l'an 285 après le déluge
universel.
Monsieur André demanda pourquoi, du temps de Philippe le Bel, c'est-à-dire
environ trois cents ans après Hugues Capet, il n'y avait pas six cent
vingt-trois milliards de princes de la maison royale? " C'est que la foi est
diminuée", dit le docteur de Sorbonne.
On parla beaucoup de Thèbes-aux-cent-portes, et du million de soldats qui
sortait par ces portes avec vingt mille chariots de guerre. " Serrez, serrez,
disait monsieur André; je soupçonne, depuis que je me suis mis à lire, que le
même génie qui a écrit Gargantua écrivait autrefois toutes les histoires.
- Mais enfin, lui dit un des convives, Thèbes, Memphis, Babylone, Ninive, Troie,
Séleucie, étaient de grandes villes, et n'existent plus. - Cela est vrai,
répondit le secrétaire de monsieur le prince Gallitzin; mais Moscou,
Constantinople, Londres, Paris, Amsterdam, Lyon qui vaut mieux que Troie,
toutes les villes de France, d'Allemagne, d'Espagne, et du Nord, étaient alors
des déserts. "
Le capitaine Suisse, homme très instruit, nous avoua que quand ses ancêtres
voulurent quitter leurs montagnes et leurs précipices pour aller s'emparer,
comme de raison, d'un pays plus agréable, César, qui vit de ses yeux le
dénombrement de ces émigrants, trouva qu'il se montait à trois cent soixante et
huit mille, en comptant les vieillards, les enfants, et les femmes. Aujourd'hui,
le seul canton de Berne possède autant d'habitants : il n'est pas tout à fait la
moitié de la Suisse, et je puis vous assurer que les treize cantons ont au-delà
de sept cent vingt mille âmes, en comptant les natifs qui servent ou qui
négocient en pays étrangers. Après cela, messieurs les savants, faites des
calculs et des systèmes, ils seront aussi faux les uns que les autres.
Ensuite on agita la question si les bourgeois de Rome, du temps des Césars,
étaient plus riches que les bourgeois de Paris, du temps de monsieur Silhouette.
" Ah! ceci me regarde, dit monsieur André. J'ai été longtemps l'homme aux
quarante écus; je crois bien que les citoyens romains en avaient davantage. Ces
illustres voleurs de grand chemin avaient pillé les plus beaux pays de l'Asie,
de l'Afrique, et de l'Europe. Ils vivaient fort splendidement du fruit de leurs
rapines; mais enfin il y avait des gueux à Rome. Et je suis persuadé que parmi
ces vainqueurs du monde il y eut des gens réduits à quarante écus de rente comme
je l'ai été.
- Savez-vous bien, lui dit un savant de l'Académie des inscriptions et belles
lettres, que Lucullus dépensait, à chaque souper qu'il donnait dans le salon
d'Apollon, trente-neuf mille trois cent soixante et douze livres treize sous de
notre monnaie courante? mais qu'Atticus, le célèbre épicurien Atticus, ne
dépensait point par mois, pour sa table, au-delà de deux cent trente-cinq livres
tournois?
-Si cela est, dis-je, il était digne de présider à la confrérie de la lésine,
établie depuis peu en Italie. J'ai lu comme vous, dans Florus, cette incroyable
anecdote; mais apparemment que Florus n'avait jamais soupé chez Atticus, ou que
son texte a été corrompu, comme tant d'autres, par les copistes. Jamais Florus
ne me fera croire que l'ami de César et de Pompée, de Cicéron et d'Antoine, qui
mangeaient souvent chez lui, en fût quitte pour un peu moins de dix louis d'or
par mois.
Et voilà justement comme on écrit l'histoire.
Madame André, prenant la parole, dit au savant que, s'il voulait défrayer sa
table pour dix fois autant, il lui ferait grand plaisir.
Je suis persuadé que cette soirée de monsieur André valait bien un mois d'Atticus;
et les dames doutèrent fort que les soupers de Rome fussent plus agréables que
ceux de Paris. La conversation fut très gaie, quoique un peu savante. Il ne fut
parlé ni des modes nouvelles, ni des ridicules d'autrui, ni de l'histoire
scandaleuse du jour.
La question du luxe fut traitée à fond. On demanda si c'était le luxe qui avait
détruit l'empire romain, et il fut prouvé que les deux empires d'Occident et
d'Orient n'avaient été détruits que par la controverse et par les moines. En
effet, quand Alaric prit Rome, on n'était occupé que de disputes théologiques;
et quand Mahomet II prit Constantinople, les moines défendaient beaucoup plus
l'éternité de la lumière du Tabor, qu'ils voyaient à leur nombril, qu'ils ne
défendaient la ville contre les Turcs.
Un de nos savants fit une réflexion qui me frappa beaucoup : c'est que ces deux
grands empires sont anéantis, et que les ouvrages de Virgile, d'Horace, et
d'Ovide, subsistent.
On ne fit qu'un saut du siècle d'Auguste au siècle de Louis XIV. Une dame
demanda pourquoi, avec beaucoup d'esprit, on ne faisait plus guère aujourd'hui
d'ouvrages de génie?
Monsieur André répondit que c'est parce qu'on en avait fait dans le siècle
passé. Cette idée était fine et pourtant vraie; elle fut approfondie. Ensuite on
tomba rudement sur un Ecossais, qui s'est avisé de donner des règles de goût et
de critiquer les plus admirables endroits de Racine sans savoir le français
(1) On traita encore plus sévèrement un Italien nommé
Denina, qui a dénigré l'Esprit des lois sans le comprendre, et qui surtout a
censuré ce que l'on aime le mieux dans cet ouvrage.
Cela fit souvenir du mépris affecté que Boileau étalait Pour le Tasse. Quelqu'un
des convives avança que le Tasse, avec ses défauts, était autant au-dessus
d'Homère, que Montesquieu, avec ses défauts encore plus grands, est au-dessus du
fatras de Grotius. On s'éleva contre ces mauvaises critiques, dictées par la
haine nationale et le préjugé. Le signor Denina fut traité comme il le méritait,
et comme les pédants le sont par les gens d'esprit.
On remarqua surtout avec beaucoup de sagacité que la plupart des ouvrages
littéraires du siècle présent, ainsi que les conversations, roulent sur l'examen
des chefs-d'œuvre du dernier siècle. Notre mérite est de discuter leur mérite.
Nous sommes comme des enfants déshérités qui font le compte du bien de leurs
pères. On avoua que la philosophie avait fait de très grands progrès; mais que
la langue et le style s'étaient un peu corrompus.
C'est le sort de toutes les conversations de passer d'un sujet à un autre. Tous
ces objets de curiosité, de science, et de goût disparurent bientôt devant le
grand spectacle que l'impératrice de Russie et le roi de Pologne donnaient au
monde. Ils venaient de relever l'humanité écrasée, et d'établir la liberté de
conscience dans une partie de la terre beaucoup plus vaste que ne le fut jamais
l'empire romain. Ce service rendu au genre humain, cet exemple donné à tant de
cours qui se croient politiques, fut célébré comme il devait l'être. On but à la
santé de l'impératrice, du roi philosophe, et du primat philosophe, et on leur
souhaita beaucoup d'imitateurs. Le docteur de Sorbonne même les admira: car il y
a quelques gens de bon sens dans ce corps, comme il y eut autrefois des gens
d'esprit chez les Béotiens.
Le secrétaire russe nous étonna par le récit de tous les grands établissements
qu'on faisait en Russie. On demanda pourquoi on aimait mieux lire l'histoire de
Charles XII, qui a passé sa vie à détruire, que celle de Pierre le Grand, qui a
consumé la sienne à créer. Nous conclûmes que la faiblesse et la frivolité sont
la cause de cette préférence; que Charles XII fut le don Quichotte du Nord, et
que Pierre en fut le Solon; que les esprits superficiels préfèrent l'héroïsme
extravagant aux grandes vues d'un législateur; que les détails de la fondation
d'une ville leur plaisent moins que la témérité d'un homme qui brave dix mille
Turcs avec ses seuls domestiques; et qu'enfin la plupart des lecteurs aiment
mieux s'amuser que s'instruire. De là vient que cent femmes lisent les Mille et
une Nuits contre une qui lit deux chapitres de Locke.
De quoi ne parla-t-on point dans ce repas, dont je me souviendrai longtemps! Il
fallut bien enfin dire un mot des acteurs et des actrices, sujet éternel des
entretiens de table de Versailles et de Paris. On convint qu'un bon déclamateur
était aussi rare qu'un bon poète. Le souper finit par une chanson très jolie
qu'un des convives fit pour les dames. Pour moi, j'avoue que le banquet de
Platon ne m'aurait pas fait plus de plaisir que celui de monsieur et de madame André.
Nos petits-maîtres et nos petites-maîtresses s'y seraient ennuyés sans doute:
ils prétendent être la bonne compagnie; mais ni monsieur André ni moi ne soupons
jamais avec cette bonne compagnie-là.
(1) Ce Monsieur Home, grand juge d'Ecosse, enseigne la manière de faire parler
les héros d'une tragédie avec esprit; et voici un exemple remarquable qu'il
rapporte de la tragédie de Henri IV, du divin Shakespeare. Le divin Shakespeare
introduit milord Falstaff, chef de justice, qui vient de prendre prisonnier le
chevalier Jean Coleville, et qui le présente au roi:
"Sire, le voilà, je vous le livre; je supplie Votre Grâce de faire enregistrer
ce fait d'armes parmi les autres de cette journée, ou pardieu je le ferai mettre
dans une ballade avec mon portrait à la tête; on verra Coleville me baisant les
pieds. Voilà ce que je ferai si vous ne rendez pas ma gloire aussi brillante
qu'une pièce de deux sous dorée; et alors, vous me verrez, dans le clair ciel de
la renommée, ternir votre splendeur comme la pleine lune efface les charbons
éteints de l'élément de l'air, qui ne paraissent autour d'elle que comme des têtes d'épingles."
C'est cet absurde et abominable galimatias, très fréquent dans le divin
Shakespeare, que Monsieur Jean Home propose pour le modèle du bon goût et de
l'esprit dans la tragédie. Mais en récompense Monsieur Home trouve l'Iphigénie
et la Phèdre de Racine extrêmement ridicules.
Le jeune Candide, dont le nom traduit à la fois la naïveté et la crédulité vit dans le "meilleur des mondes possibles" chez son oncle, le baron de Thunder-ten-Tronckh.
Enfant naturel, Candide mène une existence heureuse dans cet univers idyllique : Le baron et la baronne de Thunder-ten-Tronckh possèdent en effet "le plus beau des châteaux". Candide est ébloui par la puissance de son oncle, et par les sophismes lénifiants du docteur Pangloss, le précepteur. Il admire également Cunégonde, la fille du baron. Tout bascule le jour des premiers ébats de Candide et de Cunégonde. La réaction du baron est brutale, Candide est banni et chassé de cet Eden. Il se retrouve dans "le vaste monde".
Candide est pris dans une tempête de neige et connaît la faim et le froid. Il est enrôlé de force comme soldat de l'armée bulgare. Il prend la fuite. Capturé, il est condamné à recevoir quatre mille coups de bâton. Il échappe de justesse à la mort. Il assiste alors à la guerre et à ses massacres : c'est "une boucherie héroïque". Candide déserte et fuit jusqu'en Hollande. Il y découvre l'intolérance, et notamment l'hypocrisie sectaire d'un prédicateur huguenot. Il retrouve Pangloss rongé par la vérole. Son ancien précepteur a des allures de gueux. Il lui apprend que le beau château du baron Thunder-ten-Tronckh a été détruit et que Cunégonde a été violée et éventrée par les soldats bulgares. L'armée bulgare a également tué le baron, la baronne et leur fils. Candide et Pangloss sont recueillis et embauchés par Jacques, un bon anabaptiste qui les emmène au Portugal où le réclame son commerce. Hélas, au large de Lisbonne, leur navire connaît une horrible tempête. Le bateau du généreux négociant est englouti et ce dernier périt dans le naufrage. Candide et Pangloss en réchappent par miracle. Dès leur arrivée à Lisbonne, se produit un épouvantable tremblement de terre. Candide et Pangloss participent aux opérations de sauvetage, mais nos deux héros sont arrêtés pour propos subversifs et déférés à l'Inquisition. Pangloss est pendu et Candide flagellé. Une vieille dame le soigne et le mène de nuit dans une maison isolée. Il est présenté à une superbe femme : Cunégonde. Elle lui confirme qu'elle a été violée et éventrée, et que c'est par miracle qu'elle est encore en vie : "on ne meurt pas toujours de ces deux accidents". Cunégonde est devenue à la fois la maîtresse de Don Issachar, un banquier juif et du grand inquisiteur de Lisbonne. Menacé par ses deux rivaux, "le doux Candide", parvient à les tuer. Candide, Cunégonde et la vieille dame s'enfuient alors en direction de Cadix. Ils arrivent à Cadix au moment où un bateau s'apprête à partir en Amérique latine. Son équipage est chargé d'aller y combattre la rébellion qui règne contre les rois d'Espagne et du Portugal. Candide parvient à se faire engager. Il embarque avec Cunégonde, la vieille dame et deux valets. Lors de la traversée, la vieille dame raconte son aventure. Fille d'un pape et d'une princesse, elle a grandi " en beauté, en grâces, en talents, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances..." Puis elle a connu une suite épouvantable de malheurs : l'empoisonnement de son fiancé, l'enlèvement de sa mère, sa vente à des marchands d'esclaves. Elle s'est retrouvée prisonnière dans un fort, puis elle est devenue l'esclave d'un seigneur moscovite qui l'a battue. Elle finira par devenir la servante de Don Issachar qui la met à disposition de Cunégonde à qui elle se lie.
Suite à ce récit, la vieille dame demande aux autres passagers de raconter leur histoire. Les récits s'enchaînent, plus noirs les uns que les autres. Candide commence à prendre conscience que le mal existe sur cette terre.
A peine arrivés à Buenos Aires, Candide et Cunégonde sont à nouveau séparés. La vielle dame conseille en effet à Cunégonde de rester auprès du gouverneur qui s'est épris d'elle et à Candide de fuir l'Inquisition qui a retrouvé sa trace. Candide part avec son valet Cacambo se réfugier chez les jésuites du Paraguay. Ils y retrouvent le frère de Cunégonde, lui aussi miraculeusement rescapé. Le baron évoque son miracle : Alors qu'on allait l'enterrer, le battement de sa paupière l'a sauvé. On l'a soigné et guéri. Sa beauté, fort appréciée, lui a valu une grande fortune. Mais le jeune baron refuse qu'un bâtard puisse épouser sa sœur et frappe Candide du plat de son épée. Celui-ci se défend et le tue d'un coup d'épée.
Candide et Cacambo reprennent la fuite et se retrouvent dans un pays inconnu. Il sont faits prisonniers par les indigènes et sont à deux doigts d'être mangés. Ils ne doivent leur salut qu'à la verve et à l'habileté de Cacambo. Ils sont graciés.
Ils se dirigent alors vers Cayenne, à la recherche de la colonie française. Ils souffrent de la faim. Un jour, ils découvrent un canot sur une rivière. Ils montent à bord et se laissent porter par le courant. Le canot emprunte une voûte secrète. Candide et Cacambo se retrouvent sous terre, dans une magnifique contrée, l'Eldorado, "le pays où tout va bien" : un pays où les repas sont délicieux, les mœurs pacifiques, la population heureuse , la religion tolérante et le souverain humaniste. Mais nos héros sont trop vaniteux pour se satisfaire de cet univers idéal. Ils souhaitent revenir en Europe avec l'espoir d'éblouir Cunégonde et le monde entier de leur récit et de leur richesse. Le souverain du royaume en effet les laisse partir avec cent moutons chargés de nourriture, de pierres précieuses et d'or. Il les met aussi en garde : le bonheur ne se trouve ni dans les pierres précieuses ni dans l'or.
Candide et Cacambo retrouvent le monde. Pendant plus de trois mois, ils marchent dans les marais, les déserts et au bord des précipices. Leurs moutons meurent les uns après les autres. Lorsqu'ils arrivent à Surinam, ils n'ont plus que deux moutons. Ils rencontrent alors un esclave noir atrocement mutilé. Ceci révolte Candide et l'amène à donner une autre définition de l'optimisme : "la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal".
Nos deux héros se séparent : Candide envoie Cacambo racheter Cunégonde au gouverneur de Buenos Aires , tandis qu'il ira l'attendre à Venise.
Mais Candide se fait duper et voler par un marchand qui lui prend ses deux derniers moutons et s'embarque pour Venise sans l'attendre. Il parvient finalement à trouver un vaisseau en partance pour Bordeaux et s'embarque en compagnie d'un pauvre savant persécuté à qui il paye son voyage. Il a l'espoir que ce compagnon puisse le "désennuyer" durant le traversée.
Sur le bateau qui les emmène à Bordeaux Candide et Martin, le savant discutent du bien et du mal et de la nature de l'homme. Martin lui indique qu'il est convaincu de la prédominance du Mal sur le Bien. Et comme pour illustrer son propos, ils assistent un combat entre un navire espagnol et un vaisseau hollandais. Ce dernier coule et une centaine d'hommes se noient. Ce combat est pour Martin l'illustration des rapports humains de la façon dont "les hommes se traitent les uns les autres."
Après son arrivée à Bordeaux, Candide préfère se rendre à Paris qu'à Venise. Il n'y connaît qu'amertume et déception : un abbé retors et de fausses marquises et une fausse Cunégonde qui se révèlent être de vraies voleuses. Il se fait même injustement arrêter et ne parvient à s'enfuir qu'en soudoyant un officier de police.
Il embarque alors en compagnie de Martin pour l'Angleterre. Il assiste à l'exécution d'un amiral condamné pour "n'avoir pas fait tuer assez de monde." Finalement, il refuse de débarquer en Angleterre et demande au capitaine du bateau de l'emmener directement à Venise.
A Venise, il ne retrouve ni Cacambo, ni Cunégonde mais tombe sur Paquette, l'ancienne suivante de la Baronne de Thunder-ten-Tronckh. Elle vit en compagnie d'un moine, Giroflée. Ses confidences et celles du moine font apparaître à Candide des misères cachées. Candide décide alors de rendre visite au seigneur Pococurante qui a la réputation de n'avoir jamais eu de chagrin.
Le jeune héros s'émerveille de l'univers et de la personnalité de son hôte. Pourtant celui-ci évoque a demi-mot le dégoût et la lassitude du blasé. Candide ressort pourtant de cet entretien avec l'impression que le seigneur Pococurante est "le plus heureux de tous les hommes", car affranchi des biens matériels. Martin, lui, est plus pessimiste, il estime que ce seigneur est écœuré de tout ce qu'il possède.
Au milieu d'un souper de carnaval, alors que Candide dîne avec six malheureux anciens rois qui ont perdu leur royaume, il retrouve Cacambo qui est devenu esclave. Il lui apprend que Cunégonde l'attend sur les bords de la Propontide, près de Constantinople. Elle aussi est devenue esclave et est devenue très laide.
Candide se rend à Constantinople . Sur la galère, il croit reconnaître parmi les galériens le docteur Pangloss et le jeune baron (tous deux mal tués). Il les rachète au capitaine du navire.
Les deux anciens galériens racontent leurs aventures, mais le récit de leur malheurs ne perturbe pas Candide qui est toujours convaincu que " tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes."
Candide retrouve Cunégonde, et il est saisi d'horreur à la vue de cette femme hideuse et défigurée. Il la rachète ainsi que la vieille femme. Il ne l'aime plus, mais l'épouse "par bonté" malgré le refus répété de son frère.
Candide se débarrasse du jeune baron en le renvoyant aux galères. Il achète avec ses derniers diamants une modeste métairie où viennent se réfugier Paquette, le frère Giroflée, Pangloss, Martin, Cunégonde et Candide. Un sage vieillard leur conseille le travail qui "éloigne de nous trois grand maux, l'ennui, le vice et le besoin".
Candide en arrive à cette conclusion qui recueille l'assentiment de tous ses compagnons : " il faut cultiver son jardin."
Le conte décrit la visite de la Terre par un être de 32 mètres de haut, venue d'une planète de l'étoile Syrius nommé Micromégas et de son compagnon de la planète Saturne.
Chapitre 1:
Le narrateur est un habitant de la planète "Terre": "dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petit fourmilière". Ce narrateur va nous décrire un habitant de l'étoile Sirius nommé Micromégas. Très cultivé, celui-ci est un être qui mesure plus de deux mille pieds. Il fut contraint à l'exil et voyagea beaucoup. Il arrive sur la planète Saturne et fait la connaissance d'un Saturnien qui s'avère être le "Secrétaire de l'Académie de Saturne".
Chapitre 2:
Ce chapitre retranscrit la conversation entre Micromégas et le Saturnien. Ils débattent sur différents sujets et décident alors de faire un petit voyage philosophique ensemble.
Chapitre 3:
Au cours de leur voyage, ils vont sur Jupiter. Ils y restent une année. Ils continuent ensuite leur voyage, par Mars pour enfin arriver sur la Terre.
Chapitre 4:
Sur Terre, ils font le tour du globe. Leur grande taille limite la durée du tour du monde à 36 heures. Pour eux la Terre est une planète très petite. Ensuite ils veulent savoir si le globe est habité. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Après quelques recherches, le Saturnien a conclu qu'il n'y a pas de présence humaine. Mais Micromégas soutient le contraire. Il prend un microscope et observe plus précisément la Terre. Il aperçoit d'abord une baleine puis un bateau rempli de philosophes. Les deux voyageurs les prennent pour des atomes en raison de leurs tailles minuscules par rapport à eux.
Chapitre 5:
Ils décident alors de prendre le bateau délicatement et de l’observer plus attentivement. Dans leur allégresse d'avoir trouver des hommes, le Saturnien pense qu'ils se reproduisent.
Chapitre 6:
Micromégas le corrige sur ce fait. Ils se rendent compte qu'ils se parlent. Les deux voyageurs sont surpris. Comment un être pareil peut-il parler si ils n'ont pas d'âmes ? Ils écoutent les hommes et sont surpris d'entendre des hommes parler avec un langage aussi complexe que le leur. Le Saturnien décide alors de leur parler ce qui affolent les naufragés. Puis l'un des philosophes commence à tenter de parler au Saturnien.
Chapitre 7:
Ce chapitre est la conversation entre les hommes et les voyageurs. Les hommes expliquent à leurs interlocuteurs qu'ils ne sont pas si heureux malgré leur savoir. Les philosophes leurs expliquent alors que les hommes s’entre-tuent. Ils les comparent même à des animaux. Ils constatent que les guerres sont la cause de "barbares sédentaires qui, du fond de leur cabinet, ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre d'un million d'hommes". Après ces explications, Micromégas et le Saturnien leur posent des questions pour évaluer leur degré de connaissance. Le Sirien est surpris du grand orgueil que peuvent avoir des êtres infiniment petits. Avant son départ, il leur donne un livre.
Quand les philosophes le présentent à l'Académie des Sciences à Paris, le livre est blanc sans aucune écriture.
A Babylone, Zadig est un jeune homme comblé par la nature. Il est jeune, riche et beau. Il aime passionnément Sémire et est sur le point de l’épouser. Zadig, optimiste, est persuadé que le bonheur est possible. Hélas, il ne va enchaîner que désillusion sur désillusion.
Orcan , jaloux de l’amour entre Zadig et Sémire souhaite faire enlever cette dernière. Zadig prend la défense de sa bien-aimée. Il parvient à chasser les ravisseurs mais est gravement blessé à l’œil.
Durant sa convalescence, Sémire l’abandonne pour épouser Orcan. Zadig se réfugie dans les bras d’Azora, mais celle-ci se montre infidèle.
Déçu, Zadig décide de se consacrer à l’étude des sciences. Mais cette nouvelle activité ne va lui causer que des ennuis. Ses connaissances et la pertinence de son analyse lui valent de se retrouver en prison. Libéré, il essaye de se consoler en s’adonnant à la philosophie. Il reçoit chez lui les savants de Babylone. Mais ce succès suscite la jalousie du courtisan Arimaze, qui le fait incarcérer.
Innocenté, Zadig est libéré. Il devient le favori du roi et de la reine. Tout semble lui sourire, mais son sort semble dépendre du hasard. Il est nommé premier ministre du roi Moabdar et réussit à mettre en œuvre une politique éclairée. Hélas, c’est son bonheur qui va causer son malheur. Il tombe amoureux de la reine Astarté qui se montre sensible à ses sentiments. Menacé de mort, Zadig doit quitter Babylone.
Commence alors pour lui une période d’errance. Sur le chemin de l’Egypte, il porte secours à une femme battue par un égyptien. Il tue celui-ci. Alors arrêté comme meurtrier, il est vendu comme esclave.
Grâce à son habileté, sa science et sa sagesse, il devient l’ami de son maître Sétoc. Zadig parvient ensuite à faire abolir une coutume barbare appelée «le bûcher des veuves». Mais cette réforme lui vaut la haine des prêtres. Lors d‘un souper à Bassora, réunissant des convives de divers pays, les invités se querellent pour d’obscures questions de rites. Zadig parvient à les réconcilier en leur prouvant qu’ils sont tous du même avis et qu’ils adorent le même Dieu.
Mais les prêtres qui n’ont toujours pas accepté la réforme du «bûcher des veuves» parviennent à le faire condamner. Il échappe à la mort grâce à l’intervention d’Almona, une veuve qu’il a naguère sauvée du bûcher.
Setoc épouse Almona et Zadig envisage de rentrer à Babylone afin de revoir Astarté. En route, il est fait prisonnier par le brigand Argobad. Ce dernier lui apprend qu’une rébellion a éclaté à Babylone et que Moabdar est mort. Argobad le laisse partir. Zadig rencontre alors un pêcheur qui, maudissant sa destinée, a décidé de se suicider. Zadig l’empêche de le faire et lui fait rendre justice. Puis il croise des femmes à la recherche d’une plante destinée à soigner l’obésité de leur maître Ogul. Zadig découvre que la reine Astarté est parmi ces femmes. Zadig parvient à trouver le remède permettant de guérir Ogul et en échange, il obtient la libération d’Astarté.
Astarté est reçue triomphalement à Babylone. Des combats doivent désigner celui qui l’épousera et qui deviendra le nouveau roi de Babylone. Zadig remporte le tournoi en désarçonnant tous ses adversaires. Mais l’un des rivaux, Itobad, parvient à s’emparer de l’armure de Zadig et à se faire proclamer vainqueur à sa place.
Désespéré, Zadig erre sur les bords de l’Euphrate. Il rencontre Jesrad, un vieil ermite. Jesrad et Zadig concluent un accord : ils ne doivent pas se séparer pendant plusieurs jours. Au bout de quelques jours, Zadig réalise que l’ermite n’est autre que l’ange Jesrad qui a pris les traits d’un vieil homme. L’ange explique à Zadig le sens de la vie : « il est important de se faire à l’idée que le mal est un élément nécessaire à l’ordre du monde et à la naissance du bien.»
Zadig n’est pas totalement convaincu et l’ange s’envole vers le ciel.
De retour à Babylone, Zadig est confronté à une série d’énigmes. Il les résout facilement. Il indique que c’est lui et non pas Itobad qui portait l’armure blanche lors du tournoi. Il est finalement rétabli dans ses droits et peut épouser Astarté et devenir roi. Babylone connaît alors une période de prospérité et de bonheur …
LE RESEAU VOLTAIRE : L'association française Réseau Voltaire a été créée par Thierry Meyssan en 1994. Le Réseau Voltaire faisait partie à ses débuts de la gauche républicaine. Thierry Meyssan était secrétaire national du Parti Radical de Gauche.
 La ligne éditoriale du Réseau Voltaire fustigeait alors l'extrême droite et le cléricalisme.
Thierry Meyssan était également secrétaire de l'Observatoire National contre l'Extrême Droite.
La ligne éditoriale du Réseau Voltaire fustigeait alors l'extrême droite et le cléricalisme.
Thierry Meyssan était également secrétaire de l'Observatoire National contre l'Extrême Droite.
Les attentats du 11 septembre 2001 firent connaître le réseau Voltaire dans le monde entier. Dès le premier jour, le réseau Voltaire dénonce des incohérences dans le déroulement des événements et leur interprétation par les grands médias. Thierry Meyssan publie, en mars 2002, le premier livre remettant en cause la version officielle du 11/09: "l’Effroyable Imposture".
Cliquez sur le bouton pour accéder au nouveau réseau Voltaire.
En 2007, Thierry Meyssan considère qu'il subit une pression anormale du gouvernement Fillon sous la présidence de Monsieur Nicolas Sarkozy. Il dissout l'association française. Le bureau du Réseau Voltaire s'installe à Damas, puis à Beyrouth, puis de nouveau à Damas. Le Réseau Voltaire devint www.voltairenet.org, un réseau de presse international avec échange d'articles. Thierry Meyssan devient une personnalité française marquante au Moyen Orient contre l'impérialisme des USA.
Les délices: http://www.ville-ge.ch/bge/imv/
Le centre international d'études du 18e siècle à Ferney: http://c18.net/
D'autres Biographies de VOLTAIRE
La société Voltaire: http://societe-voltaire.org/
Des Lycées portent le nom de Voltaire pour lui rendre hommage
Le Lycée Voltaire à Paris : http://www.lyceevoltaire.fr/
Le Lycée Voltaire d'Orléans: http://www.voltaire.com.fr/
Site créé et édité par Frederic Fabre frederic@fredlit.com
 |
 |
 |
 |