
LITTERATURE DU XVIIe SIECLE
"Le dix septième siècle est le dix septième français
Frédéric Fabre
Cliquez sur un lien ci-dessous pour accéder aux informations gratuites
LES GRANDS ECRIVAINS DU XVIIe SIECLE
L'HISTOIRE DE LA LITTERATURE DU XVIIe SIECLE
HISTOIRE DE LA LITTERATURE DU XVIIe SIECLE
 Le XVIIe siècle commence
dans les années 1597-1598 avec la première loi de solidarité pour aider les pauvres en Angleterre (1597), la reprise du territoire du royaume par Henri IV
(1597 -1598), l'élection en Russie du Tsar Boris Godounov (16 janvier 1598) et la mort du Roi Philippe II en Espagne (13 septembre 1598).
Le XVIIe siècle commence
dans les années 1597-1598 avec la première loi de solidarité pour aider les pauvres en Angleterre (1597), la reprise du territoire du royaume par Henri IV
(1597 -1598), l'élection en Russie du Tsar Boris Godounov (16 janvier 1598) et la mort du Roi Philippe II en Espagne (13 septembre 1598).
Le XVIIe siècle se termine avec "la paix d'Utrecht" signée le 11 avril 1713 qui distribue les cartes au sens figuré comme au sens propre entre les ETATS SOUVERAINS EUROPEENS
Le XVIIe siècle est d'abord le siècle de l'ordre, de la structure, de la discipline et de l'organisation de la langue. C'est une réaction à l'anarchie du XVIe siècle. C'est le siècle de "l'esprit français" et du cartésianisme.
Des écrivains précieux comme Chapelain, Godeau, Gombauld et Maleville se réunissaient chez leur ami Valentin Conrart (1603 1675) alors connu pour ses "mémoires et lettres". Richelieu offrit sa protection pour créer une compagnie le 13 mars 1634 avec des écrivains comme Nicolas Faret (1596 -1646) connu pour son "honnête homme ou l'art de plaire à la Cour" (1630), Desmaret de Saint - Sorlin (1595 - 1676) et François Le Métel de Boisrobert (1592 - 1662) dont "les nouvelles héroïques et amoureuses" lui donnèrent la postérité.
Par lettre
patente du roi de 1635 qui reprit le projet de rédaction de Nicolas Faret, l'académie
française forte de 27 membres était créée.
Les grands théâtres parisiens
L'hôtel du Marais est créé par la troupe Renoir sous la direction de l'acteur Mondory. Il joue principalement les pièces et tragédies des frères Pierre et Thomas Corneille.
L'hôtel de Bourgogne concurrent direct du Théâtre du Marais, est le théâtre "officiel" où Racine joua ses pièces dont le rôle principal est tenu par la Champmeslé.
Le Palais Royal fondé par une compagnie d'acteurs italiens, reçoit en 1660, la troupe de Molière qui joua ses pièces jusqu'à sa mort.
En 1673, à la mort de Molière, Lully s'empare du palais Royal pour créer l'Opéra. L'épouse de Molière, Armande Béjart transporte la troupe à L'hôtel Guénégaud. La troupe du Marais se fonde avec la troupe de Molière pour jouer les deux répertoires.
En 1680, Louis XIV fond la troupe de l'Hôtel de Bourgogne avec la troupe de l'hôtel Guénégaud pour créer "la comédie française" qui aura à son répertoire Molière , Corneille et Jean Racine.
Vous trouvez ici :
- LES PRECIEUX
- LA QUERELLE DES ANCIENS ET MODERNES.
L'ECOLE DE MALHERBE (1555-1628)
"Enfin Malherbe vint"
c'est ainsi que Boileau salue l'avènement de la poésie classique. Malherbe s'est
appliqué à débarrasser la langue de mots étrangers, latins et des locutions
gasconnes dont l'avaient encombrée, les compagnons d'Henri IV. La langue
devait être comprise par tous e t
pour y arriver, il limita le nombre des mots.
t
pour y arriver, il limita le nombre des mots.
Il définit aussi les règles du style, dont les qualités essentielles doivent être la clarté et la sobriété. Il biffe les mots inutiles, les adverbes et les épithètes inutiles. Stephen King reprend tous les principes exposés par Malherbe dans son livre "écriture" publié en 2000 et dans sa traduction française, en 2001.
Il exige le goût et condamne les métaphores trop prolongées.
Malherbe fit "école" et eut des disciples dont deux restent célèbres:
Maynard (1582 -1646)
Honorat de Bueil marquis de Racan (1589 - 1670) avec les Bergeries (1618)
LES SUCCESSEURS DE MALHERBE
Sur le langage
Deux écrivains finirent de structurer la langue:
Jean Louis Guez de Balzac (1597 - 1654) classé comme précieux du fait de son passage à l'hôtel de Rambouillet alors qu' il a structuré la rhétorique et la prose avec ses lettres (1624) D'ailleurs Malherbes a lui - même été reçu à l'hôtel de Rambouillet.
Claude Favre Vaugelas (1585 -1650) pour la grammaire avec "ses remarques sur la langue française" (1647) et ses efforts au sein de l'académie française à partir de 1634 pour rédiger le dictionnaire de la langue française publié en 1694.
En Philosophie
carte universitaire pour faire des photocopies.
Descartes (1596 - 1650) structura la pensée par la recherche du vrai qui ne peut être atteint que par l'évidence. Seule une pensée exprimée par le "claire et le distinct" s'approche du vrai.
Dans le discours de la méthode (1636) Descartes explique que les questions doivent être décomposées en une analyse minutieuse jusqu'à la rencontre des éléments irréductibles. Chaque chose est comprise à l'aide de ses éléments, par le jeu de la logique de la raison pour reconstruire la vérité toute entière.
En matière de tragédie
Mairet (1604 - 1686) applique en matière de tragédie, la règle proposée par Aristote des trois unités soit l'unité d'action, de temps et de lieux.
Les frères Corneille Pierre (1606 -1684) et Thomas (1625 - 1709) jouent avec la règle des trois unités au point que Pierre Corneille doit subir la "querelle du Cid".
LA CRITIQUE A MALHERBE : LES GROTESQUES
Ils rejettent la discipline de la nouvelle école et se réclament de l'érudition latine, de la libre inspiration dans la veine de Rabelais. Ils défendent leur indépendance, le retour au naturel ainsi que le goût du burlesque et de la bizarrerie. Ils sont tous libertins. Théophile Gautier considère que certains sont les aïeux du romantisme:
Mathurin Régnier
(1573-1613) avec ses satires (1608) qui critique Malherbes et les moeurs de la
Cour.
Théophile de Viau (1590 - 1626)
Alexandre Hardy (1570 - 1631) qui écrit des tragi - comédies remplies d'action et de mouvements
Saint - Amand (1594 - 1661)
Mademoiselle de Gournay est la première éditrice des œuvres complètes de Montaigne. Elle écrit en 1626 "l'ombre".
Cyrano de Bergerac (1619 -1655) héro d'Edmond Rostand, voir le timbre à droite.
Tristan l'Hermite (1601 - 1655) avec Marianne (1636) et ses poésies (1641)
Charles Sorel (1599 - 1674) avec Francion (1622) et le berger extravagant (1627)
Scarron (1610 - 1660) avec le Typhon (1644) l'Enéide travestie (1648 - 1653) et le roman comique (1649 - 1657)
Furetière (1626 - 1688) avec son roman bourgeois (1666) et son dictionnaire publié dès 1684 puis en 1690, avant celui de l'académie qui ne sera publié qu'en 1694. Ce qui lui vaut son exclusion de l'Académie Française.
LA REVOLUTION DE L'ART PRECIEUX
Ils recherchent le rare, le fin et le délicat, leurs habits s'ornent de ruban comme des paquets cadeaux. Leur langue châtiée est remplie d'expressions exagérées; pour exprimer leur appréciation, ils déclarent que c'est "furieusement beau". Ils emploient des images à outrance ainsi un miroir est pour eux "le conseiller des grâces" Leur métaphore se prolonge pour devenir allégorie.
 Les précieux s'expriment
dans des salons parisiens dont les plus célèbres sont:
Les précieux s'expriment
dans des salons parisiens dont les plus célèbres sont:
L'hôtel de Rambouillet situé rue Saint Thomas du Louvre, tenu entre 1610 et 1660 par la marquise de Rambouillet surnommée Arthénice par Malherbes et par ses deux filles Angélique et Julie d'Ardennes, future Madame Montausier. L'hôtel de Rambouillet reçoit tous les écrivains qui devaient participer à "la guirlande de poésie" d'Angélique dont Madame de Sévigné et Madame de Lafayette. Les frères Corneille comme Molière y passèrent.
Le salon de la Grande Mademoiselle.
Le salon de Madame de Sablé chez qui La Rochefoucauld cisela ses maximes.
Le salon de Madame Scarron future Madame de Maintenon qui continuera ensuite sous ce nom avant d'épouser Louis XIV en seconde noce.
Le salon de Mademoiselle de Scudéry qui reçoit sous le pseudonyme de "la grande Sapho", rue de Beauce dans le quartier du Marais.
LES GRANDS NOMS DE L'ART PRECIEUX
Jean Chapelain (1595 - 1674) qui prôna la création de l'académie française. Il fut raillé par Boileau pour "la Pucelle d'Orléans ou la France délivrée" (1656).
Charles Cotin (1604-1682)
un des habitués de l'hôtel de Bourgogne, devenu "Trissotin" chez Molière.

Godeau (1605 - 1672) l'un des piliers de l'hôtel de Rambouillet sous le nom de nain de Julie à cause de sa petite taille
Malleville (1597 - 1647) a une querelle des sonnets sur "la belle matineuse" avec la "star":
Vincent Voiture (1598 - 1648) l'un des grands habitués et comiques de l'hôtel de Rambouillet, ses lettres publiées à titre posthume en 1650 sont admirées de La Fontaine et de Voltaire. Il aura un autre rival:
Benserade (1613 - 1691) qui en 1648 écrit un sonnet d'Uranie pour concurrencer le sonnet de Job. Accueilli à l'hôtel de Rambouillet, Benserade écrira les livrets de ballet de la cour de Louis XIII et de Louis XIV dont certains sur la musique de Lully
Honoré d'Urfé (1568 - 1625) avec l'astrée (1610 - 1619 - 1627)
Segrais (1624 - 1701) avec son Bérénice (1648) et sa participation au roman la princesse de Clèves
Gomberville (1600 - 1674) avec ses romans de voyage dont Polexandre (1632)
La Calprenède (1610 - 1663) avec Cassandre (1642 - 1645)
Mademoiselle Deshoulière (1638- 1694) avec ses Idylles
 Mademoiselle de Scudery
(1608 - 1670) avec le Grand Cyrius (1648 - 1653) ou Clélie (1654 - 1660), sa
notoriété est due à la carte du tendre et la pensée précieuse en matière d'amour
où il était expliqué sans rire qu'il fallait écrire des vers galants pendant une
dizaine d'année avant d'espérer la conquête de la forteresse imprenable qu'est
la femme !
Mademoiselle de Scudery
(1608 - 1670) avec le Grand Cyrius (1648 - 1653) ou Clélie (1654 - 1660), sa
notoriété est due à la carte du tendre et la pensée précieuse en matière d'amour
où il était expliqué sans rire qu'il fallait écrire des vers galants pendant une
dizaine d'année avant d'espérer la conquête de la forteresse imprenable qu'est
la femme !
SEPT GRANDS ECRIVAINS MONDAINS
surent par leur talent dépasser le langage précieux pour nous laisser de véritables documents sur leur époque:
Furetière (1626-1688) élu à l'Académie Française grâce à son Roman Bourgeois et expulsé à cause de son dictionnaire.
La Rochefoucauld (1613 - 1680) avec ses maximes publiées sans nom en 1665.
Le cardinal de Retz (1614 - 1679) avec ses mémoires sur sa vie tumultueuses ( 1671 - 1675)
Madame de Sévigné (1626 - 1696) avec ses lettres écrite à partir de 1671 à sa fille devenue épouse du lieutenant général de Provence et comtesse de Grignan. Décédée de la petite vérole en 1696 pendant un séjour ses sa fille, au château de Grignan, ses lettres déjà répandues de son vivant certaines ne furent éditées en volume qu'en 1725 puis complètement en 1867
Madame de la Fayette (1634 - 1693) avec la princesse de Clève (1678)
La Bruyère (1645 - 1696) avec "les caractères ou les moeurs de ce siècle" (1688)
Robert Charles (1659 - 1721) avec "les illustres françaises" (1713) qui mettent en scène la petite noblesse.
LA CONTRE RÉVOLUTION CLASSIQUE
A partir de 1660, quatre copains amateurs de tavernes, de vin, de femmes et de rire voulurent se débarrasser de la préciosité pour revenir aux règles de Malherbes et structurer aussi bien la langue que la construction des rimes, de la poésie et du théâtre:
Nicolas Boileau dit Despréaux (1636 - 1711) avec ses satires contre les précieux (1666 - 1668) puis ses épîtres (1674 à 1695) où il définit les trois règles classiques: raison (recherche du naturel) vérité (fille de la raison) et antiquité (appliquer l'exemple des anciens). De ces trois règles découlent la règle des trois unités de la tragédie , la séparation des genres littéraires et la netteté ou la mesure du style.
Molière (1622 - 1673) avec les précieuses ridicules (1659) et Tartuffe (1664)
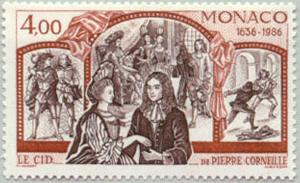 La Fontaine
(1621 - 1695)
avec ses contes libertins et ses fables (1668 - 1678 - 1694)
La Fontaine
(1621 - 1695)
avec ses contes libertins et ses fables (1668 - 1678 - 1694)
Jean Racine (1639 - 1699) avec Bérénice (1670) Bajazet (1672) Mithridate (1673) et Iphigénie (1674)
Ils sont suivis:
Desmaret de Saint - Sorlin (1595 - 1676) raille les précieuses dans "les Visionnaires" (1637)
Molière décédé prématurément, Regnard (1655 - 1709) lui succède avec notamment le joueur (1696) les Folies amoureuses (1704) et le légataire universel (1708)
Charles Dufresny (1648 - 1724) écrit avec Regnard, une comédie "la foire de Saint Germain" (1696) puis, de nombreuses autres et un roman "Amusements sérieux et comiques d'un siamois" (1699) qui inspirèrent les lettres persannes.
Florent Larton sieur d'Ancourt dit DANCOURT (1661-1725) laissera une comédie intéressante "le chevalier à la mode" (1687)
L'ÉLOQUENCE RELIGIEUSE
Les hommes d'église ont une place importante dans la société du XVIIe siècle avec, leurs lettres, leurs sermons et leurs oraisons funèbres dans lesquelles, la mort de leur prochain est prétexte à discourir sur tous les sujets:
Saint Vincent de Paul (1580 - 1660) avec ses lettres (1630 à 1660)
 Bossuet (1627 - 1704)
combattit le quiétisme de Madame Guyon fondatrice de l'école de Saint - Cyr pour
jeunes filles, de Madame de Maintenon maîtresse du roi et de Fénelon contre qui, il obtint la disgrâce royale.
Bossuet (1627 - 1704)
combattit le quiétisme de Madame Guyon fondatrice de l'école de Saint - Cyr pour
jeunes filles, de Madame de Maintenon maîtresse du roi et de Fénelon contre qui, il obtint la disgrâce royale.
Fénelon (1651 - 1715) écrit "dialogues des morts" (1692) puis "le Télémaque" (1695) pour défendre le quiétisme qui prônait que l'âme, arrivée à la contemplation parfaite de Dieu, est dans un état de calme et de quiétude absolue où elle ne désire pas le salut et ne craint pas l'enfer. Cette théorie exposée dans "le guide spirituel" (1675) du jésuite espagnol Molinos, est introduite en France malgré l'interdiction du pape, par Madame Guyon. Cette théorie a eu pour conséquence que les fidèles pouvaient se passer des services de l'église. Le Télémaque sera par conséquent, sanctionné par la disgrâce royale. Cependant Fénelon publiera en 1714 un "testament littéraire" : "lettre à l'académie".
Bourdaloue (1632 - 1704) ses discours étaient si longs qu'un siège pour dames sur lequel elles pouvaient se soulager discrètement pendant l'écoute de son sermon, prit le nom du célèbre orateur.
L'école de Bourdaloue :
Mascaron (1634 - 1703)
Fléchier (1632 - 1710)
Massillon (1663 - 1742) dont la dernière grande oraison funèbre est celle de Louis XIV en 1715 et son dernier grand prêche est "le Petit Carême" prononcé devant Louis XV en 1718.
LE JANSÉNISME UN PROTESTANTISME DANS L'EGLISE
(1623-1662)
s'intéresse d'abord à l'amour avec ses "discours sur les passions et l'amour"
(1650) avant de devenir, sous l'influence de sa
sœur, Gilberte de Perier, le
chantre du jansénisme et de Port - royal suite à une extase, dans la
nuit du 24 novembre 1654. Il utilise alors toute son intelligence et tous ses
dons de logique rigoureuse dans les "lettres provinciales" (1656 - 1657) et
dans un
ouvrage non achevé "les pensées" publiées à titre posthume par sa sœur en 1670,
pour affirmer que l'être humain est dès sa naissance, prédisposé ou non à
rejoindre le paradis. Il y a les élus de Dieu dont la vie lui est consacrée et
les autres qui n'ont pas besoin de prier pour tenter de se racheter, puisque non
choisis par Dieu, ils n'ont aucune chance de rejoindre le paradis.
Toutefois, l'élu
choisi par Dieu doit suivre les préceptes d'une vie chrétienne et mener une vie
austère. Il ne doit surtout pas apprécier le théâtre. Sinon Dieu peut le rejeter
et lui supprimer sa grâce !
Jean Racine défendra les thèses de la grâce des jansénistes dans son théâtre alors que les jansénistes sont par principe, contre le théâtre. Beaucoup de libertins comme Boileau et La fontaine sont attirés par les thèses jansénistes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent puisque Dieu a déjà choisi par la grâce, indépendamment de leur action. Alors pourquoi mener une vis austère et triste?
La critique religieuse au jansénisme est portée d'abord par les jésuites qui soutiennent par la théorie du "libre arbitre" que chacun est maître de son destin et qu'il peut par la prière et par ses actions, choisir Dieu et se frayer un passage jusqu'au paradis.
La critique littéraire est portée par Desmaret de Saint Sorlin dans "la France chrétienne ou Clovis" (1637)
LES LIBERTINS ÉRUDITS ET ATHÉES CONTESTENT L'EGLISE
Pierre Gassend dit Gassendi (1592 -1655) qui fit par ailleurs des découvertes en astronomie et en acoustique, s'entoure d'un petit groupe de libertins érudits dont Diodati, Naudé et François de La Mothe Le Vayer (1588 - 1672) précepteur du futur Louis XIV et auteur de " la Vertu des païens" (1641)
Montfaucon de Villars (1635-1675) révèle les principes rose croix dans le Comte de Gabalis.
Profondément athées et de mœurs dissolues ils furent parfois pourchassés par la police. C'est dans leurs réflexions que les philosophes du XVIIIe siècle puisèrent la source de leur pensée.
Un texte libertin publié sans nom d'auteur, "lettres de la religieuse portugaise" publiée en 1669, eut un succès énorme car l'authenticité du texte ne fut pas remis en cause. Il faut attendre le XVIIIe siècle et Rousseau pour douter de la véracité du récit.
LES SCIENCES SUBISSENT LA CONTESTATION DE L'EGLISE
Descartes (1596 - 1650) fait des découvertes en géométrie. Fermat (1601-1665) fait des calculs différentiels. Le jardin des plantes est ouvert en 1640. L'académie des sciences est fondée en 1666. Denis Papin (1647-1714) fait des expériences sur la vapeur. Tournefort (1656 - 1708) fait des travaux sur la botanique.
Pascal (1623-1662) perfectionne la brouette, invente la première machine à calculer, "La Pascaline", plusieurs théorèmes géométriques et démontre que la nature n'a pas horreur du vide. Il est considéré comme le grand génie français.
Sébastien Leprêtre dit Vauban (1633-1707) est très connu par son art militaire et pour avoir créer des citadelles sur les frontières de la France. Il a aussi écrit des ouvrages économiques pour constater d'abord que la chasse aux huguenots était néfaste pour l'économie du royaume qui se privait ainsi d'une partie de la population le plus entreprenante. Il a tenté de faire instaurer l'impôt par capitation soit une tête un impôt suivant la fortune sans considération pour les privilèges. Il a prôné sans succès la dîme royale, un impôt sur le revenu à la charge de tous, quelque soit le rang social.
QUERELLE DES ANCIENS ET DES MODERNES
En 1670: Desmaret de Saint Sorlin (1595 - 1646) publie "traité pour juger des poèmes grecs, latins et français" pour soutenir la supériorité générale des modernes sur les anciens.
En janvier 1675: Racine (1639 - 1699) publie Iphigénie avec une préface qui est une défense des anciens contre les modernes
En 1683: Fontenelle neveu de
Pierre et Thomas Corneille,
défend l'idée de la supériorité des modernes contre les anciens dans les
dialogues des morts.
Le 27 janvier 1687, Charles Perrault (1628 - 1703) auteur des fameux contes (1697) frère de Claude Perrault (1613 - 1688), architecte des colonnades du Louvre, lit à l'Académie Française, un poème "Le siècle de Louis le Grand" où il égale le siècle de Louis XIV au siècle d'Auguste et où il montre la supériorité scientifique et littéraire des modernes sur les anciens. La guerre littéraire où la politique n'est jamais loin puisqu'il s'agit de comparer Louis XIV à Auguste, est alors engagée.
En 1687, La Fontaine publie une "Épître à Monsieur de Soissons", prétexte à une déclaration de principes littéraires, dont la plus fameuse reste "Mon imitation n’est point un esclavage"
Deux camps se forment
Les modernes: Perrault, Fontenelle, un libertin Saint - Evremond (1610 - 1703), le journal de Trévoux des jésuites et le Mercure galant apporté par Thomas Corneille.
 Les anciens:
Boileau,
Racine
et
La Fontaine
qui défendent la
conception littéraire dominée depuis la Renaissance par le sentiment de la
supériorité des auteurs de l'Antiquité grecs et latins. L'idéal esthétique du
classicisme défendu par
Boileau
et
Racine,
est fondé, entre autres, sur le principe de l'imitation
des modèles, réputés indépassables, de la littérature antique.
Les anciens:
Boileau,
Racine
et
La Fontaine
qui défendent la
conception littéraire dominée depuis la Renaissance par le sentiment de la
supériorité des auteurs de l'Antiquité grecs et latins. L'idéal esthétique du
classicisme défendu par
Boileau
et
Racine,
est fondé, entre autres, sur le principe de l'imitation
des modèles, réputés indépassables, de la littérature antique.
Les modernes publient :
"la digression sur les Anciens et les Modernes" de Fontenelle en 1688 pour démontrer les progrès des arts et des sciences au cours des siècles qui créent des génies.
Dans "parallèles des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les arts et la Science" publiées de 1688 à 1697, Charles Perrault défend la thèse selon laquelle les modernes sont supérieurs ou égaux aux anciens. En 1692, deux adversaires de Boileau, Chapelain et Cotin sont encensés. Perrault met Quinault bien au-dessus de Racine et Lebrun bien au-dessus de Raphael !
En 1693, Boileau écrit, en imitant le procédé de Pindare, une Ode au Roi sur la prise de Namur. Dans un avis au lecteur, il réplique violemment à Perrault. Arrogants, les anciens multiplient les injures. Boileau ose écrire à Perrault :
Ton oncle,
dis-tu, l’assassin
M’a guéri d’une maladie :
La preuve qu’il ne fut jamais mon médecin,
C’est que je suis encor en vie.
Perrault réplique:
Nous dirons toujours les raisons.
Ils diront toujours les injures
Boileau publie en 1694:
"Réflexions critiques sur quelques passages du rhéteur Longin" où il écrit:

"L'antiquité d'un écrivain n'est pas un titre certain de son mérite; mais l'antique et constante admiration qu'on a toujours eue pour ses ouvrages, est une preuve sûre et infaillible qu'on les doit admirer"
Bayle quitte le camp des Moderne pour rejoindre les Anciens car il refuse la société nouvelle qui se profile.
Par ailleurs, Ses réflexions ridiculisent les femmes, Charles Perrault répond la même année par une "Apologie des femmes" et s'attire ainsi la faveur des femmes contre Boileau.
Réconciliation de Boileau et de Perrault
En 1694, Boileau écrit à Charles Perrault une lettre dans laquelle il reconnaît que les modernes devaient la plupart de leurs qualités à l'imitation des anciens et admet à son tour la supériorité du Siècle de Louis le Grand sur celui d'Auguste, non seulement dans les sciences et les arts mais dans certains cas, en lettres.
En fait chacun reste sur ses convictions fondamentales, Perrault continue à penser que les modernes sont supérieurs aux anciens et Boileau considère que les modernes ne peuvent être remarquables que quand ils imitent les anciens.
En 1700, grâce à une promesse faite à Racine et à Antoine Arnaud tous deux décédés, Boileau met définitivement fin à la querelle des anciens et des modernes.Boileau écrit:
Tout le trouble poétique
A Paris s’en va cesser ;
Perrault l’antipindarique,
Et Despréaux l’homérique,
Consentent de s’embrasser.
Quelque aigreur qui les anime,
Quand, malgré l’emportement,
Comme eux l’un l’autre on s’estime,
L’accord se fait aisément.
Mon embarras est comment
On pourra finir la guerre
De Pradon et du parterre.
Mais une nouvelle querelle des anciens et des modernes, appelée aussi querelle d'Homère éclatera quelques années plus tard.
Site créé et édité par Frederic Fabre frederic@fredlit.com
 |
 |
 |
 |